[Le point sur...] Le Code pénitentiaire
Réf. : Ordonnance n° 2022-478, du 30 mars 2022, portant partie législative du code pénitentiaire N° Lexbase : L2553MCK et Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire N° Lexbase : L2541MC4
Lecture: 14 min
N2444BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Thomas Lebreton, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre
Le 27 Octobre 2022
Mots-clés : Code pénitentiaire • ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 • codification • personnes détenues • administration pénitentiaire • phase post-sentencielle • exécution des peines • application des peines
Opérée à droit constant, la codification du droit pénitentiaire résulte d'une ordonnance et d'un décret, tous deux du 30 mars 2022. Entré en vigueur le 1er mai 2022, ce nouveau code laisse une impression mitigée. S'il sera indéniablement utile aux professionnels, dans la mesure où le travail de compilation de textes jusque-là épars est réussi, il contribue à publiciser encore davantage le droit pénitentiaire et fait regretter qu'un code post-sentenciel plus ambitieux n'ait pas été privilégié.
Adopté le 30 mars 2022, le Code pénitentiaire est entré en vigueur le 1er mai 2022. Cette codification, qui résulte d'une ordonnance pour sa partie législative N° Lexbase : L2553MCK, « a été conçue à droit constant, conformément aux termes de l'habilitation parlementaire » [1].
I. Adoption et entrée en vigueur
Genèse. Reprenant à son compte une suggestion contenue dans la lettre de mission du garde des Sceaux, la Commission pour une refonte du droit des peines présidée par Bruno Cotte a proposé la création d'un Code pénitentiaire en décembre 2015 [2]. Ce souhait a été réaffirmé deux ans plus tard par Bruno Cotte et Julia Minkowski dans leur rapport conjoint sur le sens et l'efficacité des peines rendu à l'occasion des chantiers de la justice [3].
Cette volonté de codification résulte du souhait de remédier à l'éparpillement du droit pénitentiaire, facteur d'insécurité juridique, dont les dispositions trouvaient principalement leur source dans deux textes que sont le Code de procédure pénale, dont le volume est jugé excessif [4], et la loi pénitentiaire de 2009 N° Lexbase : L9344IES [5]. Toutefois, le droit pénitentiaire résultait également de dispositions contenues dans le Code de déontologie du service public pénitentiaire [6], le Code de la santé publique, le Code de la sécurité intérieure et dans de nombreux autres textes de valeurs juridiques diverses et notamment infra-réglementaires. La codification témoigne aussi, et c'est bien navrant tant cet aspect devrait être totalement occulté, d'une volonté de communication autour d'une administration, pénitentiaire en l'occurrence [7]. Bien qu'identifié par la Commission « Cotte », le risque engendré par la création d'un tel code de distendre les liens entre administration pénitentiaire et autorité judiciaire a été relativisé.
Adoption. Après un premier échec en 2016 N° Lexbase : A3265SHE [8], le gouvernement a été habilité à agir par voie d'ordonnance aux fins de codification par la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire de 2021 N° Lexbase : Z459921T [9]. L'ordonnance portant partie législative du Code pénitentiaire, dont la ratification se fait toujours attendre [10], a été adoptée le 30 mars 2022 [11]. La partie réglementaire du code est pour sa part issue d'un décret adopté le même jour [12].
La création de ce code dans un délai extrêmement succinct [13] s'explique par l'anticipation des travaux rédactionnels qui ont débuté au printemps 2021 et qui ont conduit l'équipe de rédaction, relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, à successivement présenter ses travaux à la Commission supérieure de codification puis au Conseil d'État [14].
Entrée en vigueur. Le Code pénitentiaire est entré en vigueur le 1er mai 2022, concomitamment à la réforme du travail pénitentiaire [15] qu'il intègre et qui résulte de la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire [16] et de son décret d'application du 25 avril 2022 N° Lexbase : Z536152A [17].
II. Contenu
Structure. À l'image de nombreux codes modernes, dont le Code pénal, le Code pénitentiaire adopte un plan à trois niveaux (livre, titre, chapitre) [18], les subdivisions suivantes (section et sous-section) n'ayant pour leur part aucun impact sur la numérotation des articles. L'imbrication des dispositions législatives et réglementaires, organisées selon une numérotation continue, n'a pas été retenue si bien que le code est organisé en deux parties distinctes, l'une législative (C. pénit., art. L. 1 N° Lexbase : L7471MCP à L. 777-1 N° Lexbase : L7998MC9) et l'autre réglementaire (C. pénit., art. D. 112-1 N° Lexbase : L7645MC7 à D. 777-8 N° Lexbase : L6555MCR), dont les plans se répondent toutefois par symétrie.
Fond. Le Code pénitentiaire comporte bien évidemment de nombreuses dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la détention mais son plan témoigne du souhait de refléter la diversité des missions assurées par l'administration pénitentiaire et, adoptant une « dimension étendue de la notion pénitentiaire » [19], traite de la phase pré-sentencielle jusqu'à la libération des personnes détenues. Ce plan, qui diffère de celui proposé par la Commission Cotte [20], est organisé autour d'un titre préliminaire et de sept livres.
► Titre préliminaire [21]
Qualifié de « mini-code dans le Code » par l'une des chargées d'études ayant concouru à sa rédaction [22], le titre préliminaire détermine les grands principes directeurs et fixe un cadre au service public pénitentiaire.
Composé de huit articles, dont six visent à affirmer les droits des personnes détenues, ce titre rappelle la prohibition et la répression des détentions arbitraires, le respect de la dignité des personnes incarcérées ou encore la soumission de l'action pénitentiaire aux droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité et par les dispositions supranationales, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui est expressément visée.
Les missions de l'administration pénitentiaire, qualifiée de service public dès les premiers mots du premier alinéa du premier article, sont listées (C. pénit., art. L. 1 N° Lexbase : L7471MCP) et la diversité du public à l'égard duquel il exerce ses missions est soulignée (C. pénit., art. L. 3 N° Lexbase : L7470MCN).
► Livre Ier : service public pénitentiaire [23]
Composé de trois titres, le livre Ier du code décrit l’organisation et les missions des acteurs du service public pénitentiaire, fixe les règles de déontologie applicables aux agents de l’administration pénitentiaire ainsi qu’aux intervenants extérieurs et consacre les règles relatives au contrôle et à l’évaluation des établissements et services pénitentiaires [24].
► Livre II : détention en établissement pénitentiaire [25]
Le livre II aborde les différentes phases de la prise en charge des personnes détenues (entrée en détention, encellulement, transfèrement et extraction, etc.) et le maintien de la sécurité dans les établissements (autorisations d’accès, moyens de contrôle et de surveillance, quartiers spécifiques, fouilles, menottes et entraves ainsi que l’usage de la force et des armes). Le titre III, dans des dispositions quasi exclusivement réglementaires (C. pénit., art. L. 231-1 et s. N° Lexbase : L7378MCA, R. 231-1 et s. N° Lexbase : L7007MCI), expose le régime disciplinaire jusqu'alors prévu par les articles R. 57-7 et s. du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0362IP4.
► Livre III : droits et obligations des personnes détenues [26]
Ce livre présente les droits et obligations des personnes incarcérées en huit domaines distincts que sont l'accès au droit, l'hygiène, la santé et la protection sociale, la protection des biens et l'aide matérielle, le maintien des liens avec l'extérieur, l'exercice du culte, l'exercice du droit de vote, l'accès aux publications écrites et audiovisuelles et la protection de l'image, de la voix et des publications.
► Livre IV : aide à la réinsertion des personnes détenues [27]
Sont d'abord visées les activités en détention que sont le travail pénitentiaire, l'enseignement et la formation professionnelle ainsi que les activités culturelles, socio-culturelles et sportives. Consacré à la préparation de la sortie de détention, le second titre de ce livre est tout entier consacré à l'aménagement de peine. Il couvre, à grand renfort de renvois au Code de procédure pénale, toutes les phases de la procédure, de la préparation des mesures d'aménagement jusqu'à leur déroulement en passant par les décisions d'octroi.
► Livre V : libération des personnes détenues [28]
Les quatre titres du livre V témoignent du tiraillement consubstantiel à cette étape cruciale qu'est la libération. En effet, celle-ci est à la fois envisagée comme la première étape de la réinsertion hors les murs du délinquant mais aussi comme le premier jour d'une potentielle réitération ou récidive. C'est ainsi que des dispositions relatives aux aides matérielles susceptibles d'être accordées aux détenus libérés coexistent avec des mesures de suivi post-carcéral que sont la libération conditionnelle et certaines mesures de sûreté [29]. Le premier titre du livre V témoigne à lui seul de cette ambigüité puisqu'il encadre à la fois le régime de protection sociale des personnes libérées tout en fixant la liste des personnes à prévenir de la libération (victimes et autorités).
► Livre VI : intervention de l'administration pénitentiaire auprès de personnes non détenues [30]
Organisé en quatre titres, ce livre vise les missions de l'administration pénitentiaire dans les phases pré-sentencielles (enquêtes sociales ou techniques) et d'exécution des peines alternatives à l'incarcération (DDSE peine [31], sursis probatoire, travail d'intérêt général, etc.). Les mesures de sûreté (ARSE et CJ) sont curieusement traitées aux côtés des alternatives (travail non-rémunéré dans le cadre de la composition pénale) et du bracelet anti-rapprochement, mesure protéiforme par excellence [32]. Enfin, l'intervention des services pénitentiaires en matière de police administrative est évoquée, ce qui recouvre à la fois les missions ayant trait aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance [33] et aux mesures de surveillances des ressortissants étrangers assignés à résidence.
► Livre VII : dispositions relatives à l'outre-mer [34]
Comme la plupart des autres codes, le Code pénitentiaire se conclut par des dispositions propres à l'outre-mer. Sont successivement évoquées les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution N° Lexbase : L0905AHY [35] puis les autres territoires ultra-marins [36].
III. Analyse
Transfert. Le Code pénitentiaire a été construit à droit constant. Il regroupe en 1 650 articles [37] les dispositions de nombreux textes, issus ou non d'autres codes. Le transfert d'un article, codifié ou non, vers le Code pénitentiaire n'a pas manqué de poser des difficultés en termes de lisibilité. C'est ainsi que certains articles du Code de procédure pénale ont par exemple été intégralement transférés vers le Code pénitentiaire alors que d'autres, traitant de sujets distincts, ont fait l'objet d'un découpage [38]. Si des choix médians ont parfois été opérés [39], certains arbitrages témoignent d'un parti pris puisque le maintien d'un article dans le Code de procédure pénale ou son transfert vers le Code pénitentiaire révèle une mainmise sur le sujet, soit de l'autorité judiciaire [40], soit de l'administration pénitentiaire [41] et in fine du juge administratif [42]. Or la publicisation d'un droit particulièrement en prise avec les droits et libertés individuelles ne va pas sans conséquence [43].
Exclusion. Le choix de limiter ce nouveau code à la seule matière pénitentiaire et, ainsi, de ne pas envisager un Code plus global d'exécution et d'aménagement des peines est assumé [44]. Ont présidé, la volonté de ne pas rompre :
- l'unité du droit de la peine en confiant à trois codes, au lieu de deux, la peine encourue (Code pénal), le prononcé de la peine (Code de procédure pénale) et la peine exécutée et aménagée (hypothétique Code post-sentenciel) ;
- l'unité du procès, dans la mesure où la phase post-sentencielle est aujourd'hui toute entière judiciarisée, et ce, qu'il s'agisse de l'aménagement des peines [45] et même de l'exécution des peines [46].
Cette prise de position va à l'encontre des souhaits émis par une partie de la doctrine [47] et conduit à la création d'un Code pénitentiaire qui est en réalité un « Code de l'administration pénitentiaire, ou celui du service public pénitentiaire [tant il s'agit] de l'outil d'une administration » [48]. « Le risque existe que les magistrats de l'ordre judiciaire ne s'approprient pas un code réservé au seul service public pénitentiaire. Du côté des personnes placées sous main de justice, il est à craindre que le périmètre retenu par le législateur ne leur permette pas d'appréhender le processus d'exécution de la peine dans sa dimension globale et pluridisciplinaire » [49]. Il est en effet vain d'imaginer que la majorité des personnes écrouées pourraient comprendre l'aménagement des peines qu'ils subissent, qui suppose désormais la maîtrise de trois codes, là où les pénalistes, praticiens comme universitaires, non spécialisés en matière post-sentencielle éprouvent, pour la plupart, les plus grandes difficultés dans ce domaine. Plus avant, si le Code pénitentiaire avait pour prétention de s'adresser à un large public [50], la limitation de son périmètre, de même que sa présentation, sa rédaction et son accessibilité excluent les personnes détenues [51] et le réservent de facto, comme tous les autres codes, aux seuls praticiens [52].
En matière de droit pénitentiaire des mineurs, il a été fait le choix de laisser le Code de la justice pénale des mineurs prévoir les dispositions applicables à cette catégorie très spécifique de justiciables [53]. Le Code pénitentiaire se contente de procéder par un renvoi général [54].
S'il a un temps été envisagé d'intégrer dans le Code pénitentiaire les textes relatifs aux statuts des fonctionnaires pénitentiaires [55], cette idée a été écartée [56] dans la mesure où ces dispositions relèvent davantage du droit de la fonction publique et que, s'agissant des dispositions générales en cette matière, un Code général de la fonction publique est entré en vigueur en mars 2022 [57].
Codification à droit non constant ? La codification ne s'est pas entièrement faite à droit constant puisque certaines dispositions de nature réglementaire ont été reclassées à un niveau législatif [58] et certains articles relevant d'un décret simple ont été rehaussés à une valeur d'article relevant d'un décret en Conseil d'État [59]. Pour rappel, « les articles de la partie réglementaire relevant d'un décret en Conseil d'État et en conseil des ministres sont identifiés par un "R.*", tandis que ceux relevant d'un décret en conseil des ministres mais non du Conseil d'État le sont par un "D.*". Les articles relevant d'un décret en Conseil d'État sont signalés par la lettre "R." tandis que ceux qui relèvent du décret simple sont signalés par la lettre "D." » [60].
Par ailleurs, certains termes ont été remplacés puisque les « personnes détenues » ont remplacé les « détenus » [61] et le désuet « élargissement » a laissé sa place à « libération » [62]. En outre, certains articles ont été réécrits pour gagner en lisibilité.
S'agissant des créations, l'article L. 3 N° Lexbase : L7470MCN, présentant en cinq catégories les personnes à l'égard desquelles l'administration pénitentiaire exerce ses missions, est le seul article du Code qui n'est issu ni d'un transfert, ni d'une réécriture, et qui a donc été créé ex nihilo [63]. Par ailleurs, une récente position jurisprudentielle [64] a été intégrée [65] s'agissant de la protection de l'intimité des personnes détenues dans une cellule collective en matière de sanitaires [66]. Si plusieurs dispositions ont été annoncées comme nouvelles, telle que la possibilité pour une personne détenue d'élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire [67] ou la prohibition des entraves pour les femmes détenues lors d'un accouchement ou d'un examen gynécologique [68], elles ne le sont en réalité pas [69].
Perspectives. Déjà modifié avant [70] et après [71] son entrée en vigueur, le Code pénitentiaire a bien évidemment vocation à évoluer. Le gouvernement est d'ailleurs expressément invité à intervenir rapidement s'agissant de l'encellulement individuel dans la mesure où l'article prévoyant qu'il peut y être dérogé [72] n'est en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2022 [73].
[1] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-478, du 30 mars 2022, portant partie législative du Code pénitentiaire [en ligne].
[2] Commission présidée par Monsieur Bruno Cotte, Pour une refonte du droit des peines, décembre 2015, p. 20 et 21 [en ligne].
[3] Ministère de la justice, Rapport des chantiers de la justice, janvier 2018, livret n° 5 : sens et efficacité des peines, p. 16 [en ligne].
[4] Sur un plan éditorial, la maison Dalloz a toutefois logiquement fait le choix d'inclure le Code pénitentiaire dans la version 2023 de son Code de procédure pénale annoté.
[5] Loi n° 2009-1436, du 24 novembre 2009, pénitentiaire N° Lexbase : L9344IES.
[6] Issu du décret n° 2010-1711, du 30 décembre 2010, portant Code de déontologie du service public pénitentiaire N° Lexbase : L0050IPK.
[7]« Ce nouveau Code doit permettre de mieux faire connaître l'importance, la diversité et la spécificité des missions du service public pénitentiaire » (notice du décret n° 2022-479, du 30 mars 2022, portant partie réglementaire du Code pénitentiaire N° Lexbase : L2541MC4). Bruno Cotte écrivait d'ailleurs que la « valeur symbolique [du Code pénitentiaire] serait forte et montrerait la place qu'occupe cette administration » (La refonte du droit des peines : rencontre avec Bruno Cotte, Dalloz actu étudiant, février 2016, n° 2, entretien [en ligne]).
[8] Le Conseil constitutionnel ayant censuré l'article 109, 6°, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle N° Lexbase : L1605LB3 jugeant que cette disposition, adoptée sur amendement parlementaire, constituait un cavalier législatif (Cons. const., n° 2016-739 DC, 17 novembre 2016, cons. 91 N° Lexbase : A3265SHE).
[9] Loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire, art. 24 N° Lexbase : Z459921T.
[10] Projet de loi n° 11 ratifiant l’ordonnance n° 2022‑478, du 30 mars 2022, portant partie législative du Code pénitentiaire et modifiant certaines dispositions d’autres codes [en ligne].
[11] Ordonnance n° 2022-478, du 30 mars 2022, portant partie législative du Code pénitentiaire N° Lexbase : L2553MCK.
[12] Décret n° 2022-479, du 30 mars 2022, portant partie réglementaire du Code pénitentiaire N° Lexbase : L2541MC4.
[13] Publication de l’ordonnance et du décret du 30 mars 2022 au Journal officiel du 5 avril 2022, soit 3 mois et demi après la loi d’habilitation qui laissait dix mois au gouvernement.
[14] M. Wagner, L’élaboration du Code pénitentiaire vue par une rédactrice : le Code en quatre étapes, AJ pénal, 2022, p. 288.
[15] P. Auvergnon, Quand la lutte contre la récidive permet et limite les progrès de l’encadrement juridique du travail en prison, Droit social, 2022, p. 352.
[16] Loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire, art. 19.
N° Lexbase : Z49055TQ à 21 N° Lexbase : Z49083TQ et, s’agissant de l’entrée en vigueur différée, article 59, XI N° Lexbase : Z48999TQ.
[17]Décret n° 2022-655, du 25 avril 2022, relatif au travail des personnes détenues et modifiant le Code pénitentiaire N° Lexbase : Z536152A : É. Paillissé, Les apports du décret du 25 avril 2022 dans la réforme du travail pénitentiaire », Dalloz actualité, 18 mai 2022 [en ligne].
[18]Commission supérieure de codification, Avis sur le projet de création d’un Code pénitentiaire, séance du 15 juin 2021, § 10 [en ligne].
[19]J.-P. Céré, L’inédit Code pénitentiaire, D., 2022, p. 896.
[20]Annexe 7 du rapport précité.
[21]C. pénit., art. L. 1 N° Lexbase : L7471MCP à L. 8 N° Lexbase : L7467MCK.
[22]M. Wagner, L’élaboration du Code pénitentiaire vue par une rédactrice : le Code en quatre étapes, AJ pénal, 2022, p. 288.
[23]C. pénit., art. L. 111-1 N° Lexbase : L8044MCW à L. 135-1 N° Lexbase : L8040MCR , D. 112-1 N° Lexbase : L7645MC7 à D. 136-6 N° Lexbase : L7488MCC.
[24] Par l’autorité judiciaire, diverses autorités administratives indépendantes, les parlementaires ou encore, depuis la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire (Loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, art. 18 N° Lexbase : Z49019TQ), les bâtonniers.
[25]C. pénit., art. L. 211-1 N° Lexbase : L8287MCW à L. 231-3 N° Lexbase : L7377MC9 et R. 211-1 N° Lexbase : L7487MCB à R.240-9 N° Lexbase : L7763MCI.
[26]C. pénit., art. L. 311-1 N° Lexbase : L8035MCL à L. 381-1 N° Lexbase : L7331MCI et R. 311-1 N° Lexbase : L7762MCH à R. 382-1 N° Lexbase : L8159MC8.
[27]C. pénit., art. L. 411-1 N° Lexbase : L8270MCB à L. 424-5 N° Lexbase : L7299MCC et R. 411-1 N° Lexbase : L6885MCY à R. 424-31 N° Lexbase : L7252MCL.
[28]C. pénit., art. L. 511-1 N° Lexbase : L7298MCB à L. 545-1 N° Lexbase : L7286MCT et R. 510-1 N° Lexbase : L7828MCW à R. 545-5 N° Lexbase : L7195MCH.
[29]Rétention de sûreté, obligation de soins, surveillance judiciaire des personnes dangereuses, surveillance de sûreté, surveillance électronique mobile et, pour la plus récente, mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion créée par la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement N° Lexbase : L3896L7G.
[30]C. pénit., art. L. 611-1 N° Lexbase : L7285MCS à L. 632-1 N° Lexbase : L8295MC9 et D. 611-1 N° Lexbase : L7285MCS à R. 642-4 N° Lexbase : L7819MCL.
[31]Peu utile, cette peine n'a été prononcée qu'à 593 reprises entre le 24 mars et le 31 décembre 2020 (ministère de la Justice, Les peines et mesures prononcées dans les condamnations et les compositions pénales, Références Statistiques Justice, données pénales 2020 [en ligne]).
[32] Le Bracelet Anti-Rapprochement (BAR) pouvant être prononcé dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une mesure de sûreté pré-sentencielle, d'une peine d'interdiction de contact, d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'un fractionnement ou d'une suspension de peine, d'un aménagement, avec ou sans écrou, d'une mesure de sûreté post-carcérale.
[33] MICAS créées à titre provisoire par la loi n° 2017-510, du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT [en ligne], et pérennisées par la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement N° Lexbase : L3896L7G.
[34] C. pénit., art. L. 711-1 N° Lexbase : L8294MC8 à L. 777-1 N° Lexbase : L7998MC9 et R. 711-1 N° Lexbase : L8073MCY à D.777-8 N° Lexbase : L6555MCR.
[35]Départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique et département de Mayotte.
[36] Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles de Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.
[37] Communication du ministère de la justice, Un Code pénitentiaire pour rendre la loi plus intelligible, du 8 avril 2022 [en ligne].
[38] Commission supérieure de codification, avis sur le projet de création d'un Code pénitentiaire, séances du 12 octobre 2021, § 5 à 11, et du 16 novembre 2021, § 4 à 10, préc.
[39] Présentation des permis de visite ou du sursis probatoire à cheval sur les deux codes.
[40] Maintien dans le Code de procédure pénale des dispositions relatives au recours contre les conditions indignes de détention.
[41] Transfert des dispositions sur les correspondances des personnes détenues (C. proc. pén., art. R. 57-8-16 N° Lexbase : L0321IPL) vers le Code pénitentiaire (C. pénit., art. L. 345-1 N° Lexbase : L7345MCZ et s.).
[42] La recherche de cohérence entre ce qui relève de la procédure pénale, d'une part, et l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaire, d'autre part, était l'un des objectifs du législateur (étude d'impact du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, p. 242 [en ligne]).
[43] M. Herzog-Evans et A. Dejean de la Bâti, Code pénitentiaire : « something old, something new, something borrowed, and something blue », AJ pénal, 2022, p. 291.
[44] Rapport de la Commission Cotte, p. 19.
[45] Enclenchée par les lois n° 2000-516, du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes N° Lexbase : L0618AIQ et la loi n° 2004-204, du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : C42707BR.
[46] La récente confirmation de la possibilité d'agir par voie de requête en difficulté d'exécution contre une mise à exécution décidée par le parquet sur le fondement de l'article 723-16 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9483IEX en témoigne (Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-83549, F-B N° Lexbase : A12807RT).
[47] Rapport de la Commission Cotte, p. 18, nbp n° 8.
[48] J. Falxa, Le Code pénitentiaire : une codification à « droit inconstant », AJ pénal, 2022, p. 295.
[49] J.-C. Bouvier, Le choix regrettable d'un Code pénitentiaire, AJ pénal 2022, p. 299.
[51] Les détenus se référant, pour certains, au « guide du prisonnier » rédigé par l'observatoire international des prisons (OIP) qui est édité par les éditions La découverte (dernière édition de 2021) [en ligne].
[53] Voir par exemple les articles L. 124-1 N° Lexbase : L2959L84 et L. 124-2 N° Lexbase : L2520L8T du Code de justice pénale des mineurs ou encore les articles R. 124-1 N° Lexbase : L3056L8P et s.
[54] C. pénit., art. L. 4, al 2 N° Lexbase : L8039MCQ.
[55] V. par exemple le décret n° 2007-930, du 15 mai 2007, portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires N° Lexbase : L6479LCX ou le décret n° 2019-50, du 30 janvier 2019, portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation N° Lexbase : L1711LP3.
[56] Commission supérieure de codification, Avis sur le projet de création d'un Code pénitentiaire, séance 15 juin 2021, § 9, préc.
[57] Code dont la partie législative résulte de l'ordonnance n° 2021-157, 4 du 24 novembre 2021, portant partie législative du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L8062L9H (L. Clouzot, Le Code général de la fonction publique, instrument du glissement statutaire, Droit administratif, avril 2022, étude 4).
[58] V. par ex. le 1er alinéa de l'article 3 du décret n° 2010-1711, du 30 décembre, 2010 portant Code de déontologie du service public pénitentiaire N° Lexbase : L0050IPK devenu le 1er alinéa de l'article L. 2 du Code pénitentiaire N° Lexbase : L8297MCB.
[59] V. par exemple l'ancien article D. 545 du Code de procédure pénale N° Lexbase : D8497LUA, sur la convocation à comparaître devant le SPIP aux fins de mise en œuvre du sursis probatoire postérieurement à la libération, devenu les articles R. 621-1 N° Lexbase : L7192MCD et s. du Code pénitentiaire.
[61] V. par exemple l'ancien avant dernier alinéa de l'article 726 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2716MCL dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales N° Lexbase : L2680I3N remplacé par l'article L. 231-2 du Code pénitentiaire N° Lexbase : L8061MCK.
[62] Voir par ex l'ancien article D. 334 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9261I8I remplacé par l'article D. 332 21 du Code pénitentiaire N° Lexbase : L6945MC9.
[63] É. Bonis, Le Code pénitentiaire est entré en vigueur, JCP, G, 16 mai 2022, n° 19, 614.
[64] CE, 19 octobre 2020, n° 439372 N° Lexbase : A06803YT.
[65] C. pénit., art. R. 321-3, al 3 N° Lexbase : L7737MCK (à comparer avec l'ancien article D. 351 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1293ACU).
[66] Code pénitentiaire : trois questions à Marion Wagner, Dr. pén., juin 2022, n° 6, entretien 3.
[67] C. pénit., art. L. 312-2 N° Lexbase : L7373MC3.
[68] C. pénit., art. L. 226-2 N° Lexbase : L7382MCE et L. 322-10 N° Lexbase : L8275MCH.
[69] É. Paillissé, Entrée en vigueur du Code pénitentiaire : une codification à droit (presque) constant, Dalloz actualité, 20 mai 2022 [en ligne].
[70] Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 relatif au travail des personnes détenues et modifiant le Code pénitentiaire N° Lexbase : L8155MCZ ayant, notamment, créé les articles R. 412-1 et s. du Code pénitentiaire N° Lexbase : L8155MCZ.
[71] Décret n° 2022-855, du 7 juin 2022, relatif à la modification du Code de procédure pénale, du Code de la justice pénale des mineurs et de diverses dispositions (décrets simples) rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du Code pénitentiaire, et portant modifications du nouveau Code N° Lexbase : L0603MDP.
[72] C. pénit., art. L. 213-4 N° Lexbase : L8285MCT.
[73] Ordonnance n° 2022-478, du 30 mars 2022, portant partie législative du Code pénitentiaire, art. 8 N° Lexbase : Z75802T3.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482444
[Brèves] Contestation d’honoraire et oralité de la procédure : un premier président ne peut retenir un taux correspondant à la moyenne pratiquée dans le ressort de sa cour d’appel s’il ne figure pas dans les débats
Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2022, n° 21-15.272, F-B N° Lexbase : A72178MA
Lecture: 4 min
N3049BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 10 Novembre 2022
► Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Dans le cadre d’une procédure de contestation d’honoraires, le premier président de la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur un taux horaire correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort d’une cour d’appel alors que l’existence de ce taux ne résultait ni des écritures des parties reprises oralement à l’audience ni des pièces de la procédure.
Rappel de la procédure. Une femme a chargé une avocate de la société Alpijuris de la représenter dans une procédure de divorce. La convention d’honoraire conclue entre les intéressées prévoyait un honoraire fixe de 3 000 euros HT couvrant la première instance, ainsi qu’un honoraire du même montant pour l’appel. Était également prévu un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT calculé sur le montant de la prestation compensatoire.
Le tribunal de grande instance prononce le divorce et octroie à la cliente une certaine somme au titre de la prestation compensatoire. Cette dernière relève appel du jugement et confie la défense de ses intérêt à un nouveau conseil.
Par la suite, la cliente saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan aux fins de contestation d’une facture adressée par la société Alpijuris relative à des honoraires de résultat dans la procédure de divorce. La décision du Bâtonnier rendue, elle forme un recours contre celle-ci.
En cause d’appel. Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare recevable le recours formé par l’intéressée à l’encontre de la décision du Bâtonnier et fixe les honoraires dus à l’avocate associée de la société Alpijuris.
À défaut de justification de l’acceptation d’un taux horaire de rémunération de 250 euros HT par la cliente et d’une complexité particulière du dossier, le premier président décide qu’il sera fait application d’un taux horaire de 200 euros HT, correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Moyens du pourvoi. Considérant qu’en se déterminant ainsi, le juge a fondé sa décision sur des faits non compris dans le débat, la cliente forme un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel.
Décision. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance sauf en ce qu’elle déclare recevable le recours formé contre la décision du Bâtonnier.
Selon la Cour, il ne résultait ni des écritures, reprises oralement à l’audience, ni des pièces de la procédure que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence était de 200 euros HT. En retenant ce chiffre, le premier président a fondé sa décision sur un fait qui n’était pas dans le débat et a ainsi violé l’article 7 du Code de procédure civile selon lequel le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
On notera que la deuxième chambre civile a rendu un arrêt identique dans une affaire du même jour (Cass. civ. 2, 6 octobre 2022, n° 20-19.723, F-B N° Lexbase : A72138M4).
Est-ce à dire que, s’agissant d’une procédure orale, si le taux retenu avait été non mentionné dans les écritures et pièces de procédure mais, évoqué oralement à l’audience il aurait valablement pu fonder la décision du premier président ? La Cour ne le dit pas… On imagine par ailleurs qu’il eut fallu que des pièces viennent justifier l’existence et le choix de ce chiffre.
| Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, L'application du principe du contradictoire devant le premier président en matière de contentieux des honoraires de l'avocat, in La profession d’Avocats, Lexbase N° Lexbase : E38053RD |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483049
[Le point sur...] Le droit de grève a l’épreuve de la réquisition
Lecture: 17 min
N3074BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Benjamin Desaint, Avocat Associé et Aurore Tixier Merjanyan, Avocat Counsel, cabinet Factorhy Avocats
Le 26 Octobre 2022
Mot-clés : mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale • droit de grève • réquisition • pouvoir de réquisition • grève • liberté fondamentale • maintien de l’ordre public • condition de sécurité • entreprise privée
Dans le contexte social actuel, la licéité de certaines mesures de réquisition de salariés grévistes arrêtées par l’autorité préfectorale a fait l’objet de contestations devant le juge administratif, lequel n’a pas manqué de rappeler que le droit de grève, s’il est reconnu constitutionnellement, doit faire l’objet d’une conciliation nécessaire avec d’autres principes à valeur constitutionnelle.
Les mouvements sociaux, massivement suivis sur le plan national depuis le 22 septembre dernier, ont obligé certaines entreprises à solliciter, auprès de l’autorité préfectorale compétente, des mesures de réquisition de salariés grévistes.
Certains arrêtés ont été contestés devant le juge administratif, dont les très récentes ordonnances invitent à rappeler brièvement les contours du droit de grève, qui est une liberté fondamentale (I.) ainsi que le recours à la réquisition de salariés grévistes auprès du préfet (II.), mesure qui ne doit pas porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, reconnu constitutionnellement.
I. Le droit de grève, une liberté fondamentale
Alors que la prohibition des coalitions patronales et ouvrières a été instaurée par la loi « Le Chapelier » des 14-17 juin 1791, il aura fallu attendre plus de 150 ans d’évolution législative pour que le droit de grève soit reconnu.
C’est le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel la Constitution du 4 octobre 1958 fait elle-même expressément référence, qui consacre le droit de grève accordé à chacun. Ainsi, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » [1].
Les éléments constitutifs de l’exercice du droit de grève (A.) ont surtout été encadrés et définis par la construction prétorienne, qui s’est également prononcée sur la situation des salariés exerçant leur de droit de grève (B.).
A. Brefs rappels concernant les éléments constitutifs du droit de grève
L’exercice du droit de grève est constitué lorsqu’il y a une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles [2].
1) Une cessation collective du travail…
La Cour de cassation a précisé que la grève est caractérisée par un arrêt collectif de travail [3]. Néanmoins, elle admet que la grève puisse être suivie par une minorité de salariés [4].
2) … en vue d’appuyer des revendications professionnelles…
La cessation d’activité doit être accompagnée ou précédée de la présentation de revendications [5], lesquelles doivent avoir un caractère professionnel [6] pour caractériser l’exercice du droit de grève [7].
Dans le secteur privé, à la différence des services publics [8], en principe, aucun délai n’est requis entre la présentation des revendications et celui de l’interruption de l’activité, pas plus qu’une tentative de conciliation préalable [9].
Dès lors, les salariés sont libres de choisir le moment qu’ils souhaitent pour cesser le travail, sans être tenus de respecter une quelconque formalité préalable. Il suffit que l’employeur ait connaissance des revendications au moment de l’arrêt du travail [10].
3) … qui ne doit pas entrainer la désorganisation de l’entreprise.
Pour la jurisprudence, le libre choix du moment de la grève ne doit pas avoir pour effet de désorganiser l’entreprise [11]. Néanmoins, la désorganisation de la production, qui constitue, quant à elle, une conséquence normale de la grève, ne caractérise pas un abus de l’exercice du droit de grève [12].
B. La situation des salariés grévistes
Le Code du travail dispose que l’« exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié » [13].
Ainsi, le contrat de travail du salarié gréviste est simplement suspendu pendant l’exercice du droit de grève.
Les dispositions légales excluent [14], au surplus, sous peine de nullité de la mesure prise, qu’un salarié soit sanctionné ou licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève, mais aussi qu’il fasse l’objet, pour ce motif, d’une mesure discriminatoire au cours de son activité professionnelle [15].
Le corollaire du maintien de l’emploi du salarié gréviste est nécessairement celui du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Néanmoins, un salarié gréviste ne peut être sanctionné, à raison d’un fait commis à l’occasion de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d’une faute lourde [16].
Ainsi, lorsque le conflit social éclate, l’entreprise est confrontée à un ralentissement de sa production, lequel peut, in fine, compromettre son avenir si la grève persiste.
Dans une telle situation, l’employeur va rechercher le « rétablissement rapide de la production, la marche normale de l’entreprise [17] », afin de pouvoir assurer la continuité de son activité et réduire l’impact du conflit.
Pour autant, la Cour de cassation n’a pas manqué de juger que « sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut limiter l’exercice du droit de grève, et par conséquent, il ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes » [18]. Il ne peut pas non plus saisir le juge des référés pour obtenir la réquisition des grévistes afin de prévenir d’un dommage imminent consécutif à l’exercice du droit de grève [19].
L’employeur confronté à une paralysie certaine de son entreprise peut néanmoins solliciter des mesures de réquisition par la voie administrative.
II. Les mesures de réquisition de salariés grévistes auprès du préfet
Le contexte social actuel nous a rappelé que l’exercice du droit de grève fait l’objet d’une conciliation nécessaire avec d’autres principes à valeur constitutionnelle [20].
Par le passé, le Conseil constitutionnel a déjà, à plusieurs reprises, souligné que le droit de la grève doit être concilié notamment avec la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens [21] ou encore la continuité du service public [22].
Ainsi, lorsque le mouvement de grève a un fort impact sur la vie de la Nation, ce qui est le cas lorsqu’il entraine une paralysie totale ou quasi-totale du secteur des transports, il est de nature à justifier une mesure de réquisition [23].
Le Code général des collectivités territoriales rappelle cette nécessaire conciliation en donnant compétence au préfet, qui :
« en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont [il] dispose ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application » [24].
Ainsi, de très récentes ordonnances [25], rendues par le juge des référés administratif, rappellent que les mesures de réquisition arrêtées par le préfet, pour ne pas être de nature à caractériser une atteinte excessive au droit de grève, doivent être justifiées par l’importance particulière de l’activité en cause et par la menace de l’ordre public (A.) ainsi que proportionnées (B.).
A. Les mesures de réquisition doivent être justifiées par l’importance particulière de l’activité et la menace de l’ordre public
Les mesures de réquisition de salariés d’une entreprise privée [26], pour ne pas porter une atteinte excessive au droit de grève, doivent être justifiées par la nature de l’activité de l’entreprise et la menace de l’ordre public.
En effet, l’activité de l’entreprise par laquelle sont sollicitées des mesures de réquisition doit revêtir une importance particulière.
Le Conseil d’État a ainsi pu valider, par le passé, les mesures de réquisition prises pour des activités d’exploitation d’énergie, particulièrement pour une centrale thermique de production d’électricité [27] ou à propos de l’approvisionnement en carburants [28].
Dans cette espèce, la réquisition de salariés grévistes d’un site pétrolier a été approuvée, en raison de l’existence d’un risque pour le maintien de l’ordre public. En 2010, déjà, la pénurie croissante d’essence et de gazole en Île-de-France, menaçant alors le ravitaillement des véhicules de services publics et de première nécessité et l’épuisement du stock de carburant de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, justifiaient la réquisition, pour une durée de six jours, de salariés grévistes de l’établissement pétrolier de Gargenville.
Le Conseil d’État considérait que, même si « le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale », « le préfet peut légalement […] requérir des salariés en grève d’une entreprise privée dont l’activité présente une importance particulière pour le maintien de l’activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public » [29].
Le contexte social que la France connaît depuis la fin du mois de septembre a permis au juge administratif [30] de rappeler que les mesures de réquisition doivent être nécessairement justifiées par l’importance particulière de l’activité et la menace de l’ordre public.
Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a estimé, dans son ordonnance du 13 octobre 2022 [31], que la réquisition du personnel du dépôt pétrolier de Port-Jérôme-sur-Seine était justifiée dans la mesure où : « la pénurie de carburant créé de nombreuses tensions dans les files d’attente aux stations-service encore disponibles, le taux d’indisponibilité atteignant plus de 36 % en Ile de France ».
Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, quant à lui, dans son ordonnance du 14 octobre 2022 [32], précisé que « la pénurie croissante de carburants pour les véhicules automobiles constatée le 13 octobre 2022, sur le territoire français, et en particulier, sur celui des départements des Hauts-de-France où le taux d’indisponibilité pouvait atteindre 50 %, menaçait le ravitaillement des véhicules de services publics et de services de première nécessité et créait des risques pour la sécurité routière et l’ordre public. Par ailleurs le dépôt concerné alimente en carburants pour automobiles la moitié de la population de la région des Hauts-de-France, soit trois millions d’habitants ».
Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, dans son ordonnance du 20 octobre 2022 [33], a jugé que la réquisition des personnels chargés de l’activité d’expédition du site Total Energies de Feyzin était justifiée puisqu’« alors que la raffinerie de Feyzin permet l'approvisionnement de 55 % des carburants vendus en région Auvergne-Rhône-Alpes, le taux d'indisponibilité de carburant dans les stations-service du département du Rhône qui augmente chaque jour, était de près de 40 % à la date du 17 octobre 2022, sur 200 stations-service, 72 étaient en rupture partielle et 13 en rupture totale. L'épuisement des stocks disponibles des quatre dépôts de carburant du département […] menaçait le ravitaillement des véhicules de services publics, de transports en commun, certaines compagnies ayant cessé de travailler et des véhicules de première nécessité ».
Ainsi, ces dernières semaines, le juge administratif a eu à vérifier la nécessaire adéquation entre la réquisition de salariés grévistes et l’importance particulière de l’activité de l’entreprise qui les emploie (des établissements pétroliers [34], un site classé SEVESO [35] ou un laboratoire de biologie médicale [36]).
Par le passé, il l’avait déjà fait pour la réquisition de salariés grévistes employés par un établissement médico-social [37], un laboratoire d’analyses médicales [38] ou aussi des sages-femmes d’un service obstétrique [39].
Enfin, les mesures de réquisition arrêtées par le préfet pour ne pas être de nature à caractériser une atteinte excessive au droit de grève, doivent aussi être proportionnées.
B. La nécessaire proportionnalité des mesures de réquisition
Les mesures de réquisition arrêtées par le préfet doivent être imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public [40].
Ainsi, si le préfet a la possibilité de « légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins », « il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public » [41].
Dès lors, comme le rappelle le Professeur Bernard Teyssié [42], il n’est pas proportionné de décider la réquisition de toutes les sage-femmes d’une clinique sans qu’ait été envisagé « le redéploiement d’activités vers d’autres établissements de santé ou le fonctionnement réduit du service » ni recherché « si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du département » [43].
Très récemment, le tribunal administratif de Rennes [44], saisi d’un référé-liberté engagé par les salariés d’un laboratoire d’analyses médicales ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réquisition, n’a pas manqué de rappeler que la proportionnalité des mesures de réquisition était caractérisée lorsqu’est mis en place un service minimum, mais ne l’est plus, lorsqu’un service normal est assuré.
Le juge des référés, dans cette espèce, précise qu’« il n’est pas démontré que l’ampleur du mouvement de la grève […] dans cette société, serait susceptible d’avoir, sur l’activité d’analyse des prélèvements médicaux provenant des quatre établissements privés concernés, un impact tel qu’il serait susceptible de compromettre immédiatement et gravement le fonctionnement du dispositif sanitaire […], s’agissant de la sécurité des patients et de la continuité des soins, en rendant nécessaire l’organisation sans délai, par voie de réquisition, d’un service minimum ».
Dans les autres récentes ordonnances rendues par le juge des référés administratif [45], toutes les demandes de suspension des arrêtés préfectoraux de réquisition de salariés ont été rejetées - les mesures de réquisition ont été jugées comme proportionnées et, donc, licites - pour les motifs suivants :
- à propos de la réquisition de personnels grévistes au sein de la plateforme Normandie Total Energies [46]:
« l’effectif de cinq personnes par quart quand bien même serait-il l’effectif ordinairement présent sur site n’est manifestement pas excessif dès lors qu’il ressort notamment de l’avis de la Dréal Normandie qu’un tel effectif est l’effectif minimum requis pour assurer la sécurité du site, de ses installations, de son personnel […] ».
- à propos de la réquisition de personnels chargés de l’activité de pompage et d’expédition du site Exxon Mobil de Port-Jérôme-sur-Seine [47] :
« l’autorité administrative a identifié quatre salariés réquisitionnés pour leur demander d’assurer des quarts de durée limitée. […] Il n’est pas contesté que ce choix, limité en nombre et en durée, adapté à la situation évolutive des effectifs, ne tend pas à mettre en place un service normal, mais vise à assurer, par un nombre restreint, mais suffisant d’agents et une liste réduite de tâches essentielles précisément définies, un service minimum proportionné aux risques de troubles qu’il appartient à l’autorité publique de prévenir » ;
- à propos de la réquisition de personnels chargés de l’activité de distribution de carburants du dépôt pétrolier de la Côte d’Opale (site de Mardyck) [48] :
« l’effectif réquisitionné, qui ne représente qu’une faible fraction de l’effectif de l’établissement, est limité aux équipes de quart strictement nécessaires à l’accomplissement des fonctions de mélange et de transfert des carburants automobiles des réservoirs du dépôt dans les citernes des véhicules de livraison, permettant uniquement la fourniture correspondant aux nécessités de l’ordre public, à l’exclusion de toute activité de raffinage. […] Dans ces conditions […] la mesure contestée ne présente pas un caractère disproportionné aux nécessités de l’ordre public » ;
- à propos de la réquisition des personnels chargés de l’activité d’expédition du site TotalEnergies de Feyzin [49] :
« s’il est fait état de ce que certains personnels des dépôts en cause ne seraient pas grévistes, il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci auraient pu faire fonctionner les services nécessaires à l’expédition et au transport de carburant, alors qu’il est constant qu’aucun carburant n’a été distribué ou livré en provenance de ces dépôts, depuis le début du mouvement de grève […], ni davantage qu’il aurait été possible de recourir à des opérateurs extérieurs eu égard à la technicité des fonctions exercées. Par suite, le recours à des mesures de réquisition individuelles d’agents qualifiés présente un caractère nécessaire pour prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public résultant d’une pénurie croissante de carburant ».
Ainsi, la proportionnalité des mesures de réquisition prononcées par l’autorité préfectorale est toujours vérifiée par le juge administratif afin d’assurer que de telles mesures ne portent pas une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.
Ce contrôle de proportionnalité réalisé par le juge administratif se traduit spécialement par l’analyse de la motivation des arrêtés préfectoraux, lesquels doivent fixer « la nature de la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application » [50].
Enfin, il convient de rappeler qu’en cas de réquisition, notamment en vue d’assurer un service minimum nécessaire pour des raisons de sécurité, les salariés qui se seraient déclarés solidaires de la grève doivent être traités comme des non-grévistes et ainsi donc se voir verser une entière rémunération, même si moralement, ils se considèrent comme grévistes [51].
Dans ces circonstances, il apparait nécessaire, autant que faire se peut, d’encourager la négociation collective puisque « procéder à la réquisition de grévistes, dès lors qu’ils sont nombreux et déterminés, est un exercice délicat » [52].
[1] Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, art. 7.
[2] Cass. soc., 18 janvier 1995, n° 91-10.476 N° Lexbase : A1832AA4 ; Cass. soc., 18 juin 1996, n° 92-44.497 [LXB= A2013AAS] ; Cass. soc., 23 octobre 2007, n° 06-17.802, FS-P+B N° Lexbase : A8504DYM.
[3] Cass. soc., 18 janvier 1995, n° 91-10.476 N° Lexbase : A1832AA4.
[4] Cass. soc., 1er juin 1951, n° 51-01.763 N° Lexbase : A5420A4I ; Cass. soc., 21 juin 1967, n° 66-40.442, publié N° Lexbase : A2594AUM.
[5] Cass. soc., 19 novembre 1996, n° 94-42.631 N° Lexbase : A2156AA4 à n° 94-42.635 N° Lexbase : A4182AA7.
[6] Cass. soc., 18 janvier 1995, n° 91-10.476 N° Lexbase : A1832AA4.
[7] Cass. soc., 17 décembre 1996, n°95-41.858 N° Lexbase : A4137AAH.
[8] C. trav., art. L. 2512-2 N° Lexbase : L0240H9R.
[9] Cass. soc., 26 février 1981, n° 79-41.359, publié N° Lexbase : A6981C83.
[10] Cass. soc., 19 novembre 1996, n° 94-42.631 N° Lexbase : A2156AA4.
[11] Cass. soc., 18 janvier 1995, n°91-10.476 N° Lexbase : A1832AA4.
[12] Cass. soc., 30 mai 1989, n°87-10.994 N° Lexbase : A1394AAU.
[13] C. trav., art. L. 2511-1, al. 1er N° Lexbase : L0237H9N.
[14] C. trav., art. L. 2511-1, al. 2 N° Lexbase : L0237H9N.
[15] C. trav., art. L. 1132-2 N° Lexbase : L0676H9W.
[16] Cass. soc., 16 décembre 1992, n° 91-41.215 N° Lexbase : A3807AAA.
[17] T. Brill-Venkatasamy, La prévention des dommages et la cessation de la situation illicite en matière de conflits collectifs du travail, RIDC, 1994, p. 1108.
[18] Cass. soc., 15 décembre 2009, n°08-43.603, FS-P+B N° Lexbase : A7199EPC.
[19] Cass. soc., 25 février 2003, n° 00-44.339, publié N° Lexbase : A3037A7M ; Cass. soc., 25 février 2003, n° 01-10.812, publié N° Lexbase : A2630A7K.
[20] Préambule de la Constitution de 1946, art. 7 ; CE, 7 juillet 1950, n° 01645 N° Lexbase : A5106B7A.
[21] Cons. const., décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980 N° Lexbase : A8014ACS.
[22] Cons. const., décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979 N° Lexbase : A7991ACX ; Cons. const., décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 N° Lexbase : A6455DXD ; Cons. const., décision n° 2008-569 DC du 7 août 2008 N° Lexbase : A8776D9W.
[23] CE, 26 octobre 1962, Le Moult, et Synd. Union des navigants de ligne, publié au recueil Lebon.
[24] CGCT, art. L. 2215-1, 4° N° Lexbase : L8592HW7.
[25] TA Rouen, 12 septembre 2022, n° 2203654 N° Lexbase : A99368HH ; TA Rouen, 13 octobre 2022, n° 2204100 N° Lexbase : A13788PQ ; TA Lille, 14 octobre 2022, n° 2207769 N° Lexbase : A69768QG ; TA Rennes, 15 octobre 2022, n° 2205246 N° Lexbase : A97588P4 ; TA Lyon, 20 octobre 2022, n° 2207732 N° Lexbase : A44768QT.
[26] Y. Struillou, Conflits sociaux et réquisition : Finalité et modalités du contrôle exercé par le juge administratif, Dr. ouvrier, août 2011, p. 485.
[27] CE référé, 23 mai 2011, n° 349215 N° Lexbase : A5860HST.
[28] CE référé, 27 octobre 2010, n° 343966 N° Lexbase : A8011GCP.
[29] CE référé, 27 octobre 2010, préc..
[30] TA Rouen, 13 octobre 2022, n°2204100, préc. ; TA Lille, 14 octobre 2022, n° 2207769, préc. ; TA Lyon, 20 octobre 2022, n°2207732, préc..
[31] TA Rouen, 13 octobre 2022, n° 2204100, préc..
[32] TA Lille, 14 octobre 2022, n° 2207769, préc..
[33] TA Lyon, 20 octobre 2022, n° 2207732, préc..
[34] TA Rouen, 13 octobre 2022, n° 2204100, préc. ; TA Lille, 14 octobre 2022, n° 2207769, préc. ; TA Lyon, 20 octobre 2022, n° 2207732, préc..
[35] TA Rouen, 12 septembre 2022, n° 2203654 N° Lexbase : A99368HH.
[36] TA Rennes, 15 octobre 2022, n° 2205246 N° Lexbase : A97588P4.
[37] CAA Lyon, 11 décembre 2018, n° 17LY00845 N° Lexbase : A4709YS9.
[38] TA Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2019, n° 1902530 N° Lexbase : A11113AE.
[39] CE, 9 décembre, 2003, n° 262186 N° Lexbase : A4691DAY.
[40] CE, 9 décembre, 2003, n°262186, préc..
[41] CE, 9 décembre, 2003, n° 262186, préc..
[42] JCP S, 2020, act. 1, obs. B. Teyssié.
[43] CE, 9 décembre, 2003, n° 262186, préc..
[44] TA Rennes, 15 octobre 2022, n° 2205246, préc..
[45] TA Rouen, 12 septembre 2022, n° 2203654, préc. ; TA Rouen, 13 octobre 2022, n° 2204100, préc. ; TA Lille, 14 octobre 2022, n° 2207769, préc. ; TA Lyon, 20 octobre 2022, n° 2207732, préc..
[46] TA Rouen, 12 septembre 2022, n° 2203654, préc..
[47] TA Rouen, 13 octobre 2022, n° 2204100 N° Lexbase : A13788PQ, Ch. Moronval, Grève dans les raffineries : validation de l’arrêté de réquisition de salariés, Lexbase Social, octobre 2022, n° 921 N° Lexbase : N3014BZN.
[48] TA Lille, 14 octobre 2022, n° 2207769, préc..
[49] TA Lyon, 20 octobre 2022, n° 2207732, préc..
[50] CGCT, art. L. 2215-1, 4° N° Lexbase : L8592HW7.
[51] Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 98-44.427 N° Lexbase : A9186AGC.
[52] JCP S, 2020, act. 1, obs. B. Teyssié.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483074
[Brèves] Irrecevabilité du CSE à invoquer l’illégalité d’une clause d’un accord de participation qu'il a lui même signé
Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.270, FS-B N° Lexbase : A01978QD
Lecture: 2 min
N3039BZL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 26 Octobre 2022
► Le comité social et économique, signataire d'un accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord.
Faits et procédure. Une société et un comité social et économique (CSE) concluent un accord de participation.
Constatant une forte baisse du montant global de la réserve spéciale de participation au fil des ans, le CSE fait procéder à un audit des comptes arrêtés au 31 mars 2015 par un cabinet, lequel, dans son rapport remis le 19 mai 2016, en se fondant pour la détermination des capitaux propres à prendre en compte sur le « Guide de l'épargne salariale » diffusé en 2014, a conclu que le montant de la réserve spéciale de participation calculée selon l'accord de 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale.
Le CSE a donc fait assigner la société devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le versement d'un complément de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2014/2015 à 2016/2017. Il est débouté de sa demande devant la cour d’appel (CA Versailles, 16 février 2021, n° 19/05282 N° Lexbase : A13334HT). Il forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Le CSE étant signataire de l'accord de participation, il n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la clause de cet accord qui, dans le silence de la loi, a déterminé le mode de calcul des capitaux propres d'une succursale française d'une société étrangère.
|
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483039
[Brèves] Confusions de caves en copropriété et ventes successives : retour sur les conditions de la jonction de possession pour acquérir par prescription
Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2022, n° 21-19.852, Publié au bulletin N° Lexbase : A01998QG
Lecture: 4 min
N3041BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 28 Octobre 2022
► Aux termes de l’article 2265 du Code civil « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ; il en résulte que l'acquéreur peut joindre à sa possession celle de son vendeur dès lors que le bien a été envisagé par les parties comme étant compris dans la vente.
Telle est la solution qui se dégage de cet arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (solution déjà énoncée, mais a contrario : Cass. civ. 3, 17 avril 1996, n° 94-15.748, publié au bulletin N° Lexbase : A9886ABR et Cass. civ. 3, 3 octobre 2000, n° 98-20.646, inédit au bulletin N° Lexbase : A0166CM4, retenant qu’un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente).
Faits et procédure. En l’espèce, un M. X a acquis, le 2 août 2005, un lot 82 correspondant à une cave située dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété. À la demande du notaire chargé de cette vente, qui l'avait informé qu'il n'avait pas été mis en possession de la bonne cave, il a accepté amiablement de la restituer à son propriétaire.
Il a demandé à Mme Y, propriétaire du lot 81, correspondant également à une cave située au sous-sol du même ensemble immobilier constituant, selon le plan de localisation établi par le règlement de propriété d'origine, le lot 82, de lui restituer cette cave.
Cette dernière ayant refusé puis revendu ce lot à Mme Z, M. X a assigné Mme Z en restitution de cette cave qu'elle occupait, selon lui, irrégulièrement.
Mme Z a appelé en garantie Mme Y.
Décision CA. Pour dire que ni l’une ni l’autre n'avaient pu acquérir par prescription la propriété du lot 82, la cour d’appel avait retenu, d'abord, qu'en l'absence de modification régulière du plan de localisation des caves annexé au règlement de copropriété du 11 décembre 1963, la cave actuellement possédée par Mme Z correspondait, selon ce document qui était le seul applicable, au lot 82.
La cour d’appel avait relevé, ensuite, que tant le titre de propriété de Mme Y que celui de Mme Z portaient sur le lot 81, désigné comme une cave numérotée 81, puis retenu qu'en conséquence, aucun de ces actes n'avait transféré la possession du lot 82, en sorte que, ce lot étant resté en dehors de la vente, Mme Z ne pouvait joindre à sa possession celle de Mme Y.
Pourvoi. Mme Y a formé un pourvoi sur le fondement de l’article 2265 du Code civil N° Lexbase : L7206IA7, faisant valoir que l'acquéreur peut joindre sa possession dès lors que le bien a été envisagé par les parties comme étant compris dans la vente et que tel était le cas dans l'acte authentique du 2 septembre 1996 aux termes duquel les précédents vendeurs lui avaient vendu les lots 13, 81 (cave au sous-sol portant le numéro 81) et 173, ainsi que dans l'acte de promesse de vente du 18 mars 2016 par Mme Y au profit de Mme Z.
Mme Y soutenait alors qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient, dans ces deux actes successifs, inclus la cave dont le vendeur avait la possession (la cave 81 selon le plan de 1972), la cour d'appel avait violé l'article 2265 du Code civil.
Cassation. L’argument est accueilli par la Haute juridiction qui censure l’arrêt pour violation du texte précité.
Selon la Cour régulatrice, en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que, comme cela était soutenu, les ventes du 18 mars 2016 et du 2 septembre 1996 avaient porté, dans l'intention des parties et à la suite de modifications même irrégulières de l'emplacement et de la numérotation des caves, sur celle possédée par Mme Y depuis sa propre acquisition et correspondant à l'emplacement d'origine de la cave constituant le lot 82 selon l'état descriptif de division initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483041
[Chronique] Chronique de droit de l’expropriation – Octobre 2022
Lecture: 19 min
N3053BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Pierre Tifine, Professeur de droit public à l’Université de Lorraine, Directeur scientifique de Lexbase Public, Doyen de la faculté de droit, économie et administration de Metz
Le 26 Octobre 2022
Lexbase Hebdo — édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d’actualité de droit de l’expropriation rédigée par Pierre Tifine, Professeur à l’Université de Lorraine et Doyen de la faculté de droit économie et administration de Metz. Dans la première décision, la Cour de cassation réaffirme que le juge d’appel doit rechercher d’office si les conclusions relatives aux indemnités d’expropriation sont recevables (Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-14.913, FS-D). Le Conseil d’État apporte des précisions sur le rôle du préfet dans le cadre de la procédure de régularisation d’une déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (CE, 2°-7° ch. réunies, 21 juillet 2022, n° 437634, publié au recueil Lebon). La Cour de cassation est appelée, une nouvelle fois, à se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation (Cass. civ. 1, 7 juillet 2022, n° 22-10.290, FS-B). Elle rappelle ensuite qu’une décision d’une personne publique d'implanter un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée n’a pas pour effet l’extinction de ce droit (Cass. civ. 3, 6 juillet 2022, n° 21-13.550). Enfin, le juge du référé-liberté du Conseil d’État juge que la reprise des travaux ne constitue pas nécessairement une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif en l’absence d’annulation définitive de l’arrêté de cessibilité (CE, référé, 25 août 2022, n° 466421).
Sommaire
Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-14.913, FS-D
CE, 2°-7° ch. réunies, 21 juillet 2022, n° 437634, publié au recueil Lebon
Cass. civ. 3, 7 juillet 2022, n° 22-10.290, FS-B
Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-13.550, F-B
CE, référé, 25 août 2022, n° 466421
I. Le juge d’appel doit rechercher d’office si les conclusions relatives aux indemnités d’expropriation sont recevables (Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-14.913, FS-D N° Lexbase : A859978Y)
En application de l’article L. 321-22 du Code de l’expropriation N° Lexbase : L7988I4M, « le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant ». L’article R. 311-26 N° Lexbase : L7258LEK précise quant à lui que « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant ». Ce délai de trois mois est identique au délai de droit commun prévu par l’article 908 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7239LET alors que, sous l’empire de l’ancien Code de l’expropriation, l’article R. 13-49 N° Lexbase : L3177HLA ne prévoyait qu’un délai de deux mois.
Un moyen présenté pour la première fois par l’appelant dans un mémoire déposé après l’expiration de ce délai est en conséquence est irrecevable [1]. Encourt donc la cassation un arrêt qui pour fixer une indemnité de dépossession d’un montant supérieur à ce qui avait été sollicité dans le mémoire initial, prend en considération des écritures déposées après l’expiration du délai légal [2].
En l’espèce, pour fixer les indemnités d’expropriation revenant à un montant inférieur à celui demandé par le propriétaire évincé et à ceux proposés par le commissaire du gouvernement et par l’expropriant dans des conclusions déposées le 13 janvier 2020, l’arrêt se réfère aux dernières conclusions déposées par ce dernier le 9 novembre 2020, aux termes desquelles il réduit ses offres indemnitaires. En se déterminant ainsi, sans rechercher d’office si ces conclusions, déposées au-delà du délai prévu par l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, étaient néanmoins recevables, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
II. Précisions sur le rôle du préfet dans le cadre de la procédure de régularisation d’une déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (CE, 2°-7° ch. réunies, 21 juillet 2022, n° 437634, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A63954YI)
Dans la présente affaire, le Conseil d’État met un terme à la procédure au long cours concernant la déclaration d’utilité publique relative à la réalisation d’un tronçon de « la Liaison Intercantonale d’Evitement Nord » (LIEN) autour de l’agglomération montpelliéraine et emportant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols et des plans locaux d’urbanisme des communes traversées, dont celle de Grabels qui s’oppose au projet.
Dans une décision avant dire droit du 9 juillet 2021 [3], le Conseil d’État avait sanctionné l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, au motif qu’elle ne disposait pas de l’autonomie répondant aux exigences du paragraphe 1 de l’article 6 de la Directive européenne 2011/92 du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement N° Lexbase : L2625ISZ [4]. Mais plutôt que d’annuler la déclaration d’utilité publique, s’inspirant de sa jurisprudence dans le domaine des autorisations environnementales [5] et dans celui des autorisations d’urbanisme [6], le Conseil d’État avait considéré que ce vice de procédure était susceptible de régularisation et qu’il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, ou de neuf mois en cas de nouvelles consultations.
Conformément au mode d’emploi précisé dans la décision du 8 juillet 2021, le préfet a saisi la mission régionale d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable qui a rendu un avis le 28 septembre 2021 et il a organisé une consultation du public par voie électronique, du 31 janvier au 2 mars 2022.
La question se posait dès lors de savoir si ces mesures étaient de nature à régulariser l’arrêté litigieux. Conformément à la solution dégagée à l’occasion de l’arrêt « Ministre de la cohésion des territoires et Société MSE La Tombelle » du 16 février 2022 [7], le Conseil d’État rappelle que « eu égard au vice retenu, tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par l’autorité environnementale sur le dossier du projet en cause, comprenant notamment l’étude d’impact, seuls sont susceptibles d’être utilement invoqués à ce stade des moyens mettant en cause des vices propres à la mesure de régularisation, ou contestant que l’avis émis par l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétente permettrait de régulariser le vice relevé par la décision du Conseil d’État du 9 juillet 2021 ou soutenant que de nouveaux vices, fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, affecteraient la légalité de l'arrêté attaqué ».
Ce sont donc d’abord les moyens concernant la régularité de l’étude d’impact qui sont examinés par le Conseil d’État. À ce titre, il est jugé que si l’autorité environnementale avait émis le souhait d’élargir le périmètre de l’étude air et santé figurant dans cette étude, l’ampleur des modifications des flux de trafic sur les axes routiers qui n’ont pas été pris en compte ne justifiait de les intégrer dans ce périmètre.
Concernant ensuite la consultation complémentaire faite dans le cadre de la régularisation, les juges relèvent que le nouvel avis ne différait substantiellement pas de l’avis initial. Il n’y avait donc pas lieu d’organiser - toujours conformément au mode d’emploi défini dans la décision du 8 juillet 2021 - des consultations complémentaires à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seraient soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par ce nouvel avis. En conséquence, aucune reprise de l’enquête publique ne s’imposait, et une consultation du public selon la modalité retenue suffisait à la régularisation.
III. Conformité à la Constitution des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation (Cass. civ. 3, 7 juillet 2022, n° 22-10.290, FS-B N° Lexbase : A05168AD)
La Cour de cassation est saisie une nouvelle fois dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité de la conformité à la Constitution des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’articles L. 322-2 du Code de l’expropriation N° Lexbase : L9923LMH relatifs aux modalités d’évaluation de l’indemnité d’expropriation.
Dans un précédent arrêt en date du 1er avril 2021 [8], la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait considéré que la question de la conformité de ces dispositions à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1364A9E présentait un caractère sérieux justifiant sa transmission au Conseil constitutionnel. Ces dispositions imposent d’apprécier la nature et l’usage effectif de l’immeuble à une date de référence parfois très antérieure à la date de l’expropriation, tout en interdisant de tenir compte des changements de valeur depuis cette date. Plus précisément, ce qui était contesté, c’était l’absence de distinction opérée par ces dispositions selon que le bien exproprié a vocation à demeurer dans le patrimoine de l’autorité publique expropriante, ou qu’il est déjà avéré que ce bien sera revendu par l’expropriant au prix du marché, dans des conditions déjà connues lui permettant de réaliser une plus-value substantielle.
Dans une décision du 11 juin 2021, le Conseil constitutionnel avait déclaré conformes à la Constitution ces dispositions [9]. Il avait notamment relevé que les dispositions litigieuses permettaient d’éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise par la hausse de la valeur vénale du bien exproprié, consécutive à l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant, ce qui est conforme à l’objectif d’intérêt général de bon usage des deniers publics.
Si cette question revient une nouvelle fois devant la Cour de cassation c’est en raison de l’intervention de l’arrêt du Conseil d’État du 22 mars 2022, « Association Eglise évangélique de Crossroads » selon lequel les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation n’ont pas à être incluses dans le dossier soumis à enquête publique [10]. Selon les requérants, il s’agirait ici d’un changement des circonstances de droit modifiant le cadre juridique existant de nature à affecter la constitutionnalité des dispositions litigieuses. Or, peuvent constituer de telles circonstances, une interprétation jurisprudentielle constante d’une juridiction suprême conférée à une disposition législative, intervenant postérieurement à la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition législative en cause conforme à la Constitution [11].
Ce moyen est toutefois rejeté par la Cour de cassation. Elle relève, d’abord, que cette décision prise par le Conseil d’État que cette décision ne constitue pas une modification de la jurisprudence antérieure. Elle précise ensuite que dans sa décision du 11 juin 2021, le Conseil constitutionnel ne s’était pas fondé, pour déclarer ces dispositions conformes à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, sur l’existence d’un recours contre la déclaration d’utilité publique pouvant être exercé devant le juge administratif en cas de plus-value certaine et excédant les besoins du projet, réalisée par l’autorité expropriante au détriment de l’exproprié. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
IV. La décision d’une personne publique d'implanter un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée n’a pas pour effet l'extinction de ce droit (Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-13.550, F-B N° Lexbase : A582079G)
Dans son arrêt « Bergoend » du 17 juin 2013 [12], le Tribunal des conflits a limité de façon assez radicale le domaine de la voie de fait. Désormais il n’y a voie de fait que dans deux hypothèses : lorsque l’administration a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ; lorsqu’elle a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Seuls ces cas justifient, par exception au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour ordonner la cessation ou la réparation des atteintes subies.
S’agissant plus précisément des atteintes portées au droit de propriété, dans une autre décision « Epoux Panizzon » du 9 décembre 2013 [13], le Tribunal des conflits a assimilé « extinction » du droit de propriété et « dépossession définitive ». Pour qu’il y ait voie de fait, il est donc exigé que la le droit de propriété soit totalement vidé de sa substance, ce qui vise particulièrement l’hypothèse de la destruction d’un bien. En d’autres termes, le propriétaire doit être privé de l’ensemble des éléments composant son droit : usus, abusus et fructus. Mais encore faut-il préciser qu’on doit entendre cette notion dans un sens non pas matériel mais juridique. Ainsi, la destruction matérielle d’un bien immobilier n’est pas toujours assimilable à la dépossession définitive du droit de propriété dès lors que ce bien est susceptible de faire l’objet d’une remise en état. Tel est le cas dans une affaire concernant une demande de remise en état d’une haie supprimée contre la volonté de son propriétaire [14]. Dans une décision plus favorable à la compétence du juge judiciaire, la première chambre civile de la Cour de cassation a certes considéré que l’arrachage d’une haie, constituée d’arbres, sur toute sa longueur, occasionne l’extinction du droit de propriété des requérants sur ces végétaux [15]. Il n’y a pourtant pas de réelle divergence entre la première et la troisième chambre civile, la différence de solution pouvant résulter du fait que c’est une haie constituée d’arbres qui est en cause dans la seconde affaire, ce qui rend moins envisageable la remise en état des lieux que dans la première affaire.
Dans l’affaire « Bergoend », le Tribunal des conflits a pu ainsi refuser de considérer qu’une atteinte aussi grave au droit de propriété que l’implantation, sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée est assimilable à l’extinction d’un droit de propriété.
Dans la présente affaire, les faits soumis aux juges sont très semblables : un propriétaire se plaint qu’un transformateur électrique a été installé sans autorisation sur sa propriété, ce qui l’a conduit à assigner la société Enedis devant la juridiction judiciaire en paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité d’occupation jusqu’à son déplacement ou sa suppression. Dans la droite ligne de la jurisprudence « Bergoend », la Cour de cassation considère que cette situation n’a pas pour effet l’extinction du droit de propriété, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le recours en annulation de cette décision, ainsi que sur la réparation de ses conséquences dommageables.
V. La reprise des travaux ne constitue pas nécessairement une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif en l’absence d'annulation définitive de l’arrêté de cessibilité (CE, référé 25 août 2022, n° 466421 N° Lexbase : A97118EE)
L’ordonnance commentée illustre à quel point l’utilisation de la procédure de référé liberté est incertaine dans le contentieux de l’expropriation. Les faits de l’affaire sont complexes et méritent d’être relatés exhaustivement.
Une SCI était propriétaire à Marseille de parcelles sur lesquelles ont été édifiés plusieurs bâtiments au sein desquels elle exerçait diverses activités, notamment celle d’abattage. Par deux deux arrêtés du 27 février 2017, le préfet avait déclaré d’utilité publique les travaux de réalisation d’une zone d’aménagement concerté et déclaré cessible, au bénéfice de l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée, l’ensemble immobilier situé sur les parcelles en cause. Ces parcelles ont ensuite fait l’objet d'une ordonnance d’expropriation le 30 juin 2017. Les indemnités de dépossession ont été fixées par jugement rendu le 27 juin 2018 et payées le 11 décembre 2018. Toutefois, avec l’accord de l’expropriant, les sociétés exploitantes des installations présentes sur le site se sont maintenues dans les lieux jusqu’au 30 septembre 2019.
Par un arrêt du 22 février 2022 [16], la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté de cessibilité, au motif que la déclaration d’utilité publique était entachée d’illégalité. La société a alors saisi le juge de l’expropriation en application de l’article L. 223-2 du Code de l’expropriation N° Lexbase : L7962I4N qui précise que « en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ». Dans ce cas, selon le même article « après avoir constaté l’absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ».
Le 16 février 2022, l’établissement public a notifié l’ordre de service du démarrage de l’exécution des travaux de démolition des bâtiments concernés. Saisi par la SCI Les Marchés Méditerranéens, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 29 mars 2022, enjoint à l'EPA Euroméditerranée d’interrompre sans délai les travaux de démolition engagés sur les parcelles en cause jusqu’à ce que le juge de l’expropriation se soit prononcé ou, si elle est plus précoce, jusqu’à l’intervention d’un nouvel arrêté de cessibilité portant sur les parcelles en cause.
Par une ordonnance du 17 juin 2022 [17], le juge des référés du Conseil d’État a confirmé l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille tout en précisant que cette injonction prendrait fin notamment si l’arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille était annulé. Or justement, par une décision du 25 juillet 2022, le Conseil d'État a annulé l’arrêt du 22 février 2022 de la cour administrative d’appel de Marseille [18].
Saisi de nouveau par la SCI, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une nouvelle ordonnance du 29 juillet 2022, à nouveau enjoint à l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée d’interrompre sans délai les travaux de démolition engagés sur les parcelles en cause. C’est cette ordonnance qui est contestée en appel devant le juge des référés du Conseil d’État.
L’essentiel du débat juridique tient ici sur la question de savoir si l’atteinte au droit de propriété en cause est « grave et manifestement illégale » au regard des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de l’expropriation N° Lexbase : L8052I4Y énonçant les conditions de la procédure de référé liberté.
Le juge du référé liberté rappelle ici que le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 N° Lexbase : L7558AIR et 13 N° Lexbase : L1360A9A de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale [19]. Il rappelle également que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant mais suppose que ce recours puisse empêcher l’exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, telles que l’atteinte aux biens.
Or, dans la présente affaire, l’arrêté de cessibilité du 27 février 2017 n’a pas fait l’objet, à la date où le juge du référé-liberté du Conseil d’État statue, d’une « annulation par une décision définitive du juge administratif », condition exigée par l’article L. 223-2 du Code de l’expropriation susvisé. Il en résulte que « si la reprise des travaux est de nature, dans l’hypothèse d’une annulation devenue irrévocable de l’arrêté de cessibilité, à faire obstacle à ce que les biens en cause soient restitués à la société, qui serait alors indemnisée, cette reprise ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, alors que l’absence d’annulation définitive de l’arrêté de cessibilité fait en tout état de cause obstacle à l’action en restitution devant le juge de l’expropriation ».
[1] Cass. civ. 3, 8 octobre 1977, Bull. civ. III, n° 190.
[2] Cass. civ. 3, 18 mai 1989, Bull. civ. III, n° 114, D. 1991. somm. 59, obs. P. Carrias, AJPI, 1989. 802, obs. A.B.
[3] CE 2°-7° ch. réunies, 9 juillet 2021, n° 437634 N° Lexbase : A63954YI, Rec. CE, p. 224, JCP éd. A, 2021, act. 476, JCP éd. A, 2021, 2304, note F. Polizzi.
[4] JOUE, 26 janvier 2012, L 26/1.
[5] CE 2°-7° ch. réunies, 27 septembre 2018, n° 420119 N° Lexbase : A2070X88.
[6] CE 5°-6° ch. réunies, 27 mai 2019, n° 420554, n° 420575 N° Lexbase : A1439ZDN.
[7] CE 5°-6° ch. réunies, 27 mai 2019, n° 420554.
[8] Cass. civ. 3, 1er avril 2021, n° 20-17.133, FS-P N° Lexbase : A48224NW.
[9] Cons. const., décision n° 2021-915/916 QPC N° Lexbase : A70884U3.
[10] CE 2°-7° ch. réunies, n° 448610, n° 448619 N° Lexbase : A12837RX.
[11] Cons. const., décision n° 2018-749 QPC du 30 novembre 2018 N° Lexbase : A4443YNU ; v. aussi CE, 20 décembre 2018, n° 418637 N° Lexbase : A8417YR8, Rec. CE, Tables, p. 87.
[12] T. confl., n° 3911 N° Lexbase : A2154KHA, AJDA, 2013, p. 1568, chron. X. Domino et A. Bretonneau, Dr. adm., 2013, comm. 86, note S. Gilbert, JCP éd. A, 2013, comm. 2301, note C.-A. Dubreuil, JCP éd. G, 2013, comm. 1057, note S. Biagini-Girard, RFDA, 2013, p. 1041, note P. Delvolvé, RJEP, 2014, comm. 19, note L. Lebon.
[13] T. confl., n° 3931 N° Lexbase : A2513KTA, Rec. p. 376, AJDA, 2014, p. 216, chron. A. Bretonneau et J. Lessi, Dr. adm., 2014, comm. 25, note S. Gilbert, JCP éd. A, 2014, comm. 1355, note J. Martin, RD imm., 2014, p. 261, note N. Foulquier, RFDA, 2014, p. 61, note P. Delvolvé
[14] Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-21.993, FS-P+B N° Lexbase : A8764XAT, AJDI, 2020, p. 227, note F. Cohet, JCP éd. G, 2020, doctr. 648, note H. Périnet-Marquet, RD rur., 2020, comm 2, note A. Latil, LPA, 11 mai 2020, p. 15, note J.-.F. Barbieri, RD imm., 2020, p. 80, note E. Ripoch.
[15] Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 19-11.864, F-P+B+I N° Lexbase : A37983DZ, JCP éd. A, 2020, comm. 2102 et comm. 2248, note M. Carius.
[16] CAA Marseille, 22 février, n° 19MA05604 N° Lexbase : A69097ZW.
[17] CE référé, 17 juin 2022, n° 463341 N° Lexbase : A194678L.
[18] CE 6° ch., n° 462681 N° Lexbase : A93178C3.
[19] V. également CE, référé, 17 juin 2022, préc.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483053
[Brèves] Pacte Dutreil : les apports de la loi de finances rectificative pour 2022
Réf. : Loi n° 2022-1157, du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022, art. 8 N° Lexbase : L7052MDK
Lecture: 3 min
N3083BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 28 Octobre 2022
► Nouvelle impulsion du législateur en matière de pacte Dutreil.
Après la controversée position de la Cour de cassation (Cass. com., 24 novembre 2021, n° 19-25.513, F-D N° Lexbase : A50357DT), le législateur n’avait semble-t-il pas le choix. Il fallait riposter !
Rappel de la position de la Cour de cassation. Le fait pour une holding animatrice de cesser, postérieurement à la transmission de ses titres, d’exercer de manière prépondérante son activité éligible n’entraîne pas la remise en cause du régime de faveur Dutreil.
|
En pratique :
|
| Lire en ce sens, J. Mazeres, À quelle date apprécier le rôle d’animateur de groupe d’une société holding pour l’application du pacte Dutreil ? La Cour de cassation vient-elle d’ouvrir la boîte de Pandore ?, Lexbase Fiscal, octobre 2022, n° 922 N° Lexbase : N1901BZG. |
Ce que prévoit le texte de la loi de finances rectificative :
Article 8
I.-Après le c de l'article 787 B du Code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis. La condition d'exercice par la société d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission ».
II.-Le I s'applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu'à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L'un des engagements mentionnés au c bis de l'article 787 B du Code général des impôts est en cours ;
2° La société mentionnée au premier alinéa du même article 787 B n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
En pratique. Il existe désormais une obligation d’exercer l’activité jusqu’au terme des engagements.
À noter. Cette nouvelle disposition bénéficie d’une double rétroactivité :
- l’exigence de la poursuite d’une activité éligible jusqu’au terme de l’engagement individuel s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ;
- s’applique également aux transmissions pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- la société n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
- l’un des engagements de conservation est en cours.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483083
[Focus] L’actif diversifié de la société interposée : un arbitrage nécessaire à réaliser
Lecture: 8 min
N3067BZM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sarah Maubert Mendez, Avocate au Barreau de Aix-en-Provence
Le 27 Octobre 2022
Mots-clés : pacte Dutreil • transmission • patrimoine • sociétés • holdings
La mise en place du Pacte Dutreil et les nombreux écrits qui le commentent utilisent bien souvent des schémas de cibles opérationnelles pleinement éligibles ou encore des holdings animatrices dont l’actif se constitue uniquement de participations dans la société opérationnelle.
Pour autant, il peut arriver que la société dont les titres seront transmis, interposée ou non, dispose d’un actif plus étoffé.
Dans un tel cas de figure, comment articuler le Pacte Dutreil et ses bénéfices avec d’autres impositions qui viseraient à « apurer » cette société ?
Nous vous proposons ici de revenir sur un tel schéma de transmission et de chiffrer les différentes conséquences fiscales afin d’aider le chef d’entreprise à faire son choix.
I. Présentation du schéma
En l’espèce, deux associés se retrouvent, dans un schéma post-LBO, à la tête de leurs holdings patrimoniales, détenant elles-mêmes des participations dans la holding animatrice créée lors de la restructuration [1].

L’associé historique A souhaite transmettre les 70 % de sa holding patrimoniale à ses enfants, qui détiennent d’ores et déjà 30 % de la structure depuis la constitution. Pour les besoins de l’exemple, il est indiqué que la valeur de la Newco est de 30 millions d’euros. Il est également précisé que la holding patrimoniale de Monsieur A est présidente de la Newco.
La valeur de transmission de l’associé A est donc du montant suivant :
30 M * 37,5 % * 70 % = 7,875 M€
En l’état actuel du schéma, une telle transmission serait soumise au taux de 45 % en application de l’article 777 du CGI N° Lexbase : L4680I7H [2].
Afin de faciliter la transmission et de diminuer les coûts, il est proposé à Mr. A de réaliser un Pacte Dutreil sur la holding animatrice. Pour ce faire, un engagement collectif de conservation sera pris par sa holding personnelle sur les titres de la Newco. La holding patrimoniale détenant 37,5 % du capital de la Newco, elle peut prendre seule un engagement unilatéral de conservation sur les titres.
Dans les schémas où des sociétés sont interposées entre la structure transmise et la cible opérationnelle, il faut prendre en considération la constitution de l’actif des sociétés interposées.
En l’espèce, l’opération de LBO a permis à chacune des holdings patrimoniales de réaliser un cash out de 10 millions d’euros. Ces liquidités sont donc inscrites à l’actif de chacune des holdings, aux côtés de leurs participations respectives dans la Newco, d’une valeur de 11,25 millions d’euros (30 M * 37,5 %). Les actifs de chaque holding patrimoniale éligibles au bénéfice du Pacte Dutreil seront limités par la présence des liquidités à l’actif.
Le calcul précédent concernant le montant transmissible par Monsieur A est donc le suivant :
((30 M * 37,5 %) + 10 M) * 70 % = 14,875 M€
Pour obtenir le bénéfice du Pacte Dutreil sur la totalité des participations dans la holding patrimoniale, Monsieur A doit procéder à une distribution des liquidités en amont des donations. Il subira alors un impôt de distribution de 30 % sur ces opérations, majoré de la contribution sur les hauts revenus (CEHR) de 4 %.
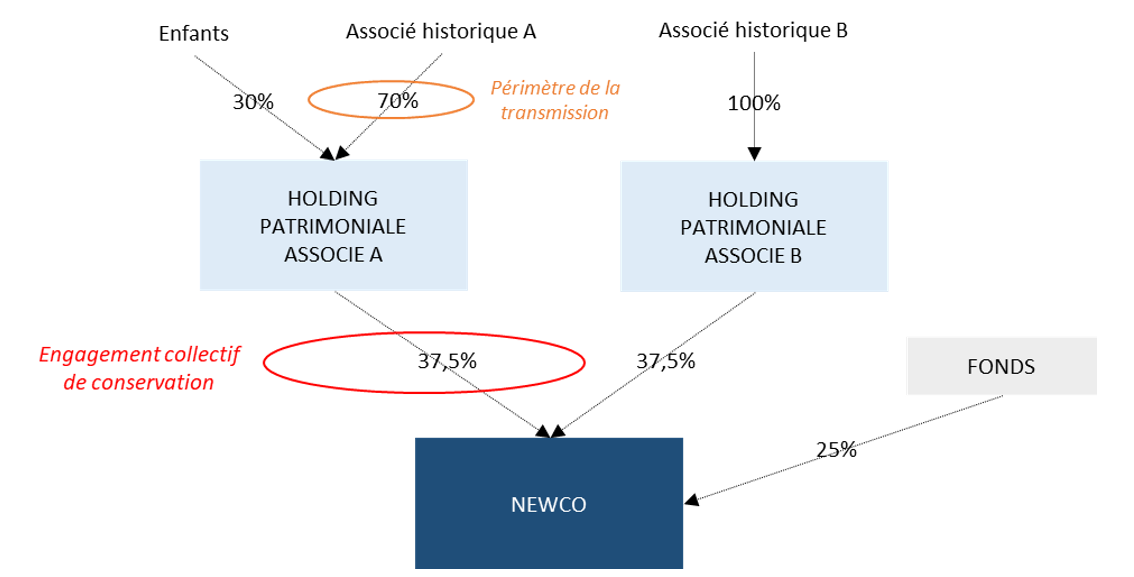
II. Mise en œuvre de chacune des options
Deux possibilités ici :
- Transmettre la holding avec les liquidités, ce qui limite le bénéfice du Dutreil à la fraction de l’actif représentant les participations éligibles,
- Apurer la holding en distribuant les liquidités en amont des donations, ce qui entraîne un impôt de distribution de 30 % + 4 %. En contrepartie, la totalité des participations transmises pourra alors bénéficier du régime du Pacte Dutreil.
Bien entendu, dans cette seconde solution, un apurement partiel des liquidités pourrait être envisagé. L’absence de distribution des liquidités permet aussi de transmettre aux donataires des liquidités sans être imposé à un taux important en fonction du montant transmis.
A. La transmission de la holding sans distribution des liquidités
Dans ce premier cas de figure, la holding patrimoniale est transmise par Monsieur A, à hauteur de 70 % et sans apurement de sa holding. Dans cette configuration, l’actif de la holding transmise est constitué de 10 millions d’euros de liquidités et de 7,875 millions d’euros de participations soit une proportion éligible au Pacte Dutreil de 44 %.
En premier lieu, il est précisé ici que Monsieur A a trois enfants et qu’il n’a procédé à aucune donation antérieure à leur encontre.
| Le conseil du praticien : Il est fondamental de poser la question des donations antérieures avant de réaliser tout chiffrage à l’attention du client. En effet, le rapport fiscal des donations entraîne des conséquences parfois considérables et notamment si les donations antérieures ont permis d’atteindre les tranches les plus élevées du barème des droits de donation. |
Monsieur A souhaite transmettre les 70 % qu’il détient dans sa holding patrimoniale en nue-propriété à ses trois enfants. Il est âgé de 55 ans au moment de l’opération, soit une valeur de la nue-propriété de 50 %.
La proportion disponible pour la donation représente 14,875 millions d’euros. Or, seul le pourcentage de 44 % de ce montant peut bénéficier du Pacte Dutreil, l’actif restant étant constitué de participations inéligibles.
La ventilation, par enfant, pour déterminer le montant des droits de donation, sera la suivante :
Participations de la Newco transmises et éligibles = 7,875 M€ * 0,7 * 1/3 = 1,8375 M€
Liquidités = 10 M€ * 0,7 * 1/3 = 2,3 M€
La partie correspondant aux participations dans la Newco peut être réduite de 75 % en application du Pacte Dutreil, soit un montant à inclure dans l’assiette de 459k€.
L’assiette globale à soumettre aux droits de donation est donc de 2,3 + 459k€ soit un total de 2,759k€. En appliquant le barème de l’article 669 du CGI N° Lexbase : L7730HLU, puis le barème de l’article 777 du CGI, les droits de donation par enfant seraient de l’ordre de 365k€.
Par ailleurs, les liquidités conservées dans la holding pourraient être distribuées :
- Aux nus-propriétaires s’il s’agit de dividendes prélevés sur les réserves [3],
- À l’usufruitier, s’il s’agit de sommes relevant des bénéfices [4].
Une telle distribution subirait un impôt de distribution pouvant aller jusqu’à 34 % [5]. Toutefois, il faut ici signaler que 30 % des distributions iraient de toute façon aux enfants d’ores et déjà pleins propriétaires d’une partie des participations.
La distribution coûterait alors à chaque enfant le montant d’impôt supplémentaire suivant :
10 M€ * 70 % /3 = 2,3 M€ * 34 % = 782k€.
Soit un total subi de 365 + 782k = 1,147 million d’euros.
B. La transmission de la holding après distribution des liquidités
La holding dispose de 10 millions d’euros de liquidités. L’apurement de ces 10 millions d’euros coûterait environ 34 %. Le coût, pour apurer les participations de Monsieur A avant transmission, serait le suivant :
10 M€ * 70 % = 7 M€ * 34 % = 2,38 millions d’euros
Pour arriver au même résultat que dans le premier schéma (la transmission de ces liquidités à ses enfants également), un impôt supplémentaire devrait être appliqué. Chaque enfant pourrait recevoir 1,54 million d’euros supplémentaires, taxés à 40 %, soit un impôt supplémentaire de 468k€.
L’actif de la holding patrimoniale ne serait alors plus constitué que des 7,875 millions d’euros de participations, totalement éligibles au bénéfice du Pacte Dutreil.
La transmission pour chaque enfant par Monsieur A de ses 70 % en nue-propriété coûterait alors le montant suivant :
7,875 M€ / 3 = 2,625 M€ * 25 % = 656k€
En appliquant le barème de l’article 669 du CGI, puis le barème de l’article 777 du CGI, les droits de donation par enfant seraient de l’ordre de 43k€.
Soit un total subi de 468k€ + 43k€ = 511k€.
Attention, il faut ajouter à ce dernier montant les 2,38 millions supportés par Monsieur A lors de la transmission (soit 793k€ par enfant), soit une imposition totale de 1,304 million d’euros.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le choix de l’une ou de l’autre des solutions repose surtout sur les objectifs recherchés par le chef d’entreprise. S’il souhaite conserver une partie des liquidités pour lui, le montant d’impôt dans la situation B) sera diminué d’autant puisqu’il ne transmettra pas toutes les liquidités à ses enfants. Également, il peut être tenté, dans la situation B) de n’apurer la holding que partiellement, ce qui aura également des conséquences sur le coût total. Enfin, nous sommes ici partis du principe que la transmission était réalisée en nue-propriété, mais il pourrait tout à fait être envisagé de réaliser la transmission en pleine propriété, pour profiter partiellement ou totalement de l’article 790 du Code général des impôts N° Lexbase : L8960IQW.
Il faut ici surtout souligner l’importance de l’adaptation du conseil aux objectifs du client. La recherche de l’optimisation des coûts à tout prix peut parfois être inadaptée face aux diversités de situations qui peuvent être rencontrées par le contribuable et son conseil. Il faut donc toujours échanger en profondeur avec le client pour s’assurer qu’il a toutes les clefs en main pour faire un choix éclairé.
[1] Pour les besoins de l’exemple, on considère que l’opération de LBO est intervenue depuis suffisamment de temps pour que la holding soit réellement animatrice.
[2] Il est ici considéré que Mr. A est père de trois enfants, soit une assiette de 2,625 millions d’euros par enfants.
[3] Sauf à ce que l’usufruitier les récupère en mettant en place un quasi-usufruit
[4] Ce qui est peu probable en l’espèce puisque les liquidités font suite à l’opération de LBO qui remonte à quelque temps
[5] Application de la flat tax ainsi que de la CEHR.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483067
[Brèves] Déréférencement des sites internet sur injonction de la DGCCRF : conformité à la Constitution
Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1016 QPC, du 21 octobre 2022 N° Lexbase : A21758QM
Lecture: 4 min
N3064BZI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 26 Octobre 2022
► Sont conformes à la Constitution les dispositions législatives permettant à l'administration d'enjoindre de déréférencer certaines adresses électroniques des interfaces dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite.
QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juillet 2022 par le Conseil d'État (CE, 9°-10° ch. réunies., 22 juillet 2022, n° 459960 N° Lexbase : A57948CL) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du a, du 2 °, de l'article L. 521-3-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L7394MD9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1508, du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC.
Aux termes de ces dispositions, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prendre des mesures pour faire cesser certaines pratiques commerciales frauduleuses commises à partir d'une interface en ligne. En particulier, elle peut, dans certains cas, enjoindre aux opérateurs de plateforme en ligne de procéder au déréférencement des adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère illicite.
Les critiques formulées contre ces dispositions. Il était reproché à ces dispositions par la société requérante et par la société intervenante de permettre à l'administration d'ordonner le déréférencement d'une interface en ligne, sans subordonner une telle mesure à l'autorisation d'un juge ni prévoir qu'elle doit être limitée dans le temps et porter sur les seuls contenus présentant un caractère manifestement illicite. Au regard des conséquences que cette mesure emporterait pour l'exploitant de l'interface et ses utilisateurs, il en résultait selon elles une méconnaissance de la liberté d'expression et de communication ainsi que de la liberté d'entreprendre.
Décision. Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative de limiter l'accès des utilisateurs à des sites internet ou à des applications en imposant la disparition de leurs adresses électroniques dans le classement ou le référencement mis en œuvre par les opérateurs de plateforme en ligne. Ce faisant, elles portent atteinte à la liberté d'expression et de communication.
Le Conseil constitutionnel juge que, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs et assurer la loyauté des transactions commerciales en ligne. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
En deuxième lieu, d'une part, la mesure de déréférencement ne s'applique qu'à des sites internet ou à des applications, exploités à des fins commerciales par un professionnel ou pour son compte, et permettant aux consommateurs d'accéder aux biens ou services qu'ils proposent, lorsqu'ont été constatées à partir de ces interfaces des pratiques caractérisant certaines infractions punies d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs. D'autre part, seules peuvent faire l'objet d'un déréférencement les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite.
En troisième lieu, les dispositions contestées ne peuvent être mises en œuvre que si l'auteur de la pratique frauduleuse constatée sur cette interface n'a pu être identifié ou s'il n'a pas déféré à une injonction de mise en conformité prise après une procédure contradictoire et qui peut être contestée devant le juge compétent.
En quatrième lieu, le délai fixé par l'autorité administrative pour procéder au déréférencement ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Ce délai permet aux personnes intéressées de contester utilement cette décision par la voie d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS et L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT du Code de justice administrative.
En dernier lieu, les dispositions contestées permettent, sous le contrôle du juge qui s'assure de sa proportionnalité, que la mesure de déréférencement s'applique à tout ou partie de l'interface en ligne.
Par l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication doit être écarté.
Puis, se prononçant sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel retient, par les mêmes motifs que ceux précédemment relevés et en relevant en outre que les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'empêcher les exploitants de ces interfaces d'exercer leurs activités commerciales, leurs adresses demeurant directement accessibles en ligne, que ce grief doit également être écarté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483064
[Brèves] Examen judiciaire des autres causes de licenciement pour déterminer le montant de l’indemnité versée au salarié : encore faut-il que l’employeur le demande !
Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.533, FS-B N° Lexbase : A02008QH
Lecture: 4 min
N3085BZB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
Le 02 Novembre 2022
► En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié.
Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale en premier lieu pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail. Avant le prononcé de la décision judiciaire, son contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur. De ce fait, la salariée conteste devant la juridiction prud’homale le bien-fondé de son licenciement.
La cour d’appel (CA Nancy, 25 mars 2021, n° 19/03401 N° Lexbase : A35904MW) déclare, tout d’abord, le licenciement de la salariée nul, en ce que l’employeur a reproché à celle-ci d’avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail. Elle considère que ce grief est constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale.
Les juges du fond condamnent, ensuite, l’employeur à verser à la salariée la somme de 38 110 euros, équivalent à seize mois de salaire, pour licenciement nul. La cour d’appel retient, à ce titre, que les barèmes dit « Macron », prévus à l’article L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM, ne sont pas applicables en cas de violation d’une liberté fondamentale. En outre, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs visés par la lettre de licenciement pour apprécier l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Enfin, l’arrêt ordonne à l’employeur de rembourser les allocations de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que :
- les juges du fond n’ont pas étudié les autres griefs visés par la lettre de licenciement pour évaluer l’indemnité allouée à la salariée ;
- l’action en résiliation judiciaire intentée par la salariée n’ouvrait pas droit au remboursement des indemnités de chômage par l’employeur.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant, selon l’article L. 1235-1 du Code du travail N° Lexbase : L8060LGM, que si l’employeur ne demande pas expressément aux juges d’examiner les autres griefs justifiant le licenciement du salarié, ces derniers n’ont pas à le faire d’office.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’un des griefs invoqués par l’employeur portait atteinte à la liberté fondamentale de la salariée d’agir en justice et a constaté que l’employeur ne critiquait pas, à titre subsidiaire, la somme réclamée par cette dernière en conséquence de la nullité du licenciement.
En pratique, lorsque l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement est nul. Néanmoins, l’employeur a la faculté de demander aux juges si les autres motifs sont fondés et d’en tenir compte pour la fixation de l’indemnité versée au salarié qui n’est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois, prévu à l’article L. 1235-3-1 du Code du travail N° Lexbase : L1441LKL.
Autrement dit, en cas de demande expresse de l’employeur, le juge doit apprécier les autres causes de licenciement pour déterminer le montant de l’indemnité versée au salarié.
Par ailleurs, la Haute juridiction précise que le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées ne peut être ordonné que dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 1235-4 du Code du travail N° Lexbase : L0274LM4, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La nullité du licenciement, Les conséquences pécuniaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86274QL. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483085
[Brèves] Habilitation familiale : transposition des actes interdits en matière de tutelle ?
Réf. : Cass. avis, 20 octobre 2022, n° 22-70.011, FS-B+R N° Lexbase : A79688Q8
Lecture: 2 min
N3122BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 28 Octobre 2022
► L'article 494-6 du Code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du Code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en qualité de juge des tutelles, était saisi, par une personne habilitée à représenter une majeure protégée pour tous les actes relatifs à sa personne et ses biens, d'une requête aux fins de renoncer, au nom de celle-ci, à la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son conjoint décédé.
Estimant que la question de droit était nouvelle, présentait une difficulté sérieuse et était susceptible de se poser dans de nombreux litiges, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a adressé une demande d’avis formulée ainsi : « Les actes interdits en matière de tutelle, prévus par l'article 509 du Code civil, sont-ils transposables en matière d'habilitation familiale générale par représentation, notamment à la lumière de l'article 494-6 du Code civil ? ».
La réponse est positive selon la Cour de cassation qui, après avoir rappelé les dispositions de l’article 494-6 du Code civil N° Lexbase : L7352LPY, relève que l'habilitation ne pouvant porter que sur les actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation, il en résulte qu'elle ne peut porter sur les actes que le tuteur ne peut accomplir, même avec une autorisation, lesquels sont énoncés à l'article 509 du Code civil N° Lexbase : L2246IBS.
Elle ajoute que la nécessité, pour la personne habilitée, d'obtenir l'autorisation du juge pour accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit ou, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de la personne protégée l'impose, un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec celle-ci ne lui confère pas le pouvoir d'agir en dehors des limites ainsi fixées.
En conséquence, selon la Cour de suprême, l'article 494-6 du Code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du Code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.
|
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483122
[Brèves] Création d'une gare au Triangle de Gonesse pour le Grand Paris Express : compétence du TA de Cergy-Pontoise car pas nécessaire aux JO 2024 !
Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 464620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68148P3
Lecture: 2 min
N3058BZB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 27 Octobre 2022
► Le litige relatif à la création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports en commun Grand Paris Express relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Principe. Si, par l'effet du 5° de l'article R. 311-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L8701MCA, la cour administrative d'appel de Paris est compétente en premier et dernier ressort pour connaître, par dérogation aux règles générales fixées par le Code de justice administrative quant à la compétence de premier ressort des juridictions administratives de droit commun, de l'ensemble des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction d'infrastructures, d'équipements et de voiries menées en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c'est à la condition que ces opérations puissent être regardées, au vu notamment du dossier de candidature de Paris pour ces Jeux, comme étant nécessaires, même pour partie, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement de cet événement.
Application. Il ne ressort ni du dossier de candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ni des éléments propres au projet de création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports en commun Grand Paris Express que cette opération serait nécessaire, même partiellement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Décision. Par suite, la demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gonesse modifiant le plan local d'urbanisme de la commune afin de prendre en compte la création sur la ligne 17 Nord d'une gare au Triangle de Gonesse ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel de Paris résultant du 5° de l'article R. 311-2 du Code de justice administrative, mais relève de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-7 du même Code N° Lexbase : L7155HZZ (idem pour la contestation d'un arrêté ministériel classant les communes dans différentes zones en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, CE, 4°-5° ch. réunies, 16 juin 2016, n° 387531, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3535RT4).
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d'appel, La compétence des cours administratives d'appel, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483058
[Brèves] Déferrement devant le procureur à l’issue de la garde à vue : n’encourt pas la nullité le procès-verbal de comparution retranscrivant les propos recueillis de la personne non assistée par l’avocat régulièrement avisé
Réf. : Cass. crim., 18 octobre 2022, n° 22-81.934, F-B N° Lexbase : A84618P3
Lecture: 6 min
N3038BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Helena Viana
Le 23 Novembre 2022
► Méconnaît les dispositions de l’article 393 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui se réfère à la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-125 QPC, du 6 mai 2011, pour énoncer que le procureur de la République ne peut, lors du déferrement d’une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1 du Code de procédure pénale, ni interroger la personne ni consigner ses déclarations hors la présence de son avocat sauf à méconnaître les droits de la défense. Le seul fait que l’avocat, régulièrement avisé, ne soit pas présent lorsque sont recueillis les déclarations de l’intéressé au cours dudit déferrement, n’entraîne pas la nullité du procès-verbal de comparution, mais a pour seule conséquence de rendre impossible la condamnation de la personne poursuivie sur le seul fondement de ces déclarations ainsi recueillies.
Faits et procédure. Le conducteur d’un véhicule a été déféré devant le procureur de la République en application de l’article 393 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5538LZ7 pour des faits de violences en récidive ainsi que de conduite sans permis. Il a ensuite été traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate. Devant la juridiction, il a soulevé in limine litis la nullité du procès-verbal de comparution devant le procureur de la République faisant état de ses déclarations, dans la mesure où ces propos avaient été tenus et recueillis hors la présence de son avocat.
En cause d’appel. La cour d’appel de Douai a prononcé l’annulation partielle du procès-verbal de comparution devant le procureur de la République, en cancellant deux lignes dudit procès-verbal contenant les déclarations litigieuses. Pour fonder la décision, la cour se réfère à la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 N° Lexbase : A7885HPQ, par laquelle le Conseil émet une réserve d’interprétation quant à l’article 393 du Code de procédure pénale dans sa rédaction avant la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014. Pour les juges du fond, le procureur de la République ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, « ni interroger la personne ni consigner ses déclarations hors la présence de son avocat ».
Moyens du pourvoi. Le procureur général, demandeur au pourvoi, fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de s’être référé à la décision susvisée du Conseil constitutionnel alors que celle-ci avait été rendue concernant la rédaction ancienne de l’article 393 du Code de procédure pénale. Il allègue que dans la rédaction actuelle issue de la loi du 27 mai 2014, le législateur a prévu une garantie suffisante des droits de la défense en prévoyant un droit à l’assistance d’un avocat et une notification du droit de garder le silence.
Décision. Au visa de l’article 393 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Elle en infère le principe selon lequel le procureur a la faculté de recueillir les observations ou procéder à l’interrogatoire de la personne qu’il envisage de poursuivre en application des articles 394 N° Lexbase : L1545MAH, 395 N° Lexbase : L3802AZT et 397-1-1 N° Lexbase : L7519LSB du Code de procédure pénale, dès lors qu’il a avisé l’intéressé de son droit de garder le silence et de son droit d'être assistée d'un avocat.
Ainsi, selon la Chambre criminelle, la cour d’appel, en retenant la nullité du procès-verbal litigieux a méconnu le texte et le principe susvisé.
Pour comprendre la solution de la Cour, il faut rappeler ce que déclarait le Conseil constitutionnel dans la décision visée et revenir à la lecture de l’article 393 du Code de procédure pénale à l’époque où le Conseil statue.
En effet, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 2 juin 2014, l’article 393 du Code de procédure pénale, énonçait seulement qu’« après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande , le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396 ». Ces dispositions ajoutaient que « le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. ». Aucune référence n’était faite quant à la possibilité pour le magistrat de pouvoir recueillir les observations de la personne ou procéder à son interrogatoire, comme cela est le cas depuis la loi du 27 mai 2014.
À partir de ce constat, le Conseil constitutionnel a alors émis une réserve d’interprétation à sa déclaration de constitutionnalité de l’article 393 du Code de procédure pénale. Il énonçait que « cette disposition, qui ne permet pas au procureur de la République d'interroger l'intéressé, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution » (cons. n° 13).
Or dans l’arrêt référencé, la Chambre criminelle, reproche justement aux juges du fond de s’être référé à la décision précitée du Conseil constitutionnel, et ce alors que les motifs et réserves énoncés se rapportaient à une version qui n’est plus en vigueur à l’heure où les juges statuent. En effet, depuis le législateur a ajouté à l’article litigieux que le procureur entend les observations de l’avocat « après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire ».
En outre, les hauts magistrats rappellent qu’aucune disposition n’interdit au procureur d’interroger la personne déférée devant lui et de retranscrire les éventuelles déclarations qu’elle souhaite faire.
L’apport de l’arrêt réside, semble-t-il, dans la sanction que confère la Chambre criminelle à l’absence de l’avocat lorsque de telles déclarations sont faites. Elle déclare que cette absence, dès lors que l’avocat a été régulièrement avisé, a pour seule conséquence de rendre impossible la condamnation de la personne poursuivie sur le seul fondement de ces déclarations ainsi recueillies. Pour ce faire, la Chambre criminelle invoque l’application de l’article préliminaire du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1305MAL.
| Pour aller plus loin : Étude : L'exercice de l'action publique, Les modes accélérés de comparution, Le déferrement préalable devant le procureur de la République, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E84293C8. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483038
[Jurisprudence] La presque impossible exonération du propriétaire d’un bâtiment en ruine
Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2022, n° 19-26.249, F-D N° Lexbase : A61148IB
Lecture: 12 min
N3075BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marc Dupré, Enseignant-chercheur, Doyen faculté DEG, UCO, CREDO, Chercheur associé Centre Jean Bodin UPRES EA n° 4337
Le 27 Octobre 2022
Mots clés : responsabilité • propriétaire • bâtiment • ruine • entretien • occupation sans droit ni titre • faute (non) • exonération (non)
La Cour de cassation énonce que l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier par une victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment en ruine lorsque l’accident résulte d’un défaut d’entretien de l’immeuble.
Par un arrêt rendu le 15 septembre 2022 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2022, n° 19-26.249, F-D N° Lexbase : A61148IB), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme la responsabilité du propriétaire d’un immeuble dès lors que la ruine est causée par un défaut d’entretien, même si la victime était au moment de l’accident un occupant sans droit ni titre.
Un couple propriétaire d’un bien immobilier dépendant d’une copropriété conclut un bail avec deux personnes en 1995. Le 4 avril 2011, une décision judiciaire constate que la dernière locataire sur place est déchue de tout titre d’occupation depuis le 20 mars 2010 et ordonne la libération des lieux dans les quatre mois suivant la notification de la décision. La notification lui est faite dans le courant de l’été 2012. L’ancienne locataire se maintient néanmoins dans les lieux et le 13 août 2012 chute de la fenêtre de sa cuisine à la suite de la rupture du garde-corps sur lequel elle avait pris appui.
Elle assigne en indemnisation les propriétaires en 2013, puis assigne en 2014 en intervention forcée la société gestionnaire de location du bien immobilier, le syndic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que des assureurs.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 septembre 2019 (CA Paris, 2-5, 10 septembre 2019, n° 18/01892 N° Lexbase : A8913ZM3), fait droit à la demande de la victime. Les propriétaires du bien forment un pourvoi, ainsi que le gestionnaire de location du bien immobilier.
Deux moyens sont examinés en détail par la deuxième chambre civile. Le quatrième est de nature procédurale et entraine la cassation partielle de l’arrêt. Le pourvoi contestait l’irrecevabilité de la demande de garantie présentée pour la première fois en cause d’appel par le gestionnaire de location. Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q, la Cour de cassation constate que la cour d’appel n’a pas invité les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité pour nouveauté de cette demande en cause d’appel qu’elle avait relevée d’office.
C’est essentiellement le deuxième moyen en ses deux premières branches qui nous intéressera ici. Les propriétaires contestent leur condamnation à indemniser la victime sur le fondement de l’article 1386 ancien du Code civil N° Lexbase : L1492ABU, devenu 1244 du Code civil N° Lexbase : L0946KZ3, in solidum avec la société de gestion locative. Ils considèrent que la victime a commis une faute en lien causal avec la réalisation des dommages en ne libérant pas les lieux. Cette faute doit exonérer en tout ou partie les propriétaires. Par ailleurs, le fait d’avoir toléré le maintien dans les lieux de la victime n’ôte pas à l’occupation sans droit ni titre son caractère illicite.
La deuxième chambre civile répond par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, synthétisé dans un attendu particulièrement strict :
« L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier par la victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu'il est établi que l'accident subi par cette dernière résulte du défaut d'entretien de l'immeuble ».
Si l’occupante de l’immeuble était sans droit ni titre, c’est bien la rupture du garde-corps de la fenêtre résultant d’un défaut d’entretien qui a été la cause du dommage. Dès lors, aucune faute ne pouvait être retenue contre la victime permettant d’exclure ou de réduire son droit à indemnisation.
La solution est intéressante à double titre : en ce qu’elle rappelle d’abord une réelle sévérité à l’égard des propriétaires (I) et en ce qu’elle s’inscrit dans un contexte plus général (II).
I. Une solution sévère pour les propriétaires
Le régime de l’article 1244 du Code civil présente quelques particularités (A), entraînant une exonération presque impossible du propriétaire lorsque les conditions sont réunies (B).
A. Les particularités du régime des bâtiments
Contrairement à l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7, le régime des bâtiments consacre la responsabilité du seul propriétaire en cas de dommage causé par la ruine de son bien. Premier régime de notre droit moderne ayant constitué une responsabilité de plein droit, le propriétaire ne peut également arguer de son absence de faute dans l’apparition de la ruine [1].
L’origine de la ruine est double : elle est consécutive à un vice de construction [2] ou à un défaut d’entretien. Si la preuve de la ruine, de son origine et de ses conséquences dommageables repose sur les épaules du demandeur, ce dernier n’a pas à démontrer que la ruine, liée ici à un défaut d’entretien, constitue une faute du propriétaire [3].
En l’espèce, ces points évoqués notamment dans le premier moyen du pourvoi ne semblaient pas soulever de difficultés particulières pour la Cour, laquelle n’a pas relevé d’éléments de nature à entraîner la cassation. La victime ayant chuté après avoir pris appui sur le garde-corps en très mauvais état de la fenêtre de sa cuisine, les éléments constitutifs de la responsabilité étaient bien réunis. La Cour refuse ainsi de se pencher sur le comportement humain consistant à s’appuyer sur le garde-corps et occasionnant la chute de ce dernier, élément qui aurait pu interroger la notion de ruine. Les éléments relatifs au montant de son indemnisation ne présentaient pas davantage de discussions.
En revanche, le sujet de l’exonération éventuelle des propriétaires pouvait se poser : d’un regard extérieur il peut sembler surprenant que la situation d’occupation sans droit ni titre du bien n’ait aucune conséquence juridique en l’espèce.
B. Une exonération presque impossible du propriétaire
L’arrêt confirme cependant de manière très claire l’impossible exonération des propriétaires. Cela n’est pas nouveau : une fois les éléments constitutifs de la responsabilité du propriétaire démontrés, il est difficilement envisageable que ce dernier puisse s’exonérer [4]. La preuve d’une cause étrangère en la matière est ainsi particulièrement complexe à rapporter [5].
C’était ici la faute de la victime, occupant sans droit ni titre les lieux, qui était mise en avant par les propriétaires. Ceux-ci souhaitaient au mieux obtenir une exonération totale de responsabilité, et au minimum que le droit à indemnisation de la victime soit réduit du fait de sa faute consistant à se maintenir sans droit ni titre dans les lieux.
La jurisprudence est cependant frileuse à accueillir la faute exonératoire de la victime. C’est ce qu’illustre un arrêt du 17 février 2005 de la deuxième chambre civile. Il s’agissait d’une affaire dans laquelle une personne participant à un déménagement et informée du mauvais état d’une balustrade avait tout de même pris appui sur celle-ci, provoquant son effondrement. La Cour avait pu relever : « la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la victime, ni à l'encontre de l'occupant des lieux de nature à exonérer même partiellement le propriétaire de sa responsabilité pour défaut d'entretien du bâtiment » [6].
Dans l’arrêt du 15 septembre 2022, le contrôle de la Cour de cassation semble un peu plus important. Elle constate que la cour d’appel a, « à juste titre », rejeté l’existence d’une faute de la victime. La formulation retenue dans la décision interpelle cependant. Elle semble retenir que l’existence même d’un accident qui résulterait du défaut d’entretien de l’immeuble empêcherait d’invoquer l’existence d’une faute consistant à occuper sans droit ni titre l’immeuble.
Deux éléments sont notables. Par extrapolation, il serait imaginable de considérer que seul un comportement fautif empêchant la réunion des conditions d’application du régime des bâtiments (comme le fait de secouer volontairement le garde-corps jusqu’à le faire tomber), et imposant de se tourner vers un autre régime de responsabilité, peut offrir une voie de secours au défendeur. Mais est-on encore bien dans une condition d’exonération du propriétaire ou dans l’examen des conditions de mise en œuvre du régime des bâtiments en ruine ? La question se pose sérieusement si l’on considère l’impossibilité pour le propriétaire d’invoquer l’existence d’un comportement manifestement fautif (le maintien dans les lieux sans droit ni titre), et surtout l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre ce comportement et le dommage. Or ce sont ces éléments qui pourraient permettre de caractériser une exonération ou a minima une réduction du droit à indemnisation de la victime. Ici les propriétaires sont empêchés d’évoquer une faute de la victime au nom de l’existence d’un défaut d’entretien du bien.
Par ailleurs, la formulation de l’attendu de principe, qui n’évoque à aucun moment la ruine du bâtiment consécutive au défaut d’entretien, interroge. Est-on encore dans l’application de l’article 1244 du Code civil et des conséquences dommageables d’une ruine ? Ou sommes-nous en présence d’une chose inerte, un garde-corps, dans un état anormal, qui relève davantage de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil ?
II. Une solution à replacer dans un contexte plus général
L’arrêt est intéressant à comparer à une décision rendue récemment par la même chambre de la Cour de cassation en application de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil (A). Il interroge plus largement sur le maintien de ce régime au sein de notre droit positif (B).
A. Le second épisode des accidents de garde-corps
Un arrêt du 7 avril 2022 [7] est particulièrement intéressant à mettre en parallèle avec celui qui nous occupe [8]. Dans cette affaire un jeune homme, alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants, s’était assis pour fumer au bord d’une fenêtre dépourvue de garde-corps. Il avait basculé et fait une chute mortelle. La deuxième chambre civile avait cassé la décision de la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 23 juin 2020, n° 19/01807 N° Lexbase : A20573PU) écartant la responsabilité du propriétaire-gardien de l’immeuble sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil. Elle avait alors précisé que la fenêtre était dépourvue de garde-corps susceptible d’empêcher la chute mortelle, pour en conclure que « l'imprudence de la victime n'était pas la cause exclusive du dommage ».
Sans préjuger d’une éventuelle diminution du droit à indemnisation des victimes devant la cour d’appel de renvoi, la solution rendue en avril dernier consacre également un attachement plus important aux conditions de mise en œuvre du régime qu’à la question de l’exonération du responsable. Il sera intéressant d’observer si le seul fait de réunir les conditions d’application du régime de responsabilité du fait des choses empêche ou non l’invocation d’une faute de la victime ayant participé à la production de son dommage [9]. Cela est peu probable et en tout cas peu souhaitable.
Car l’orientation prise par l’arrêt du 15 septembre 2022, déjà ambigu par son absence de mention de la ruine du bâtiment, est très sévère pour les propriétaires sans qu’il soit utile de l’étendre à d’autres régimes. Elle est par ailleurs difficilement explicable, voire acceptable pour de nombreux propriétaires : si le propriétaire est tenu de réaliser des travaux d’entretien touchant à des éléments comme les garde-corps, encore faut-il qu’il puisse avoir accès au bâtiment. La situation est déjà complexe en présence d’un locataire, elle devient en pratique très difficile en présence d’un occupant sans droit ni titre. Est-il acceptable d’envisager la responsabilité du propriétaire dans le cadre d’un squat de longue durée et sans qu’aucun bail préalable ait eu cours ? Plus encore, le maintien d’un régime qui ne s’applique qu’aux propriétaires, alors que l’occupant dispose des caractéristiques d’un gardien, interroge.
Dès lors, c’est la question même de la survie de l’article 1244 qui est posée.
B. L’abrogation souhaitable du régime des bâtiments
Le débat sur une abrogation du régime des bâtiments n’est pas nouveau. Déjà en 2002 la Cour de cassation proposait son abandon [10], soutenue par une partie importante de la doctrine [11]. Le projet de la Chancellerie de mars 2017 [12] comme la proposition sénatoriale de juillet 2020 [13] ont également fait le choix de ne pas reprendre ces dispositions.
Il faut appuyer cette probable évolution, bien que la réforme de la responsabilité civile ne semble pas immédiatement à l’ordre du jour au Parlement. Une solution transitoire pourrait passer par une action plus décisive de la Cour de cassation en ce domaine. Elle consisterait à offrir aux victimes une option entre les articles 1242, alinéa 1er, et 1244 du Code civil [14], une option entre une action contre le gardien ou le propriétaire, entre un régime assez simple à mettre en œuvre et un régime plus complexe. Mais, pour être totalement efficace, elle devrait envisager un alignement des conditions dans lesquelles l’exonération du défendeur, ou du moins la limitation du droit à indemnisation de la victime en cas de faute de sa part, pourrait être accueillie. Cela aurait pour effet bénéfique de rapporter l’essentiel du contentieux vers l’application de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, tout en offrant une incitation au législateur à se pencher sérieusement sur la réforme de certains régimes spéciaux de responsabilité au sein du Code civil.
[1] Cass. civ. 19 avril 1887, D., 1888, n° 1, p. 27 ; Cass. civ. 1, 28 juin 1972, n° 70-14.262, publié au bulletin N° Lexbase : A3403CKA.
[2] Cass. civ. 2, 14 décembre 1978, n° 77-12.245 N° Lexbase : A3818CTL.
[3] Cass. civ. 3, 4 juin 1973, n° 71-14.373, publié au bulletin N° Lexbase : A0396CGR ; Cass. civ. 1, 22 novembre 1983, n° 82-70288, publié au bulletin N° Lexbase : A6256CIK, Gaz. Pal. 1984. 2. Pan. 263, obs. F. Chabas.
[4] Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., LexisNexis, 2018, n° 412.
[5] V. dans le cadre d’une ruine consécutive à un vice de construction, Cass. civ. 1, 3 mars 1964, n° 60-13.025, bull. civ. 1, n° 125 ; refus pour une tempête, Cass. civ. 2, 14 décembre 1978, n° 77-12.245 N° Lexbase : A3818CTL ou Cass. civ. 3, 8 décembre 2004, n° 03-15.541, FS-P+B N° Lexbase : A3630DE8.
[6] Cass. civ. 2, 17 février 2005, n° 02-10.770, F-P+B N° Lexbase : A7325DGE.
[7] Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-19.746, F-B N° Lexbase : A38447S8.
[8] V. également au sujet des garde-corps, Cass. civ. 3, 22 juin 2022, n° 21-10.512, FS-B N° Lexbase : A165978X, sur le manquement du preneur à son obligation contractuelle de délivrance.
[9] En faveur d’un rapprochement entre la responsabilité du fait des choses et la responsabilité des bâtiments, visant à n’imputer qu’au seul propriétaire la responsabilité d’un bâtiment en ruine, V. Depadt-Sebag, Faut-il abroger l'article 1386 du code civil ?, D., septembre 2006, n° 31, p. 2113.
[10] Cour de cassation, La responsabilité - Rapport de la Cour de cassation 2002, La documentation française, 2003, p. 731, not. p. 12.
[11] Ph. le Tourneau, J. Julien, L’immeuble et la responsabilité civile, in Mélanges Roger Saint Alary, PU Toulouse I, 2006, p. 303 ; J. Julien Responsabilité du fait des bâtiments, Rép. civ. Dalloz, 2018, n° 71 ; v. cependant V. Depadt-Sebag, La justification de l’article 1386 du code civil, préf. J. Huet, LGDJ, Thèses, BDP, 2000, p. 352.
[12] Ministère de la Justice, Projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, not. art. 1243.
[13] Sénat, Proposition de loi n° 678 portant réforme de la responsabilité civile, 29 juillet 2020, not. art. 1242.
[14] D. Mazeaud, Requiem pour l'article 1386 du code civil : premières notes jurisprudentielles, D., décembre 2000, n° 44, p. 467.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483075
[Jurisprudence] Révocation du directeur général d’une SAS : les statuts, tous les statuts… rien que les statuts ?
Réf. : Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382, F-B N° Lexbase : A55138NI
Lecture: 10 min
N3069BZP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Thierry Favario, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3
Le 27 Octobre 2022
Mots clés : directeur général ; société par actions simplifiée (SAS) ; révocation ; convention de direction ; statuts
Dans cet important arrêt, la Cour de cassation rappelle que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Elle précise que si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. Pareille précision intéressera les praticiens chargés notamment de rédiger les conventions de direction liant ces sociétés à leurs dirigeants.
Toute société forme un ordre juridique plus ou moins complexe. La société par actions simplifiée n’y fait pas exception. Les normes y sont variées, que régente un principe d’ordre. L’arrêt ci-dessus référencé, publié au Bulletin, explicite ledit principe, lequel permet d’articuler statuts et actes extra-statutaires.
Les faits de l’espèce sont simples. Par lettre du 13 mai 2011, M. X est nommé directeur général de la SAS Y, par décision de son associé unique, la société Z. Il est révoqué de ses fonctions le 17 décembre 2014. M. X conteste la décision de révocation. L’estimant sans juste motif, il réclame en justice la somme stipulée dans ladite lettre en pareil cas. La cour d’appel [1] le déboute de sa demande en se fondant sur les statuts de la SAS Y prévoyant une révocation ad nutum du directeur général. L’ancien dirigeant forme un pourvoi en cassation contre sa décision. Si les faits sont simples, l’identification de la norme applicable l’est moins : les statuts de la SAS Y énoncent le principe d’une révocation ad nutum et sans indemnité du directeur général de la société ; la lettre de désignation du 13 mai 2011 précise à l’inverse qu’ « en cas de révocation de vos fonctions de directeur général de la société sans juste motif, vous bénéficierez d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de votre rémunération brute fixe ».
Quelle règle appliquer : ad nutum et sans indemnité ou sans juste motif avec indemnité ? Ad nutum et sans indemnité. La Cour de cassation rejette en effet le pourvoi. Sa réponse fera date par sa clarté et sa portée. De la lecture combinée des articles L. 227-1 N° Lexbase : L2397LR9 et L. 227-5 N° Lexbase : L6160AIY du Code de commerce, la Cour déduit en effet « que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général ». Elle précise que « Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger ». Un rappel salutaire : la prééminence des statuts (I) implique la subordination des « actes extra-statutaires » (II).
I. Prééminence des statuts
Les statuts présentent une nature hybride, faisant écho à la nature duale de la société : ils forment à la fois le contrat déterminant les relations entre associés et fixant leurs droits et obligations [2] et la « Constitution » organisant le fonctionnement institutionnel de la société. Seule cette seconde dimension nous intéresse ici.
A. Du bon usage de la liberté statutaire
L’irruption de la société par actions simplifiée dans le paysage juridique français a signé le retour d’une approche « contractuelle » de la société : l’idée est suffisamment connue pour ne pas y revenir. L’article L. 227-5 du Code de commerce symbolise cette contractualisation : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Une lecture rapide du texte incline à mettre l’accent sur la liberté conférée aux associés. Liberté dont ils usent avec prudence semble-t-il. La jurisprudence de la Cour de cassation révèle ainsi que les organes de direction sui generis, par opposition à ceux impérativement définis par la loi [3], empruntent nombre de leurs traits à des organes légaux connus [4] et, en matière de révocation, les statuts s’écartent rarement de l’option entre ad nutum [5] et « juste motif » [6].
Était précisément en cause, en l’espèce, la situation d’un directeur général, organe qui peut être statutairement institué [7] et dont les statuts sont susceptibles de fixer un ensemble de droits et d’obligations parmi lesquels notamment, nous précise l’arrêt, « les modalités de révocation ». De fait, l’article 12 des statuts de la SAS prévoyait, d’une part, que « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu’aucun motif soit nécessaire, par décision de la collectivité des associés ou de l’associé unique » et, d’autre part, que « la cessation, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, des fonctions de directeur général, ne donnera droit au directeur général révoqué à aucune indemnité de quelque nature que ce soit ». Ledit article illustre la liberté statutaire dont disposent les parties si on se souvient que le directeur général d’une société anonyme est, lui, révocable pour « juste motif » [8]. Il est également en rupture avec la règle classique selon laquelle un dirigeant social « exécutif » est révocable pour « juste motif » tandis que celui « non exécutif » l’est en principe ad nutum. Mais la liberté statutaire prime en matière de société par actions simplifiée [9].
B. Du nécessaire rappel de la prééminence des statuts
Peut-être consciente de son audace, la SAS a souhaité adoucir le sort du directeur général par ce fameux courrier du 13 mai 2011 indiquant qu’en cas de révocation de ses fonctions de directeur général de la société sans juste motif, M. X bénéficierait d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de sa rémunération brute fixe.
Une lecture plus attentive de l’article L. 227-5 du Code de commerce s’impose ici : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Rédigé à l’indicatif, le texte est impératif. Les statuts, et uniquement eux, fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, à l’exclusion de tout autre « acte extra-statutaire ». Invoquer la lettre du courrier du 13 mai 2011 pour arguer que son contenu prime sur les statuts est donc erroné : un « acte extra-statutaire » ne peut pas écarter la règle statutaire et transformer une révocation ad nutum en révocation pour juste motif. Il est vrai que la lettre émanait de l’associé unique de la SAS si bien qu’il aurait été permis de tirer un argument – fragile – selon lequel elle modifiait les statuts. Fragile par son ignorance de la procédure particulière de modification des statuts et des formalités subséquentes.
L’argument conduirait par ailleurs à faire varier les statuts de la SAS au gré des desiderata des parties, la société d’une part, son dirigeant d’autre part. Une instabilité bien éloignée d’une analyse des statuts comme « Constitution » de la société. Ce n’est du reste pas la première fois que la Cour de cassation confère aux statuts de la société par actions simplifiée force et prééminence s’agissant de l’organisation de sa direction. Un précédent important était déjà à noter [10]. L’arrêt sous commentaire s’inscrit dans son sillage… tout en le dépassant.
II. Subordination des « actes extra-statutaires »
C’est naturellement la seconde partie de la solution qui retient l’attention : « si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger ». Ces deux propositions sont à examiner.
A. Ne pas déroger aux statuts
La terminologie employée donnerait une clé de compréhension de la solution. L’arrêt évoque un « acte extra-statutaire », notion qui se distinguerait du « pacte extra-statutaire » : le premier émanerait de la société via ses organes et préciserait le fonctionnement interne de la société, comme, par exemple, un règlement intérieur [11] ou la lettre litigieuse qualifiée de tel en l’espèce ; le second lierait, soit deux ou plusieurs associés de la société, soit la société elle-même et un ou plusieurs associés, et aménagerait des droits et obligations qui leur sont particuliers. En d’autres termes, l’ « acte extra-statutaire » faisant écho à la dimension institutionnelle de la société, serait naturellement subordonné aux statuts, tandis que le « pacte extra-statutaire », reflet de sa dimension contractuelle, pourrait, dans la limite de l’ordre public, aménager les droits et obligations des associés [12]. La lettre du 13 mai 2011, analysée en un « acte extra-statutaire », ne peut donc déroger aux statuts.
Les praticiens doivent connaître cette solution pour mesurer la portée des actes qu’ils concluent : les termes d’un tel document entrant en contradiction avec les statuts sont inefficaces et c’est donc à l’aune de ceux-ci que s’apprécie la pertinence de ceux-là. On peut dès lors se demander si en l’espèce, la SAS n’a pas induit en erreur M. X sur la réalité de son statut, point non discuté devant la Haute juridiction. La présente solution intéresse également les magistrats en ce qu’elle clarifie leur tâche. Une fois l’acte qualifié, son régime juridique s’impose et le principe posé in casu est celui de la hiérarchie. L’arrière-plan institutionnel de la solution chasse toute considération tirée du droit des contrats : inutile d’invoquer la volonté des parties et la force obligatoire des contrats [13], laquelle s’efface devant celle des statuts, voire l’adage specialia generalibus derogant, inapplicable dès lors que les actes en concours ne sont pas de même nature.
B. Mais compléter les statuts
L’« acte extra-statutaire » peut compléter les statuts. À bien y réfléchir, son domaine d’application s’étendra à proportion du mutisme des statuts. Des « rubriques » dont on pourrait penser qu’elles s’incarnent naturellement dans une disposition statutaire pourraient être logées dans un tel acte, le cas échéant.
Le présent arrêt imposerait ainsi en creux aux praticiens d’identifier précisément ce qui relève du statut « primaire » du dirigeant de la société par actions simplifiée, à graver dans les statuts, et ce qui constitue son statut « complémentaire » personnel, défini au sein d’une convention de direction.
Or, en l’espèce, les statuts envisageaient précisément le régime global de la révocation du directeur général – sans délai, sans motif et sans indemnité –, ne laissant ainsi que peu d’espace pour un éventuel complément. La contradiction entre les statuts et l’acte du 13 mai 2011 était donc flagrante, leur objet coïncidant parfaitement. La solution eut été différente si les statuts avaient prévu le principe d’une indemnité, l’acte en précisant le montant ou les critères de détermination. Et si les statuts s’étaient limités à évoquer une révocation ad nutum, soit sans délai et sans motif, du dirigeant ? La lettre, à la condition de ne pas remettre en cause la nature de la révocation statutaire, aurait-elle pu stipuler le versement d’une indemnité ? On peut le penser, ladite lettre complétant les statuts sans y déroger.
***
En conclusion, contrairement à l’apparence d’une solution formulée avec fermeté, pareille précision jurisprudentielle introduit une souplesse de nature à rassurer la pratique sur la validité et l’efficacité des conventions conclues en matière de direction de société. D’abord les statuts ; ensuite les « actes extra-statutaires » qui précisent ceux-ci ou se logent dans les interstices laissés libres. En somme, les statuts oui…mais pas que les statuts.
[1] CA Paris, 5-9, 18 février 2021, n° 20/00654 N° Lexbase : A69504HU.
[2] Par ex. : C. civ., art. 1833, al. 1er N° Lexbase : L8681LQL : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».
[3] C. com., art. L. 227-6 N° Lexbase : L6161AIZ. Il s’agit du président de la SAS et, le cas échéant du directeur général ou directeur général délégué.
[4] Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-20.158, F-D N° Lexbase : A9088MZM : « comité de surveillance ».
[5] Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-11.650, F-D N° Lexbase : A0960MKR.
[6] Cass. com., 14 novembre 2018, n° 17-11.103, F-D N° Lexbase : A8009YL9, rectifié par Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-11.103, F-D N° Lexbase : A7161Y7D.
[7] C. com., art. L. 227-6, al. 3.
[8] C. com., art. L. 225-55 N° Lexbase : L5926AIC.
[9] Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, F-B N° Lexbase : A94347P4 : « […] les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités […] ». Sur cet arrêt, B. Saintourens, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 710 N° Lexbase : N0830BZR.
[10] Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28.792, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8400S9Y.
[11] Analyse qui expliquerait la subordination déjà reconnue du règlement intérieur aux statuts : Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-13.795, F-P+B N° Lexbase : A3462G4Y.
[12] En accordant à un associé un droit de préférence en cas de cession de titres sociaux, un droit d’information privilégié…
[13] C. civ., art. 1103 N° Lexbase : L0822KZH.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483069
