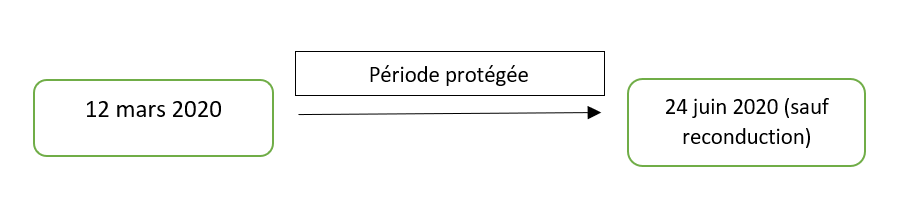[Brèves] Règlement de copropriété : licéité d’une clause prohibant la pose d'enseignes en façade d'un immeuble situé dans le périmètre de protection d’un monument historique
Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-22.441, FS-P+B+I (N° Lexbase : A56913KY)
Lecture: 2 min
N2958BY9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 22 Mai 2020
► Ne peut être considérée comme illicite au motif qu'elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux, la clause du règlement de copropriété, prohibant la pose d'enseignes en façade de l'immeuble, dès lors qu’elle correspond à la destination de l'immeuble situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune d‘Avignon.
Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 26 mars 2020 (Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-22.441, FS-P+B+I N° Lexbase : A56913KY).
Dans cette affaire, les propriétaires de lots à usage commercial loués à une société, situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avaient formé tierce-opposition à un arrêt du 5 juin 2012, condamnant, à la demande du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, le locataire commercial à procéder à la dépose des panneaux publicitaires et enseignes apposés sur la façade.
Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 5 juillet 2018, n° 17/00240 N° Lexbase : A4576XWE) de dire que l'article 9 g) du règlement de copropriété n'était pas une clause illicite en l'état de la destination de l'immeuble et qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 5 juin 2012. En effet, les requérants soutenaient que, lorsque le règlement de copropriété stipule que les boutiques situées au rez-de-chaussée de l'immeuble pourront être utilisées à des fins commerciales, pour n'importe quel commerce ou industrie, la clause selon laquelle "il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque" est contraire à la destination de l'immeuble et doit être réputée non écrite.
Mais la Cour de cassation valide l’analyse des juges d’appel qui, ayant retenu que la clause figurant à l'article 9 g) du règlement de copropriété, selon laquelle « il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque », correspondait à la destination de l'immeuble qui était situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune d‘Avignon, ont pu, par ces seuls motifs, en déduire que celle-ci ne pouvait être considérée comme illicite au motif qu'elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux et qu'il n'y avait pas lieu de rétracter l'arrêt rendu le 5 juin 2012.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472958
[Brèves] Publication d’une ordonnance visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
Réf. : Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 (N° Lexbase : L6258LWP)
Lecture: 3 min
N2889BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 08 Avril 2020
► Prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6258LWP), a été publiée au Journal officiel du 2 avril 2020.
L'article 1er confie de plein droit aux exécutifs locaux, sans qu'une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération, afin de faciliter la prise des décisions dans les matières permettant d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements.
L'article 2 étend le dispositif de l'article 10 de la loi n° 2020-290, en fixant pendant la durée de l'état d'urgence au tiers, au lieu de la moitié, le quorum de membres nécessaires pour une réunion non seulement de l'organe délibérant des collectivités et des groupements, mais également des commissions permanentes des collectivités et des bureaux des EPCI à fiscalité propre.
L'article 3 facilite la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres. Il abaisse la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l'organe délibérant des collectivités et des groupements.
L'article 4 allège les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales.
L'article 5 traite différentes questions relatives aux EPCI à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires.
L'article 6 autorise la réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements.
L'article 7 assouplit transitoirement les modalités de transmission des actes au contrôle de légalité, sans remettre en question les voies de transmission habituelles (par papier et par le biais du système d'information @ctes auquel une majorité de collectivités et groupements sont déjà raccordés).
L'article 8 permet de réduire le délai de convocation en urgence des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Il rend par ailleurs applicables à ces conseils les dispositions de l'article 6 s'agissant de l'organisation de réunions par téléconférence.
L’article 9 accorde un temps supplémentaire aux EPCI à fiscalité propre dans leurs délibérations en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines.
L'article 10 apporte des compléments nécessaires à la bonne application de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5718LWP).
L'article 11 précise les dates d'entrée en vigueur et de fin des dispositions de la présente ordonnance.
Enfin, l'article 12 fixe la liste des dispositions de l'ordonnance applicables au bloc communal en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472889
[Focus] Régime dérogatoire d'exécution des contrats dans le cadre de la crise sanitaire : exécuter ou ne pas exécuter ?
Lecture: 49 min
N2983BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Dimitri Houtcieff, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Saclay, Vice-Doyen de la Faculté d'Evry Val d'Essonne, Directeur du Master 2 "Contrats d'affaires et du crédit"
Le 09 Avril 2020
Défaillances contractuelles et difficultés des entreprises. Le Covid-19 tétanise l’économie française comme celle du monde. L’état d’urgence sanitaire retentit sur de nombreux contrats en cours [1]. Les restrictions à la liberté de circulation, la fermeture des centres commerciaux, des restaurants, des débits de boissons et -plus généralement- de tous les « lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation » [2] a entravé l’exécution de nombre de conventions. Non seulement les entreprises directement visées sont privées de l’essentiel de leurs revenus, mais leurs difficultés retentissent sur leurs partenaires commerciaux et autres contractants. Ces défaillances contractuelles en chaînes risquant d’emporter beaucoup d’entreprises avec elles, les cessations des paiements sont, dès lors, figées pour un temps. L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 [3] décide, en effet, que « l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 », jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire [4]. Le redressement ou la liquidation attendront : le débiteur échappe à l’obligation de déposer son bilan dans les quarante-cinq jours de la date réelle de la cessation des paiements. Cependant, ce traitement des difficultés des entreprises semble s’attacher davantage à masquer les symptômes qu’à endiguer le mal : aucun texte ne dispense le débiteur contractuel de ses obligations en raison de la crise.
Force obligatoire des échéances. Le droit des contrats semble immunisé contre le Covid-19 : la prolifération des textes adoptés en vue de faire face à l’épidémie l’a quasiment épargné [5]. Pour preuve, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures [6] ne le touche qu’à la marge. En premier lieu, si l’article 1er de ce texte précise que ses dispositions sont applicables « aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire », cette « période juridiquement protégée » [7] ne profite guère, en principe, aux obligations contractuelles.
En second lieu, l’article 2 de l’ordonnance -qu’il est ici nécessaire de reproduire- précise, en effet, que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». Il ajoute qu’« Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit ».
Seuls les délais et les mesures « prescrits par la loi ou le règlement » sont ainsi concernés : une interprétation a contrario mais incontestable de l’article 2 de l’ordonnance conduit à exclure les obligations contractuelles. Quoique le Président ait un moment laissé entendre que [8], par principe, les échéances conventionnelles ont toujours « force de loi à l’égard de ceux qui les ont faites ».
Suspension du cours de certaines clauses sanctionnant l’inexécution. Si elle laisse, ainsi, intactes les obligations contractuelles, l’ordonnance neutralise, cependant, certaines clauses sanctionnant le retard ou l’inexécution de la prestation dans les délais : ainsi que l'on le verra, les clauses pénales, les clauses résolutoires ou bien encore les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées « ne pas avoir pris cours » dès lors que le délai a expiré pendant la période protégée. L’ordonnance n° 2020-306 accouche, ainsi, d’un curieux système, où seules certaines clauses comminatoires ou sanctionnatrices sont paralysées un temps, cependant que les échéances et obligations contractuelles demeurent : c’est dire que le droit commun des contrats demeure l’instrument essentiel de traitement des difficultés entraînées par l’épidémie.
Exécuter ou ne pas exécuter ? Telle est toujours la question. Les difficultés d’exécution rencontrées par le contractant en raison de l’épidémie le placent au cœur d’une alternative triviale : exécuter ou pas. Le débiteur n’étant pas dispensé de s’exécuter par l’ordonnance, il n’échappera, en principe, à l’engagement de sa responsabilité en cas d’inexécution de ses obligations que si les conditions de la force majeure sont réunies. A moins qu’il ne préfère, notamment si la force majeure n’est pas caractérisée, recourir à la révision pour imprévision, afin de profiter d’un rééquilibrage de la convention à son profit. Somme toute, les circonstances liées au Covid-19 peuvent déboucher sur une inexécution (I) ou sur une modification du contrat (II).
I - Inexécution entraînée par le Covid-19
Exécuter plus tard ou ne pas exécuter du tout. L’inexécution n’est pas toujours définitive. Certains mécanismes permettant, alors, de limiter les conséquences d’une inexécution tardive (A). Si les difficultés demeurent, le débiteur n’aura, le plus souvent, d’autre espoir que de démontrer la force majeure (B).
A - Exécuter plus tard : la neutralisation sanctionnant l’inexécution d'une obligation dans un délai déterminé
Si l’ordonnance ne touche pas, en principe, à la force obligatoire des échéances purement contractuelles (1), elle suspend, cependant, le cours de certaines clauses (2).
1 - Le maintien de principe des échéances contractuelles
Force obligatoire des échéances purement contractuelles. Ainsi qu’on l’a dit, l’ordonnance n° 2020-306 ne suspend pas, en principe, les délais contractuels. Les parties au contrat demeurent tenues d’exécuter les obligations conventionnelles aux échéances prévues. Il peut, cependant, arriver que les contrats soient soumis en l’application de formalités devant être accomplies dans des délais légaux. La circulaire interprétant l’ordonnance n° 2020-306 évoque ainsi l’exemple de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7564LBR), qui impose en substance au créancier d’informer la caution de l’évolution de la dette principale avant le 31 mars de chaque année. Un tel délai a beau s’appliquer au contrat, il n’en demeure pas moins fixé par la loi : il tombe, dès lors, dans le champ d’application de l’article 2. Ainsi que le relève la même circulaire, donc, l’information considérée pourra être régulièrement délivrée dans les deux mois qui suivent la fin de la période juridiquement protégée, c’est-à-dire dans les trois mois de la cessation de l’état d’urgence. Encore le créancier n’est-il pas tenu de s’exécuter avec retard : il lui est loisible d’accomplir cette obligation dans les délais ordinaires.
Délai supplémentaire de résiliation. Une autre mesure applicable aux conventions en cours doit être signalée. L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 prévoit, en effet, que « lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période [juridiquement protégée], de deux mois après la fin de cette période ». Les difficultés matérielles causées par l’épidémie ne sauraient conduire à confiner les parties dans leurs contrats : la préservation de leur liberté contractuelle -qui, après tout, a valeur constitutionnelle [9]- imposait qu’elles puissent en sortir une fois passé l’état d’urgence.
2 - La neutralisation des clauses sanctionnant le retard d’exécution
Suspension des clauses sanctionnant l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé. Si les échéances contractuelles ne sont pas modifiées par l’ordonnance, l’article 4 de ce texte suspend, toutefois, le cours de certaines clauses sanctionnant le retard ou l’inexécution de celles-ci. Il dispose, tout d’abord, que « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er ». Les clauses considérées sont ainsi neutralisées le temps de la « période juridiquement protégée » et même davantage : l’alinéa suivant du même texte précise, ensuite, que « ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme ». Enfin, le troisième alinéa de l’article 4 précise que « le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er ». Un dispositif du même ordre est mis en place par l’ordonnance du même jour relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de Covid-19 [10].
Afin de préserver la force obligatoire des échéances contractuelles tout en neutralisant les sanctions conventionnellement attachées à l’inexécution, le mécanisme invite, ainsi, à distinguer selon que les clauses visées ont pris effet avant ou après le 12 mars 2020. Dans le cas où ils ont pris effet avant cette date, le cours de l’astreinte ou l’application de la clause pénale sont suspendus : ils reprendront le lendemain de l’expiration de la période juridiquement protégée. Dans le cas où la date de l’inexécution censée déclencher les astreintes et les clauses visées est postérieure au 12 mars, elles sont neutralisées : elles ne reprendront leur cours et ne produiront leurs effets qu’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, si le débiteur ne s’est pas exécuté d’ici là. Autant dire que ce mécanisme devrait inciter les créanciers d’obligations inexécutées à patienter le temps de la période juridiquement protégée en espérant une exécution spontanée par le débiteur. La neutralisation des clauses résolutoires et autres clauses pénales dissuadera, sans doute, les créanciers d’agir en justice pour obtenir paiement, pour peu que l’engorgement des tribunaux qui résultera de la crise n’y suffise pas : on peut voir là un moyen comme un autre d’inviter à la résolution amiable des conflits.
Difficulté d’interprétation. L’article 4 ne manquera sans doute pas de susciter quelques difficultés d’interprétation. Son champ d’application est d’abord incertain. Cette disposition ne vise, en effet, littéralement que les clauses ayant pour objet « de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé » : les clauses paralysées sanctionnent typiquement le non-paiement d’une redevance ou d’un loyer après l’échéance. Il se peut, cependant, que des obligations continues ou des devoirs indépendamment d’un quelconque délai soient également visés par des clauses pénales ou résolutoires : la question se posera, alors, de savoir si l’article 4 débouchera malgré tout sur une neutralisation de ces clauses en pareil cas. S’il est, par exemple, certain que le franchiseur ne peut invoquer la clause résolutoire durant la période juridiquement protégée pour sanctionner un défaut de paiement de redevance, la question se pose de savoir s’il peut se prévaloir de la même clause en cas de manquement du franchisé à la clause de non-concurrence, à l’obligation d’exploitation ou bien encore à la bonne foi contractuelle. S’il est vrai que cette interprétation littérale semble implicitement écartée par la circulaire -qui évoque généralement les clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l’inexécution du débiteur-, cette dernière n’a pas de raison de lier l’interprétation judiciaire sur ce point…
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 pose, du reste, plus généralement, la question de savoir si l’énumération à laquelle il procède est limitative. On est tenté de le penser. Le principe demeurant celui de la force obligatoire et, la neutralisation des clauses étant conçue comme une mesure exceptionnelle et temporaire, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 devrait s’interpréter restrictivement. Le mécanisme de l’astreinte ou celui de la déchéance sont, cependant, suffisamment flous pour être assez accueillants : la caducité que les parties auraient attachée au non-accomplissement de telle formalité doit-elle par exemple être assimilée à une clause de déchéance [11] ? Au reste, ainsi qu’on l’a dit, la circulaire semble plaider pour une conception relativement extensive des clauses visées… Quoi qu’il en soit, il n’est pas douteux que ce texte suscitera quelques querelles de qualification : il y a, par exemple, fort à parier que les créanciers d’obligations inexécutées seront tentés de prétendre que la clause sanctionnant telle inexécution contractuelle doit être qualifiée de clause indemnitaire ou de dédit.
Difficultés d’articulation. Au-delà même de ces difficultés d’interprétation, le débiteur en difficulté pour cause de coronavirus a sans doute peu à espérer, en réalité, de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306. La neutralisation des clauses considérées n’emporte pas la paralysie d’autres prérogatives dont le créancier insatisfait continue de disposer. L’article 1219 du Code civil (N° Lexbase : L0944KZY), qui codifie l’exception d’inexécution, lui permet, par exemple, de « refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Mieux encore, l’article 1220 du Code civil (N° Lexbase : L0943KZX) lui permet d’anticiper l’inexécution éventuelle : il dispose, en effet, qu’« une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ». Tout au plus le créancier devra-t-il notifier cette suspension dans les meilleurs délais, à charge pour l’autre partie de contester l’exception d’inexécution devant le juge… quand les circonstances le permettront ! Encore l’exception d’inexécution est-elle porteuse d’un peu d’espoir pour l’autre partie : elle est, en effet, nécessairement temporaire, ce qui n’est pas le cas de la résolution unilatérale.
L’article 1226 du Code civil (N° Lexbase : L0937KZQ), selon lequel « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ». Selon le même texte, dans son alinéa 3, « lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». A défaut de pouvoir faire valoir la clause résolutoire, le créancier pourrait, donc, résoudre le contrat unilatéralement.
Influence de la bonne foi sur l’exercice des prérogatives unilatérales ? Ces prérogatives unilatérales peuvent-elles être encadrées ? La résolution unilatérale pourrait-elle être adoucie ? Ce n’est pas impossible : la bonne foi pourrait ici se révéler salvatrice. La jurisprudence admet, après tout, que la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, pour peu qu’il ne porte pas atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties [12]. La déloyauté peut, ainsi, déboucher sur la paralysie d’une « prérogative contractuelle » [13], c’est-à-dire un pouvoir unilatéral lié à la qualité de contractant et permettant à l’une des parties de modifier la situation de l’autre [14]. La bonne foi pourrait, ainsi, être utilement sollicitée pour paralyser l’exercice déloyal des prérogatives unilatérales ainsi que des clauses contractuelles non visées par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306. Séduisante en théorie, cette piste achoppe cependant en pratique sur un obstacle de détail : elle impose à la victime de l’exercice déloyal de la prérogative de contester judiciairement la situation acquise par son cocontractant.
B - Ne pas exécuter du tout : la force majeure
Force majeure d’hier et d’aujourd’hui. En cas d’inexécution, le débiteur peut espérer échapper à sa responsabilité en démontrant la force majeure. Si la notion est ancienne, sa définition a été modifiée par l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats. L’ancien article 1148 du Code civil (N° Lexbase : L1249ABU) disposait qu’il « n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Insistant sur la libération du débiteur et sa libération de tous dommages-intérêts, le texte ne s’appesantissait guère sur les éléments constitutifs de la force majeure. Le nouvel article 1218 du Code civil (N° Lexbase : L0930KZH) est plus didactique et affirme qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Ces modifications ne sont théoriquement pas indifférentes : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats -le 1er octobre 2016- demeurent soumis au droit antérieur. Il n’est, cependant, pas certain que cette dualité de fondements découlant de la date de conclusion des conventions se traduise par des effets concrets. Certes, l’article 1218 du Code civil n’évoque pas expressément la condition traditionnelle d’extériorité de la force majeure, les rédacteurs de l’ordonnance ayant considéré qu’elle avait été abandonnée par la jurisprudence [15]. L’évocation d’un événement échappant au contrôle du débiteur n'est, néanmoins, pas si éloignée de l’extériorité et la position de la jurisprudence n’était pas si claire [16]. Ajoutons que les juridictions du fond semblent tentées d’assimiler purement et simplement les dispositions d’hier et d’aujourd’hui en évoquant l’article 1148 devenu 1218 du Code civil [17]. La question de savoir si la survenance de l’épidémie constitue un cas de force majeure impose, donc, aujourd’hui comme hier de vérifier si elle constitue un événement imprévisible, extérieur et irrésistible (1). Ce n’est que lorsque ces conditions seront réunies, qu’il conviendra, alors, d’étudier les effets de la force majeure sur les contrats (2).
1 - Conditions de la force majeure
Casuistique de la force majeure. La question de savoir si la survenance de l’épidémie de Covid-19 constitue un cas de force majeure exonérant le débiteur de sa responsabilité ne saurait déboucher sur une réponse systématique : s’il est vrai que les toutes premières décisions rendues à propos du Coronavirus ont admis cette qualification [18], tout dépend, cependant, des circonstances [19]. Les déclarations et autres décisions des pouvoirs publics n’ont, ainsi, que peu d’influence. L’affirmation du ministre de l’Economie selon laquelle « l’Etat considère le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises » ne lie pas les juges [20] ! Plus fondamentalement, l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas, par lui-même, un cas de force majeure : à l’instar de l’état de catastrophe naturelle, il ne dispense pas d’apprécier les circonstances [21]. Tout au plus, certaines décisions prises -telles que la fermeture des établissements accueillant du public non indispensables à la Nation ou encore les restrictions aux réunions- pourront-elles, ainsi, être prises en compte dans le cadre de la caractérisation de la force majeure, afin de démontrer que l’événement échappait au contrôle du débiteur.
Sur un autre plan, les dispositions de l’article 1218 du Code civil n’étant pas d’ordre public, rien n’interdit aux parties d’exclure toute influence de la force majeure ou d’en délimiter le domaine par une clause, ce qu’admet le Code civil : selon l’article 1351 (N° Lexbase : L0998KZY), « l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure ». Pour peu que ces clauses ne soient pas abusives rien n’exclut que ces stipulations produisent tous leurs effets : autant dire que les articles 1171 du Code civil (N° Lexbase : L1981LKL) [22] et L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B) [23], qui sanctionnent les clauses abusives, l’un en matière de contrat d’adhésion, l’autre en cas de contrat conclu entre un consommateur ou un non-professionnel et un professionnel, devraient être fréquemment sollicités en cette matière.
Evénement échappant au contrôle du débiteur. La condition de l’extériorité de l’épidémie est, en l’occurrence, la plus facile à vérifier : il est difficilement contestable que cette pandémie échappe à tout contrôle, y compris donc à celui du débiteur ! Cette condition sera d’autant plus facile à démontrer en cas de décision de l’administration ou de fait du prince [24] : à défaut de caractériser, à elles seules, la force majeure, les décisions de fermeture des « lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation », ou d’interdiction des rassemblements de 5 000 personnes [25] ou de 100 [26] attestent de l’impuissance du débiteur.
Evénement ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. La question de savoir si l’événement était imprévisible au moment de la conclusion du contrat dépendra également des circonstances. Certes, on peut affirmer, sans prendre trop de risque, que l’apparition d’un virus létale débouchant en quelques mois sur le confinement d’une moitié de l’humanité était raisonnablement imprévisible. Si le caractère imprévisible d’une épidémie a parfois été écarté par les juges, c’est souvent qu’elle était récurrente [27] : tel n’est pas le cas de l’épidémie de Covid-19, qui n’a pas de précédent contemporain. Il conviendra, cependant, en pratique, de prendre garde à la date de la conclusion du contrat, la force majeure ne pouvant être admise que pour autant que la survenance de l’épidémie ou de ses conséquences n’était pas prévisible à ce moment. Tout dépendra, donc, de l’appréciation plus ou moins sévère de la « prévisibilité » de la survenance en France d’une épidémie de grande ampleur. La jurisprudence a parfois été rigoureuse [28] : la cour d’appel de Saint-Denis a, par exemple, considéré que « l’épidémie de chikungunya a débuté en janvier 2006 [ne pouvait] être retenue comme un événement imprévisible justifiant la rupture du contrat en août suivant après une embauche du 04 juin » [29]. Une telle rigueur se comprend d’ailleurs. La force majeure est une exception à force obligatoire du contrat. Il n’en demeure pas moins que le caractère imprévisible de l’épidémie pourra être sujet à débats judiciaires pour peu que le contrat ait été conclu dans le courant du mois de février ou au début du mois de mars. Le contentieux risque, d’ailleurs, d’être d’autant plus nourri que nombre de contrats auront sans doute été conclus par tacite reconduction durant cette période. Les conventions reconduites constituent, en effet, des contrats nouveaux : une appréciation rigoureuse de la force majeure dans le cadre de cette convention pourrait, ainsi, conduire les juges à ne pas l’admettre, au motif que l’événement n’était pas imprévisible à la date de la conclusion de la convention tacitement reconduite…
Evénement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. L’article 1218 du Code civil impose encore que les effets de l’événement ne puissent être évités par des mesures appropriées. Il s’agit là de la condition classique d’irrésistibilité : le débiteur était-il en mesure d’éviter les conséquences de l’épidémie ? La réponse est incontestablement négative s’il est lui-même frappé par le virus : la jurisprudence admet, en effet, que la maladie peut constituer un cas de force majeure [30]. Il en va de même si des décisions administratives empêchent l’exécution du contrat, par exemple, en imposant la fermeture du commerce ou en interdisant le voyage vers telle ou telle destination. Néanmoins, cette condition pourra susciter quelques débats, dans l’hypothèse où la prestation aurait pu être accomplie autrement ou par équivalent : l’impossibilité de se réunir dans un lieu accueillant du public n’exclut pas nécessairement que la conférence organisée se tienne par l’intermédiaire de dispositifs vidéo ; les marchandises qui ne peuvent être livrées par un fournisseur peuvent peut-être être livrées par un autre [31].
Evénement empêchant l'exécution de son obligation par le débiteur. Cette condition prolonge la précédente et participe de l’irrésistibilité : elle s’en distingue d’ailleurs malaisément [32]. Elle exprime, néanmoins, l’impossibilité au cœur de la force majeure [33]. Si tout dépend, ici encore, des circonstances, il reste que l’exécution de certaines obligations est presque toujours considérée comme possible en raison de leur nature : la Cour de cassation a ainsi affirmé le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne pouvait s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure [34]. Dans le même ordre d’idées, la cour d’appel de Paris a estimé qu’une épidémie avérée, « même à la considérer comme un cas de force majeure, ne suffi[sait] pas établir ipso facto [une] baisse ou [une] absence de trésorerie » [35]. On ne saurait, en effet, admettre que le débiteur puisse se prévaloir de son insolvabilité pour échapper à l’exécution de son obligation : tant que la monnaie existe, la prestation demeure possible, même si le débiteur peine à l’exécuter [36]. La solution n’est, cependant, pas si absolue qu’il y paraît. La doctrine admet généralement que même les obligations monétaires laissent prise à la force majeure, pour peu que l’exécution tardive résulte d’une contrainte extérieure et que l’exécution tardive ne soit pas satisfactoire pour le créancier [37]. En pareil cas, la force majeure ne devrait cependant avoir qu’un effet suspensif -qu’autorise d’ailleurs expressément l’article 1218 alinéa 2 du Code civil- évitant au débiteur de supporter les conséquences de l’exécution tardive sans le libérer pour autant de son obligation.
2 - Effets de la force majeure
Dualités. L’article 1218 du Code civil admet que la force majeure puisse être définitive ou temporaire. Il dispose en effet dans son alinéa second que « Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». Il convient donc de distinguer ces deux hypothèses.
Empêchement temporaire : suspension du contrat. Les pires choses ayant aussi une fin, la force majeure peut n’être que temporaire. On peut, à cet égard, espérer que cette épidémie ne sera pas éternelle : les contrats dont l’exécution redeviendra possible devraient, dès lors, être simplement suspendus jusque-là, ainsi que l’affirme désormais l’article 1218 alinéa 2. La jurisprudence ancienne l’admettait d’ailleurs déjà et la solution vaut aussi pour les contrats non soumis à la réforme : la Cour de cassation affirme ainsi depuis longtemps qu’« en cas d’impossibilité momentanée d’exécution d’une obligation, le débiteur n’est pas libéré, cette exécution étant seulement suspendue jusqu’au moment où l’impossibilité vient à cesser » [38]. Les parties ne sont alors pas libérées : le contrat est suspendu un temps. L’hypothèse doit être distinguée du retard d’exécution non justifiée par la force majeure. Si l’ordonnance n° 2020-306 neutralise, comme on s’en souvient, certaines clauses liées à l’inexécution, elle ne dispense pas le débiteur de son obligation : au contraire, la force majeure temporaire libère le débiteur de toute obligation le temps qu’elle dure. Cette suspension peut bénéficier aux deux parties ou bien être unilatérale, selon l’économie du contrat. Elle a cependant ses limites. En premier lieu, certaines obligations ne sauraient être suspendues : la force majeure est impuissante à paralyser, serait-ce pour un moment, l’obligation de bonne foi ou ses avatars, telle l’obligation de non-concurrence. En second lieu, il se peut que l’empêchement temporaire prive d’utilité la convention : la livraison de denrée périssable n’a, par exemple, plus de sens, lorsqu’elle est remise à plus tard. Le contrat sera alors résolu de plein droit, comme si l’empêchement avait été définitif.
Empêchement définitif. Si l’empêchement est définitif, la force majeure entraîne en principe l’exonération totale du débiteur : le contrat est résolu de plein droit -c’est-à-dire, théoriquement, sans même qu’une décision judiciaire s’impose- et toute responsabilité contractuelle du débiteur est écartée, même si une rupture des relations commerciales en découle [39]. Les tiers ne peuvent pas davantage rechercher la responsabilité du contractant : si la Cour de cassation a récemment réaffirmé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » [40], encore faut-il qu’une faute contractuelle puisse être retenue à son encontre, ce qu’exclut justement la force majeure.
Les risques. Que le débiteur de l’obligation rendue impossible soit dispensé d’exécuter sa prestation est une chose. Faut-il cependant en déduire qu’il ne pourra non plus bénéficier de la prestation dont son cocontractant est tenu dans le cadre d’un contrat synallagmatique ? La réponse est facile si le contrat est translatif de propriété : les risques se transférant en même temps que la propriété, l’acheteur reste tenu du prix même si la chose a péri. L’épidémie de Coronavirus devrait cependant moins poser cette question que celle des conséquences de l’impossibilité d’exécuter une prestation.
Selon l’article 1351 du Code civil, « l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive ». Libéré de sa prestation par la force majeure [41], le débiteur ne peut réclamer la prestation réciproque prévue par le contrat synallagmatique [42] : tel est le sens de la vieille maxime « res perit debitori ». Non seulement le débiteur exonéré ne peut rien espérer, mais il doit restituer s’il a déjà reçu paiement [43]. Ces solutions traditionnelles ne manqueront pas d’avoir d’importantes répercussions. Songeons, ainsi, aux baux commerciaux, où l’obligation de délivrance du bailleur lui impose de veiller à la commercialité des locaux : si le propriétaire des murs a été dans l’incapacité d’assurer celle-ci -par exemple parce que le commerce exploité dans ses murs est un café soumis à l’interdiction des commerces non essentiels [44]- il pourra certes invoquer la force majeure pour échapper à toute responsabilité. Le preneur pourra, en revanche, légitimement refuser le paiement du loyer pour la période considérée. Si les ordonnances du 25 mars 2020 n’ont accordé aucun délai de grâce aux preneurs, ils pourraient donc bien tirer profit de l’impossibilité d’exécuter dans laquelle se trouvent nombre de bailleurs pour ne rien débourser du tout…
Question pratique. Pour conclure sur ce point, on relèvera une difficulté pratique suggérée par la nouvelle facture de l’article 1218 du Code civil. Cette disposition affirme, en effet, que si l’empêchement est définitif, « le contrat est résolu de plein droit » : elle revient ce faisant sur une jurisprudence séculaire subordonnant la fin du contrat à une décision judiciaire même en cas de force majeure [45]. Il résulte de ce texte que la force majeure produit mécaniquement ses effets. Deux remarques peuvent être faites sur ce point. En premier lieu, dès lors que la force majeure est démontrée, le juge perd tout pouvoir d’appréciation : il est tenu de faire application des règles des articles 1351 et 1351-1 du Code civil. En second lieu, à supposer que la jurisprudence admette, comme y invite cette disposition, que la résolution est indépendante de toute décision judiciaire, on ne saurait trop conseiller à la partie se prévalant de la force majeure de notifier cette décision au plus tôt à son cocontractant : il paraît, en effet, pour le moins légitime de l’informer de ce que le contrat a pris fin.
II - Modification du contrat entraînée par le Covid-19
La prévision de l’imprévisible. Les parties peuvent espérer préserver la convention autant que faire se peut. Les stipulations contenues par certains contrats leur permettront, sans doute, de faire face aux conséquences de l’épidémie. Les clauses dites de Hardship -qui prévoient une renégociation du contrat lorsque leurs conditions sont remplies- ou bien encore les MAC (material adverse change) clauses -qui protègent contre la survenance d’événement significativement défavorable entre la signature du contrat et la réalisation de l’opération- préserveront quelques contractants des conséquences de la pandémie. On laissera cependant de côté ici l’étude de ces clauses. Non seulement leur application dépend de leur rédaction, mais nombre de contrats -y compris de « contrats d’affaires »- ne comportent aucune stipulation de cet ordre. Ainsi, imagine-t-on mal, par exemple, qu’un bail commercial comporte une quelconque clause de renégociation du loyer susceptible d’être appliquée en raison de l’épidémie ! On ne s’arrêtera pas davantage sur l’hypothèse « non pathologique » d’un accord entre le créancier et le débiteur pour modifier la convention aux fins de la préserver : on ne s’intéressera, ci-après, qu’aux mécanismes mis en place par le droit commun pour pallier l’absence de telles stipulations ou d’accord.
La modification du contrat en raison des circonstances. Le droit commun autorise désormais les parties à espérer une modification du contrat en raison des circonstances : c’est la « révision pour imprévision » (A). D’autres mécanismes peuvent cependant être envisagés pour remodeler le contrat en fonction des circonstances induites par l’épidémie (B).
A - La modification du contrat par le juge
Il convient d’envisager brièvement les conditions du recours à la révision pour imprévision (1) avant d’étudier ses effets (2).
1 - Conditions de l’imprévision
Avant d’étudier les conditions posées par l’article 1195 du Code civil (N° Lexbase : L0909KZP) pour recourir à la révision pour imprévision (b), il convient de faire quelques observations sur l’applicabilité du mécanisme (a).
a - Applicabilité du mécanisme de l’imprévision
Application de la loi dans le temps et caractère supplétif de l’article 1195 du Code civil. Deux conditions préalables doivent être vérifiées pour espérer recourir à la révision pour imprévision : non seulement le contrat doit être soumis à la réforme (1°), mais le dispositif de l’article 1195 du Code civil ne doit pas avoir été écarté par la loi ou les parties (2°).
1° - Application de la loi dans le temps
La révision pour imprévision ne s’applique qu’aux contrats soumis à la réforme du droit des contrats. La consécration de la révision pour imprévision est une innovation de la réforme du droit des contrats : le dispositif de l’article 1195 du Code civil ne s’applique donc qu’aux conventions conclues après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats. Les contrats conclus antérieurement à cette date demeurent, en revanche, soumis à une conception rigoureuse de la force obligatoire : à leur égard, ainsi que l’a affirmé en son temps la Cour de cassation, « la règle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites est générale et absolue : en aucun cas, il n’appartient aux tribunaux de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et ils ne pourront davantage, sous prétexte d’une interprétation que le contrat ne rend pas nécessaire, introduire dans l’exercice du droit constitué par les contractants, des conditions nouvelles, quand bien même le régime ainsi institué paraîtrait plus équitable à raison des circonstances économiques » [46].
Application anticipée de la réforme ? Cette dichotomie entre les contrats conclus avant ou après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats est peu satisfaisante en pratique. On peut donc se demander si les juges ne seront pas tentés d’interpréter le droit antérieur à la lumière des nouvelles dispositions. On sait, en effet, qu’afin d’éviter que la réforme du droit des contrats ne débouche sur trop de distorsions, la Cour régulatrice s’est engagée dans un mouvement d’harmonisation des solutions en interprétant parfois le droit ancien en considération de « l’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » [47]. On pourrait, dès lors, imaginer que l’ancien article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) soit interprété à la lueur de « l’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance », afin d’en déduire une possibilité judiciaire de modification du contrat, quand bien même il serait antérieur à la réforme. La jurisprudence n’y paraît cependant pas favorable : la cour d’appel de Paris a réaffirmé récemment sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil, que « le contrat est intangible et que le juge n’a pas le pouvoir de le réviser » [48]. Tout au plus admet-elle l’existence d’une obligation de renégocier le contrat sur le même fondement [49] : selon un récent arrêt de la cour d’appel de Paris, « les dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige posent le principe de l’intangibilité des conventions qui exclut la révision pour imprévision par le juge. Néanmoins, il peut être admis que l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi doit inciter les parties à renégocier une convention dont le déséquilibre résulte notamment d’une hausse imprévisible du coût de l’énergie qui est susceptible de bouleverser l’économie du contrat » [50]. Peut-être l’importance de l’épidémie conduira-t-elle sur ce point la jurisprudence à assouplir ?
2° - Applicabilité du mécanisme de l’article 1195 du Code civil au contrat
Les clauses faisant obstacle à la révision pour imprévision. Le mécanisme de la révision pour imprévision n’est pas d’ordre public, de sorte qu’il est loisible aux parties de l’écarter par une simple clause contractuelle. Ces clauses se sont évidemment multipliées. Certaines d’entre elles peuvent, sans nul doute, être contestées, pour peu qu’elles débouchent sur un déséquilibre significatif : en pareil cas, et pour peu qu’elles soient souscrites entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur [51], ou bien encore dans le cadre d’un contrat d’adhésion [52], voire à l’occasion de relations commerciales [53], ces clauses peuvent être réputées non-écrites sur le fondement des dispositions de lutte contre les clauses abusives. D’autres obstacles peuvent égalementse dresser sur la voie de l’invocation de la révision pour imprévision.
L’exclusion de l’imprévision par le droit des contrats spéciaux. L’article 1195 du Code civil est une disposition de droit commun. Paradoxalement, cette considération peut parfois nuire à son applicabilité : la jurisprudence tend, en effet, à en déduire son exclusion par certaines règles de droit des contrats spéciaux. La cour d’appel de Douai a par exemple tout récemment jugé que « les circonstances imprévisibles ne sont pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat », excluant ainsi la révision pour imprévision d’un marché à forfait [54]. Quant à la cour d’appel de Versailles, elle a écarté la révision pour imprévision en matière de bail commercial, au prétexte que « le statut des baux commerciaux prévoit de nombreuses dispositions spéciales relatives à la révision du contrat de bail (révision triennale, clause d’indexation), [et qu’] il n’y a pas lieu de faire application des dispositions générales de l’article 1195 précité, ces dernières devant être écartées au profit des règles spéciales du statut des baux commerciaux, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté [le preneur] de sa demande de révision fondée sur les dispositions générales du Code civil » [55]. Si cette dernière décision est plus que contestable -on voit mal en quoi les règles propres à la fixation des loyers ont à voir avec l’imprévision- elles attestent néanmoins d’une certaine réticence à l’égard du mécanisme de l’article 1195 : là encore, l’avenir dira si cette rigueur survivra au coronavirus.
b - Conditions d’application
Le Covid-19 : une circonstance imprévisible. A supposer que les conditions qui viennent d’être dites soient remplies -c’est-à-dire que le contrat soit soumis la réforme et qu’aucune disposition ni stipulation n’écarte l’application de l’article 1195 du Code civil- la partie subissant les conséquences de l’épidémie pourra songer à se prévaloir de la révision pour imprévision. Si une telle imprévision se définit traditionnellement comme un bouleversement imprévisible des circonstances économiques ayant présidé à la conclusion du contrat [56], le nouvel article 1195 du Code civil la présente plus largement comme « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat [qui] rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ». Il est donc peu douteux que la survenance de l’épidémie sera invoquée à ce titre. Les conséquences de cette imprévision se déclinent alors en deux temps.
Renégociation. Le premier alinéa de l’article 1195 du Code civil instaure une obligation préalable de renégociation : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ». Ce dispositif aboutit à une obligation de renégocier fort proche de celles qu’avait admise la jurisprudence antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 1195 du Code civil et que les parties liées par un contrat antérieur à la réforme peuvent du reste toujours invoquer [57]. Encore faut-il, pour qu’elle se déclenche, que le changement de circonstances ait été imprévisible au moment où le contrat a été conclu : comme s’agissant de la force majeure -et ainsi qu’on l’a évoqué plus haut- il conviendra d’être particulièrement attentif, dans l’appréciation de cette condition, à la date de conclusion du contrat.
L’objet de cette obligation de renégocier est par ailleurs cantonné. Elle est limitée aux modalités du contrat : l’obligation de renégociation ne saurait, en effet, imposer la conclusion d’un nouveau contrat, ne serait-ce que pour des raisons tenant à la liberté contractuelle. Cette obligation n’est par ailleurs que de moyens : il ne saurait pas non plus être imposé aux parties d’aboutir dans leurs négociations, encore moins de consentir aux modifications du contrat. Au vrai, la partie subissant le bouleversement des circonstances devra se garder de nourrir trop d’espoirs dans ces négociations. Non seulement leur cours ne suspend guère la force obligatoire du contrat -qui demeure obligatoire dans l’entretemps- mais ces négociations tendent davantage à la survie du contrat qu’à un retour à l’équilibre : si la partie profitant du déséquilibre doit « prendre en compte » la modification des circonstances, il n’en résulte pas qu’il lui revienne d’assurer le maintien de ses bénéfices au cocontractant, ni même de lui garantir une absence de perte.
Révision en cas d’échec des négociations. Selon l’article 1195, alinéa 2, du Code civil, « en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation ». S’il n’est pas étonnant que la résolution du contrat puisse être convenue, on peut en revanche douter de l’accord des parties pour solliciter « l’adaptation » du contrat par le juge. Au reste, selon le même article 1195 du Code civil, « à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ». Le coronavirus donnera à la jurisprudence l’occasion de faire les preuves de l’efficacité ou non de ce mécanisme. Il n’est, cependant, pas certain que les juges s’engagent avec enthousiasme dans une magistrature économique. Ajoutons que la simple difficulté à obtenir une date d’audience pour obtenir la révision du contrat devrait dissuader nombre de contractants de recourir à ce mécanisme pour lui préférer des solutions se dispensant du juge.
B - La modification du contrat sans le juge
Prérogatives unilatérales. La réforme du droit des contrats fait bénéficier les contractants de prérogatives unilatérales les dispensant de recourir au juge. Le coronavirus débouchant, non seulement sur une crise économique, mais également sur une crise judiciaire -les audiences étant rendues particulièrement difficiles lorsqu’elles demeurent possibles- il pourrait inciter les parties à y recourir pour modifier la convention. On ne reviendra pas ici sur la résolution unilatérale, évoquée ci-avant, qui débouche du reste non pas sur la modification, mais sur l’anéantissement du contrat. La réduction du prix qu’autorise désormais le Code civil mérite en revanche que l’on s’y arrête (1). On évoquera également la caducité, qui permet d’envisager la fin du contrat pour l’avenir, débouchant ainsi sur une modification du contrat dans le temps (2).
1 - Réduction du prix
Décision unilatérale de réduire le prix. Issu de la réforme du droit des contrats, le nouvel article 1223 du Code civil (N° Lexbase : L2338K7Q) permet en substance au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée d’obtenir une réduction du prix. Dans sa réduction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018 [58], applicable à compter du 1er octobre 2018, l’article 1223 du Code civil prévoit qu’« en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit ». L’alinéa suivant dispose que « si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ». Si cette dernière possibilité est de peu de secours pour le créancier, la possibilité de réduire le prix sans recourir au juge qu’organise le premier alinéa paraît en revanche prometteuse.
Pouvoir unilatéral de modification du contrat en l’absence de paiement intégral par le créancier. Le pouvoir de réduction conféré au créancier dans l’hypothèse où il n’a pas intégralement payé le prix est particulièrement important [59] : il permet de tirer unilatéralement les conséquences de la dégradation de la prestation de l’autre partie. Ce pouvoir unilatéral est du reste indépendant des circonstances : peu importe que la prestation n’ait pas été correctement accomplie en raison du coronavirus ou d’autre chose. Ainsi, le créancier qui n’a par exemple pas été intégralement livré des fournitures promises n’aura qu’à procéder à un paiement partiel, en fonction de l’évaluation proportionnelle du prix à laquelle il aura unilatéralement procédé.
Conditions. Le texte subordonne la mise en œuvre de la réduction du prix au respect de quelques conditions. Il impose d’abord une mise en demeure, afin d’offrir au débiteur une dernière chance de s’exécuter correctement. S’il ne le fait pas, le créancier qui n’a pas intégralement réglé la prestation notifie sa décision de réduire -« proportionnellement » [60]- le prix. Si le débiteur accepte par écrit cette décision, les choses en reste là : le contrat est en quelque sorte refait par les parties qui ont toutes les deux manifesté leur volonté. S’il conteste cette décision, il appartiendra en revanche au débiteur de saisir le juge pour la contester.
Utilité du dispositif. Ainsi qu’on le voit, si le mécanisme n’écarte pas totalement le juge, il fait toutefois peser les conséquences du recours judiciaire -que l’épidémie rend particulièrement lourdes- sur la partie ayant imparfaitement exécuté la prestation. Même si la charge de la preuve pèse sur lui [61], le créancier bénéficiera ainsi de la réduction qu’il se sera appliquée à lui-même tant qu’un juge ne l’aura pas condamné à payer davantage. Le temps jouera pour lui, ceci d’autant plus que l’appréciation de cette réduction ressortit à la compétence du juge du fond, à l’exclusion de celle du juge des référés [62]. La réduction du prix confère ainsi au créancier un moyen de pression en l’autorisant à placer le débiteur devant le fait accompli et à faire peser sur lui la contrainte et l’aléa de la procédure judiciaire.
2 - Caducité
Perte d’intérêt du contrat et intérêt de la caducité. L’épidémie de coronavirus pourrait conduire à un regain d’intérêt pour la caducité du contrat. Il se peut en effet qu’une partie n’ait plus d’intérêt à poursuivre l’exécution d’une convention, sans pour autant qu’elle puisse se prévaloir d’un quelconque cas de force majeure ou d’une imprévision. Voici par exemple un commerçant de détail frappé par le coronavirus et dans l’impossibilité de tenir sa boutique : il ne pourra se prévaloir de cette situation pour refuser de payer les denrées périssables que son fournisseur est disposé à lui livrer conformément à la convention. A supposer qu’aucune stipulation contractuelle ne règle cette question, l’article 1186 alinéa 1er du Code civil (N° Lexbase : L0892KZ3), pourrait permettre au créancier d’échapper à la poursuite du contrat [63].
Selon cette disposition, « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ». Les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme sont, il est vrai, incertaines. La question se pose ainsi de savoir si la caducité opère de plein droit, ou si elle droit être prononcée par le juge. Les textes invitent à trancher en faveur de la première branche de l’alternative : quoiqu’une telle interprétation n’écarte pas le rôle du juge, elle permettrait à la partie se prévalant de la caducité d’imposer à l’autre le risque de contester la situation acquise. L’article 1186 du Code civil pose également la question de savoir ce que recouvre la notion « d’élément essentiel » : l’intérêt du contrat pour une partie peut-il passer pour un tel élément entraînant la fin du contrat en cas de disparition ? Ce n’est pas certain : la jurisprudence qui l’a un temps admis sur le terrain de la cause de l’obligation s’est éteinte en même temps que cette notion a disparu [64]. Il n’est pas certain que le coronavirus ne la ressuscite pas.
Et demain : prévoir l’imprévisible ? Comme on le voit, le droit des contrats est décidément immunisé contre le Covid-19 : les règles séculaires qui le régissent ont connu d’autres bouleversements, d’autres pandémies même, sans vaciller. L’épidémie participera sans doute au perfectionnement de ses règles plutôt qu’à leur effondrement. Elle devrait cependant inciter à l’avenir à davantage encore de précaution dans la rédaction d’actes : le contrat n’est-il pas après tout un acte de prévision si hardi qu’il permet même d’envisager l’imprévisible ?
[1] Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT).
[2] Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, NOR: SSAZ2007749A (N° Lexbase : Z229179S).
[3] Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale (N° Lexbase : L5884LWT).
[4] Ibid..
[5] Les articles relatifs à cette question sont nombreux : on renverra ici pour l’essentiel à J. Heinich, L'incidence de l'épidémie de coronavirus sur les contrats d'affaires : de la force majeure à l'imprévision, D., 2020, p.611. et à M. Mekki, De l’urgence à l’imprévu du Covid-19 : quelle boîte à outils contractuels ?, AJ Contrat, 2020, p.164 et s..
[6] Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7).
[7] Pour cette expression : Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5954LWG).
[8] E. Macron, Adresse aux Français, 12 mars 2020 : « Les échéances qui sont dues dans les prochains jours et les prochaines semaines seront suspendues pour toutes celles et ceux qui en ont besoin ».
[9] Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC (N° Lexbase : A4712KGM), JCP éd., G, 2013, 929, note J. Ghestin.
[10] Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5731LW8), article 4 : « ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce ; Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée ».
[11] A se fier encore à la circulaire, il semble que les auteurs du texte n’aient eu à l’esprit que la déchéance du terme…
[12] Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A2234DXZ), JCP, éd. G, 2007, II, 10154, note D. Houtcieff ; D., 2007 p. 2839, note P. Stoffel-Munck ; Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086, FS-P+B (N° Lexbase : A2088MYY), Gaz. Pal., 2015, n° 99, p. 18, obs. D. Houtcieff ; JCP, éd. G, 2015, 306, obs. J. Ghestin et G. Virassamy ; Cass. com., 8 novembre 2016, n° 14-29.770, F-D (N° Lexbase : A8955SGR), RTDCiv., 2017, p. 133, obs. H. Barbier.
[13] Par ex., Cass. civ. 3, 8 avril 1987, n° 85-17.596 (N° Lexbase : A7560AAA), Bull. civ. III, n° 88, Rép. Defrénois, 1988, p. 75, obs. J.-L. Aubert ; RTDCiv., 1988, pp. 120 et s., obs. J. Mestre, JCP, éd. G, 1988, II, p. 21037, note Y. Picod. ; Cass. com., 15 mai 2012, n° 10-26.391 ; Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 13-28.063, F-D (N° Lexbase : A5088RZH), Gaz. Pal., 2017, obs. D. Houtcieff.
[14] En ce sens, L. Aynès, RDC, 2007, p. 1107, obs. préc..
[15] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JO n°0035 du 11 février 2016 (N° Lexbase : Z0453939) : « Le texte reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, délaissant le traditionnel critère d'extériorité, également abandonné par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006 (Ass. Plén. 14 avr. 2006, n° 04-18902 et n° 02-11168), pour ne retenir que ceux d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ».
[16] V. Cass. civ. 3, 15 octobre 2013, n° 12-23.126, F-D (N° Lexbase : A0901KNP), qui relève expressément qu’un « incendie avait été pour les preneurs un fait imprévisible, irrésistible et extérieur » ou encore, dans le même sens, Cass. civ. 3, 23 mars 2017, n° 16-12.870, F-D (N° Lexbase : A7829ULK).
[17] V. par ex. TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 13 juillet 2017, n° 15/00991 : « S’agissant d’un non-respect d’engagements contractuels, le débiteur n’est responsable de son inexécution que si celle-ci peut lui être imputée de sorte qu’il peut être exonéré de toute responsabilité en cas de survenance d’un cas fortuit ou d’une situation de force majeure dans les termes fixés par l’article 1148 devenu 1218 du Code civil ». Dans le même sens, TGI Nanterre, 7e ch., 30 mai 2017, n° 13/01009 : « L’article 12 ainsi rédigé ne permet nullement à la société […] de s’exonérer de sa responsabilité dans des cas ne correspondant pas nécessairement à la force majeure, celle-ci restant définie par référence à l’article 1148 ancien, 1218 nouveau, du code civil ». Adde CA Montpellier, 1° ch. b, 28 février 2018, n° 17/00784 (N° Lexbase : A7583XEL) « Si le preneur se réfère aux critères de l’article 1218 nouveau du Code civil définissant la force majeure en matière contractuelle, pour dire que cet incendie constitue bien un événement échappant à son contrôle, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du bail et dont les effets ne pouvaient être évités par d’autres mesures appropriées que celles prises, c’est de façon superfétatoire, dès lors que, selon l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur, demeurent soumis à la loi ancienne, comme c’est le cas du bail de l’espèce conclu le 14 octobre 2015 ».
[18] Quelques décisions du même jour de la cour d’appel de Colmar ont qualifié le coronavirus de force majeure. Ces décisions n’ont, cependant, pas été rendues en matière contractuelle mais de droit des étrangers : v. not. CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, n° 20/01142 (N° Lexbase : A88683IB) ; CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, n° 20/01143 (N° Lexbase : A90603IE) ; CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, n° 20/01206 (N° Lexbase : A07363KH).
[19] V. L. Landivaux, Contrats et coronavirus : un cas de force majeure ? ça dépend…, Dalloz actualité, 7 avril 2020.
[20] Vie publique, Déclaration de Bruno le Maire du 28 février 2020. Le Ministre avait du reste lui-même immédiatement restreint la portée de cette affirmation générale en explicitant le sens de sa phrase en cantonnant sa portée aux marchés publics : « Ce qui veut dire que pour tous les marchés publics de l'Etat, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n'appliquerons pas de pénalités, car nous considérons le coronavirus comme un cas de force majeure ».
[21] Comp. en matière de catastrophe naturelle : Cass. civ. 3, 10 décembre 2014, n° 12-26.361, FP-P+B (N° Lexbase : A6075M77), D., 2015, p. 362 , note J. Dubarry et C. Dubois, et 1863, obs. L. Neyret ; RTDCiv., 2015. 134, obs. H. Barbier et 399, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal., 15 avril 2015, p. 22, obs. N. Blanc. Adde V. Leduc, Catastrophe naturelle et force majeure, RGDA, 1997, p. 409. Adde Cass. civ. 3, 10 décembre 2002, n° 01-12.851, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4219A4Z) Bull. civ. III, n° 256 : selon laquelle, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déduit de la simple constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle donnée à des inondations, la conséquence nécessaire que cet événement avait, dans les rapports contractuels, le caractère de force majeure.
[22] C. civ., art. 1171 al. 1er (N° Lexbase : L1981LKL) : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
[23] C. consom., art. L. 212-1 al. 1er (N° Lexbase : L3278K9B) : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
[24] Cass. civ. 3, 1er juin 2011, n° 09-70.502, FS-P+B (N° Lexbase : A3137HTD), Bull. civ. 3, III, n° 89, D., 2011, p. 2679, obs. A.-C. Monge.
[25] Arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, NOR: SSAZ2007069A (N° Lexbase : L3753LWW).
[26] Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, NOR: SSAZ2007749A (N° Lexbase : Z229179S).
[27] V. par ex. CA Nancy, 1re ch., 22 novembre 2010, n° 09/00003 (N° Lexbase : A1459GLM) : « Les parties ont produit une documentation très complète sur la Dengue dont il ressort que cette maladie virale dite 'grippe tropicale’ très répandue a été décrite pour la première fois en 1779 et sévit régulièrement depuis le début des années 1980 dans l’ensemble de la zone intertropicale en raison de l’érosion des programmes d’éradication du moustique qui en est le vecteur. Ce phénomène épidémique présente un caractère récurrent notamment dans les Antilles françaises. La survenance au cours du mois d’août 2007 et dans les mois suivants de nombreux cas de Dengue jusqu’à aboutir au dépassement du seuil épidémique n’est donc pas un phénomène nouveau. Dans le bulletin du mois de septembre 2007, l’analyse effectuée par l’institut de veille sanitaire révélait l’existence de nombreux cas de Dengue depuis le milieu de l’année 2006 ainsi que le dépassement du seuil épidémique durant dix-huit semaines sur trente-six pour l’année 2007 avec une forte augmentation des cas biologiquement confirmés pour le mois d’août et la première semaine de septembre (document n°20 produit par l’appelant). Ces documents démontrent que l’épidémie survenue au cours de l’année 2007 ne présentait donc pas un caractère imprévisible ». Adde plus récemment : CA Basse-Terre, 1re ch., 17 décembre 2018, n° 17/00739 (N° Lexbase : A5434YRP).
[28] P. Guiomard, La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts, Dalloz actualité, 4 mars 2020.
[29] CA Saint-Denis de la Réunion, 29 décembre 2009, n° 08/02114 (N° Lexbase : A6009GPA).
[30] Ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168 (N° Lexbase : A2034DPZ), Bull., Ass. plén., n° 5, JCP, éd. G, 2006, II, 10087, P. Grosser ; Contrats, conc. consom., 2006, comm. n° 152, L. Leveneur ; D., 2006, p. 1577, note P. Jourdain ; RDC, 2006, p. 1083, obs. Y.-M. Laithier ; RDC, 2006, p. 1207, obs. G. Viney.
[31] Cass. civ. 1, 12 juillet 2001, n° 99-18.231, (N° Lexbase : A1970AUI), Bull. civ. I, n° 216 : Ne constitue pas un cas de force majeure l’impossibilité invoquée par une société d’honorer son contrat d’approvisionnement, faute pour elle d’expliquer en quoi la défaillance de son fournisseur avait présenté un caractère irrésistible. Adde, dans le même sens en matière administrative, CAA Bordeaux, 4e ch., 20 novembre 2014, n° 12BX03261 (N° Lexbase : A9666M3E).
[32] F. Gréau, Force majeure : les caractères de la force majeure Rep. Civ. Dalloz, 2017, spéc. n° 67.
[33] La question se pose en théorie de savoir si ce texte ne recouvre pas deux hypothèses : l’évitabilité des conséquences de l’événement, et l’évitabilité de l’événement lui-même. La question n’a que peu d’intérêt ici : il paraît en effet peu contestable que le débiteur n’avait pas de prise sur l’événement lui-même.
[34] Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306, F-P+B (N° Lexbase : A8468MWK), Bull. civ. IV, n° 118, D., 2014, p. 2217, note J. François ; Rev. sociétés 2015, p. 23, note C. Juillet ; RTDCiv., 2014. 890, obs. H. Barbier ; JCP, 2014. 1117, note V. Mazeaud.
[35] CA Paris, 17 mars 2016, n° 15/04263 (N° Lexbase : A8418Q7W).
[36] La solution est présentée comme étant applicable, au-delà des obligations monétaires, à toutes les obligations ayant pour objet une chose fongible : CA Paris, 21 décembre 1916, DP 1917. 2. 33 note H. Capitant.
[37] V. F. Gréau, Force majeure : les caractères de la force majeure, Rep. Civ. Dalloz, 2017, spéc. n° 72.
[38] Cass. civ. 1, 24 février 1981, n° 79-12.710 (N° Lexbase : A5243DNI), Bull. civ. I, n° 65, D., 1982, jur., p. 479, note D. Martin ; Cass. civ. 3, 22 février 2006, n° 05-12.032, F-P+B (N° Lexbase : A4518DQE), Bull. civ. III, n° 46, RDC, 2006, p. 1087, obs. Y.-M. Laithier ; RTDCiv., 2006, p. 764, obs. J. Mestre et B. Fages ; Cass. civ.1, 18 décembre 2014, n° 13-24.385, F-P+B (N° Lexbase : A2825M87).
[39] Comme le remarque notre collègue Julia Heinich, la responsabilité du fait de la rupture des relations commerciales est écartée par l’article L.442-1 II, dernier alinéa, du Code de commerce : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
[40] Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 (N° Lexbase : A85133AK), D., 2020, p. 416, note J.-S. Borghetti ; D., 2020, p. 353, obs. M. Mekki ; D., 2020, p.394, point de vue M. Bacache : AJ contrat 2020, p. 80, obs. M. Latina ; JCP, éd. G, 2020, 167, note M. Mekki ; Gaz. Pal., 4 février 2020, n° 5, p. 15, note D. Houtcieff.
[41] L’article 1231-1 du Code civil (N° Lexbase : L0613KZQ) ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
[42] Cass. civ., 14 avril 1891, DP, 1891, 1, p. 419, note M. Planiol ; Cass. civ. 1, 20 mars 2014, n° 12-26.518, F-P+B (N° Lexbase : A7421MHC), Bull. civ. I, n° 58.
[43] Cass. civ.1, 20 mars 2014, n° 12-26.518, F-P+B (N° Lexbase : A7421MHC), Bull. civ., I, n° 58.
[44] Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, NOR: SSAZ2007749A.
[45] Par ex. Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-24.633, F-D (N° Lexbase : A2936M37) : « La résolution d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements et alors même que cet empêchement résulterait de la force majeure ».
[46] Cass. civ., 15 novembre 1933, S., 1934, I, p. 13. Adde Cass. civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, D., 1876, 1, p. 193, note A. Giboulot.
[47] Cass. ch. mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411 (N° Lexbase : A8476TNA), D., 2017, p. 793, obs. note explicative de la Cour de cassation, note B. Fauvarque-Cosson ; D., 2017, p. 1149, obs. N. Damas ; AJ Contrat, 2017, p. 175, obs. D. Houtcieff ; RTDCiv., 2017, p. 377, obs. H. Barbier.
[48] CA Paris, 9 mai 2019, n° 17/04789, Gaz. Pal., 2019, n°31, p.21 obs. D. Houtcieff.
[49] Sur cette obligation, voir infra.
[50] CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 janvier 2020, n° 18/01078 (N° Lexbase : A88663BY).
[51] C. consom., art. L.212-1 (N° Lexbase : L3278K9B).
[52] C. civ., art. 1171 (N° Lexbase : L1981LKL).
[53] C. com., art. L.442-1 I 2°(N° Lexbase : L0501LQM).
[54] CA Douai, ch. 1, sect. 2, 23 janvier 2020, n° 19/01718 (N° Lexbase : A44603C8), Gaz. Pal., 2020, n° 14, p.36 obs. D. Houtcieff.
[55] CA Versailles, 12e ch., 12 décembre 2019, n° 18/07183 (N° Lexbase : A9242Z7G), Gaz. Pal., 2020, n° 14, p.36 obs. D. Houtcieff.
[56] Sur l’imprévision, voy. not. P. Stoffel-Munck, Regards sur la théorie de l’imprévision, Aix-en-Provence, PUAM, 1994 ; C. Jamin, Révision et intangibilité, Dr. et patrimoine, mars 1998, pp. 46 et s. ; D. Tallon, La révision pour imprévision au regard des enseignements récents du droit comparé, in Droit et vie des affaires, Etudes à la mémoire d’Alain Sayag, Paris, Litec, 1997, p. 403 ; C. Ménard, Imprévision et contrats de longue durée : un économiste à l’écoute du juriste, in Etudes offertes à Jacques Ghestin, Paris, LGDJ, 2001, p. 661 ; E. Savaux, L’introduction de la révision ou de la résiliation pour imprévision, RDC, 2010, p. 105 ; M. Mekki, Hardship et révision du contrat, JCP, éd. G, 2010, p. 1219 ; B. Deffains et S. Ferey, Pour une théorie économique de l’imprévision en droit des contrats, RTDCiv., 2010, p. 719.
[57] Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547 (N° Lexbase : A4297ABR), Bull. civ. IV, n° 338, RTDCiv., 1993, p. 124, obs. J. Mestre, JCP, éd. G, 1993, II, 22614, note G. Virassamy, Rép. Defrénois, 1993, art. 35663, obs. J.-L. Aubert.
[58] Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L0250LKH).
[59] Voy. sur cette question, D. Houtcieff, Les nouveaux pouvoirs unilatéraux du contractant : l’étendue des pouvoirs, RDC, 2018.
[60] Sur cette proportionnalité, V. D. Houtcieff, Droit des contrats, 4e éd., Bruylant, 2018, n° 955-6.
[61] Voy. par ex., T. com. Paris, 19e ch., 21 février 2018, n° 2016051093 : « Attendu qu’en application de l’article 1315, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, il appartient à celui qui se prévaut de l’inexécution défectueuse de ses obligations par son cocontractant pour obtenir une réduction du prix des prestations qu’il a reçues ou une indemnité destinée à réparer son préjudice, d’établir tant la nature que la gravité des manquements allégués et d’apporter la preuve, tant de l’existence que du montant du dommage qu’il allègue ».
[62] Comp. T. com. Manosque, 12 octobre 2010, n° 2010003506 : « Constatons que la demande tendant à la résiliation anticipée du contrat du 26.07.2005 aux torts de la SARL B... et au paiement d’une clause pénale contractuelle, se heurte à des difficultés sérieuses qui rendent incompétent le juge des référés ».
[63] V. posant cette même question, J. Heinich, art. préc.
[64] Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.646, FS-P+B (N° Lexbase : A0620EBL), JCP, éd. G, 2009, II, 10000, note D. Houtcieff, Rép. Defrénois, 2008, art. 38916, p. 671, obs. R. Libchaber ; RTDCiv., 2009, p. 111, obs. B. Fages ; RDC, 2009, p. 49, obs. D. Mazeaud. Adde dans le même sens pour la Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n°14-20.498, F-D (N° Lexbase : A9485NNM), D., 2015, p. 2361 , note D. Mazeaud ; RTDCiv. 2016, p. 339, obs. H. Barbier ; V. en sens contraire, Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.453, F-D (N° Lexbase : A7374MHL), D., 2014, p. 1915, note D. Mazeaud ; RTDCiv., 2014, p. 884, obs. H. Barbier ; Cass. com., 3 juillet 2019, n° 17-27.820 (N° Lexbase : A2975ZIZ), AJ Contrat, 2019, p. 452, obs. D. Houtcieff ; RTDCiv. 2019, p.858 obs. H. Barbier.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472983
[Focus] Prorogation des délais et adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire : ce que prévoit l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
Réf. : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7)
Lecture: 13 min
N2946BYR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alizée Scaillierez, cabinet Adden avocats Nouvelle-Aquitaine, Avocate au barreau de Bordeaux, membre de l’Institut de droit public du Barreau de Bordeaux
Le 09 Avril 2020
Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a pour objet de prendre un certain nombre de mesures visant, d’une part, à la préservation des délais de recours et des mesures qui ont expiré ou expirent pendant une période qu’elle définit et, d’autre part, à la suspension et l’interruption de certains délais et de certaines procédures en matière administrative devant intervenir durant cette même période.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire exceptionnelle que nous rencontrons, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), publiée le 24 mars 2020 au Journal Officiel, a déclaré l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 24 mai 2020 [1] et a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, toute mesure « pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (N° Lexbase : L8825HBH)» notamment :
« 2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d'une décision de justice ;
b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ;
(…) » [2].
Une série d’ordonnances a ainsi été publiée au JO le 26 mars 2020, dont l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ici commentée [3].
L’ordonnance n° 2020-306 est divisée en 3 titres :
- le titre Ier sur les « dispositions générales relatives à la prorogation des délais » (1) ;
- le titre II intitulé « autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative » (2) ; et
- et le titre III sur les « dispositions diverses et finales » (3).
I - Sur la prorogation des délais
A - Le champ d’application de l’ordonnance : la « période juridiquement protégée » [4]
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 prévoit que :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».
Autrement dit, la « période juridiquement protégée » correspond à la période d’état d’urgence sanitaire (2 mois, pour le moment : 24 mars + 2 mois = 24 mai 2020) augmenté d’un mois (24 juin 2020). En l’état, la période ainsi définie par l’article 1er de l’ordonnance court du 12 mars 2020 inclus jusqu’au 24 juin 2020 inclus.
B - Les exclusions expresses du champ d’application
L’ordonnance commentée n’est pas applicable :
« 1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci ».
Enfin, l’article 1er précise que « les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020 ».
C - Sur les délais de recours
C’est l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 qui définit les délais concernés :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit ».
Il en résulte que les délais dont le terme est échu entre le 12 mars 2020 inclus et le 24 juin 2020 inclus sont prorogés pour une durée maximale de 2 mois, soit jusqu’au 24 août 2020 [5].
La circulaire du 26 mars 2020, modifiée le 30 mars 2020, du ministère de la Justice précise sur ce point que :
« ce délai supplémentaire après la fin de la période juridiquement protégée ne peut toutefois excéder deux mois : soit le délai initial était inférieur à deux mois et l’acte doit être effectué dans le délai imparti par la loi ou le règlement, soit il était supérieur à deux mois et il doit être effectué dans un délai de deux mois ».
D - Sur les délais concernant les mesures administratives et juridictionnelles
L’article 3 de l’ordonnance prévoit que les mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 inclus et le 24 juin 2020 inclus sont prorogées de plein droit jusqu’au 24 août 2020.
Sont ici visées les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes :
« 1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation » ;
« 2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction » ;
« 3° Autorisations, permis et agréments » ;
« 4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale » ;
« 5° Mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ».
Le juge ou l’autorité compétente peut toutefois modifier ces mesures, ou y mettre fin lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.
E - Sur la résiliation de certaines conventions
S’agissant des conventions ne pouvant être résiliées « que durant une période déterminée » ou renouvelée « en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé », l’article 5 prévoit que cette période ou ce délai sont prolongés de deux mois s'ils expirent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 août 2020.
II - Sur les délais et procédures en matière administrative
Le titre II relatif aux « autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative » s’applique aux « administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de Sécurité sociale » [6].
A - Les délais d’instruction et les délais « à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 » doit intervenir, même de manière implicite
L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-360 prévoit que :
« Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public ».
Il en résulte que :
- les délais d’instruction et les délais dans lesquels les personnes visées par l’article 6 doivent émettre une décision, un accord ou un avis, même implicite, sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020 inclus [7] ;
- et que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 est reporté à compter du 25 juin 2020.
B - Les délais imposés par l’administration pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature
L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-360 prévoit que:
« Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ».
Précisons que, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 précités, l’article 9 de l’ordonnance prévoit expressément que le cours de certains délais pourra reprendre dans certaines hypothèses [8].
Un décret devra ainsi déterminer « les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend ». Un autre décret pourra, « pour ces mêmes motifs », « pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d'en informer les personnes concernées ».
C - Les délais en matière d’enquête publique
Concernant les enquêtes publiques « déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisée pendant la période [courant du 12 mars 2020 jusqu’au 24 juin 2020 inclus] » et dont le retard ou l’absence d’accomplissement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent (conditions cumulatives), l’article 12 de l’ordonnance prévoit que l'autorité peut adapter les modalités de ces enquêtes :
- soit « en prévoyant que l'enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. La durée totale de l'enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l'interruption due à l'état d'urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur » ;
- soit « en organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés ».
L’article 12 de l’ordonnance précise que « lorsque la durée de l'enquête excède la période définie au I de l'article 1er de la présente ordonnance, l'autorité compétente dispose de la faculté de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l'enquête restant à courir, aux modalités d'organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie d'enquêtes dont elle relève » et que « dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l'état d'urgence sanitaire de la décision prise en application du présent article ».
III - Sur les autres dispositions prévues
L’ordonnance n° 2020-306 prévoit également que « sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l’Union européenne », l’article 13 dispense les « projets de texte ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire » « de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celles du Conseil d'Etat et des autorités saisies pour avis conforme ».
La consultation du Conseil d’Etat et celle des autorités saisies pour avis conforme sont ainsi maintenus.
L’article 14 précise enfin les conditions d’application de l’ordonnance n° 2020-306 dans les Iles de Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.
[1] Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, art. 4 : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des circonscriptions territoriales qu'il précise.
La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.
Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au même premier alinéa » - Autrement dit, en fonction de l’évolution de la situation, il pourra être mis fin à l’état d’urgence sanitaire (par décret en Conseil des ministres) avant le délai de deux mois ainsi prévu ou, au contraire, la loi pourra le proroger.
[2] Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, art. 11.
[3] En matière juridictionnelle, nous pouvons également noter les ordonnances n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5740LWI), n° 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT) et n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).
[4] Désignée ainsi par la circulaire n° CIV/01/20 du 26 mars 2020, de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (NOR : JUSC 2008608C) (N° Lexbase : L5954LWG).
[5] Voir en ce sens : Fiche pratique sur l'adaptation des procédures devant les juridictions administratives, publiée sur le site du Conseil d’Etat.
[6] Article 6 de l’ordonnance.
[7] Est notamment concerné par cet article le délai d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme mais aussi le délai de retrait d’une autorisation d’urbanisme.
[8] C’est sur le fondement de cet article que le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020, portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6216LW7), a été adopté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472946
[Brèves] Covid-19 : publication d’un décret définissant les conditions et modalités d’établissement, à distance, de l’acte notarié sur support électronique
Réf. : Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6326LW9)
Lecture: 2 min
N2921BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Manon Rouanne
Le 08 Avril 2020
► Le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 (N° Lexbase : L6326LW9), publié au journal officiel le 4 avril 2020, a pour objet, afin de tenir compte des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de pallier l’impossibilité, qui en résulte, pour les parties de se rendre physiquement chez un notaire, d’adapter le régime d’établissement des actes notariés sur support électronique en définissant les conditions et modalités d’établissement, à distance, de l’acte notarié sur un tel support.
Tout d’abord, de manière dérogatoire, ce texte autorise le notaire instrumentaire, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire définie par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : L5506LWT, art. 4), à établir un acte notarié sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées.
Le décret s’attache, ensuite, à définir les modalités d’établissement, par voie électronique, de l’acte notarié qui en conditionnent la validité en prévoyant l’obligation d’effectuer l’échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l'acte au moyen de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
En outre, il est fait obligation au notaire instrumentaire de recueillir, simultanément avec le consentement ou la déclaration susmentionnés, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique (décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique N° Lexbase : L9036LGR).
Enfin, le texte conditionne la perfection de l’acte à l’apposition, par le notaire instrumentaire, de sa signature électronique sécurisée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472921
[Brèves] Publication de cinq nouvelles ordonnances en matière sociale
Réf. : Ordonnances n° 2020-385 (N° Lexbase : L6261LWS), n° 2020-386 (N° Lexbase : L6263LWU), n° 2020-387 (N° Lexbase : L6260LWR), n° 2020-388 (N° Lexbase : L6259LWQ) et n° 2020-389 (N° Lexbase : L6264LWW) du 1er avril 2020
Lecture: 6 min
N2890BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 08 Avril 2020
► Cinq nouvelles ordonnances intéressant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les services de santé au travail, les instances représentatives du personnel, la formation professionnelle et le report du scrutin de représentativité dans les TPE ont été publiées au Journal officiel du 2 avril 2020.
- Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat N° Lexbase : L6261LWS) : cette ordonnance assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « PEPA ».
→ report de la date limite de versement au 31 août 2020 (au lieu du 30 juin actuellement) ;
→ disparition de la condition de conclure un accord d’intéressement ;
→ montant de la prime peut être compris entre 1 000 et 2 000 euros sous réserve que la société soit dotée d’un dispositif d’intéressement ;
→ montant de la prime qui peut être modulé en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie ;
→ possibilité pour les entreprises de verser la prime exceptionnelle exonérée, jusqu’à 1 000 euros, de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.
- Services de santé au travail (ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020, adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle (N° Lexbase : L6263LWU) : cette ordonnance adapte temporairement les missions des services de santé au travail pour les associer à la politique de lutte contre la propagation du virus :
→ dans le cadre de leurs missions et prérogatives, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par la diffusion de messages de prévention contre le risque de contagion, l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates et l’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité ;
→ les médecins du travail sont autorisés à réaliser des tests de dépistage et à prescrire des arrêts de travail en cas d’infection d’un salarié, selon un protocole à définir par arrêté des ministres et par décret ;
→ les visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des salariés ainsi que les autres interventions usuelles peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables ou urgentes. Un décret viendra préciser les modalités d’application.
Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 août 2020. Les visites médicales ayant fait l’objet d’un report après cette date devront être organisées par les services de santé au travail au plus tard avant le 31 décembre 2020.
- Mesures relatives aux IRP (ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020, portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel N° Lexbase : L6264LWW) :
→ les processus électoraux en cours sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Les mandats en cours sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats définitifs ;
→ les opérations électorales n’ayant pas encore commencé le 12 mars 2020 sont reportées jusqu’à trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
→ possibilité, à titre dérogatoire et temporaire, de tenir des réunions en visioconférence ou en conférence téléphonique, et, à titre subsidiaire, de recourir à des messageries instantanées, pour toute réunion du CSE, du CSE central et des autres instances concernées, après information des membres élus ;
→ le CSE peut être informé concomitamment à la mise en œuvre par l’employeur des mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
- Mesures d’urgence en matière de formation professionnelle (ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle N° Lexbase : L6260LWR) : cette ordonnance reporte les échéances fixées par la loi en matière de certification qualité et d’enregistrement des certifications et des habilitations dans le répertoire spécifique :
→ report au 1er janvier 2022 (au lieu du 1er janvier 2021) de l’échéance fixée initialement aux organismes de formation professionnelle pour obtenir la certification qualité ;
→ report au 1er janvier 2022 de l’échéance de l’enregistrement, dans le répertoire spécifique tenu par France compétences, des certifications ou habilitations recensées à l’inventaire au 31 décembre 2018 ;
→ report au 31 décembre 2020 concernant la réalisation par l’employeur des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié ainsi que l’application des sanctions prévues dans le cas où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais.
Par ailleurs, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ainsi que les associations transitions pro pourront financer de manière forfaitaire, dans la limite de 3 000 euros, les parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE) des candidats, notamment des salariés placés en activité partielle.
Enfin, l’ordonnance autorise la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour permettre de couvrir la totalité du cycle de formation. En outre, les jeunes inscrits dans un CFA, mais qui n'avaient pas encore de contrat avec un employeur, pourront y rester jusqu'à six mois, soit trois de plus que ce que prévoit la loi du 5 septembre 2018.
- Report du scrutin de mesure de l’audience syndicale dans les TPE et prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles N° Lexbase : L6259LWQ) : cette ordonnance :
→ permet le report du scrutin qui pourra se tenir au cours du premier semestre 2021 ;
→ décale la date du prochain renouvellement général des conseillers prud'hommes à une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022 ;
→ proroge le mandat en cours des conseilleurs prud’hommes jusqu’à cette date ;
→ décale le prochain renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 31 décembre 2021. Par conséquent, le mandat en cours des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est prorogé jusqu'à cette date.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472890
[Textes] Les délais de procédure civile face à l’épidémie de covid-19
Réf. : Ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures (N° Lexbase : L5730LW7) ; ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT)
Lecture: 50 min
N2925BYY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Rudy Laher et Charles Simon, Professeur à l’Université de Limoges et Avocat au barreau de Paris
Le 25 Mai 2020
| 1. Les textes organisant la prorogation des délais 1.1. Le texte fondateur : la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 1.2. Le texte créant une prorogation ad hoc des délais et une paralysie de certaines mesures : l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 1.3. Le texte suspendant les délais en matière de saisie immobilière : l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 2. La période potentiellement protégée 3. La prorogation de la plupart des délais 3.1. La prorogation des délais pour les actes et formalités devant être effectués par les parties 3.1.1. Le champ matériel de la prorogation de délai 3.1.2. Le champ temporel de la prorogation de délai 3.1.3. Le mécanisme sui generis de nouveau délai courant à la fin de la période juridiquement protégée, dans la limite de deux mois 3.1.4. La question de la computation des délais prorogés 3.1.5. La question des actes accomplis au cours de la période juridiquement protégée 3.1.6. Exemples de mise en œuvre du mécanisme de prorogation créé a. Délai inférieur à deux mois arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée b. Délai supérieur à deux mois arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée c. Délai ayant commencé à courir avant la période juridiquement protégée et arrivant à échéance après d. Délai ayant commencé à courir pendant la période juridiquement protégée et arrivant à échéance après 3.1.7. L’injustice possible du mécanisme choisi 3.2. La prorogation des délais pour les mesures administratives et juridictionnelles 3.2.1 Le champ matériel de la prorogation de délai 3.2.2. Le champ temporel de la prorogation de délai 3.2.3. Le report de plein droit de tous les délais de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée, sauf décision contraire ou cas particulier 4. La paralysie ou la suspension de certaines mesures et certains délais particuliers 4.1. La paralysie des mesures en matière d’astreinte 4.1.1. La suspension des astreintes ayant pris effet avant le début de la période juridiquement protégée, le 12 mars 2020 4.1.2. Le report des astreintes prenant effet au cours de la période juridiquement protégée 4.2. La suspension des délais en matière de saisie immobilière |
Les bouleversements liés à l’épidémie de covid-19 en cours créent une difficulté quant au respect des délais, en particulier de procédure. Le fonctionnement de toute la chaîne du droit est en effet affecté, du justiciable qui a d’autres préoccupations et se trouve confiné chez lui au juge dont la juridiction fonctionne au ralenti, quand elle fonctionne.
Le risque était, donc, que des délais expirent pendant cette période et qu’un contentieux se multiplie à son issue, notamment autour d’une suspension du cours des délais du fait de la force majeure (C. civ., art. 2234 N° Lexbase : L7219IAM). Il était de plus à craindre des appréciations divergentes entre juridictions, voire au sein d’une même juridiction.
C’est pour prévenir ces difficultés que le Gouvernement est intervenu afin de mettre en place un « moratoire », c’est-à-dire une mesure législative exceptionnelle et temporaire, collective et objective, de modification des délais « lorsque des événements graves se produisent et entraînent des perturbations importantes dans la vie du pays » [1].
Par le passé, le législateur avait pu utiliser la technique du report général des dates limites [2] ou la suspension générale des délais à compter d’une certaine date [3]. Il a fait un autre choix dans le cas présent. Plutôt que de recourir à des notions connues des juristes, suspension et interruption, il a choisi de recourir à un régime largement ad hoc, sauf en matière de saisie immobilière et d’astreinte où c’est une suspension qui s’applique. Il est donc important pour le praticien de comprendre le mécanisme ainsi créé et d’identifier les difficultés qu’il pourrait engendrer dans ses dossiers.
Après avoir présenté les textes organisant le moratoire mis en place (1.), il faut identifier la « période potentiellement protégée » faisant l’objet du moratoire (2.) et les différents régimes créés, prorogation ad hoc pour une large part (3.) et une paralysie dans quelques cas (4.), en prenant garde aux règles de computation des délais qui peuvent receler des difficultés.
1. Les textes organisant la prorogation des délais
Le moratoire mis en place découle de trois textes : la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) (1.1) et deux ordonnances du 25 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) (1.2.) et l’ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT) (1.3.).
1.1. Le texte fondateur : la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
C’est l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : Z47011SP) d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui autorise le Gouvernement à intervenir par voie d’ordonnance afin de prendre toute mesure pour faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Concernant la date d’expiration des délais pour agir, ce texte indique en son 2° b) que le Gouvernement peut prendre toute mesure « adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions ».
S’agissant de l’organisation matérielle des juridictions, l’article 11 2° c) de la loi indique que peut être adoptée toute mesure « adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances […] les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ».
La loi fixe, également la période d’application de ces mesures : « ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 ». Si la date de départ de la période d’application est ferme, le 12 mars 2020, sa date de fin est donc flottante.
Sur cette base, le Gouvernement a pris deux ordonnances intéressant les délais de procédure en matière civile et l’organisation des juridictions parmi les vingt-cinq ordonnances qui ont été publiées au Journal officiel le 26 mars 2020.
1.2. Le texte créant une prorogation ad hoc des délais et une paralysie de certaines mesures : l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
La première ordonnance est l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. La Direction des Affaires civiles et du Sceau est venue préciser l’interprétation à donner aux dispositions parfois lacunaires de cette ordonnance par une circulaire du 26 mars 2020, rectifiée le 30 mars 2020 (N° Lexbase : L5954LWG).
Matériellement, l’article 1er de l’ordonnance circonscrit, par la négative, son champ d’application. On comprend qu’elle ne concerne, tout d’abord, que les délais et mesures en matière civile. Ceux résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale sont en effet exclus et font l’objet d’une autre ordonnance (ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale N° Lexbase : L5740LWI). L’ordonnance prévoit d’autres exclusions, notamment en matière électorale, d’édiction et de mise en œuvre de mesures privatives de liberté, d’inscription à des établissements d’enseignement…
Temporellement, les délais et mesures concernés sont ceux expirant dans une période comprise entre :
- le 12 mars 2020, conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT) ;
- et un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclarée conformément à cette même loi.
Cette période est dénommée « période juridiquement protégée » dans la circulaire accompagnant l’ordonnance mais ce terme ne se trouve pas dans l’ordonnance elle-même.
En ce qui concerne le moratoire mis en place, l’ordonnance prévoit plusieurs régimes pour les délais et mesures entrant dans son champ d’application :
- un régime général de « prorogation » sui generis pour les délais attachés à toute une liste d’actes (article 2 de l’ordonnance) et de mesures administratives et juridictionnelles, en particulier d’instruction (article 3 de l’ordonnance). Cette prorogation ne correspond ni à une suspension ni à une interruption des délais ;
- un régime de paralysie des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance pour inexécution (article 4 de l’ordonnance) variant suivant que la sanction a déjà pris effet avant le début de la période juridiquement protégée (suspension des effets) ou devait prendre effet pendant celles-ci (report de la prise d’effet).
1.3. Le texte suspendant les délais en matière de saisie immobilière : l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
La seconde ordonnance est l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. Elle a également fait l’objet d’une circulaire du 26 mars 2020 (N° Lexbase : L6210LWW) toujours en provenance de la Direction des Affaires civiles et du Sceau. Cette circulaire est longue de plus de vingt pages.
Le texte est riche et concerne a priori le fonctionnement matériel des juridictions. Ses articles 12 et 13 prévoient, cependant, des prorogations de délai en matière de mesures de protection et de mesures d’assistance éducatives.
Surtout, son article 2 prévoit une suspension des délais mentionnés aux articles L. 311-1 (N° Lexbase : L5865IRN) à L. 322-14 (N° Lexbase : L5892IRN) et R. 311-1 (N° Lexbase : L2387ITL) à R. 322-72 (N° Lexbase : L2491ITG) du Code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire en matière de saisie immobilière, hors distribution du prix.
Faute d’indication en sens contraire, il s’agit de la suspension de droit commun que l’on retrouve, par exemple, à l’article 2230 du Code civil (N° Lexbase : L7215IAH). C’est-à-dire que le cours du délai est temporairement arrêté, sans que le délai déjà couru ne soit effacé. Le délai reprendra, donc, son cours à l’issue de la période de suspension.
De façon quelque peu étonnante, faute d’indication contraire, les délais en matière de distribution du prix devraient être soumis au régime de prorogation de l’ordonnance n° 2020-306 puisque l’ordonnance n° 2020-304 ne vise pas les dispositions les concernant.
Temporellement, la suspension dure pendant la même « période juridiquement protégée » que celle de l’ordonnance n° 2020-306, à savoir du 12 mars 2020 à un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
2. La période potentiellement protégée
Ainsi qu’il vient d’être vu, le moratoire que les ordonnances n° 2020-304 et n° 2020-306 ont mis en place s’articule autour d’une « période juridiquement protégée » selon la terminologie des circulaires accompagnant ces ordonnances.
La date de début de cette période juridiquement protégée est fixe : il s’agit du 12 mars 2020.
Cette date ne semble correspondre à l’entrée en vigueur d’aucune mesure particulière. La fermeture de certains lieux accueillant du public résulte d’un arrêté postérieur du 14 mars 2020 et le confinement d’un décret n°2020-260 du 16 mars 2020 (N° Lexbase : L5282LWK). Il semble que cette date du 12 mars 2020 corresponde en réalité à l’annonce aux Français du Président de la République. Il recommandait, alors, aux personnes de plus de 70 ans de ne pas sortir de chez elles et annonçait la fermeture des établissements d’enseignement à compter du 16 mars 2020. Il s’agissait donc de l’annonce des premières mesures impactant le quotidien de l’ensemble des Français, même si l'on trouve dès le 20 février 2020 un arrêté relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l’épidémie de virus covid-19. Mais il ne concernait que les personnes ayant séjourné à Wuhan, en Chine, point d’origine de l’épidémie, et prévoyait leur mise en quarantaine.
Quelle que soit de la raison pour laquelle le 12 mars 2020 a été choisi comme date de début de la période juridiquement protégée, celle-ci est connue, ce qui n’est pas le cas de la date de fin qui est à l’heure actuelle simplement déterminable.
Cette date de fin est en effet définie comme intervenant à « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 ». On peut supposer que l’idée a été d’aménager une « période-tampon » d’un mois entre la cessation de l’état d’urgence sanitaire et la fin de la période juridiquement protégée, correspondant à une période de reprise d’activité.
Pour l’heure, l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 dispose que « l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi »; soit le 24 mars 2020 conformément à sa date de publication et les dispositions quant à son entrée en vigueur [4]. On pourrait donc légitimement penser que la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est d’ores et déjà connue et calculer tous les nouveaux délais de procédure en considérant pour acquis que le dies ad quem tombe le 24 juin 2020 [5] à minuit en application des articles 641 (N° Lexbase : L6802H73) et 642 (N° Lexbase : L6803H74) du Code de procédure civile.
Seulement, la prudence doit rester de mise. Ce n’est pas un hasard si les rédacteurs de l’ordonnance n’ont pas indiqué de date définitive et se sont contentés d’évoquer « la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ». En fonction de l’évolution de l’épidémie, il n’est en effet pas du tout impossible que cette date soit reculée à plus tard ou avancée. L’article 4 de la loi du 23 mars 2020 prévoit d’ailleurs que l’état d’urgence sanitaire peut être :
- prorogé au-delà du délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi par une autre loi ;
- ou prématurément levé par décret en Conseil des ministres.
Si la « période juridiquement protégée » [6] est donc dès à présent déterminable, elle ne doit en aucun cas être considérée trop rapidement comme déterminée.
Le schéma ci-dessous permet de visualiser les différentes situations possibles :

Il faut ainsi faire preuve ici de la plus grande prudence et rester vigilant quant à la date effective de cessation de l’état d’urgence sanitaire qui seule permettra de calculer, en toute sécurité, la date de fin de la période juridiquement protégée.
3. La prorogation de la plupart des délais
Ceci posé, à suivre la lettre de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, c’est donc une « prorogation » ad hoc qui doit s’appliquer aux actes et formalités devant être accomplis par les parties, d’une part, (3.1.) ainsi qu’aux mesures administratives et juridictionnelles prononcées par une autorité, d’autre part (3.2.).
3.1. La prorogation des délais pour les actes et formalités devant être effectués par les parties
Une fois les champs matériel (3.1.1.) et temporel (3.1.2.) du mécanisme de prorogation définis, ce mécanisme sera présenté (3.1.3.), en détaillant une difficulté potentielle sur la computation des délais postérieurs à la période juridiquement protégée (3.1.4.). Puis, un développement particulier sera consacré à la question des actes accomplis au cours de la période juridiquement protégée (3.1.5.). Enfin, différentes hypothèses seront illustrées par des exemples (3.1.6.) qui amèneront à s’interroger sur une possible injustice du mécanisme pour les délais expirant immédiatement en dehors de la période juridiquement protégée. Ceux-ci ne bénéficieront en effet d’aucune prorogation et il faudra donc tout particulièrement les surveiller (3.1.7.).
3.1.1. Le champ matériel de la prorogation de délai
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». Le même article ajoute qu’« il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».
Cet inventaire à la Prévert rend le texte difficilement compréhensible mais il a le mérite de souligner le très large champ d’application matériel de la prorogation prévue par l’ordonnance. Il n’est qu’à espérer que certains actes et formalités n’aient pas été oubliés car alors ce désir d’exhaustivité se retournera contre la volonté affichée d’un moratoire le plus large possible.
Il est important de souligner que cette « prorogation » ne s’applique qu’aux formalités prescrites par la loi ou le règlement. Les délais et les paiements prévus contractuellement ne sont donc pas concernés par l’article 2 [7].
Enfin, la circulaire du 26 mars 2020 signale que les dispositions de droit commun peuvent toujours être appliquées « si leurs conditions sont réunies et sous réserve de l’appréciation du juge » [8].
3.1.2. Le champ temporel de la prorogation de délai
Temporellement, le moratoire ne s’applique pas à tous les délais car l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précise qu’il ne concerne que les délais qui sont arrivés à échéance ou les actes qui devaient être accomplis pendant la période juridiquement protégée. Logiquement, le terme des actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020 n’est donc pas reporté. Les actes dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l’expiration de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ne font également l’objet d’aucun report de délai, ce qui n’était, en revanche, pas évident. Ce choix a, en pratique, des conséquences potentiellement problématiques comme il sera vu plus loin.
3.1.3. Le mécanisme sui generis de nouveau délai courant à la fin de la période juridiquement protégée, dans la limite de deux mois
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pose que l’acte qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée « sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
Comme l’indique avec justesse la circulaire du 26 mars 2020, il ne s’agit « ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée […], ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée ». Seulement, même si l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 emploie l’expression connue de « prorogation » pour désigner le mécanisme mis en place, ce dernier ne ressemble à aucune autre « prorogation » du droit processuel.
Celle-ci procède, en général, par simple augmentation du délai initial. On peut citer en exemple l’article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6758LEZ) selon lequel lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, certains délais « sont augmentés » de « un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer » ou « deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger ».
Théoriquement, il n’est pas ici question d’augmenter le délai initial mais de créer un « nouveau délai » [9] au cours duquel il sera interdit de regarder l’acte comme tardif. Son point de départ sera le même pour tous mais, ainsi qu’il a été dit, il est encore indéterminé puisqu’il correspond à la fin de la période juridiquement protégée.
Sa durée est, quant à elle, celle initialement prévue et repartira de zéro. Elle ne pourra, néanmoins, pas excéder deux mois. L’ordonnance crée, en effet, un délai-butoir à compter de la fin de la période juridiquement protégée pour accomplir les actes arrivés à échéance pendant celle-ci.
Au bout du compte, le système mis en place par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pourrait certainement être qualifié de « prorogation » dans son sens le plus général de « prolongation (dans le temps) […] au-delà de l’échéance » [10]. Seulement, d’un point de vue plus technique, force est de constater que cette « prorogation » présente aussi quelques points communs avec d’autres techniques comme la suspension [11] et l’interruption [12]. Au vrai, il s’agit d’un mécanisme sui generis que le législateur a possiblement nommé « prorogation » faute de mieux. Cette facilité de langage ne facilite sans doute pas les choses mais elle peut se comprendre [13].
3.1.4. La question de la computation des délais prorogés
Quoi qu’il en soit de la qualification du mécanisme, le point de départ du délai prorogé soulève une difficulté. En effet, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 indique que l’acte concerné doit être effectué dans le délai légalement imparti « à compter de la fin de la période juridiquement protégée » soit, à nouveau, en l’état, le 24 juin 2020 à minuit.
La logique voudrait que l’on considère que le nouveau délai commence à courir après la fin de la période juridiquement protégée, soit le 25 juin 2020 à 00h00. En effet, jusqu’au 24 juin 2020 à minuit, l’ancien délai est prorogé et il est, donc, étrange de faire commencer à courir le nouveau délai au même instant. Mais l’expression « à compter de la fin de la période juridiquement protégée » jette le trouble.
D’autant plus que l’autre régime de prorogation prévues pour les mesures administratives et juridictionnelles prévoit, quant à lui, une prorogation des délais « suivant la fin de la période juridiquement protégée ». Cette expression se prête plus facilement à une interprétation prenant le lendemain de la fin de la période juridiquement protégée comme point de départ de la computation du délai prorogé.
La circulaire accompagnant l’ordonnance est muette sur ce point. Par prudence, nous ne pouvons, donc, que conseiller de considérer que le point de départ de la computation du délai prorogé est la date de fin de la période juridiquement protégée soit, en l’état, le 24 juin 2020.
Une suspension des délais aurait sans doute été plus simple à manier dès lors qu’il aurait pu être considéré que les délais recommençaient à courir une fois la cause de suspension disparu, soit après la fin de la période juridiquement protégée, donc à compter du 25 juin 2020 en l’état.
3.1.5. La question des actes accomplis au cours de la période juridiquement protégée
La problématique de la computation des délais mise à part, la différence fondamentale entre la suspension de droit commun et la situation actuelle, liée à l’épidémie de covid-19, réside dans le fait que la suspension est en principe justifiée par une impossibilité d’agir de celui à qui la prescription est opposée. C’est l’article 2234 du Code civil qui dispose, par exemple, que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La situation actuelle entrave sans aucun doute la liberté d’action des parties devant accomplir un acte, mais elle n’empêche sans doute pas l’ensemble d’entre elles d’accomplir cet acte. C’est pourquoi la prorogation des délais est sans incidence sur la possibilité pour les parties d’accomplir les actes auxquels elles sont tenues.
La réalisation de ces actes peut cependant donner naissance à de nouveaux délais à la charge d’autres personnes. C’est par exemple le cas de la notification d’un jugement qui fait partir le délai de recours quand il existe (C. proc. civ., art. 528 N° Lexbase : L6676H7E) ou du dépôt des premières conclusions d’appelant qui fait partir le délai de dépôt des conclusions de l’intimé (C. proc. civ., art. 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 909 N° Lexbase : L7240LEU du même code, selon que la procédure d’appel ordinaire est à bref délai).
Si ces nouveaux délais nés pendant la période juridiquement protégée expirent pendant celle-ci, ils seront prorogés de la même façon que les délais ayant commencé à courir avant son début le 12 mars 2020. Mais il est tout à fait possible que ces nouveaux délais expirent après la période juridiquement protégée. Il y a alors une difficulté. En effet, dans ce cas, ces nouveaux délais ne bénéficieront d’aucune prorogation alors même que la réalisation des actes sous-jacents aura été entravée par les difficultés actuelles. La situation n’est donc pas pleinement satisfaisante comme les exemples suivants l’illustrent.
3.1.6. Exemples de mise en œuvre du mécanisme de prorogation créé
Quelques exemples permettront de comprendre le mécanisme mis en place et les difficultés qu’il peut créer, en prenant pour hypothèses que la période juridiquement protégée prenne bien fin le 24 juin 2020, en l’absence de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire ou de décret l’abrégeant, et, par prudence, que le point de départ de la computation du nouveau délai est ce même 24 juin 2020 et non le 25
a. Délai inférieur à deux mois arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée
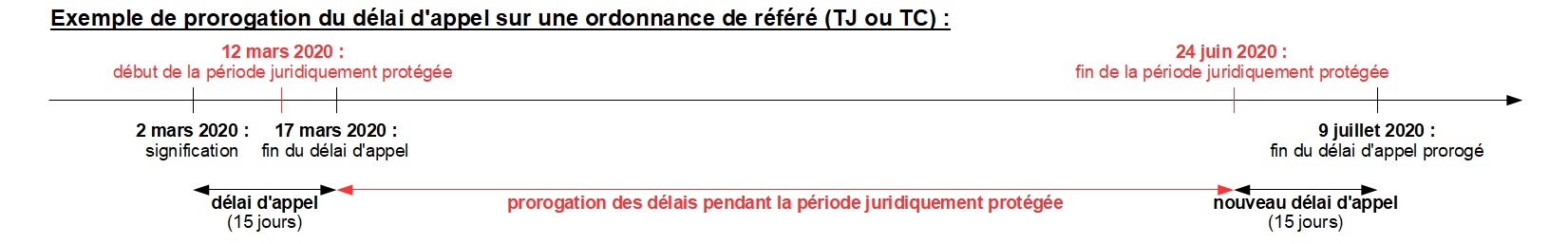
Dans l’exemple ci-dessus, une ordonnance de référé du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce a été signifiée le 2 mars 2020. Le délai d’appel est de quinze jours (C. proc. civ., art. 490 N° Lexbase : L6604H7Q), soit jusqu’au 17 mars 2020. La date d’expiration du délai étant dans la période juridiquement protégée, le délai d’appel est prorogé jusqu’à la fin de celle-ci soit, par hypothèse, le 24 juin 2020. A cette date, par prudence, un nouveau délai d’appel de quinze jours commence à courir, soit jusqu’au 9 juillet 2020, en ne comptant pas le jour de départ du délai, s’agissant d’un délai exprimé en jours, en application du premier alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6802H73).
b. Délai supérieur à deux mois arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée
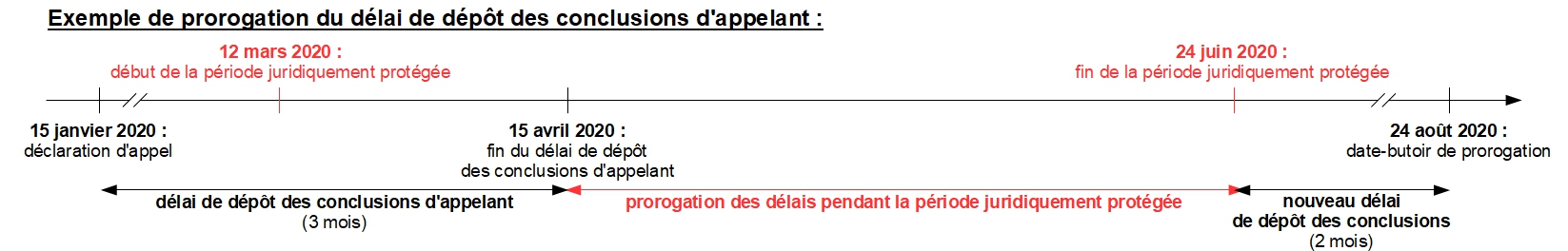
Dans l’exemple ci-dessus, une déclaration d’appel a été effectuée le 15 janvier 2020. Le délai de dépôt des conclusions d’appelant est de trois mois (C. proc. civ., art. 908 N° Lexbase : L7239LET), soit jusqu’au 15 avril 2020. La date d’expiration du délai étant dans la période juridiquement protégée, le délai de dépôt des conclusions d’appelant est prorogé jusqu’à la fin de celle-ci soit, par hypothèse, le 24 juin 2020. A cette date, par prudence, un nouveau délai de dépôt de trois mois commence en théorie à courir, soit jusqu’au 24 septembre 2020 en prenant en compte le quantième du jour de départ du délai, s’agissant d’un délai exprimé en mois, en application du deuxième alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6802H73).
Mais cette date est postérieure au délai-butoir de deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée soit, toujours par hypothèse et par prudence, le 24 août 2020. La date-limite de dépôt des conclusions d’appelant est donc le 24 août 2020.
c. Délai ayant commencé à courir avant la période juridiquement protégée et arrivant à échéance après
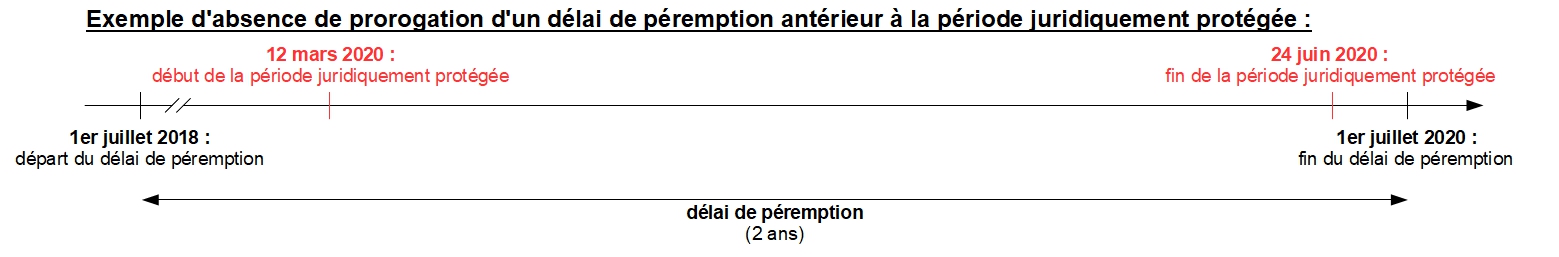
Dans l’exemple ci-dessus, un délai de péremption d’instance a commencé à courir le 1er juillet 2018. Les parties ont deux ans pour accomplir une diligence l’interrompant (C. proc. civ., art. 386 N° Lexbase : L2277H44), soit jusqu’au 1er juillet 2020. La date d’expiration du délai étant hors de la période juridiquement protégée, la partie souhaitant interrompre le délai ne bénéficie d’aucune prorogation.
Cette situation paraît illogique et injuste. En effet, un délai de péremption ayant commencé à courir trois mois plus tôt, le 1er avril 2018 serait normalement arrivé à expiration le 1er avril 2020, pendant la période juridiquement protégée. Il aurait en conséquence bénéficié d’une prorogation de délai de près de quatre mois, jusqu’à la date butoir du 24 août 2020, par prudence. Le délai de péremption effectif serait donc de deux ans et près de cinq mois dans un cas, le plus ancien, contre deux ans dans l’autre, alors que les parties ont subi les mêmes difficultés pratiques pendant toute la période juridiquement protégée.
d. Délais ayant commencé à courir pendant la période juridiquement protégée et arrivant à échéance après
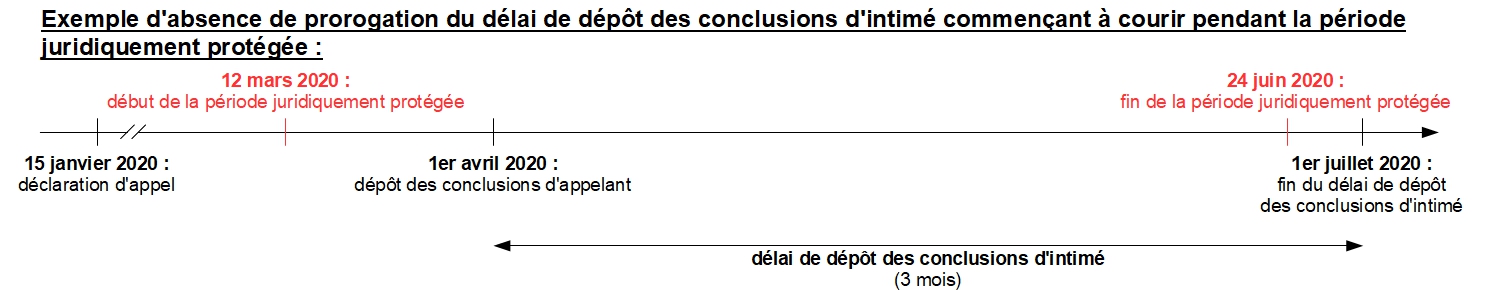
L’exemple ci-dessus est similaire à celui pris plus haut pour illustrer l’hypothèse des délais de plus de deux mois arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée. La déclaration d’appel étant du 15 janvier 2020, l’appelant avait, par prudence, jusqu’au 24 août 2020 pour déposer ses premières conclusions, du fait de la prorogation de délai liée à la période juridiquement protégée. Mais s’il conclut le 1er avril 2020, le délai de trois mois dont l’intimé dispose pour répondre (C. proc. civ., art. 909 N° Lexbase : L7240LEU) expirera le 1er juillet 2020, soit en dehors de la période juridiquement protégée. Ce délai ne bénéficiera donc d’aucune prorogation.
Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école : malgré les problèmes de fonctionnement des juridictions, il est tout à fait possible de signifier des conclusions devant la cour d’appel en cette période, par RPVA. Le sentiment d’illogisme et d’injustice est alors à plein : l’intimé aura vu son délai pour conclure largement entamé par les problèmes actuels, quand bien même il existerait un sas d’un mois entre la cessation de l’état d’urgence sanitaire et la fin de la période juridiquement protégée.
Un autre cas illustre de façon encore plus aiguë les difficultés qui risquent de se présenter en pratique :
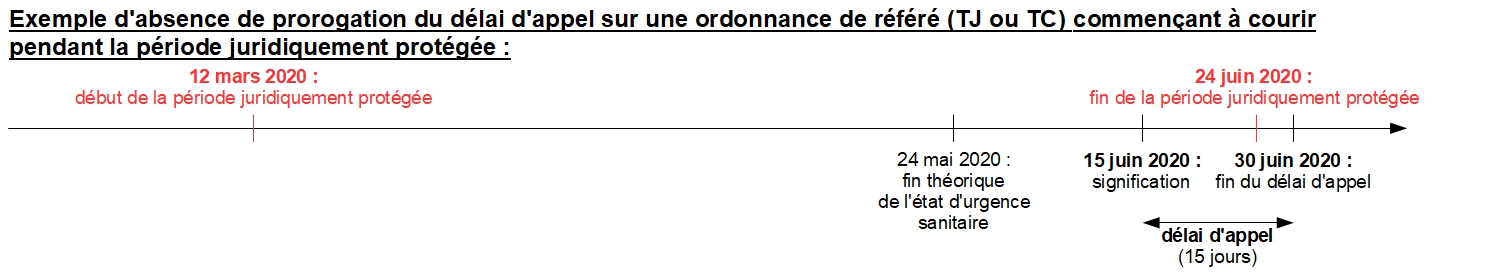
Dans l’exemple ci-dessus, une ordonnance de référé du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce est signifiée le 15 juin 2020. Le délai d’appel est de quinze jours (C. proc. civ., art. 490 (N° Lexbase : L6604H7Q), soit jusqu’au 30 juin 2020. La date d’expiration du délai étant hors de la période juridiquement protégée, ce délai ne bénéficiera d’aucune prorogation.
Là encore, il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école : le dernier mois de la période juridiquement protégée correspond à un « sas » faisant suite à la cessation de l’état d’urgence sanitaire. En conséquence, l’activité aura repris et on peut penser que les huissiers délivreront à nouveau des actes.
Selon le jour de signification, le délai d’appel sera prorogé ou non. Ainsi, en retenant, par hypothèse, une fin de la période juridiquement protégée le 24 juin 2020, le délai d’appel d’une ordonnance de référé signifiée le 9 juin 2020 et expirant normalement le 24 juin 2020 sera, par prudence, le 9 juillet 2020, du fait de la prorogation des délais. En revanche, le délai d’appel d’une ordonnance de référé signifiée le 10 juin 2020 expirera le 25 juin 2020. Une différence d’un jour dans la date de signification emporte un décalage de 14 jours du délai d’appel.
3.1.7. L’injustice possible du mécanisme choisi
S’il est certain qu’il était nécessaire de fixer un régime pour aménager les délais courants actuellement ou étant susceptibles de commencer à courir pendant l’épidémie de covid-19, le mécanisme choisi est critiquable sur plusieurs points.
Tout d’abord, le choix d’un mécanisme ad hoc est source de complexité pour les praticiens et les juristes en général qui ne peuvent pas se rattacher à un régime déjà connu. Ils sont donc forcés d’aller à l’encontre de leurs réflexes pour comprendre ce que le Gouvernement a voulu faire.
Ensuite et ainsi qu’il a été vu, le mécanisme créé ne s’intéresse qu’aux délais arrivant à expiration pendant la période de difficultés : la période de l’état d’urgence proprement dite, puis le sas d’un mois correspondant à la reprise d’activité. La question de tous les délais arrivant à échéance immédiatement après a été laissée de côté.
On peut penser que c’est parce qu’il existe peu de délais supérieurs à trois mois et demi, la durée actuellement prévisible de la période juridiquement protégée (du 12 mars 2020 au 24 juin 2020). Mais c’est oublier tous les délais qui prendront naissance pendant la période juridiquement protégée, en particulier après le déconfinement de la population et la fin de l’état d’urgence sanitaire.
De ce point de vue, une suspension des délais aurait sans doute été à la fois plus simple, puisqu’il s’agit d’un régime connu, et plus juste puisqu’elle aurait bénéficié à tous les délais en cours, y compris ceux s’éteignant hors de la période de suspension.
L’édiction d’un régime spécial ne peut, à cet égard, être justifié par le fait qu’il aurait fallu permettre à ceux qui le pouvaient, et le souhaitaient, d’accomplir les actes leur revenant pendant l’épidémie. En effet, si, ainsi qu’il a été dit, la suspension des délais se justifie en principe par une impossibilité d’accomplir un acte, la loi prévoit de nombreux cas de suspension où cela n’est pas le cas.
A titre d’exemple, l’article 2235 du Code civil (N° Lexbase : L7220IAN) suspend la prescription entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. On comprend qu’il s’agit là de favoriser la paix des ménages. Certaines personnes peuvent en effet, se sentir dans l’impossibilité d’agir contre la personne avec laquelle elles sont liées. Mais il ne s’agit que d’un sentiment. Cela ne signifie pas que d’autres personnes, moins sensibles à ce genre de considérations, ne puissent pas engager une action contre l’autre membre du couple avant leur séparation. Simplement, si elles ne le font pas, le délai pour agir est paralysé jusqu’à la séparation.
Le régime de la suspension était donc parfaitement à même de s’appliquer à la situation présente et aurait sans doute conduit à des situations moins choquantes que celles que l’on peut d’ores et déjà prévoir. La question de la computation des délais n’aurait pas non plus été problématique.
3.2. La prorogation des délais pour les mesures administratives et juridictionnelles
A côté des délais à la charge des parties, un régime de prorogation des délais a également été créé pour les mesures en particulier juridictionnelles. Après en avoir à nouveau délimité le champ matériel (3.2.1.) et temporel (3.2.2.), il faudra en envisager les implications pratiques (3.2.3.).
3.2.1. Le champ matériel de la prorogation de délai
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit une prorogation de délai pour les mesures suivantes :
- les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
- les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
- les autorisations, permis et agréments ;
- les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
- les mesures d’aide à la gestion du budget familial.
Il en est de même pour les mesures :
- de protection juridique des majeurs et des victimes de violence [14] (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art 12) ;
- et d’assistance éducative et d’aide à la gestion du budget familial (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art 13)
Dans ces cas de figure, il ne s’agit plus de prolonger un délai imparti aux particuliers pour agir mais d’augmenter la durée d’une mesure administrative ou juridictionnelle décidée par une autorité comme une juridiction ou certains organes administratifs [15].
On notera à ce sujet que les mesures conservatoires dont il est question ici ne sont sans doute pas les mesures conservatoires du Code des procédures civiles d’exécution mais celles que, par exemple, le juge des référés peut prendre (C. proc. civ., art. 835 N° Lexbase : L9135LTI pour le tribunal judiciaire et article 873 N° Lexbase : L0850H4A pour le tribunal de commerce). Tout d’abord, formellement, le préambule de l’ordonnance n° 2020-306 ne vise pas le Code des procédures civiles d’exécution, au contraire de l’ordonnance n° 2020-304. Ensuite, pratiquement, il serait étrange que les délais de dénonciation des saisies conservatoires de créances et des saisies-attribution soient traités différemment alors qu’ils sont de même durée (huit jours à compter de la saisie) et ont le même objet (informer le débiteur ou prétendu tel de la saisie).
3.2.2. Le champ temporel de la prorogation de délai
Temporellement, le moratoire ne concerne à nouveau que les mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cours de la période juridiquement protégée.
Les mesures dont le terme vient à échéance postérieurement à la période juridiquement protégée ne sont donc pas impactées.
3.2.3. Le report de plein droit de tous les délais de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée, sauf décision contraire ou cas particulier
Le moratoire mis en place a l’avantage de la simplicité. Les délais arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée sont prorogés de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de :
- deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée pour les mesures listées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 et pour les mesures de protection juridique des majeurs et des victimes de violence ;
- un mois pour les mesures d’assistance éducative et d’aide à la gestion du budget familial.
On retrouve la même difficulté que pour les délais à la charge des parties quant à la computation des délais : faut-il considérer que la prorogation intervient le 24 juin 2020, jour de fin de la période juridiquement protégée, ou le lendemain, le 25 ? L’expression « suivant la fin de la période juridiquement protégée » nous fait pencher pour le 25. En l’absence de réponse claire, nous recommandons cependant encore de prendre comme point de départ de la prorogation, le 24 juin 2020.
C’est-à-dire que, sous réserve d’abréviation ou de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, les mesures listées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 ainsi que celles de protection juridique des majeurs et des victimes de violence sont prorogées au 24 août 2020 et celles d’assistance éducative et d’aide à la gestion du budget familial sont prorogées au 24 juillet 2020. Ce mécanisme se rapproche par conséquent davantage d’une « prorogation » que celui bénéficiant aux délais à la charge des parties. En effet, il fixe une date de prorogation unique pour toutes les mesures concernées, quel que soit leur délai initial.
Cependant, l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précise que « le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020 ». A contrario, les mesures prises après le 12 mars 2020 et qui arriveraient à échéance avant la fin de la période juridiquement protégée sont donc obligatoirement prorogées. L’hypothèse est étrange. Reste à voir si elle se présentera en pratique puisque l’on peut espérer que le juge ou l’administration qui prononcera la mesure prévoira spontanément que sa date d’échéance soit postérieure à la date de prorogation.
Le juge peut également mettre fin aux mesures de protection juridique des majeurs et des victimes de violence qu’il prononce ou peut en modifier le terme en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-304. Il n’est pas ici fait de distinction selon que la mesure a été prononcée avant ou après le 12 mars 2020.
Enfin, s’agissant des mesures d’assistance éducative et d’aide à la gestion du budget familial, l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-304 permet également d’y mettre fin avant l’expiration du délai de prorogation mais il ne semble pas qu’une modification du terme soit possible. Là aussi, il n’est pas ici fait de distinction selon que la mesure a été prononcée avant ou après le 12 mars 2020.
Dans tous ces cas, l’effectivité de la prorogation légale de la mesure demeure, donc, en grande partie soumise au bon vouloir des pouvoirs administratifs et judiciaires. Cette souplesse était nécessaire en raison de la diversité des situations à traiter et de l’impossibilité pour les autorités de prévoir une telle situation. Mais la précarité pour les justiciables du système mis en place doit être relevée.
La fragilité de ce mécanisme tient, également, au fait que les mesures visées par la prorogation sont limitativement énumérées. A contrario, les mesures qui ne sont pas visées par ces trois articles et qui expirent entre le 12 mars 2020 et la fin du mois qui suit la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire prennent donc fin à la date prévue initialement, sauf si le juge a renouvelé la mesure ou en a prorogé le terme.
Finalement, les différentes hypothèses en la matière peuvent être synthétisées ainsi en prenant, encore une fois par prudence, le 24 juin 2020 comme point de départ du délai de prorogation.

4. La paralysie ou la suspension de certaines mesures et certains délais particuliers
Concernant certaines mesures et certains délais particuliers, le Gouvernement a fait le choix de ne pas appliquer le régime de prorogation ad hoc mis en place mais de privilégier un régime s’apparentant à la suspension dans le cas des astreintes (4.1.), voire la suspension elle-même dans le cas des délais en matière de saisie immobilière (4.2.).
4.1. La paralysie des mesures en matière d’astreinte
Chacun sait que l’astreinte est une « condamnation pécuniaire accessoire » [16] destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter et qu’elle est distincte des dommages et intérêts [17]. Dans la mesure où l’état d’urgence sanitaire rend parfois difficile l’exécution volontaire des décisions de justice, il paraissait naturel de ne pas alourdir inutilement le passif des débiteurs.
Deux régimes distincts ont été prévus, l’un pour les astreintes ayant déjà pris effet avant la période juridiquement protégée (4.1.1.), l’autre pour celles devant prendre effet pendant celles-ci (4.1.2.).
4.1.1. La suspension des astreintes ayant pris effet avant le début de la période juridiquement protégée, le 12 mars 2020
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a prévu que « le cours des astreintes […] qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période [juridiquement protégé] ».
Temporellement, ainsi qu’il a été vu, le 12 mars 2020 correspond à la date de début de la période juridiquement protégée.
Matériellement, on retrouve ici la notion usuelle de suspension qui arrête temporairement le cours d’un délai sans effacer le délai déjà couru au sens de l’article 2230 du Code civil (N° Lexbase : L7215IAH). Les astreintes suspendues pendant la période juridiquement protégée recommenceront donc à courir à compter de l’issue de celle-ci soit, en l’état, au 25 juin 2020 (le cours de l’astreinte restant suspendu le dernier jour de la période juridiquement protégée, le 24 juin 2020).
Le schéma ci-dessous illustre la situation :
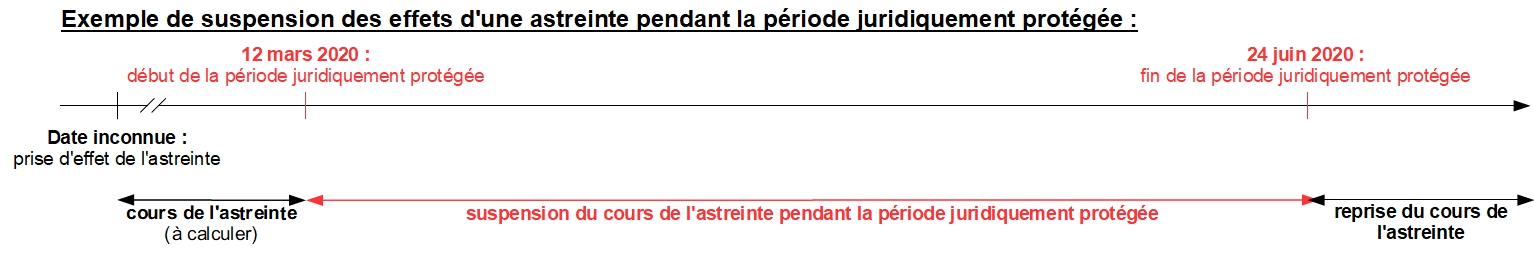
4.1.2. Le report des astreintes prenant effet au cours de la période juridiquement protégée
Pour les astreintes qui devaient prendre effet après le 12 mars 2020 et pendant la période juridiquement protégée, le même article prévoit qu’elles seront « réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période juridiquement protégé ». Celles-ci prendront cours « à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme ».
De façon étonnante, on retrouve dans ce dernier cas la terminologie que le Code civil employait pour la suspension du délai de prescription avant la réforme de 2008. L’ancien article 2251 (N° Lexbase : L2539ABN), en tête de la section du Code civil sur « [l] causes qui suspendent le cours de la prescription », prévoyait en effet, dans une tournure aujourd’hui sibylline, que « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ». S’agissant de la cause de suspension déjà évoquée au sein du couple, l’article 2253 (N° Lexbase : L2541ABQ) prévoyait alors que « la prescription ne court point entre époux ».
Il est cependant douteux que le Gouvernement ait voulu ainsi rendre hommage au langage juridique des rédacteurs du Code civil de 1804. Plus vraisemblablement, en visant une absence de prise de cours ou de production d’effet des astreintes venant à échéance au cours de la période juridiquement protégée, il a voulu passer l’idée d’un « report » au sens courant du terme. On peut regretter cette difficulté manifeste du Gouvernement à manier le langage et les concepts juridiques, ce qui complexifie et obscurcit largement son propos pour les professionnels du droit au lieu de le clarifier.
En tout état de cause, en prévoyant un délai supplémentaire d’un mois après la période juridiquement protégée pour exécuter l’obligation assortie d’une astreinte, l’astreinte ne recommencera donc à courir que deux mois et non un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire soit, en l’état, au 25 juillet 2020.
L’existence d’un tel délai se comprend dans la mesure où il faut bien laisser aux débiteurs l’opportunité d’exécuter volontairement la décision de justice qui les condamne. La rigidité de sa durée passe, en revanche, pour perfectible. C’est un délai bien trop long pour les débiteurs qui ont les moyens de s’exécuter immédiatement et qui auront bénéficié d’au moins deux mois et de jusqu’à plus de quatre mois de répit pour les astreintes qui auraient dû prendre effet entre les 12 et 24 mars 2020. En même temps, c’est un délai bien trop court pour ceux qui auront souffert des conséquences économiques de cette situation exceptionnelle. Reste que ce choix aura le mérite de simplifier les calculs et garantira une certaine sécurité juridique.
Quoi qu’il en soit, le schéma ci-dessous illustre la situation :
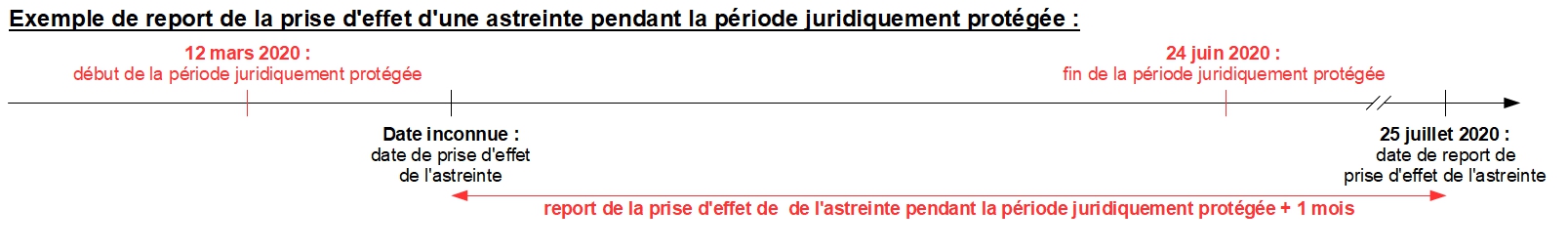
4.2. La suspension des délais en matière de saisie immobilière
Un régime particulier a enfin été réservé aux délais en matière de saisie immobilière. En effet, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prévoit que « les délais mentionnés aux articles L. 311-1 (N° Lexbase : L5865IRN) à L. 322-14 (N° Lexbase : L5892IRN) et R. 311-1 (N° Lexbase : L2387ITL) à R. 322-72 (N° Lexbase : L2491ITG) du Code des procédures civiles d’exécution sont suspendus pendant la période mentionnée à l’article 1er ». Ces articles du Code des procédures civiles d’exécution correspondent aux délais appliqués en matière de saisie immobilière, du commandement de payer valant saisie à l’adjudication de l’immeuble.
Les délais correspondant à la distribution du prix qui se trouvent aux articles L. 331-1 (N° Lexbase : L5893IRP) à L. 331-33 (N° Lexbase : L2502ITT) et R. 331-1 (N° Lexbase : L2492ITH) à R. 334-3 (N° Lexbase : L2510IT7) du Code des procédures civiles d’exécution ne sont, quant à eux, pas visés. Il faut donc en déduire qu’ils ne sont pas suspendus mais sont soumis aux autres régimes instaurés par les ordonnances n° 2020-304 et 2020-306.
Il en est de même de la saisie immobilière dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Pour rappel, celle-ci, dénommée « exécution forcée sur les biens immeubles », suit un régime à part aux termes de l’article L. 341-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5896IRS). Ce régime est fixé par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en particulier ses articles 141 et suivants.
S’agissant d’une procédure longue, coûteuse et complexe, « les raisons de l’exclusion de la saisie immobilière restent mystérieuses et inexplicables » [18]. Et l’on ne comprend pas plus que les délais relatifs à la distribution du prix d’adjudication[19] fassent l’objet d’un traitement différencié alors même que la Cour de cassation a précisé que la saisie immobilière et la distribution étaient les deux phases d’une même procédure [20]. De même pour la procédure d’exécution forcée sur les biens immeubles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Volontaire ou involontaire, une telle lacune reste regrettable.
En tout état de cause, la suspension des délais proclamée par l’ordonnance n° 2020-304 laisse perplexe car la procédure de saisie immobilière mêle des délais à la charge des parties mais aussi des délais de procédure fixés par le juge. De plus, certains délais se comptabilisent en jours et d’autres en mois, ce qui pose un problème de computation.
En voici un premier exemple :
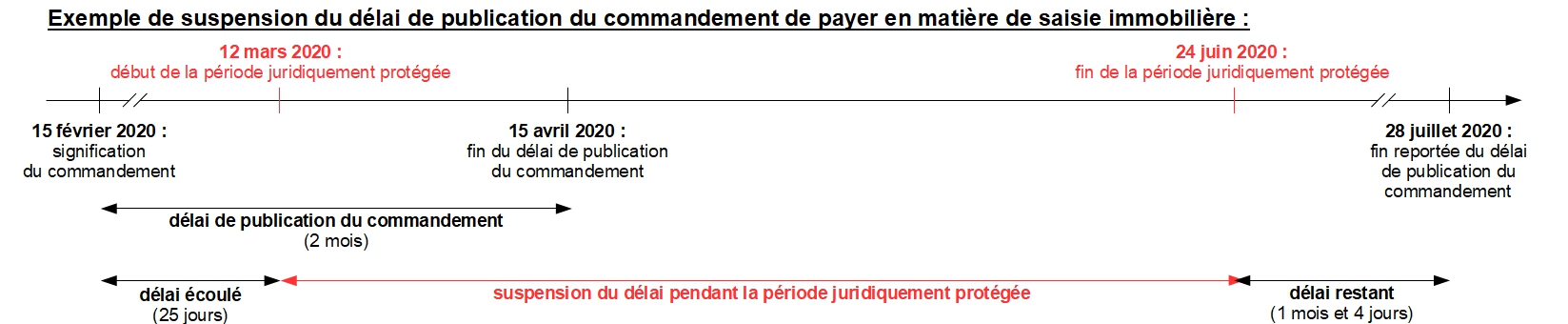
Dans l’exemple ci-dessus, un commandement de payer valant saisie est signifié le 15 février 2020. Le délai de publication est de deux mois (C. proc. civ. exécution art. R. 321-6 N° Lexbase : L7862IUQ), soit jusqu’au 15 avril 2020. Mais le délai a été suspendu le 12 mars 2020 et recommencera donc à courir à l’issue de la période juridiquement protégée soit, par hypothèse, le 25 juin 2020 (les délais restants suspendus le dernier jour de la période juridiquement protégée, le 24 juin 2020).
Quel est alors le délai restant à courir ? Vingt-cinq jours se sont écoulés entre la signification le 15 février et le 11 mars 2020, dernier jour avant la suspension. Mais cela est indifférent : s’agissant d’un délai exprimé en mois, il est calculé de quantième à quantième aux termes du deuxième alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile. Au moment de la suspension, il restait donc un mois et quatre jours à courir sur le délai de publication. Celui-ci reprenant son cours le 25 juin 2020, il s’éteindra donc le 28 juillet 2020, un mois et quatre jours plus tard, ce selon la règle de computation des délais exprimés en mois et en jours aux termes du troisième alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile.
Ce premier exemple ne pose pas de difficultés majeures. En voici un second qui laisse plus perplexe. Il mêle des délais à la charge des parties mais aussi du juge :
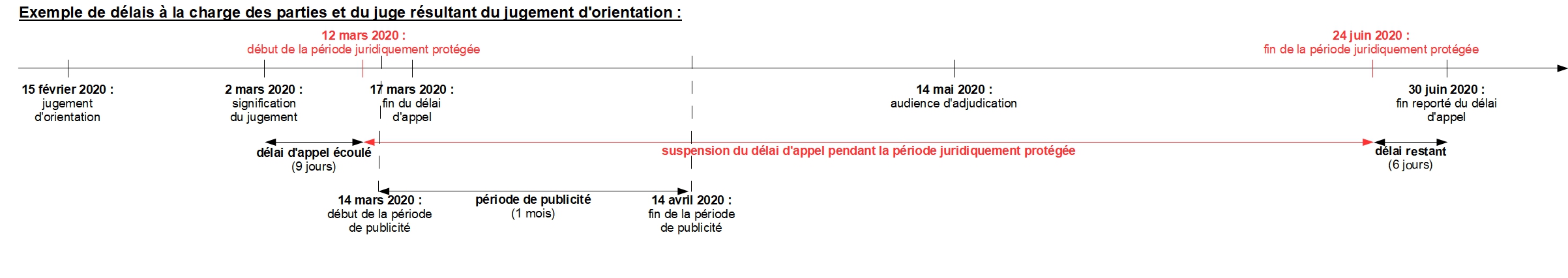
Dans l’exemple ci-dessus, un jugement d’orientation a été rendu le 15 février 2020. Il a fixé la date de l’audience d’adjudication au 14 mai 2020, soit dans le délai de deux à quatre mois de son prononcé prévu par l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2445ITQ). Le jugement d’orientation a été signifié le 2 mars 2020. Le délai d’appel est de quinze jours (C. proc. civ. exécution, art. R. 311-7 N° Lexbase : L7260LEM), soit jusqu’au 17 mars 2020. Mais le délai a été suspendu après le 11 mars 2020. Neuf jours se sont donc écoulés et le délai recommencera à courir à l’issue de la période juridiquement protégée soit, par hypothèse, le 25 juin 2020. Il s’éteindra donc le 30 juin 2020, le délai étant exprimé en jours et six jours restant à courir au moment de la suspension.
La vente forcée doit faire l’objet de mesures de publicité dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-31 N° Lexbase : L4956LTQ), soit, en l’espèce, entre le 14 mars 2020 et le 14 avril 2020. Mais ces dates sont en pleine période juridiquement protégée. Selon le texte de l’ordonnance n° 2020-304, ces délais sont suspendus. Mais comment la vente peut-elle avoir lieu sans publicité ? Par ailleurs, le tribunal maintiendra-t-il l’audience du 14 mai 2020 alors que les enchérisseurs ne pourront sans doute pas s’y présenter ? La suspension des délais ne permet pas de répondre à ces questions.
Il est à espérer que les juges de l’exécution fassent preuve de pragmatisme et, dans le souci d’une bonne administration de la justice, ordonne le report de l’adjudication sur le fondement combiné de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, des ordonnances n° 2020-304 et 306 du 25 mars 2020 et de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L6800LEL) en constatant un cas de force majeure.
Au surplus, dans notre exemple, le report permettra, également, l’exercice de l’appel du jugement d’orientation - reporté au 29 juin 2020 et offrira au poursuivant, la possibilité, si la cour d’appel n’a pas statué un mois avant la date de l’adjudication, de solliciter un second report en vertu de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2438ITH).
A défaut, il est à craindre que les procédures de saisie immobilière qui étaient déjà avancées au 12 mars 2020 fassent l’objet d’un contentieux important et complexe lorsque les tribunaux reprendront leur activité normale.
En tout état de cause, les perturbations actuelles au niveau des cabinets d’avocats et des juridictions risquent de faire sortir les procédures de saisie immobilière de leur trajectoire habituelle. Quoi qu’il en soit de l’effet interruptif des délais pendant la période juridiquement protégée, les praticiens doivent donc faire preuve de la plus grande vigilance sur le suivi de leurs dossiers. S’il apparaît que la date de péremption du commandement de payer valant saisie est proche de celle à laquelle la procédure de saisie sera remise en ordre, une ordonnance de prorogation des effets du commandement devra être sollicitée du juge de l’exécution au visa de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2419ITR) et publiée au service de la publicité foncière. A défaut, le risque est d’avoir à recommencer la procédure depuis le début.
[1] C. Chainais, Fr. Ferrand, L. Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, 34e éd., Dalloz, 2018, n° 1043.
[2] Tel a été le cas avec la loi n°74- 1115 du 27 décembre 1974 pour la grève des P. et T. (N° Lexbase : L6451LWT)
[3] Tel a été le cas avec l’ordonnance n° 706 du 29 juin 1962 suspendant les délais à compter du 1er avril 1962, à la suite des événements en Algérie (N° Lexbase : L6453LWW).
[4] L’article 22 du même texte indiquant que « la présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’Etat ».
[5] V. en ce sens : C. Auché, N. De Andrade, « Coronavirus : impact sur les délais pour agir et les délais d’exécution forcée en matière civile », D. actu. 30 mars 2020.
[6] Pour reprendre une expression figurant dans la circulaire du 26 mars 2020.
[7] Le texte emploie par deux fois l’expression « prescrit par la loi ou le règlement ».
[8] Tel est, par exemple, le cas pour la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir (C. civ., art. 2234 N° Lexbase : L7219IAM) ou celui de la force majeure en matière contractuelle (C. civ., art. 1218 N° Lexbase : L0930KZH).
[9] Circulaire du 26 mars 2020.
[10] G. Cornu, Vocabulaire juridique, 13e éd., PUF, 2020.
[11] Même si, théoriquement, les actes peuvent encore être valablement accomplis pendant la période de confinement.
[12] Même si le nouveau délai de procédure ne sera pas toujours de la même durée que l’ancien.
[13] Elle permet aussi de justifier l’application commune de la « prorogation » aux délais de prescription et de forclusion. V. en ce sens : C. Auché, N. De Andrade, op. cit.
[14] Au sens des articles 515-9 (N° Lexbase : L2997LUK) à 515-13 (N° Lexbase : L9318I3I) du Code civil.
[16] G. Cornu, op. cit.
[17] C. proc. civ. exécution, art. L. 131-2 (N° Lexbase : L5816IRT)
[18] Fr. Kieffer, Saisie immobilière et covid-19 : Ô temps suspends ton vol… , D. actu. 31 mars 2020.
[19] C. proc. civ. exécution, art. L. 331-1 à L. 334-1 et R. 331-1 à R. 334-3.
[20] Cass., avis, 15 mai 2008, n° 0080003P (N° Lexbase : N9992BES).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472925
[Brèves] Covid-19 : modification des règles applicables au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie
Réf. : Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020, modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L6270LW7)
Lecture: 2 min
N2891BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 08 Avril 2020
► Un décret, publié au Journal officiel du 3 avril 2020 (décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 N° Lexbase : L6270LW7), modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L6019LWT ; lire N° Lexbase : N2836BYP).
Comme annoncé par le Gouvernement, ce texte ouvre le bénéfice du fonds aux entreprises ayant subi durant le mois de mars une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 %, au lieu de 70 % précédemment.
Par ailleurs, il modifie les dispositions relatives aux documents justificatifs devant accompagner la demande d’aide. Ainsi, alors qu’initialement devait notamment être joint à la demande d’aide une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020, cette déclaration sur l’honneur doit désormais attester que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement.
Enfin, le décret précise les échanges de données nécessaires à l'instruction des demandes complémentaires de l’aide forfaitaire de 2 000 euros. Ainsi il est prévu que « des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire […], pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472891
[Textes] La justice civile à l’heure du confinement : une procédure dérogatoire du 21ème siècle
Réf. : Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT)
Lecture: 26 min
N2899BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Etienne Vergès, professeur à l’Université Grenoble Alpes
Le 09 Avril 2020
Mots clés : procédure civile • covid-19 • période dérogatoire • juge unique • renvoi d'audience • audiences à distance • procédures sans audience • échanges • contradictoire • décision
La justice doit s’adapter à la menace du coronavirus et au confinement généralisé qui en est la conséquence juridique. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 » (N° Lexbase : L5506LWT) a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance « les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ».
Ces règles dérogatoires doivent avoir pour seules fins « de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances ». En d’autres termes, la loi autorise le Gouvernement à prendre toute mesure de procédure civile destinée à permettre aux magistrats aux avocats, aux greffiers et autres personnels de justice, de travailler en situation de confinement ou, à tout le moins, de tenir des audiences dans des conditions permettant d’assurer le respect des règles de distanciation sociale.
L’habilitation tout juste votée, le Gouvernement s’est empressé de publier plusieurs ordonnances concernant la justice civile et pénale. Parmi ces textes, l’ordonnance n° 2020-304 crée un régime procédural dérogatoire qui institue une nouvelle forme de procédure, laquelle s’inscrit parfaitement dans les évolutions de la justice civile amorcées depuis le début des années 2000.
Le recours aux ordonnances : une voie atypique en procédure civile
On peut douter de l’efficacité et de l’opportunité d’avoir recours à une ordonnance pour modifier les règles de procédure civile. La matière relève de la compétence du pouvoir réglementaire. Le domaine de la loi est cantonné à la création de nouveaux ordres de juridiction et au statut des magistrats [1]. Or, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 relèvent quasi-exclusivement de la procédure civile pure. Il aurait donc été plus judicieux d’avoir recours au règlement pour établir ce régime dérogatoire. Une fois ratifiée, l’ordonnance aura une valeur législative et, par conséquent, elle sera théoriquement inapte à modifier le Code de procédure civile.
Prise dans la vague des vingt-cinq « ordonnances état d’urgence sanitaire » la réforme temporaire de la procédure civile suit assurément la mauvaise voie, mais cette question liée aux sources du droit paraît quelque peu dérisoire au regard de l’enjeu de cette réforme.
Le domaine d’application du régime dérogatoire : la « matière non pénale »
L’article 1er de l’ordonnance précise que ses dispositions « sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ».
Le recours à l’expression « matière non pénale » n’est pas courant, et l'on a plutôt l’habitude de désigner le domaine concerné comme étant celui des « juridictions civiles » entendues au sens large : le tribunal judiciaire, la cour d’appel, le tribunal de commerce, le conseil des prud’hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux. Il s’agit aussi, dans une certaine mesure, du contentieux devant certains juges de ces juridictions, et en particulier le juge des libertés et de la détention, compétent dans des matières que l’on peut qualifier de « non pénales » : le contentieux du droit des étrangers et celui des soins sans consentement.
La circulaire d’application (N° Lexbase : L6210LWW), qui explicite les dispositions de l’ordonnance donne également une indication précieuse s’agissant des matières concernées devant ces juridictions : le régime s’applique en matière civile, commerciale, sociale, fiscale, mais aussi en matière disciplinaire [2].
La période dérogatoire, dite « période juridiquement protégée »
L’expression « période juridiquement protégée » utilisée par la circulaire désigne la période durant laquelle le régime dérogatoire institué par l’ordonnance vient se substituer aux règles de procédure civile en vigueur devant les juridictions visées ci-dessus [3].
L’article 1er de l’ordonnance dispose que cette période est comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT). Selon cet article, la période originelle de l’état d’urgence sanitaire est de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 25 mars 2020, lendemain du jour de sa publication.
Le régime dérogatoire est donc établi jusqu’au 25 juin 2020 au moins. Toutefois, la loi du 23 mars prévoit que l’état d’urgence sanitaire peut être prorogé par une nouvelle disposition législative.
Le régime dérogatoire institué par l’ordonnance utilise tous les outils de la procédure civile moderne, de l’usage de la communication électronique à la procédure sans audience, en passant par le juge unique, le tout marqué par un assouplissement du formalisme procédural.
Nous proposons ici un exposé et une analyse de l’ordonnance en suivant, non pas une lecture article par article, mais plutôt une approche thématique.
1. Compétence et composition des juridictions
Le dépaysement des dossiers
L’article 3 de l’ordonnance organise un mécanisme de transfert de compétence entre plusieurs juridictions de premier ressort relevant d’une même cour d’appel. Ce mécanisme doit permettre de pallier la défaillance d’une juridiction, qui serait due à la perte sensible d’une partie de son personnel, soit en raison de la maladie, soit comme conséquence du confinement. La disposition évoque, ainsi, l’hypothèse dans laquelle une juridiction du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner. Le premier président de la cour d’appel peut, ainsi, désigner par ordonnance une autre juridiction de même nature et de même ressort au sein de la cour d’appel pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
A la lecture de la circulaire, il apparaît que ce mécanisme de dépaysement a vocation à s’appliquer de façon tout à fait exceptionnelle, les chefs de juridiction ayant déjà la possibilité d’opérer des transferts de personnels (magistrats, greffiers), d’une juridiction à l’autre en ayant recours à des délégations.
S’il a lieu, le dépaysement peut porter sur les contentieux relatifs à certaines matières ou à certaines procédures particulières (ex. le référé). Le premier président de la cour d’appel doit, avant de prendre son ordonnance de dépaysement, solliciter l’avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées.
L’ordonnance doit être publiée dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et la circulaire suggère, également, la publication sur le site internet de la cour d’appel et des juridictions de première instance concernées. Il est donc recommandé de consulter régulièrement ces sites internet pour prendre connaissance d’éventuels transferts de compétence.
La composition à juge unique
L’ordonnance modifie substantiellement la composition des juridictions afin d’écarter les hypothèses dans lesquelles les juges doivent se réunir pour délibérer. Elle consacre le télétravail des magistrats. L’article 5 de l’ordonnance prévoit, ainsi, que les juridictions peuvent statuer à juge unique dans toutes les situations ou l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision d’avoir recours à une procédure sans audience a lieu pendant la période juridiquement protégée. La généralité de la disposition vise, ainsi, toutes les procédures en état susceptibles d’être jugées en première instance ou en appel. Toutefois, le recours au juge unique n’est pas généralisé à toutes les juridictions et l’ordonnance, complétée par la circulaire, tient compte des situations particulières qui sont synthétisées dans le tableau suivant.
| Tribunal judiciaire et Cour d’appel | Le président de la juridiction peut décider d’une composition à juge unique. L’affaire est jugée par un magistrat du siège. |
| Pôles sociaux du tribunal judiciaire | Le magistrat du siège statue sans les assesseurs représentant respectivement le collège des salariés et celui des employeurs |
| Tribunal paritaire des baux ruraux | Le magistrat du siège statue sans les assesseurs représentant les bailleurs et preneurs |
| Tribunal de commerce | Le président du tribunal de commerce peut confier le rapport au juge chargé de l’instruction de l’affaire, qui rapportera à la formation collégiale. Cette décision est applicable à tous les contentieux, y compris aux procédures collectives. Elle n’est pas soumise à l’accord des parties. |
| Conseil de prud’hommes | Il statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié |
Les règles de compositions des juridictions issues de l’article 5 de l’ordonnance comportent plusieurs nuances. D’une part, la composition dérogatoire peut être automatique (conseil des prud’hommes [4]) ou soumise à la décision du président de la juridiction (tribunal judiciaire, cour d’appel, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux). D’autre part, la composition de la juridiction est, soit composée d’un juge unique (tribunal judiciaire, cour d’appel, tribunal paritaire des baux ruraux), soit d’une collégialité aménagée (juge rapporteur ou formation restreinte).
En ce qui concerne spécifiquement le tribunal judiciaire, la circulaire précise que les compétences de droit commun qui peuvent être dévolues aux magistrats à titre temporaire en application de l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 sont maintenues (N° Lexbase : L5336AGQ). Par exemple, les magistrats à titre temporaire (MTT) peuvent continuer à occuper les fonctions de juge du contentieux de la protection.
S’agissant spécifiquement du conseil de prud’hommes, la circulaire précise que la saisine préalable du bureau de conciliation et d’orientation demeure obligatoire et que le recours à la formation de départage continue, le cas échéant, de s’appliquer.
2. La tenue des audiences
Les audiences sont les phases de la procédure les plus problématiques au regard des risques de contamination. Aussi, l’ordonnance prévoit plusieurs dispositifs visant à éliminer ou réduire ces risques. Le plus radical consiste dans le report l’audience. De façon plus nuancée, l’audience peut se tenir en condition de publicité réduite, ou par visioconférence.
Les audiences reportées
Le juge est le maître du rythme du procès. Il dispose, en droit commun, de la faculté de renvoi, tant des audiences, que des auditions des parties. L’ordonnance adapte la procédure du renvoi à la nécessité d’en informer les parties de façon simple et efficace, mais également dans le but prévenir l’absence d’une partie à l’audience qui a fait l’objet du renvoi.
L’information des parties sur les renvois
L’article 4 de l’ordonnance prévoit que, lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, notamment électronique. Cet assouplissement du formalisme d’information des parties s’applique dans les cas suivants :
- les parties sont assistées ou représentées par un avocat ;
- les parties non représentées et non assistées ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » conformément à l’article 748-8 Code de procédure civile (N° Lexbase : L1185LQX).
La circulaire énumère les différents modes de communication qui sont offerts aux greffes et qui varient en fonction des justiciables ou des juridictions. Nous les présentons dans le tableau suivant.
| Mode de communication | Situation concernée |
| RPVA | Lorsque la procédure est enregistrée sur WinciTGI ou WinciCA (cela ne concerne pas les tribunaux de proximités) |
| Courriel |
|
| Lettre simple | En toute situation |
| Modes de communication publics des audiences reportées
| En toute situation |
La partie absente à l’audience qui a fait l’objet d’un renvoi : priorité au jugement par défaut
L’assouplissement du formalisme destiné à informer les parties d’un renvoi crée un risque de défaut d’information, et par conséquent, d’absence d’une partie à l’audience. En droit commun, en l’absence d’une partie qui a été régulièrement citée à personne, la juridiction rend une décision réputée contradictoire. Le jugement est encore réputé contradictoire lorsque la partie qui n’a pas été citée à personne dispose d’un droit d’appel contre la décision. En revanche, la décision est rendue par défaut, et susceptible d’opposition devant une juridiction de même degré, lorsque deux conditions sont cumulées : la partie n’a pas été citée à personne et la décision est rendue en dernier ressort (C. proc. civ., art. 473 N° Lexbase : L1185LQX).
L’ordonnance assouplit ce dispositif. L’article 4, alinéa 2, dispose que « si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut ». Une des deux conditions pour que le jugement par défaut soit rendu est donc supprimée. Dans le dispositif dérogatoire, pour que la partie soit jugée par défaut à l’audience qui a fait l’objet d’un renvoi, il suffit qu’elle n’ait pas été citée à personne. Cette partie peut alors former une opposition contre le jugement et être jugée une nouvelle fois en première instance. De surcroît, son droit d’appel est préservé.
La disposition apparaît claire, mais sa lecture est rendue complexe par la nécessité de combiner les deux alinéas de l’article 4 de l’ordonnance. En effet, l’extension de la procédure par défaut n’est prévue que lorsque le justiciable n’est pas assisté ou représenté par un avocat, et qu’il n’a pas non plus consenti à la dématérialisation de la procédure. Dès lors, pour comprendre le mécanisme du défaut dans son ensemble, il faut une nouvelle fois se référer à la circulaire selon laquelle :
« la décision est toujours rendue par défaut, y compris lorsqu’elle est susceptible d’appel, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
• le défendeur n’a pas été assisté ou représenté par un avocat ;
• le défendeur n’a pas consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la Justice ;
• le défendeur ne comparaît pas à l’audience de renvoi ;
• le défendeur n’a pas été cité à personne. »
En définitive, l’ordonnance n’assouplit pas fondamentalement les conditions nécessaires pour rendre un jugement par défaut. Certes, elle supprime une condition, mais elle en ajoute deux autres.
La restriction de la publicité de l’audience
Lorsque l’audience a lieu, l’article 6 de l’ordonnance donne au président de la juridiction le pouvoir de restreindre la publicité avant l’ouverture de l’audience. Plusieurs possibilités s’offrent à lui.
Il peut :
- décider que les débats se déroulent en publicité restreinte (c’est-à-dire limiter le nombre de personnes dans la salle d’audience) ;
- décider que les débats se tiennent en chambre du conseil (en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience) ;
- autoriser des journalistes à assister à l’audience, quelle que soit la mesure de la restriction de la publicité, étant entendu que cette autorisation est impossible dans les cas où la chambre du conseil est requise par le droit commun (assistance éducative, matière familiale, etc.).
Selon la circulaire, et dans le silence de l’ordonnance, la restriction de la publicité peut concerner l’ensemble des audiences d’une juridiction. La décision est alors prise par le président de la juridiction et doit faire l’objet de mesures de publicité et d’affichage adaptées.
A dire vrai, ces mesures relatives à la restriction de la publicité des audiences à l’égard du public semblent quelque peu surabondantes au regard des restrictions de circulation liées au confinement des Français. Aucune formule de l’autorisation de déplacement dérogatoire ne permet d’assister à une audience pour une raison autre que professionnelle. On imagine donc aisément que, hormis quelques journalistes, le public n’afflue pas dans les salles d’audience des juridictions civiles. Mail il convient de rappeler que l’ordonnance a vocation à s’appliquer dans un délai qui s’étendra au-delà du confinement. La restriction de la publicité trouvera, alors, toute sa raison d’être.
Les audiences à distance
L’article 7 de l’ordonnance autorise tout juge [5] ou président de formation de jugement à avoir recours à des procédés permettant de tenir l’audience à distance, c’est-à-dire
- la visioconférence
- à défaut de moyens techniques, tout autre moyen de communication électronique, notamment téléphonique.
Quelle que soit la technique utilisée, le juge doit s’assurer de l’identité des parties, de la qualité de la transmission et de la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Cette dernière précision est d’autant plus importante que l’avocat peut participer à cette audience dans un lieu différent de celui de son client. Autrement dit, chaque protagoniste peut intervenir depuis son lieu de confinement.
La décision du juge (ou du président) est une mesure d’administration judiciaire, qui n’a pas à être motivée et qui est insusceptible de recours.
3. Les procédures sans audience
La procédure sans audience est une pratique procédurale qui a été consacrée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L1578LUY). Cette procédure peut être mise en œuvre dans le cadre d’une procédure écrite, mais également orale. Le principe fondamental qui sous-tend la mise en œuvre de cette procédure est celui du consentement préalablement exprimé par les parties.
L’article 8 de l’ordonnance déroge à ce principe de plusieurs manières.
En premier lieu, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, de sa propre initiative et sans demander l’accord des parties, que la procédure se déroulera sans audience. Cette initiative ne concerne que les procédures dans lesquelles la représentation est obligatoire et celles dans lesquelles les parties sont, de fait, assistées ou représentées par un avocat. Les parties sont informées du choix du juge par tout moyen [6]. Si elles souhaitent s’opposer à la procédure sans audience, les parties doivent le faire dans les quinze jours. Par conséquent, le principe du consentement est finalement respecté. Mais, en réalité, le risque pour la partie qui s’y oppose est de voir l’audience renvoyée à une date indéterminée. Ça n’est donc pas une décision nécessairement judicieuse, sauf à utiliser cette opposition comme une stratégie dilatoire, c’est-à-dire celle d’un défendeur qui, sachant sa situation mal engagée, va utiliser la période d’urgence sanitaire pour tenter d’échapper un temps à une décision inéluctable. Le juge pourrait, alors, contrer cette stratégie dilatoire en décidant de tenir une audience à juge unique et en publicité restreinte ou en chambre du conseil.
En second lieu, la procédure sans audience peut, dans certains cas, être imposée par le juge. Il s’agit des procédures en référé, des procédures accélérées au fond [7] et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé [8], les parties ne peuvent alors s’opposer à la décision du juge.
Lorsque la procédure suit la voie « sans audience », la communication entre les parties est faite par notification entre avocats, solution qui se comprend puisque cette procédure ne concerne que des parties assistées ou représentées par un avocat.
Par ailleurs, la circulaire suggère aux magistrats d’inciter les parties à recourir à une mise en état conventionnelle du litige. Cette procédure, plutôt lourde puisqu’elle nécessite la conclusion d’une convention de procédure participative entre les parties, et qu’elle peut conduire au retrait du rôle, pourrait néanmoins trouver une occasion opportune de s’appliquer dans ce contexte de crise. Elle permettrait de réduire les échanges et de favoriser une mise en état purement écrite entre les parties. Cette solution n’est pourtant pas envisageable dans toutes les situations, et notamment si l’affaire nécessite la mise en place d’une mesure d’expertise.
4. La liberté des échanges entre les parties
Le formalisme des échanges entre les parties disparaît avec l’article 6 de l’ordonnance qui dispose que « les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire ».
La communication entre les parties est donc libre dans toutes les procédures qui imposent que les parties échangent par lettre recommandée avec avis de réception [9].
La généralité des termes de cet article pourrait laisser penser que l’abandon du formalisme concerne toutes les procédures, en particulier celles soumises aux contraintes liées à la communication électronique, qu’elle soit obligatoire ou interdite.
Toutefois, la circulaire établit une distinction entre la « communication entre les parties » et la « communication avec la juridiction ». La première est libre, mais la seconde demeure soumise aux contraintes de la communication électronique obligatoire. La circulaire affirme, ainsi, que l’article 6 de l’ordonnance «relatif aux échanges entre les parties, ne déroge [...] pas aux articles 850 N° Lexbase : L9345LTB et 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 du Code de procédure civile, qui imposent de transmettre par voie électronique les actes de procédure au tribunal judiciaire en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe et à la cour d’appel ».
La circulaire rappelle également que, malgré la liberté des échanges, le choix du moyen de communication doit se faire en tenant compte de son aptitude à prouver que l’on a bien communiqué. Autrement dit, si un courriel ou un courrier recommandé peuvent utilement être assortis d’un avis de réception, cela n’est pas le cas d’un courrier simple, qui n’apporte aucune garantie, ni de réception ni de preuve de la réception. Ce rappel trivial n’en est pas moins utile notamment au regard des difficultés rencontrées durant cette crise par le transport du courrier.
5. Le référé expéditif
Le référé est par nature une procédure rapide. On a l’habitude de dire que le juge des référés est celui de l’urgence et de l’évidence. Le cliché n’est pas entièrement fidèle à la réalité, puisqu’il existe des référés sans évidence, tel que le référé probatoire de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). En revanche, la question de l’urgence réside bien dans l’ADN du référé.
Durant la période de crise sanitaire, les urgences doivent être priorisées et il s’avère que le juge des référés ne peut consacrer le même temps à toutes les urgences. Pour cette raison, l’article 9 de l’ordonnance aménage un mécanisme original de référé sans audience. Le texte énonce qu’« en cas d’assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé ». Ce référé, que nous qualifions d’expéditif, s’applique devant toutes les juridictions susceptibles d’être saisies selon cette procédure, y compris devant le premier président de la cour d’appel.
Le rapport au président de la République explique que cette procédure est destinée à éviter l’engorgement des audiences de référé qui ont été maintenues. Il s’agit, donc, de permettre à cette procédure du survivre en temps de crise, en concentrant le travail des juges sur les procédures qui méritent d’être examinées de façon approfondie.
Ce nouveau mécanisme pose de multiples questions.
D’abord, il s’agit de savoir ce que signifie la formule « s’il n’y a pas lieu à référé ». Le rapport et la circulaire n’éclairèrent pas vraiment le sens de l’article 9. Toutefois, il semble que la formule renvoie notamment à la condition de l’absence de contestation sérieuse. Ainsi, le juge saisi en référé de droit commun peut rejeter sans audience et sans débat contradictoire une demande qui lui paraît donner lieu à une contestation sur le fond.
Ensuite, il s’agit de savoir à partir de quelles pièces le juge peut rendre sa décision. S’il statue sans audience et par une ordonnance non contradictoire, cela ne signifie pas que la procédure ne l’est pas. Saisi par assignation, le juge peut avoir connaissance des pièces et écritures des parties. Ainsi, le débat peut avoir lieu par écrit, même sans audience. Mais cette hypothèse n’est pas la seule. Le juge peut aussi décider de rejeter sans audience une demande qui lui paraît irrecevable ou ne pas donner lieu à référé à la seule lecture de l’assignation.
Enfin, la question essentielle demeure celle du respect des principes fondamentaux de la procédure : le droit au juge, le principe du contradictoire, etc... Ces principes subissent ici une atteinte, mais ils ne sont pas violés. En effet, les parties disposent de différentes voies pour accéder à un juge et à un débat contradictoire. Elles peuvent exercer une voie de recours contre la décision du juge des référés [10]. Elles peuvent encore s’adresser au juge du fond. Ainsi, s’il y a bien une atteinte aux principes fondamentaux, cette atteinte n’est pas définitive et la partie dont la demande a été rejetée de façon expéditive dispose de plusieurs solutions pour rétablir l’accès au juge et au débat contradictoire. Provisoire et justifiée par l’état d’urgence sanitaire, cette procédure expéditive paraît donc satisfaire aux exigences du procès équitable.
6. La communication de la décision
L’article 10 de l’ordonnance dispose que « sans préjudice des dispositions relatives à leur notification, les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen ».
Cet énoncé laconique n’emporte pas un assouplissement du formalisme de la notification. En réalité la disposition instaure une modalité supplémentaire de communication de la décision qui vient s’ajouter à la notification. Cette double communication repose sur l’idée que la notification, par son formalisme lourd, risque de ne pas pouvoir être effectuée dans un délai raisonnable durant la période de crise sanitaire. Il est également probable que les justiciables ne puissent se déplacer à l’audience de prononcé de la décision. Pour autant, ces derniers doivent être tenus informés de l’existence et du sens de la décision.
La circulaire suggèr,e ainsi, à l’institution judiciaire de communiquer les décisions aux avocats des parties par RPVA, par courriel ou par dépôt dans leur case sur le lieu de la juridiction. Lorsque le justiciable n’est ni représenté ni assisté par un avocat, la circulaire préconise de l’informer par un appel téléphonique.
Comme le précise l’article 10 de l’ordonnance, cette communication ne constitue pas une notification. Elle n’en produit pas les effets. Elle ne permet pas de faire courir les délais de recours et elle ne rend pas la décision exécutoire. Il s’agit donc simplement d’éviter au justiciable d’avoir à se déplacer pour connaître la décision et d’attendre un délai trop long pour en avoir la communication.
En définitive, cette ordonnance adoptée dans l’urgence instaure un régime procédural équilibré et adapté à la situation de crise sanitaire et à l’impératif de distanciation sociale. On pourra arguer de l’atteinte à certains droits fondamentaux ou à certains principes de la procédure. Nous estimons, à l’inverse, qu’elle apporte une réponse à l’urgence et à la gravité de la situation et qu’elle permet surtout à l’institution judiciaire, dans son ensemble, de continuer à œuvrer pour que les justiciables soient défendus et que la justice puisse être rendue. Dominé par un esprit pratique, ce régime dérogatoire et provisoire emprunte à tous les instruments de la procédure civile moderne. Il pourrait bien inspirer des réformes futures de la justice.
[1] Constitution, art. 34 (N° Lexbase : L0860AHC).
[2] Circulaire du 26 mars 2020, JUSC2 2008609C, CIV/02/20, de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5954LWG)
[3] Selon la circulaire, les dispositions de l’ordonnance « introduisent des règles d’organisation ou de procédure qui dérogent ou écartent celles qui résultent de l’application des dispositions de procédure ».
[4] Ce recours automatique à la formation restreinte ressort d’une lecture littérale de l’article 5 de l’ordonnance, mais la circulaire affirme le contraire, en énonçant que « le président de la juridiction peut décider que le conseil statuera en formation restreinte, composée d’un conseiller employeur et un conseiller salarié ». Le rapport au président de la République fait apparaître la même interprétation (simple faculté pour le président de la juridiction). Cette interprétation étant contra legem, nous ne la partageons pas.
[5] Cette faculté est expressément prévue pour le juge des libertés et de la détention.
[6] En pratique, les avocats sont avertis par RPVA ou par courriel à leur adresse professionnelle.
[7] Pour rappel, la procédure accélérée au fond s’est substituée à l’ancienne procédure dite « en la forme des référés ».
[8] Il s’agit essentiellement des procédures non pénales devant le juge des libertés et de la détention.
[9] Procédure orale devant le tribunal judiciaire ou procédure devant le tribunal de commerce.
[10] La circulaire précise que l’ordonnance non contradictoire « est susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation selon le montant et la nature de la demande » (N° Lexbase : L5954LWG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472899
[Focus] Covid-19 : premier bilan des mesures mises en place en matière de fiscalité
Lecture: 20 min
N2981BY3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 09 Avril 2020
Lexbase Hebdo Edition Fiscale vous propose de dresser un premier bilan des mesures mises en places en matière de fiscalité face à l’épidemie de Covid-19.
I - Les mesures applicables aux entreprises
Les entreprises qui assurément sont en première ligne de cette crise sanitaire ont été les premières à bénéficier de mesures d’aide de la part du Gouvernement. L’objectif est clair : maintenir ou retrouver une trésorerie pour les entreprises.
A - Report des échéances fiscales
Le Gouvernement a donné la possibilité aux entreprises qui en avaient besoin de reporter les cotisations sociales et les impôts directs dus à partir du 15 mars.
Pour les entreprises ou les experts-comptables qui interviennent pour des clients dans cette situation, il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).
Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de prélèvement à la source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels.
Pour le paiement de la contribution foncière des entreprises (CFE) ou de la taxe foncière (TF), il est possible de suspendre, en cas de contrat de mensualisation, les paiements sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service. Le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité.
Les reports sont accordés pour un délai de trois mois sans aucune pénalité et sans aucun justificatif.
| Nouveauté : une grande entreprise qui demande un report d’échéances fiscales et sociales ou un prêt garanti par l’Etat s’engage à ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l’étranger et ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020. Les entreprises qui auraient pris de telles mesures avant le jour d’annonce du dispositif le 27 mars 2020, ne sont pas concernées par cet engagement. |
►Pour plus de précisions sur ce dispositif, retrouvez les informations données par le Gouvernement à l’adresse suivante.
Pour accompagner les entreprises face à la crise du covid-19, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin a décidé de prolonger ces mesures exceptionnelles pour les échéances sociales et fiscales du mois d’avril. Ainsi, comme en mars, les entreprises qui subissent des difficultés financières liées à la crise sanitaire auront la possibilité de demander un report de leurs échéances d’impôts directs d'avril.
B - Remises d’impôts directs, intérêts de retard ou de pénalités
Pour les situations les plus difficiles, les entreprises peuvent également demander une remise sur les impôts directs.
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières de l'entreprise demandeuse.
Les entreprises doivent attester d’un baisse du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020, présenter les autres dettes en cours, emprunts, cotisations sociales, indiquer la dernière situation de la trésorerie et de manière générale présenter tout élément pouvant justifier de difficultés sérieuses.
►La DGFiP met à disposition un modèle de demande afin de faciliter les démarches.
C - La commission des chefs de services financiers
| La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales. |
Le débiteur lui-même, qui peut être un commerçant, un artisan, un agriculteur, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et une personne morale de droit privé (sociétés, associations). Un mandataire ad hoc du débiteur peut également saisir la CCSF.
Pour que la demande soit recevable, l’entreprise doit être à jour de ses déclarations fiscales et sociales, du paiement du prélèvement à la source et ne pas avoir été condamnée pour travail dissimulé.
Les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles, à l'exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source.
Un dossier exposant la situation financière de l’entreprise doit être déposé auprès du secrétariat de la CCSF dans le ressort de laquelle se situe son siège social, ou son principal établissement. Le dossier est composé, entre autres, d’une attestation justifiant de l’état de ses difficultés financières, d'une attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations de sécurité sociale, des états prévisionnels de chiffre d’affaires et de trésorerie pour les prochains mois, des trois derniers bilans et de la situation actuelle de la trésorerie
►Pour les TPE, le dossier de saisine de la CCSF est disponible sur le site de la DGFiP.
D - Remboursement anticipée des crédits d’impôts et des crédits de TVA
| Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 peuvent dès maintenant demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant sur leur impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat. |
Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt restituables en 2020, notamment CICE et CIR/CII et ceux concernant certains secteurs en difficultés (le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques, le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelle, le crédit d’impôt pour dépenses de production de films et d’œuvres audiovisuelles étrangers, le crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés, le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques ou le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo).
La société doit se rendre sur son espace professionnel pour déclarer :
- la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573),
- la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (formulaire n° 2069-RCI ou déclaration spécifique), - le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020 à défaut de déclaration de résultats.
Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire EDI).
Dans le contexte de la crise du COVID-19, les demandes de remboursement de crédit de TVA seront traitées dans les plus brefs délais.
II - Les mesures concernant les particuliers
A - Report de la déclaration 2020 des revenus 2019
Le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé sur TF1 mardi 31 mars le report des échéances de la déclaration de revenus. Les nouvelles dates limites pour rendre sa déclaration des revenus de 2019 sont fixées au 4 juin 2020, 23h59 dernier délai, dans la zone 1 (départements de 01 à 19) et pour les non-résidents, au 8 juin 2020 pour la zone 2 (départements de 20 à 54) et au 11 juin pour la zone 3 (départements 55 à 974/076). Le service de télé-déclaration des revenus sera accessible sur le site Internet des impôts à compter du 20 avril 2020.
Le changement le plus important concerne les contribuables qui continuent à déclarer au moyen du formulaire papier et qui bénéficieront d’un délai étendu, jusqu’au 12 juin 2020.
Rappelons à ce sujet que, présentée comme une étape préparatoire à la mise en place du prélèvement à la source, l'obligation de remplir sa déclaration de revenus par internet s'appliquait à tous les contribuables en 2019. Les contribuables dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet peuvent continuer de remplir une déclaration papier. De même, les contribuables qui ne savent pas utiliser le web peuvent aussi continuer continuer d'utiliser les formulaires au format papier.
Calendrier de la déclaration en ligne
| Date d’ouverture du service de déclaration | Lundi 20 avril 2020 | |
|
Dates limites de souscription des déclaration | Zone 1 (départements n° 1 à n° 19) | 4 juin 2020 à 23h59 |
| Zone 2 (départements n° 20 à n° 54) | 8 juin 2020 à 23h59 | |
| Zone 3 (départements n° 55 à 974/976) | 11 juin 2020 à 23h59 | |
Calendrier de la déclaration papier
| Réception des déclarations papier | A partir du 20 avril jusqu’à mi mai |
| Date limite de dépôt des déclarations | 12 juin 2020 à 23h59, cachet de la Poste faisant foi |
B - La déclaration automatique
En ce qui concerne la déclaration automatique mise en place par la loi de finances pour 2020, elle sera proposée aux foyers fiscaux imposés en 2019 uniquement sur la base des revenus préremplis par l’administration et pour lesquels aucun changement de situation n’a eu lieu en 2019.
- si le contribuable a déclaré en ligne l'année dernière : un courriel d'information sur ce nouveau dispositif signalant que le récapitulatif des informations connues de l'administration est disponible, pour vérification, dans l’espace particulier sera envoyé ;
- si le contribuable a déposé une déclaration papier en 2019 : un courrier avec la nouvelle déclaration de revenus sous un format adapté, accompagnée de documents présentant ce nouveau mode de déclaration sera envoyé.
Environ 2/3 des usagers pourraient ne pas avoir à déclarer cette année grâce à la déclaration automatique.
A noter : si certains éléments doivent être complétés ou modifiés (adresse, situation de famille, montant des revenus et charges, dépenses éligibles à réduction / crédit d'impôt, option pour choisir l’imposition au barème des revenus de capitaux mobiliers…), la déclaration devra être remplie et signée comme habituellement.
C - Ajustement du taux de prélèvement à la source
Depuis l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, l’impôt est prélevé en « temps réel ». Baisse de salaires ou chômage partiels, de nombreux français vont être affectés financièrement. Les contribuables peuvent ainsi signaler une baisse de revenus sur leur espace particuliers sur le site impots.gouv.fr, dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Actualiser suite à une baisse ou une hausse de vos revenus ». Un nouveau taux sera calculé par l'administration fiscale puis transmis aux organismes qui vous versent des revenus
Attention, la baisse anticipée de ses revenus doit être au moins supérieure à 10 % par rapport aux revenus de l’année précédente. Cette condition n’est pas assouplie pour le moment.
A noter que, même sans modulation, le prélèvement s'adapte aux revenus.
►Consulter en ce sens, l’Infographie « Prélèvement à la source » (N° Lexbase : X4283CH4).
D - Qu’en est-il du régime fiscal applicable aux travailleurs transfrontaliers ?
| Dans un communiqué de presse en date du 19 mars 2020, le ministère de l’Economie et des Finances a indiqué que la France a trouvé un accord avec l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg pour que le maintien à domicile des travailleurs frontaliers n’entraîne pas de conséquence sur le régime d’imposition qui leur est applicable. |
Pour rappel, les régimes d’imposition existants permettent l'imposition exclusive des salaires des travailleurs transfrontaliers dans l’Etat de résidence, soit la France pour les frontaliers qui y résident, à condition de ne pas dépasser un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière de l'autre Etat.
Face à la crise sanitaire que nous traversons, la France s'est accordée avec la Belgique et la Suisse pour que, jusqu'à nouvel ordre, les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers sont amenés à demeurer chez eux pendant cette crise ne soient pas pris en compte pour le décompte du nombre de jours prévus. Par conséquent, ces jours n’auront pas d’incidence sur l’éligibilité au régime spécifique d’imposition dont bénéficient les travailleurs frontaliers.
En ce qui concerne l’Allemagne, l’accord amiable conclu avec la France le 16 février 2006 couvre déjà cette situation (N° Lexbase : X7422ADA).
Pour le Luxembourg, rappelons que la nouvelle convention avec la France (N° Lexbase : L1333LWB), en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Paris le 20 mars 2018, approuvée par la loi du n° 2019-130 du 25 février 2019 (N° Lexbase : L3816LPZ) et publiée par le décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019 (N° Lexbase : L7469LTS) ne prévoit pas de régime spécifique pour les travailleurs frontaliers. C’est la règle générale d’imposition des salaires au lieu d’activité qui prévaut (méthode de l’exemption). La nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise instaure un seuil de tolérance. Ainsi, un frontalier français ne pourra pas travailler plus de 29 jours par an en dehors du Luxembourg sans que la rémunération afférente ne soit imposée en France.
►Lire en ce sens, Julie Lamoure, Statut fiscal des travailleurs frontaliers, Lexbase Fiscal, 2012, n° 487 (N° Lexbase : N2114BTH).
E - Particuliers non-résidents et confinement : quid de la résidence fiscale ?
| L’administration fiscale s’est prononcée à ce sujet et a indiqué qu’un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation (« travel ban ») décidées par le pays de résidence, n’est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l’article 4 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L6146LU8). |
Au regard de l'article 4 B du Code général des impôts précité, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; ou
- celles qui exercent en France une activité professionnelle ; ou
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Un seul des critères soit rempli au regard du droit interne français pour qu'un contribuable soit considéré comme résident fiscal de France. En conquence, si le domicile fiscal est en France, le particulier est passible de l'impôt en France sur l'ensemble de ses revenus, y compris la rémunération de son activité à l'étranger et doit alors déposer sa déclaration de revenus auprès du service des impôts dont dépend son domicile fiscal.
S’agissant du critère personnel du foyer ou lieu de séjour principal en France, le Conseil d'Etat a précisé que le lieu de séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer [...], la notion de foyer familial qui renvoie à celle de résidence habituelle et revêt donc un certain caractère de permanence, est un critère prioritaire de l'imposition. Le lieu de séjour principal qui se définit à partir de données contingentes ne doit être recherché que dans le cas où l'existence d'un foyer ne peut être déterminée (CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6488ANM).
Sur la notion d’exercice en France d’une activité professionnelle non accessoire, pour les salariés, le domicile fiscal dépend du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle. Pour les non salariés, il sera nécessaire de rechercher s’ils disposent en France d’un point d’attache fixe, un établissement ou une exploitation. Le Conseil d’Etat a pu juger qu’un contribuable étaitrésident fiscal français du fait de l’exercice sur le territoire d’une activité professionnelle, alors même que l’administration n’avait pas été en mesure de prouver qu’il en tirait une quelconque rémunération (CE 10° et 9° ssr., 26 mai 2010, n° 296808, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6875EXW).
Le centre des intérêts économiques se définit comme le lieu où le contribuable a réalisé ses principaux investissements ou le lieu où il possède le siège de ses affaires. Il peut également s’agir du lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles d’où il tire la majeure partie de ses revenus. Attention, la seule constatation d’un patrimoine en France n’est pas suffisante pour ce critère, si le patrimoine n’est pas productif de revenus (CE 8° et 3° ssr., 27 janvier 2010, n° 294784, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7546EQK).
Ces dispositions s’appliquent sous réserve des conventions fiscales internationales.
Il peut arriver que la résidence fiscale d’un contribuable soit localisée dans deux Etats différents. Dans cette hypothèse de conflit de résidence, il convient de se référer à la convention fiscale internationale qui a été conclu entre ces deux Etats s’il en existe une.
| Pour l’administration, au regard des conventions internationales, il apparaît également que le fait qu’une personne soit retenue provisoirement en France en raison d’un cas de force majeure ne soit pas de nature, pour ce seul motif, à la considérer comme y ayant établi son foyer permanent ou y ayant le centre de ses intérêts vitaux. |
►Lire en ce sens, Actes de colloque, Marc Pelletier, La résidence, clé d’application des conventions fiscales internationales conclues par la France : difficultés et perspectives, Lexbase Fiscal, 2019, n° 768 (N° Lexbase : N7172BXW).
►Lire également, Simon Ginesty, Le statut fiscal de l’expatrié, Lexbase Fiscal, 2011, n° 429 (N° Lexbase : N4946BRM).
III - Adaptation des délais de procédures
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), prend diverses mesures générales s’appliquant tant aux usagers qu’à l’administration. En matière de contentieux fiscal, elle institue une sorte de « période protégée » pendant une période comprise entre le 12 mars et l’expiration d’un délai de un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
A - Les reports des délais
L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 vise de manière générale « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée […] sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit ».
Il est donc prévu un délai supplémentaire égal au délai initial sans pouvoir excéder deux mois et qui commence à courir à compter de la fin de la période d’urgence sanitaire. En conséquence et pour le moment, le délai serait reporté au maximum jusqu’au 24 août 2020.
En ce qui concerne le report des formalités déclaratives
Ce dispositif n’est pas applicable aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, art. 10).
Par exception peuvent être prévues des mesures de report. Ainsi le délai de dépôt des liasses fiscales, en principe fixée au 20 mai, est prorogé au 31 mai 2020.
Les procédures déclaratives peuvent également être adaptées afin de permettre aux entreprises de pouvoir attester être à jour de leurs obligations (notamment pour la saisine de la Commission des chefs de services financiers).
De même la campagne de déclaration d’impôt sur le revenu a été prolongé. Pour rappel, la campagne débutera le 20 avril et s’achèvera en fonction des zones entre le 4 et le 11 juin 2020. Pour les déclarants papier, la campagne de déclaration se fera du 20 avril au 12 juin 2020.
B - Suspension et prorogration des délais en matière fiscale
L’ordonnance du 25 mars 2020 suspend les délais de prescription du droit de reprise de l’administration qui expirent le 31 décembre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 24 juin 2020. Ces dispositions sont applicables aux rectifications mais également aux intérêts de retard, majorations et amendes.
Sont également suspendus, pour la même période, l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale. Le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé, dans son intervention télévisée du 31 mars 2020 qu’il n’y aurait plus de contrôles fiscaux pendant toute la durée du confinement dans les secteurs les plus touchés par la crise.
Concernant les délais en matière de recouvrement et de contestation des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 prévoit une
suspension jusqu’au 24 août 2020, des délais en cours au 12 mars 2020 ou qui devraient commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020.
S’agissant enfin des décisions de rejet des réclamations, l’article 7 de l’ordonannce prévoit que les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un de ces organismes ou personnes peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont
suspendus jusqu’au 24 juin 2020.
La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrits et d’agréments.
A noter que l’administration fiscale, a, dans une mise à jour du 3 avril 2020, intégré ses commentaires relatifs aux dispositions prises dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 et à l’adaptation par ordonnances des délais de procédures administratives et juridictionnelles.
L’administration fiscale attire l’attention sur le fait que, pour les déclarations fiscales, aucun report d’échéance n’est prévu par ordonnance. Sauf dans le cas des mesures de report prises par instruction aux services (services des impôts des entreprises et services des impôts des particuliers) et accordées sur demande des contribuables (par exemple : échéances d’impôts directs de mars), les contribuables sont tenus de déclarer et de payer leurs dettes fiscales selon les règles et le calendrier de droit commun.
Ces commentaires font l’objet d’une consultation publique du 3 avril 2020 au 13 avril 2020.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472981
[Brèves] Obligation pour chaque établissement d'enseignement supérieur de communiquer les critères d’examen des candidatures (y compris les traitements algorithmiques) dans le cadre de « Parcoursup »
Réf. : Cons. const., décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 (N° Lexbase : A56893KW)
Lecture: 4 min
N2920BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 08 Avril 2020
► Chaque établissement d'enseignement supérieur doit rendre compte des critères en fonction desquels ont été examinées les demandes d'inscription en premier cycle dans le cadre de « Parcoursup », cette communication pouvant comporter des informations relatives aux critères utilisés par les traitements algorithmiques éventuellement mis en œuvre par les commissions d’examen, lesquelles devront également être accessibles aux tiers à l’issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats.
Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 3 avril 2020 (Cons. const., décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 N° Lexbase : A56893KW, sur renvoi de CE, 15 janvier 2020, n° 433296 N° Lexbase : A17513BH).
Objet de la QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 janvier 2020 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L5999LRM), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (N° Lexbase : L4718LIL).
Ces dispositions prévoient que les candidats peuvent obtenir la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen ainsi mis en œuvre par les établissements ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise à leur égard. En revanche, elles excluent l'application de deux articles du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA, art. L. 311-3-1 N° Lexbase : L4874LAR et L. 312-1-3 N° Lexbase : L4872LAP) relatifs à la communication et à la publicité des traitements algorithmiques utilisés comme fondement, exclusif ou partiel, d'une décision administrative individuelle (voir CE, 12 juin 2019, n° 427916 N° Lexbase : A2217ZET).
Contrôle des dispositions législatives faisant l'objet de la QPC. Par les dispositions contestées, le législateur a considéré que la détermination de ces critères et modalités d'examen des candidatures, lorsqu'ils font l'objet de traitements algorithmiques, n'était pas dissociable de l'appréciation portée sur chaque candidature. Dès lors, en restreignant l'accès aux documents administratifs précisant ces critères et modalités, le législateur a souhaité protéger le secret des délibérations des équipes pédagogiques au sein des établissements. Il a ainsi entendu assurer leur indépendance et l'autorité de leurs décisions. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
Une fois qu'une décision a été prise à leur égard, les candidats peuvent, à leur demande, obtenir la communication par l'établissement des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision de refus prise à leur égard. Ils peuvent ainsi être informés de la hiérarchisation et de la pondération des différents critères généraux établies par les établissements ainsi que des précisions et compléments apportés à ces critères généraux pour l'examen des vœux d'inscription. La communication prévue par ces dispositions peut, en outre comporter des informations relatives aux critères utilisés par les traitements algorithmiques éventuellement mis en œuvre par les commissions d'examen.
Réserve - une communication ne bénéficiant qu'aux candidats. Une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des candidatures effectivement retenus par les établissements porterait au droit garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques.
Il juge que, dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge que les limitations apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs résultant de l'article 15 de la Déclaration de 1789 sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à cet objectif.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472920
[Brèves] Droit au déréférencement : le Conseil d’Etat tire les conséquences des arrêts de la CJUE et en précise la portée géographique
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 mars 2020, n° 399922, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A53703K4)
Lecture: 4 min
N2906BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 08 Avril 2020
► Est annulée la sanction infligée par la CNIL à Google à raison de son refus de faire droit aux demandes de déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur de recherche, l’obligation de déréférencement résultant du droit de l’UE étant limitée aux versions correspondant aux Etats membres et la CNIL ne pouvant d’elle-même imposer un déréférencement mondial.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 27 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 mars 2020, n° 399922, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A53703K4).
L’affaire. Le 21 mai 2015, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a mis en demeure Google, lorsqu'elle fait droit à une demande d'une personne physique tendant à la suppression de la liste des résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom, de liens menant vers des pages web, d'effectuer cette suppression sur toutes les extensions de nom de domaine de son moteur de recherche. Par une délibération du 10 mars 2016, après avoir constaté que la société ne s'était pas, dans le délai imparti, conformée à cette mise en demeure, la formation restreinte de la CNIL a prononcé à son encontre une sanction, rendue publique, de 100 000 euros. Google a alors demandé l'annulation de cette délibération.
La décision.
Rappel de l’arrêt de la CJUE du 24 septembre 2019 (CJUE, 24 septembre 2019, aff. C-507/17 N° Lexbase : A3917ZPR ; lire les obs. de C. Le Goffic N° Lexbase : N0703BYP).
Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu que par son arrêt du 24 septembre, la CJUE a dit pour droit que : « l'article 12, sous b), et l'article 14, premier alinéa, sous a), de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 (N° Lexbase : L8240AUQ) […], ainsi que l'article 17, paragraphe 1, du Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L0189K8I ; « RGPD »), […] doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'exploitant d'un moteur de recherche fait droit à une demande de déréférencement en application de ces dispositions, il est tenu d'opérer ce déréférencement non pas sur l'ensemble des versions de son moteur, mais sur les versions de celui-ci correspondant à l'ensemble des Etats membres et ce, si nécessaire, en combinaison avec des mesures qui, tout en satisfaisant aux exigences légales, permettent effectivement d'empêcher ou, à tout le moins, de sérieusement décourager les internautes effectuant une recherche sur la base du nom de la personne concernée à partir de l'un des Etats membres d'avoir, par la liste de résultats affichée à la suite de cette recherche, accès aux liens qui font l'objet de cette demande ».
Application à l’affaire.
Le Conseil d’Etat estime, dès lors, qu'en sanctionnant Google au motif que seule une mesure s'appliquant à l'intégralité du traitement liée au moteur de recherche, sans considération des extensions interrogées et de l'origine géographique de l'internaute effectuant une recherche, est à même de répondre à l'exigence de protection telle qu'elle a été consacrée par la Cour de justice de l'Union européenne, la formation restreinte de la CNIL a entaché la délibération attaquée d'erreur de droit.
En outre, pour le Conseil d'Etat, si la CNIL soutient en défense que la sanction contestée trouve son fondement dans la faculté que la Cour de justice a reconnue aux autorités de contrôle d'ordonner de procéder à un déréférencement portant sur l'ensemble des versions d'un moteur de recherche, il ne résulte, en l'état du droit applicable, d'aucune disposition législative qu'un tel déréférencement pourrait excéder le champ couvert par le droit de l'Union européenne pour s'appliquer hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne. Au surplus, ajoute-t-il, une telle faculté ne peut être ouverte qu'au terme d'une mise en balance entre, d'une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant et, d'autre part, le droit à la liberté d'information. Or, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que, pour constater l'existence de manquements persistants et reprocher à la société Google d'avoir méconnu l'obligation de principe de procéder au déréférencement portant sur l'ensemble des versions d'un moteur de recherche, la formation restreinte de la CNIL n'a pas effectué une telle mise en balance.
La décision de la CNIL est donc annulée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472906
[Brèves] Prise en compte des conséquences de la rétroactivité de la dissolution dans le bilan de la société confondante
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 18 mars 2020, n° 426473, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95843IS)
Lecture: 4 min
N2910BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Avril 2020
► Un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt et ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise, telle qu'elle résulte à cette date des opérations de toute nature faites par l'entreprise ;
► Si, parmi ces opérations, figure la dissolution sans liquidation d'une filiale, les conséquences de cette dissolution pour la société confondante doivent être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle cette opération est intervenue, mais ne peuvent l'être dans le bilan précédent ;
► Lorsqu'un effet rétroactif est attaché, sur le plan fiscal, à cette dissolution à une date déterminée, laquelle ne peut être antérieure à la date de clôture du bilan de l'exercice précédent, la société confondante est tenue de prendre en compte, au besoin au moyen de retraitements extra-comptables, toutes les conséquences de la date ainsi stipulée, à laquelle les effets de la fusion remontent.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 18 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 18 mars 2020, n° 426473, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95843IS).
En l’espèce, une société est devenue détentrice de la totalité des titres de sa filiale après l'acquisition, le 19 janvier 2010, de 5,15 % de ces titres auprès des fondateurs de cette dernière. Le 5 février 2010, la société a procédé à une augmentation de capital de six millions d'euros de cette filiale, à laquelle elle a intégralement souscrit. Le 11 février 2010, elle a prononcé la dissolution sans liquidation de celle-ci, en faisant application du régime de la transmission universelle de patrimoine prévu à l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM). Un effet rétroactif a été donné à cette opération, sur le plan fiscal, au 1er janvier 2010. Après s'être placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9521ITS), la société a évalué une moins-value globale, du fait de l'annulation des titres de sa filiale, à 18 592 484 euros prenant notamment en compte l'augmentation de capital intervenue le 11 février 2010.
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le montant de cette moins-value en estimant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'augmentation de capital intervenue le 5 février 2010 et a fixé cette moins-value à 13 177 484 euros. La société mère du groupe fiscalement intégré, venant aux droits de la société en France, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rehaussement, notamment d'impôt sur les sociétés, résultant de la minoration de cette moins-value. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande (TA de Montreuil, 3 décembre 2015, n° 1404051 N° Lexbase : A1599YLS). La cour administrative d'appel de Versailles, saisie par la société mère, a rétabli la moins-value d'annulation des titres de la filiale à hauteur de 18 592 484 euros (CAA de Versailles, 6 novembre 2018, n° 16VE00247 N° Lexbase : A0842YLR).
Le Conseil d’Etat juge, en l’espèce, que la société confondante est réputée s’être substituée fiscalement à la société absorbée à la date d’effet rétroactif et doit être regardée comme ayant reçu elle-même les apports pour leur valeur à la date où l’augmentation du capital est intervenue.
⇒ Rappelons que l’arrêt de principe en matière de rétroactivité fiscale d’une TUP date de 1974 ( CE Section, 12 juillet 1974 n° 81753, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7621AYW). Le Conseil d’Etat a jugé, dans le cas d'une fusion de sociétés, que dans la mesure où la rétroactivité donnée par les parties à l'acte d'apport ne remonte pas à une date antérieure à celle de l'ouverture de l'exercice au cours duquel la convention a été conclue, la société absorbante est en droit, pour la détermination de ses résultats imposables, de prendre en compte, dans le premier bilan établi après fusion, les déficits provenant de la reprise des opérations de la société absorbée depuis la date d'effet de la rétroactivité fixée dans le contrat.
(Cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X7882ALI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472910
[Brèves] Imposition à l’IS : l’absence de réalisation d’opérations au cours d’une année civile ne suffit pas à écarter l’exercice d’une activité commerciale
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 18 mars 2020, n° 425443, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95823IQ)
Lecture: 4 min
N2907BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 20 Avril 2020
► L'application des dispositions de l'article 35 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3342LCR) est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
► La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence ;
► A cet égard, la circonstance qu'au cours d'une année aucune opération mentionnée à l'article 35 du Code général des impôts n'ait été réalisée par une société civile ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'application de ces dispositions pour cette année.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 18 mars 2020, n° 425443, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95823IQ).
En l’espèce, une SCI a été constituée entre deux associés avec pour objet social « l'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains, l'édification de bâtiments à usage d'habitation et accessoirement commercial, la construction ou l'achat de tous biens immobiliers et mobiliers, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location de biens immobiliers acquis ou édifiés par la société [...] éventuellement, la revente des ensembles immobiliers acquis ou édifiés par elle ». Elle a acquis deux immeubles et a vendu l'un des deux lots du bâti du premier immeuble et le terrain à bâtir attenant et, après avoir créé douze lots dans le second immeuble, en a vendu quatre.
A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercice clos de 2008 à 2010, l'administration fiscale a remis en cause le caractère civil de ses activités au motif qu'elle exerçait une activité de marchand de biens et l'a, en conséquence, assujettie à l'impôt sur les sociétés pour les années en cause. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SCI tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2008 à 2010. La cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la SCI, déchargé celle-ci des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre de 2010, réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (CAA de Bordeaux, 25 septembre 2018, n° 16BX02171 N° Lexbase : A0566YG3).
Pour rappel, aux termes de l’article 35 I du Code général des impôts, présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles. La notion d’habitude résulte alors soit de la pluralité des ventes réalisées dans le cadre d’une même opération, soit de l’activité passée ou présente du commerçant. Pour la doctrine administrative, l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat ou de la souscription et non à celui de la revente.
Pour décharger la SCI des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 2010, la cour s'est fondée sur la seule circonstance que, au cours de cette année, la société n'avait réalisé aucune opération de revente et s'était exclusivement livrée à des opérations de location de biens immobiliers ne relevant pas du champ d'application de l'article 35 du Code général des impôts. A tort selon le Conseil d’Etat. En statuant de la sorte, alors qu'une telle circonstance ne suffisait pas, à elle seule, à écarter l'application combinée de l'article 35 du Code général des impôts et de l'article 206 du même Code (N° Lexbase : L6204LUC) à la SCI, la cour a commis une erreur de droit.
⇒ Pour retenir l’activité de marchands de biens, la jurisprudence retient deux critères : l’intention spéculative qui s’apprécie au moment de l’achat des biens et le caractère habituel des opérations d’achat revente (CE 3° et 8° ssr., 19 novembre 2008, n° 291039, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3124EBC).
Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X4051ALM).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472907
[Brèves] Possibilité pour le conseil de prud'hommes de caractériser le harcèlement sexuel même en cas de relaxe au pénal
Réf. : Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-23.682, FS-P+B (N° Lexbase : A60753K9)
Lecture: 1 min
N2950BYW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 08 Avril 2020
► La décision du juge pénal, qui s'est borné à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur.
Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2020 (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-23.682, FS-P+B N° Lexbase : A60753K9).
Dans les faits. Une salariée est engagée par contrat de professionnalisation en qualité d'assistante dentaire. Elle est, par la suite, licenciée pour faute grave. Soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel, elle saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Parallèlement, le tribunal correctionnel relaxe l'employeur des fins de la poursuite pour harcèlement sexuel.
La position de la cour d’appel. De son côté, la cour d’appel estime que la salariée a été victime de harcèlement sexuel et que donc son licenciement est nul. En effet, elle relève que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel n’était fondé que sur le seul défaut d'élément intentionnel. Face à cette décision, l’employeur décide de former un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle souligne que la caractérisation de faits de harcèlement sexuel, en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1°, du Code du travail (N° Lexbase : L8840ITL), ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel (sur Les actions judiciaires contre l’auteur du harcèlement sexuel, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E9997YYW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472950
[Textes] Les modalités pratiques de la nouvelle procédure d’opposition aux brevets français devant l’INPI
Réf. : Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention (N° Lexbase : L9353LUX) ; décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 (N° Lexbase : L3667LWQ) et arrêté du 6 mars 2020 (N° Lexbase : L3680LW9)
Lecture: 23 min
N2913BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Didier Intes, Conseil en Propriété Industrielle, Associé du Cabinet Beau de Loménie, Professeur-associé au CEIPI et Gaston Vedel, juriste au Cabinet Beau de Loménie, titulaire du CAPA, Intervenant au CEIPI
Le 09 Avril 2020
L’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention et publiée le 13 février 2020 au Journal officiel, a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) les nouvelles dispositions relatives à la procédure d’opposition aux brevets d’invention français devant l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après INPI). Elle a été complétée par deux textes publiés au Journal officiel du 8 mars 2020 : le décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, relatif à la procédure d'opposition aux brevets d'invention, et l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle.
1. Contexte et objectifs de l’ordonnance
Jusqu’à présent, l’INPI ne disposait pas du pouvoir de rejet d’une demande de brevet français pour défaut d’activité inventive. Il n’était, par ailleurs, pas possible d’initier un recours administratif contre la décision de délivrance d’un brevet français par l’INPI [1].
Cette procédure d’examen simplifiée, moins exigeante que celle d’autres offices de propriété industrielle, a pu être critiquée en ce qu’elle confrontait potentiellement les tiers à des brevets « faibles » susceptibles d’entraver indûment leur liberté d’exploitation et ne pouvant être attaqués qu’au plan judiciaire, ce qui pouvait les conduire à renoncer à l’exploitation envisagée. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK), dite loi « PACTE », a renforcé la procédure d’examen des brevets français, en prévoyant notamment un examen plus complet, incluant désormais un examen de l’activité inventive [2].
La loi « PACTE » a également autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant normalement de la compétence du Parlement, nécessaires pour la création d’un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l’INPI afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d'un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d’opposition abusives, ainsi que de prévoir les règles de recours applicables aux décisions résultant de l’exercice de ce droit [3].
A la suite d’une consultation publique lancée par la Direction Générale des Entreprises [4] (DGE), l’ordonnance du 12 février 2020 vient ainsi introduire dans le CPI les dispositions attendues relatives à cette nouvelle procédure d’opposition devant l’INPI.
Elle est accompagnée d’un rapport au Président de la République du même jour [5], synthétisant les dispositions de l’ordonnance.
Les objectifs de ces nouvelles dispositions sont multiples :
- harmoniser la pratique de l’INPI sur la pratique de l’Office européen des brevets (ci-après OEB) et des principaux offices nationaux ;
- renforcer la « qualité » des brevets français, en permettant à tout tiers de leur opposer des documents qui n’auraient pas été identifiés par l’INPI dans le cadre de la procédure d’examen [6] ;
- faciliter la contestation des brevets délivrés par l’INPI, en permettant à tout tiers de contester sa validité dans le cadre d’une procédure administrative, a priori moins onéreuse et moins complexe qu’une procédure judiciaire ;
- réduire le contentieux judiciaire en annulation des brevets [7] ;
- limiter, notamment pour les acteurs économiques les plus fragiles, la gêne que peuvent occasionner des brevets dont la validité serait contestable.
2. Entrée en vigueur
Sous réserve des délais complémentaires qui pourraient être prévus compte tenu de la pandémie liée au virus covid-19, les dispositions de l’ordonnance du 12 février 2020 entrent en vigueur le 1er avril 2020 [8], à l’exception de certaines dispositions relatives à l’Outre-mer [9].
Elles s’appliquent aux brevets d’invention dont la mention de délivrance a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à compter du 1er avril 2020 [10].
Elles s’appliqueront ainsi aux brevets délivrés après le 1er avril 2020, bien que les demandes correspondantes aient été déposées sous l’emprise de l’ancien dispositif, qui ne connaissait pas de procédure d’opposition.
3. Conditions de recevabilité de l’opposition
3.1. L’opposition est ouverte à toutes personnes, physiques ou morales, à l’exception du titulaire du brevet concerné [11].
Contrairement aux actions judiciaires, la recevabilité de l’opposition ne supposera pas la démonstration d’un intérêt à agir de l’opposant, ce qui facilite largement les démarches et permettra également à des intermédiaires d’exercer des oppositions pour le compte de tiers.
Le recours en réformation devant la cour d’appel de Paris [12] est quant à lui soumis aux conditions procédurales de droit commun [13] et supposera donc la démonstration par l’appelant d’un intérêt à agir. Cela ne devrait toutefois pas soulever de difficulté dans la mesure où l’intérêt à agir de l’appelant devrait naître de la contestation de la décision du Directeur général de l’INPI l’ayant débouté de tout ou partie de ses demandes.
3.2. Le délai pour former opposition est de 9 mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet concerné [14], conformément à la pratique de l’OEB [15].
En revanche, on peut regretter que l’ordonnance n’inclut pas de règle équivalente à celle de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE) [16], prévoyant la possibilité, pour une personne faisant l’objet d’une action en contrefaçon ou ayant engagé une action en déclaration de non-contrefaçon recevable, de se joindre, hors délai, à une procédure d’opposition en cours à l’encontre du brevet qui lui est opposé.
Il conviendra d’être particulièrement vigilant quant au respect de ce délai de 9 mois, car l’inobservation de ce délai ne pourra pas faire l’objet d’un recours en restauration [17].
3.3. Lorsque plusieurs oppositions sont formées à l’encontre du même brevet, leur jonction est ordonnée d’office par l’INPI [18].
4. Titres concernés par l’opposition
La procédure d’opposition est limitée aux seuls brevets d’invention.
Sont ainsi exclus les autres titres de propriété industrielle protégeant les inventions, tels que les certificats d’utilité ou les certificats complémentaires de protection [19].
5. Fondements possibles de l’opposition
L’opposition ne peut se fonder que sur des motifs limitativement énumérés [20], incluant :
- le défaut de brevetabilité de l’invention (absence d’invention, défaut de nouveauté, d’activité inventive et/ou d’application industrielle) ;
- l’insuffisance de description ;
- l’extension de l’objet au-delà du contenu de la demande initiale.
L’opposant pourra ainsi contester la validité de tout ou partie du brevet opposé en se fondant sur les principaux motifs de nullité existants.
L’opposant pourra invoquer les documents de l’art antérieur identifiés dans le cadre du rapport de recherche, ainsi que tous autres documents qu’il estime pertinents.
L’opposant a l’obligation de préciser les fondements et la portée de l’opposition (revendications du brevet opposées dont la validité est contestée) avant la fin du délai d’opposition, ces derniers ne devant plus pouvoir être modifiés ultérieurement dans le cadre de la procédure d’opposition [21] alors qu’ils pourraient l’être dans le cadre d’un recours devant la cour d’appel [22].
6. Procédure d’opposition
6.1. A l’instar d’une procédure judiciaire, la procédure d’opposition est une procédure écrite et contradictoire [23], impliquant que les arguments et pièces invoqués soient systématiquement communiqués à l’INPI et à l’ensemble des parties impliquées.
Au même titre que le juge judiciaire, l’INPI est en charge de faire respecter le contradictoire [24].
6.2. La procédure d’opposition se décomposera en plusieurs phases, qui comprennent :
- une phase de recevabilité, qui est de deux mois maximum, durant laquelle la recevabilité de l’opposition sera examinée par l’INPI ;
- une phase d’instruction [25], qui doit être de onze mois maximum, dont les modalités ont été précisées par l’article R. 613-44-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4578LWH), issu du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, relatif à la procédure d'opposition aux brevets d'invention , qui elle-même inclut :
- une phase d’information, durant laquelle l’INPI notifiera, sans délai, l’opposition au titulaire du brevet et le titulaire déposera, dans un délai imparti, ses observations et ses propositions éventuelles de modification des revendications ;
- une phase de rédaction de l’avis d’instruction, qui est de trois mois, durant laquelle l’INPI notifiera aux parties son avis d’instruction, détaillant son opinion sur l’opposition et les arguments des parties ;
- une phase de débat écrit, durant laquelle, dans un délai imparti, les parties s’échangeront leurs observations écrites et le titulaire du brevet pourra proposer des modifications complémentaires des revendications ;
- une phase de débat oral, sorte de plaidoiries, durant lesquelles les parties présenteront leurs observations orales à l’INPI ;
- une phase de décision, qui est de quatre mois, suivant la clôture de l’instruction et aboutissant à la décision du Directeur général de l’INPI.
Le schéma ci-dessous, publié par l’INPI [26], synthétise les différentes phases et délais de la procédure d’opposition :
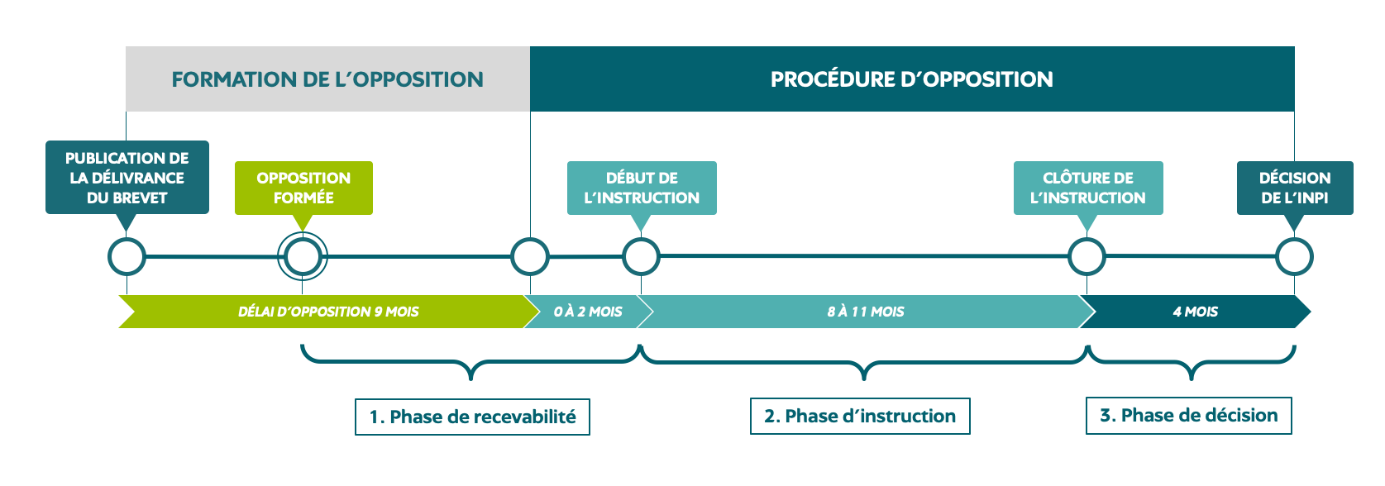
L’ensemble des délais prévus par le décret apparaît particulièrement court et obligera chaque partie à anticiper au maximum les arguments de la partie adverse.
Sauf extension des délais (existant par exemple dans le cadre des procédures judiciaires [27]), les sociétés étrangères pourraient avoir des difficultés importantes à suivre efficacement les débats avec leurs conseils.
6.3. De manière étonnante, le principe « silence vaut rejet » s’appliquera et l’opposition sera réputée rejetée si le Directeur général de l’INPI n’a pas statué dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période d’instruction [28].
Cette nouvelle disposition interroge du fait de l’absence totale de motivation du rejet de l’opposition dans une telle hypothèse. Elle pourrait impliquer de mettre en œuvre des recours propres au droit administratif afin d’obtenir une motivation de la décision de rejet.
L’INPI devrait tenter d’éviter cette situation en statuant systématiquement sur le bien-fondé des oppositions dans les délais applicables.
6.4. L’opposition est inscrite au Registre National des Brevets [29], ce qui permettra aux tiers d’en être informés.
Conformément aux pratiques existantes, l’ensemble des éléments du dossier devrait être accessible aux tiers dans des délais réduits sur le site internet de l’INPI.
7. Modification du brevet sous opposition
Conformément à la pratique en cours devant l’OEB, le titulaire du brevet opposé pourra modifier les revendications du brevet en réponse aux motifs d’opposition soulevés par l’opposant [30].
Ces modifications devront naturellement répondre aux exigences habituelles prohibant toute extension de l’objet de la demande par rapport au contenu de la demande initiale et toute extension de la protection conférée par le brevet. Elles devront, également, elles-mêmes constituer une position de repli du breveté vis-à-vis des griefs de l’opposant [31].
Sous les mêmes réserves, le titulaire du brevet opposé pourra également modifier la description et les dessins [32].
Conformément à la pratique en cours devant l’OEB, le Directeur général de l’INPI pourra donc révoquer le brevet en tout ou en partie (seulement certaines revendications), ou le maintenir sous une forme modifiée, selon les propositions du titulaire du brevet.
La procédure d’opposition devant l’INPI devrait donc se dérouler dans des conditions tout à fait similaires à celles existant devant l’OEB, avec la pratique des requêtes subsidiaires permettant aux titulaires de brevet de préparer différentes positions de repli, avec des revendications modifiées, pour faire face aux différentes attaques des opposants.
8. Effet de la décision d’opposition
La décision du Directeur général de l’INPI a les effets d’un jugement [33]. A ce titre, elle constitue un titre exécutoire et peut faire l’objet d’une exécution forcée.
La décision de révocation a un effet absolu [34] et sera assimilable à ce titre à une décision judiciaire statuant sur la validité d’un brevet.
Lorsque la décision de l’INPI révoque partiellement le brevet, le titulaire devra solliciter la modification du brevet devant l’INPI pour se conformer à cette décision si un recours n’est pas engagé par l’une des parties [35]. L’INPI contrôlera la conformité des modifications du brevet à la décision de révocation partielle intervenue dans le cadre de l’opposition, qui devra intervenir dans le cadre d’une limitation devant l’INPI [36].
De manière classique, les effets de la décision d’opposition rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet [37].
9. Coûts
9.1. Précisée par l’arrêté du 6 mars relatif aux redevances de procédures de l’INPI, la taxe d’opposition sera finalement de 600 €.
A titre de comparaison, la taxe d’opposition devant l’OEB est de 785 €.
9.2. Les frais de Conseils en propriété industrielle devraient être assez similaires à ceux à prévoir pour une procédure d’opposition devant l’Office.
9.3. S’agissant de la prise en charge et du remboursement des frais afférents à la procédure d’opposition, le principe est que chacune des parties supportera les frais qu’elle a exposés [38], comme cela est le cas dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OEB.
Toutefois, le Directeur général de l’INPI aura la possibilité de décider d’une répartition différente, en mettant par exemple à la charge d’une des parties seulement les frais de la procédure. Une telle décision devrait être motivée par des raisons tirées de l’équité et supposera probablement une certaine motivation de la décision.
En revanche, à l’instar de la procédure existant en matière d’opposition devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après EUIPO), le montant des sommes mises à la charge d’une des parties sur décision du Directeur général sera plafonné par un barème [39], qui sera fixé par arrêté à intervenir prochainement.
A titre de comparaison, ce montant maximum du remboursement est de 300 € devant l’EUIPO.
En revanche, de manière étonnante, il n’existe aucune procédure équivalente dans le cadre d’autres procédures administratives devant l’INPI, notamment les procédures d’opposition, de nullité ou de déchéance de marques.
Les praticiens attendront avec intérêt le barème à intervenir et la nouvelle pratique de l’INPI sur ce point.
10. Relations entre procédure d’opposition et autres procédures
10.1. Il ne sera désormais plus possible de limiter un brevet si ce dernier fait l’objet d’une procédure d’opposition devant l’INPI [40].
Dans le même sens, la procédure de limitation sera close par l’INPI si une procédure d’opposition est formée à l’encontre du brevet [41].
En revanche, la limitation restera possible si elle est sollicitée alors qu’une demande en nullité du brevet concerné est présentée dans le cadre d’une action judiciaire, que ce soit à titre principal (par un tiers qui contesterait judiciairement la validité du brevet) ou à titre reconventionnel (par un tiers défendeur à une action en contrefaçon engagée sur la base du brevet).
10.2. La procédure d’opposition est suspendue en cas d’action judiciaire en revendication de propriété ou en nullité du brevet concerné, ainsi qu’en cas de demande conjointe des parties pour une durée de quatre mois, renouvelable deux fois [42].
L’INPI a également la possibilité de suspendre la procédure dans l’attente d’informations ou d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue de l’opposition [43], par exemple liés à une procédure administrative ou judiciaire parallèle en France ou à l’étranger.
En revanche, l’ordonnance et le décret ne prévoient aucune disposition particulière sur l’impact d’une opposition devant l’INPI sur une action judiciaire en contrefaçon ou en nullité du brevet opposé. Un sursis à statuer pourra donc être sollicité par les parties à l’action judiciaire pour des motifs tirés d’une bonne administration de la justice et devrait faire l’objet d’une décision au cas par cas, selon les critères fixés par la jurisprudence existant en matière d’opposition devant l’OEB [44].
10.3. Le projet de décret prévoyait l’impossibilité d’introduire une action en nullité devant le tribunal judiciaire si une décision d’opposition « ayant le même objet et la même cause a été rendue par l’INPI entre les mêmes parties »[45].
Cette disposition qui avait vraisemblablement pour objet de limiter le contentieux judiciaire en nullité des brevets pouvait étonner dans la mesure où aucun équivalent n’existe dans l’hypothèse d’une procédure d’opposition devant l’OEB et où elle aurait pu pousser les opposants à se faire représenter par des « hommes de paille » dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’INPI, ce qui est possible compte tenu de l’absence d’exigence d’un intérêt à agir [46]. Le projet d’article R. 615-1 A a finalement été abandonné.
11. Recours
11.1. Les décisions du Directeur général de l’INPI statuant sur opposition pourront faire l’objet d’un recours en réformation devant la cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois de la décision du Directeur général de l’INPI [47], éventuellement augmenté des délais de distance [48].
Le régime de l’opposition en matière de brevet se distingue ici de celui applicable aux oppositions à l’enregistrement de marque, qui font l’objet d’un simple recours en annulation.
Contrairement à la procédure d’opposition, les parties devront obligatoirement se faire représenter par un avocat inscrit à l’Ordre des avocats du Barreau de Paris.
11.2. L’INPI ne sera pas formellement partie à l’instance, mais son Directeur général pourra présenter des observations écrites ou orales [49]. Dans la mesure où l’INPI se voit reconnaître un pouvoir quasi-juridictionnel dans le cadre de la procédure d’opposition, sa participation à l’instance devant la cour d’appel apparaît surprenante et avait été fortement critiquée dans le cadre des discussions sur les projets d’ordonnance et de décret.
Les conclusions et pièces des parties doivent lui être adressées par lettre RAR [50], sous les mêmes sanctions et délais que ceux applicables entre les parties (incluant la caducité de l’appel et l’irrecevabilité en cas de non-respect des délais impératifs [51]), ce qui alourdira fortement le formalisme pour les parties. Le Directeur général de l’INPI doit également notifier ses observations écrites aux parties selon les mêmes formes.
Le Ministère public pourra prendre communication des affaires et intervenir s’il l’estime nécessaire [52].
11.3. Le recours est un recours en réformation, dit de plein contentieux, dans le cadre duquel la cour d’appel sera saisie de l’intégralité du litige et statuera en fait et en droit [53].
Les règles procédurales issues du Code de procédure civile seront applicables[54]. Les parties devront notamment prêter attention aux délais impératifs applicables pour déposer leurs premières conclusions, qui ont été légèrement modifiées :
- 3 mois à compter du recours pour le demandeur (appelant) pour déposer ses conclusions [55] ;
- 3 mois à compter des conclusions du demandeur pour le défendeur (intimé) pour déposer ses conclusions et former, le cas échéant, un recours incident [56] ;
- en cas de recours incident, 3 mois à compter dudit recours incident pour le demandeur (appelant et défendeur au recours incident) pour déposer ses conclusions sur ledit recours incident [57].
Le non-respect de ces délais impératifs, éventuellement augmentés des délais de distance [58], est sanctionné sévèrement respectivement par la caducité du recours du demandeur et l’irrecevabilité des conclusions du défendeur ou du demandeur.
Conformément à la pratique judiciaire, mais contrairement à la pratique habituelle de l’OEB, l’opposant pourra invoquer de nouveaux moyens (fondements juridiques ou arguments) pour soutenir ses demandes en nullité du brevet et produire de nouvelles pièces, incluant de nouveaux documents de l’art antérieur [59].
Cette particularité de la procédure d’opposition française permettra aux parties de développer des stratégies particulières quant aux arguments et pièces qu’elles invoquent devant l’INPI et devant la cour d’appel.
La procédure d’appel est toutefois soumise au principe dit de concentration qui impose aux parties d’invoquer l’ensemble de leurs prétentions dès leurs premières conclusions [60].
11.4. L’arrêt de la cour d’appel pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation selon les règles de droit commun.
De manière particulièrement étonnante, le Directeur général de l’INPI pourra se pourvoir en cassation à l’encontre de la décision de la cour d’appel [61], alors même qu’il n’est pas formellement partie à la procédure d’appel et intervient à titre quasi-juridictionnel en première instance de la procédure d’opposition.
11.5. Contrairement à la procédure d’opposition devant l’INPI, la procédure devant la cour d’appel ne devrait faire l’objet que d’une publicité limitée, les conclusions et pièces déposées par les parties n’étant habituellement pas accessibles aux tiers.
Le caractère hybride de la procédure d’opposition « à la française » distingue cette dernière de la pratique de la plupart des Offices, où l’ensemble des éléments échangés entre les parties (fondements de l’opposition, arguments, antériorités citées, etc.), y compris en appel, est habituellement accessible aux tiers.
12. Conclusion
La mise en place d’une procédure d’opposition, couplée au renforcement de la procédure d’examen des demandes de brevet devant l’INPI, semble cohérente et hisse le droit français des brevets au niveau de celui d’autres grandes juridictions [62].
Cette procédure est donc certainement bienvenue et ses modalités, notamment en termes de coûts et de durée, semblent raisonnables.
Plusieurs facteurs peuvent cependant faire douter de l’attractivité du régime d’opposition à la française. Son caractère hybride, avec une première instance purement administrative devant l’INPI, mais une deuxième instance judiciaire, entraine de curieuses conséquences.
Alors que l’opposant est contraint, pendant toute la phase administrative de première instance, par les moyens invoqués avant la fin du délai d’opposition, les parties pourront au contraire présenter de nouveaux moyens et de nouvelles antériorités lors du recours. Les différences entre les règles formelles et procédurales existant en première et seconde instance pourraient complexifier une procédure qui se voulait simple et diminuer l’effectivité du principe du double degré de juridiction.
On peut également se demander si le concurrent du breveté prendra le risque de former une opposition dans la mesure où il s’interdirait la possibilité d’engager par la suite une action judiciaire en nullité. Le système pourrait ainsi encourager le recours à un homme de paille dans le cadre de l’opposition.
Le risque d’atteinte au principe du double degré de juridiction est augmenté par l’application du principe du « silence vaut rejet » à la procédure d’opposition, contraignant ainsi l’opposant à s’en remettre à la réactivité de l’INPI.
Alors que la procédure administrative de première instance semble fluide, le recours devant la cour d’appel comporte des lourdeurs, comme l’obligation faite à chaque partie de communiquer ses actes et conclusions à l’INPI en RAR dans des délais contraints, au risque de perdre ses droits, alors même que l’INPI ne serait en principe pas partie à ce recours et que ces documents sont de toute façon remis à la cour d’appel.
Les recours devant la cour d’appel ne devraient pas ailleurs pas participer au désengorgement souhaité des juridictions judiciaires, ni à la réduction des coûts globaux de l’opposition.
Les prérogatives de l’INPI, « juge » de la première instance, à intervenir dans le cadre d’un recours devant la cour d’appel, voire d’un pourvoi en cassation, interrogent. On ne peut qu’espérer que ces interventions seront cadrées et effectuées en toute transparence.
Il semble que, lorsque l’opposition se conclura par une décision de maintien du brevet sous une forme modifiée, le breveté devra revenir vers l’INPI pour, de manière ex-parte, mettre en œuvre cette décision sous la forme d’une procédure de limitation. L’opposant aura-t-il cependant la faculté d’intervenir dans le cadre de cette procédure ? L’expérience des procédures d’opposition devant l’OEB montre que la présentation des sous-revendications et les modifications de la description, consécutives à l’accord sur une revendication indépendante limitée, peuvent donner lieu à d’intenses débats.
Ces écueils seront probablement lissés à l’épreuve de la réalité et faisant espérer que la procédure d’opposition à la française connaisse le même succès que celle pratiquée à l’OEB.
[1] Après sa délivrance, la validité d’un brevet d’invention français ne pouvait être contestée que dans le cadre d’une action judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris.
[2] Article 122 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, modifiant l’article L. 612-12 du CPI et s’appliquant aux demandes de brevet français déposées à partir du 22 mai 2020.
[3] Article 121, I, 1° et 2° de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises.
[4] Projets d’ordonnance et de décret relatifs à la création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention, publiés par la DGE, du 22 novembre 2019.
[5] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention (JORF du 13 février 2020, texte n° 13).
[6] Bien que les rapports de recherche établis par l’Office européen des brevets pour le compte de l’INPI soient réputés de bonne qualité, ils citent généralement des demandes de brevet et brevets publiés, et incluent rarement d’autres types de documents de l’art antérieur (documents relatifs aux produits existant sur le marché par exemple), généralement mieux connus par les acteurs du marché concerné.
[7] Les actions en nullité de brevet engagées à titre principal, sans demande reconventionnelle en contrefaçon du titulaire du brevet, constituent toutefois une portion faible du contentieux brevet, l’essentiel du contentieux de la validité des brevets s’inscrivant dans le cadre d’actions en contrefaçon (la nullité du brevet étant généralement soulevée par le défendeur à l’action).
[8] Article 5 de l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention.
[9] Les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-116, relatives à l’article L. 811-1-1 du CPI (N° Lexbase : L9511LUS), dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de service (N° Lexbase : L5296LTC), entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signée à Bruxelles le 19 février 2013.
[10] Article 5 de l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention.
[11] C. prop. intell., art. L. 612-23, nouv. (N° Lexbase : L3568ADI).
[12] Cf. infra, n° 11.
[13] C. prop. intell., art. R. 411-20 (N° Lexbase : L8656LTR).
[14] C. prop. intell., art., R. 613-44, nouv. (N° Lexbase : L4604LWG). Le projet d’ordonnance faisait expressément référence à un délai de 9 mois, mais l’article L. 613-23 introduit par l’ordonnance du 12 février 2020 précise finalement que les conditions et délais applicables sont prévus par un décret en Conseil d’Etat. Le décret a été publié au JORF du 8 mars 2020.
[15] Article 99 (1) de la CBE.
[16] Article 105 de la CBE.
[17] C. prop. intell., art. L. 612-16, nouv., in fine (N° Lexbase : L9504LUK).
[18] C. prop. intell., art. R. 613-44-3, nouv. (N° Lexbase : L4588LWT).
[19] C. prop. intell., art. L. 611-2, nouv., in fine (N° Lexbase : L4007ADR).
[20] C. prop. intell., art. L. 613-23-1, nouv. (N° Lexbase : L9506LUM).
[21] C. prop. intell., art. R. 613-44-1, nouv. (N° Lexbase : L4605LWH).
[22] Cf. infra n° 11.3.
[23] C. prop. intell., art. L. 613-23-2, nouv. (N° Lexbase : L9507LUN).
[24] C. prop. intell., art. R. 613-44-4, nouv. (N° Lexbase : L4589LWU).
[25] C. prop. intell., art. L. 613-23-2, nouv..
[26] Cf. site internet de l’INPI, « S'opposer à un brevet délivré à compter du 1er avril 2020 », .
[27] L’article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6758LEZ) prévoit une augmentation des délais d’un mois pour les personnes demeurant dans les territoires et départements d’Outre-mer et de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger.
[28] C. prop. intell., art. L. 613-23-2, al. 2, nouv. et R. 613-44-6, al. 1er, nouv. (N° Lexbase : L4578LWH).
[29] C. prop. intell., art. R. 613-44-1, nouv., in fine (N° Lexbase : L4605LWH).
[30] C. prop. intell., art. L. 613-23-3, I, 1°, nouv.(N° Lexbase : L9501LUG).
[31] C. prop. intell., art. L. 613-23-3, I, 2°, 3° et 4°.
[32] C. prop. intell., art. L. 613-23-3, II, nouv..
[33] C. prop. intell., art. L. 613-23-2, nouv. (N° Lexbase : L9507LUN).
[34] C. prop. intell., art. L. 613-23-6, al. 1er, nouv. (N° Lexbase : L9510LUR).
[35] C. prop. intell., art. L. 613-23-6, al. 3, nouv..
[36] C. prop. intell., art. R. 613-45, 6°, nouv..
[37] C. prop. intell., art. L. 613-23-6, al. 1er, nouv..
[38] C. prop. intell., art. L. 613-23-5, nouv. (N° Lexbase : L9509LUQ).
[39] C. prop. intell., art. L. 613-23-5, nouv..
[40] C. prop. intell., art. L. 613-24, al. 4, nouv. (N° Lexbase : L9502LUH).
[41] C. prop. intell., art. L. 613-24, al. 5.
[42] C. prop. intell., art. R. 613-44-10, nouv. (N° Lexbase : L4580LWK).
[43] C. prop. intell., art. R. 613-44-10.
[44] La jurisprudence fait droit aux demandes de sursis à statuer selon des motifs d’opportunité liées notamment au sérieux de l’opposition, à sa durée potentielle ou encore à son caractère dilatoire.
[45] Projet d’article R. 615-1 A.
[46] Cf. supra n° 3.1
[47] C. prop. intell., art. R. 612-73-3 (N° Lexbase : L4602LWD) et R. 411-21(N° Lexbase : L8657LTS).
[48] C. prop. intell., art. R. 411-43(N° Lexbase : L8711LTS).
[49] C. prop. intell., art. R. 411-23, al. 2 (N° Lexbase : L8661LTX).
[50] C. prop. intell., art. R. 411-33 (N° Lexbase : L8659LTU).
[51] Cf. infra n° 11.3.
[52] C. prop. intell., art. R. 411-23, al. 3.
[53] C. prop. intell., art. R. 411-19, al. 2(N° Lexbase : L8700LTE).
[54] C. prop. intell., art. R. 411-20 (N° Lexbase : L8656LTR)PI.
[55] C. prop. intell., art. R. 411-29 (N° Lexbase : L8706LTM).
[56] C. prop. intell., art. R. 411-30 (N° Lexbase : L8694LT8).
[57] C. prop. intell., art. R. 411-32 (N° Lexbase : L8658LTT).
[58] C. prop. intell., art. R. 411-43 (N° Lexbase : L8711LTS).
[59] C. prop. intell., art. R. 411-38, al. 1er (N° Lexbase : L8666LT7).
[60] C. prop. intell., art. R. 411-37 (N° Lexbase : L8665LT4).
[61] C. prop. intell., art. L. 411-4 (N° Lexbase : L9498LUC).
[62] Les offices européen, allemand, japonais et américain, par exemple.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472913
[Brèves] Transport aérien : compétence du tribunal du lieu de la fourniture du service de transport pour connaître de l’indemnisation du passager ayant conclu un contrat avec une agence de voyage
Réf. : CJUE, 26 mars 2020, aff. C-215/18 (N° Lexbase : A24823K7)
Lecture: 3 min
N2888BYM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 08 Avril 2020
► Un passager ayant réservé son vol par l'intermédiaire d'une agence de voyages peut introduire contre le transporteur aérien un recours en indemnisation, pour un retard de vol important, devant le tribunal du lieu de départ du vol ; en effet, en dépit de l'absence de contrat entre ce passager et le transporteur, un tel recours relève de la matière contractuelle au sens du Règlement sur la compétence judiciaire (Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 N° Lexbase : L7541A8S), de sorte qu'il peut être formé devant le tribunal du lieu de la fourniture du service de transport aérien.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-215/18 N° Lexbase : A24823K7).
L’affaire. Une personne (le passager) a conclu, avec une agence de voyages tchèque, un contrat de voyage à forfait comprenant, d'une part, un transport aérien entre Prague (République tchèque) et Keflavík (Islande), assuré par un transporteur aérien danois, et, d'autre part, un hébergement en Islande. Le vol ayant accusé un retard de plus de quatre heures, le passager a introduit un recours en indemnisation, pour un montant de 400 euros, contre la compagnie aérienne devant le juge tchèque au titre du Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU). C’est dans ces circonstances que la juridiction tchèque a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si, en l'occurrence, il existe une relation contractuelle entre le passager et le transporteur, permettant au premier d'introduire un recours contre le second devant elle du fait que cette juridiction constitue le tribunal du lieu de départ du vol retardé.
La décision. La Cour rappelle, tout d'abord, que la notion de « transporteur aérien effectif » soumis aux obligations découlant du Règlement sur les droits des passagers aériens comprend non seulement le transporteur aérien qui effectue ou a l'intention d'effectuer un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager mais également celui qui effectue ou envisage d'effectuer un vol au nom d'un tiers qui a conclu un contrat avec ce passager. Ainsi, dans une situation, telle que celle en cause, où le transporteur aérien a réalisé le vol au nom d'une agence de voyages qui a conclu un contrat avec le passager, ce dernier, en cas de retard important de son vol, peut se prévaloir du Règlement sur les droits des passagers aériens contre le transporteur, même en l'absence de contrat entre le passager et le transporteur. La Cour rappelle, ensuite, que, bien que la conclusion d'un contrat ne constitue pas une condition pour l'application des dispositions spéciales en matière contractuelle du Règlement sur la compétence judiciaire, le recours à ces dispositions présuppose qu'il existe un engagement librement consenti d'une partie envers une autre. A cet égard, la Cour souligne qu'un transporteur aérien effectif qui n'a pas conclu de contrat avec le passager mais est débiteur vis-à-vis de lui des obligations découlant du Règlement sur les droits des passagers aériens au nom d'une agence de voyages doit être considéré comme remplissant des obligations qu'il a librement consenties à l'égard de cette agence. Sur ce point, la Cour précise que ces obligations trouvent leur source dans le contrat de voyage à forfait que le passager a conclu avec l'agence en cause. Dans ces conditions, la Cour relève qu'un recours en indemnisation, pour le retard important d'un vol, introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif qui n'est pas le partenaire contractuel du passager doit être considéré comme relevant de la matière contractuelle. Par conséquent, dans une telle situation, le passager peut introduire un recours en indemnisation contre le transporteur devant le tribunal du lieu de départ du vol, conformément à la jurisprudence.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472888