[A la une] Le droit, la Justice et les bonnes intentions
Lecture: 4 min
N6331BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Dosé, Avocat à la Cour
Le 03 Février 2021
Commençons par citer Montesquieu : « Lorsqu’on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par des lois ». À tout le moins pas de façon inconsidérée ou précipitée.
La loi du 15 juin 1971 a pour la première fois institué un délit spécifique de non-dénonciation de sévices ou de privations infligées à un mineur de 15 ans, sans qu’aucune immunité familiale ne puisse être opposée. En 1992, l’infraction codifiée à l’article 434-3 du Code pénal ne fait plus référence à des sévices mais à la locution beaucoup plus large de « mauvais traitements », et étend son champ d’application aux personnes qui ne seraient pas en mesure de se protéger en raison de leur âge, d’une maladie, d’une infirmité quelconque, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. Les juges ont alors tôt fait de considérer que les atteintes sexuelles étaient une variante desdits « mauvais traitements », et la loi interprétative du 17 juin 1998 est venue entériner cette jurisprudence en visant expressément les atteintes sexuelles au sein de l’article.
Dans un même souci de précision et de clarification, la loi du 14 mars 2016 ajoute aux « mauvais traitements » et « atteintes sexuelles » les agressions sexuelles, que la jurisprudence avait toutefois déjà pris en considération. Surtout, elle étend l’incrimination à quiconque n’aurait pas informé les autorités administratives ou judiciaires de privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles « infligés à un mineur », et plus seulement à un mineur de quinze ans. Deux ans plus tard, la réforme du 3 août 2018 transforme l’infraction instantanée en infraction continue et aggrave le quantum de la peine d’emprisonnement encourue lorsque la non-dénonciation concerne un mineur de 15 ans.
Ces dernières semaines, dans le tumulte de « l’affaire Duhamel », les parlementaires se sont empressés de déposer ou de soutenir des propositions de réformes visant à allonger le délai de prescription de l’infraction de non-dénonciation. De six ans aujourd’hui, ce délai serait porté à dix ans à compter de la majorité de la victime en cas de délit et à vingt ans en cas de crime, ce qui ne va pas sans poser de graves problèmes. Déjà, en 2016, le cardinal Barbarin s’était vu reproché de ne pas avoir informé les autorités judiciaires de faits prescrits depuis des décennies, alors que l’élément intentionnel de l’infraction réside justement dans la conscience et la volonté de son auteur d’entraver l’action judiciaire. Comment peut-on entraver l’exercice de l’action publique automatiquement éteinte du fait de la prescription ?
Surtout, et l’avocat général Joël Sollier l’avait rappelé avec force au cours de son réquisitoire devant la cour d’appel de Lyon le 29 novembre 2019, il convient de se méfier d’une justice qui ferait de l’élément symbolique son principe d’action. Car l’un des éléments matériels de cette infraction, et ce qui la justifie, réside précisément dans l’état de minorité ou de vulnérabilité de la victime : c’est parce que celle-ci est incapable de saisir la justice que l’infraction créée un mécanisme de substitution qui oblige le tiers informé à le faire à sa place. Et lorsque cette incapacité tombe, autrement dit lorsque la victime devenue majeure se trouve en capacité de saisir les « autorités judiciaires ou administratives », l’infraction de non-dénonciation doit s’éteindre. Sauf à accepter que celui qui a reçu les confessions d’une victime désormais âgée de près de quarante ans puisse être poursuivi pénalement durant des décennies pour avoir tu ce que la victime n’a jamais souhaité révéler. Sauf à considérer encore, dans une logique absolutiste, que les familles des victimes à qui celles-ci se seraient confiées, à l’instar de Camille Kouchner, puissent être poursuivies jusqu’à leur trente-huit ans pour n’avoir pas livré à la justice ce que leur enfant, frère, sœur ou conjoint voulaient garder secret. Aussi, dénonçant un raisonnement jusqu’à l’absurde qui « pourrait même conduire à poursuivre les victimes devenues adultes et qui n’ont pas dénoncé les faits, ne serait-ce que pour protéger autrui (…) », l’avocat général Joël Sollier s’inquiétait à juste titre des « conséquences dévastatrices » d’une telle extension. Le droit, la justice et les bonnes intentions ne font pas toujours bon ménage : cette réforme, portée par un vaste et nécessaire mouvement de libération de la parole des victimes, pourrait bien inciter celles qui ne sont pas encore prêtes à dénoncer les violences qu’elles ont subies à se taire et à s’enfermer dans le silence.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476331
[Brèves] Aide juridictionnelle : l’avocat qui souhaite contester sa rémunération en cassation ne peut se représenter lui-même
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 433994, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85354DH).
Lecture: 3 min
N6321BYR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 03 Février 2021
►Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3301ALT) ; ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'AJ, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'Etat en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article.
Procédure. Le tribunal administratif de Strasbourg avait fait droit aux conclusions d’une requérante tendant à l'annulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et avait rejeté les conclusions de l'intéressée tendant ce que l'Etat verse à son conseil, la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4) et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La question qui se posait au Conseil d'Etat dans cette affaire était celle de la recevabilité du pourvoi.
Réponse du CE. La Haute juridiction administrative précise qu’il résulte de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire. Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3301ALT). Ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'AJ, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'Etat en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article.
Recevabilité. La Haute juridiction administrative note que le pourvoi de la requérante a été, à la suite de l'invitation en ce sens qui lui a été faite, régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'il est ainsi recevable.
|
A rapprocher : s'agissant du recours ouvert au seul avocat contre la partie d'un jugement relatif à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CE, 11 janvier 2006, n° 279878 (N° Lexbase : A5331DME) ; CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893 (N° Lexbase : A3272S93). Pour en savoir plus : V., ETUDE : L'aide juridictionnelle, Le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E38403RN). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476321
[Actes de colloques] Publication des actes du colloque du 25 septembre 2020 à la Faculté de droit d'Amiens - La profession d’avocat : les risques de l’exercice
Lecture: 1 min
N6281BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lexbase Avocats
Le 04 Février 2021
Le 25 septembre 2020, se tenait à la Faculté de droit d'Amiens, un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et de François Viney. Partenaire de cet évènement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver, dans son numéro de février 2020, les interventions qui ont eu lieu lors de cet événement.
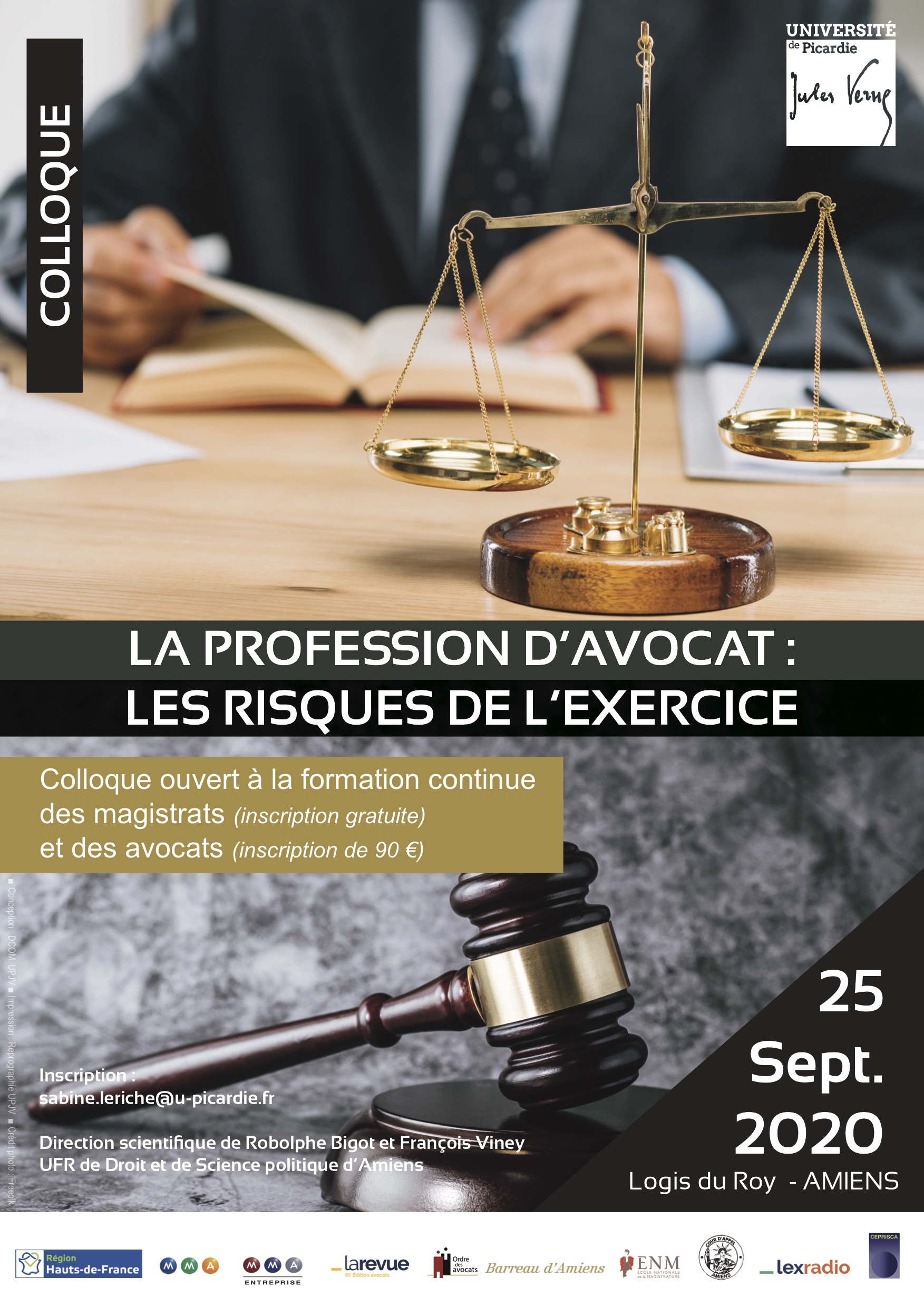
Propos introductifs, Maître Dorothée Fayein-Bourgois, Bâtonnier d’Amiens (N° Lexbase : N5991BYK)
Partie 1. De l’évolution à la réalisation des risques
I - L’évolution des risques de l’avocat
Risques et avocat en entreprise, Maître Xavier Chiloux, avocat au barreau de Paris (N° Lexbase : N6011BYB)
Risques et procédure d’appel, Paul Giraud, professeur, UPJV (N° Lexbase : N6028BYW)
II - La réalisation des risques : les responsabilités de l’avocat
La responsabilité pénale de l’avocat, Elise Letouzey, MCF, UPJV (N° Lexbase : N6098BYI)
La responsabilité disciplinaire de l’avocat, Jean-Marie Brigand, MCF, Le Mans Université (N° Lexbase : N6071BYI)
La responsabilité civile de l’avocat : les dommages réparables, Hadi Slim, professeur, Université de Tours (N° Lexbase : N6047BYM)
Le bénéficiaire des obligations de l’avocat, Maître Jean de Salve de Bruneton, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : N6283BYD)
Les fautes civiles de l’avocat, François Viney, MCF, UPJV (N° Lexbase : N6016BYH)
Partie 2. De la prise en charge à la prévention des risques
I - La prise en charge des risques générés par l’avocat
Les mécanismes de garantie obligatoire des risques, Rodolphe Bigot, MCF, UPVJ (N° Lexbase : N6010BYA)
Les commissions sinistres et la gestion des risques : respect du réclamant, traitement des sinistres, prévention par des modèles de lettres de réclamation, Yves Avril, ancien Bâtonnier, avocat honoraire, Président d’honneur du Conseil régional de discipline, docteur en droit (N° Lexbase : N5996BYQ)
L’appréhension des risques par l’assureur dominant, Pierre Roger, Responsable souscription des grands comptes professions du chiffre et du droit, MMA (N° Lexbase : N6094BYD)
II - La prévention des risques par la formation (initiale, continue et spécialisation) de l’avocat
Le point de vue des responsables de formation, Morgane Daury, professeur, UPJV, directrice de l’IEJ d’Amiens, et Maître Patrick Delahay, président honoraire d’IXAD et président de l’AFEDA (association des écoles d’avocats) (N° Lexbase : N6286BYH)
Le point de vue d’un Bâtonnier, Maître Fabrice Bertolotti, barreau de Compiègne, président du Conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Amiens (N° Lexbase : N5995BYP)
Propos conclusifs, Florence G’sell, professeur, Université de Lorraine (N° Lexbase : N6287BYI)
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476281
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Propos introductifs
Lecture: 5 min
N5991BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Dorothée Fayein-Bourgois, Bâtonnier d'Amiens
Le 03 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
Je suis très honorée de prendre la parole devant un tel auditoire et, comme vous, friande de ce dont je vais être instruite par ces intervenants durant les quelques heures que nous nous apprêtons à passer ensemble en cette fin de semaine.
Cette invitation - j’allais dire cet appel, mais la délicatesse de Monsieur Rodolphe Bigot ne se satisferait pas du recours à l’injonction - cette invitation, donc, à prendre un peu de hauteur, et à nous extraire, pour un temps, des périls de l’exercice est une joie.
La joie que l’on éprouve à la rencontre et à l’échange, en ces temps singuliers de nécessaire cloisonnement, et lorsque l'on sait qu’un avocat isolé est un avocat en danger.
La joie que l’on éprouve à la pensée, à la nourriture de l’esprit, lorsque les slogans et les coups de mentons paraissent parfois constituer, en 140 caractères, notre seul horizon.
La joie que l’on éprouve à entendre des mots capables de reconstituer en volume ce que sont nos vies parfois écartelées entre des injonctions qui paraissent si contradictoires.
Alors, merci au CEPRISCA de continuer, par son exigence combinée à la passion, de porter haut les couleurs d’Amiens et de l’Université Picardie Jules Verne.
La profession d’avocat : les risques de l’exercice.
Le risque de l’exercice est pluriel, nous le verrons.
Je le distingue naturellement des « risques du métier » : les risques pris par les entrepreneurs que nous sommes aussi ; des risques économiques et financiers ; les risques pris par les femmes et les hommes, de chair et de sang, que nous sommes aussi ; des risques psycho-sociaux, auxquels les Ordres tentent d’apporter des réponses.
Ces risques du métier, ce sont les risques que l’on court pour soi.
Les risques de l’exercice, ce sont les risques que l’ont fait courir aux autres : à la société ou à nos clients …
Et auxquels répond l’engagement éventuel de nos responsabilités civile, pénale et disciplinaire.
La réponse à ces risques en termes d’engagement de responsabilité et en termes de prévention est contenue dans notre corpus déontologique ; la déontologie, qui n’est pas cet élément conservateur, dénué de sens, qui viendrait contraindre et asservir ; elle est, je crois, cette norme sans cesse renouvelée, dans la transmission, qui nécessite un compagnonnage, et dont l’existence vivante garantit la confiance que la société et nos clients peuvent avoir en nous.
Le Bâtonnier que je suis, au presque terme de ces deux années de mandat, connaît intimement les risques du métier et les risques de l’exercice ; il se doit de protéger à la fois les avocats des risques du métier et les tiers des risques de l’exercice.
Et c’est un exercice périlleux qui interroge sans cesse le serment, et l’indépendance, parfois radicale, à laquelle il nous appelle, le courage aussi.
Entre la grève sur fond de réforme des retraites exprimant sans doute davantage une crise identitaire, et la crise sanitaire, cette année a considérablement ébranlé nos vies d’avocats, de citoyens, la vie des barreaux et des Ordres ; comme elle a interrogé profondément la devise de notre République, elle a interrogé profondément notre serment.
Quelle vérité dans la radicalité ?
C’est une question qui habite mes journées ; l’indépendance peut-elle aller jusqu’à s’affranchir des limites assignées par nos règles professionnelles ?
Je pense, et comment ne pas penser, à nos confrères d’ailleurs et pas si loin, ainsi que le soulignait Madame le Procureur Général près la cour d’appel d’Amiens, Brigitte Lamy, aux termes de son discours d’installation, le 11 septembre dernier, qui exercent au péril et au prix de leurs vies.
Alors, on pourrait se taire et ne plus rien avoir à dire, tant les risques du métier et les risques de notre exercice semblent si dérisoires aux côtés des risques pris par Ebru Timtik, Nasrin Sotoudeh, Aytaç Unsal, Monferrier Dorval et tant d’autres, puisque chaque jour apporte son lot de funestes nouvelles.
Mais, au contraire, je crois que nous ne pouvons pas nous taire.
La liberté dont nous jouissons nous oblige.
Je crois que le respect dû à notre serment ne trouve à s’ancrer que dans les risques que nous assumons, car ils procèdent de celui-ci, prêté et recueilli un jour par une cour d’appel.
Je crois que nous devons à ces confrères « d’ailleurs » d’être conscients de ce qui nous lie, de l’exigence radicale qui nous contraint à prendre des risques ; et à prendre la mesure de la liberté qui est la nôtre en en respectant les contraintes.
Alors, l’audace chantée par René Char, souvent repris par Madame Christiane Taubira, « Impose ta chance. Serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder ils s'habitueront ». Oui.
Oui, pour aller aux périphéries ; ne plus se contenter d’être assigné à résidence dans des territoires devenus trop petits pour les audacieux ; se voir soumettre des problématiques déontologiques nouvelles ; imaginer de nouveaux modes d’accès aux droits ; des nouveaux modes d’exercice…
Mais pas sans Isaïe « Elargis l'espace de ta tente. Allonge tes cordages ! Renforce tes piquets ».
Ce sont ces piquets qu’il convient d’interroger. Souvent.
Lorsque le gros temps s’annonce, et ce n’est pas le Bâtonnier Yves Avril, marin et navigateur émérite qui me démentira, il faut vérifier l’état des aussières.
Merci, ici, de nous donner l’occasion de jeter l’ancre pour un vrai bel état des lieux des aussières.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475991
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Risques et avocats en entreprise
Lecture: 12 min
N6011BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Xavier Chiloux, Avocat à la Cour, Ancien membre du Conseil National des Barreaux et du Conseil de l'Ordre
Le 03 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
En premier lieu, je voulais vous exprimer le plaisir et l’honneur que j’ai à parler devant vous en introduction de nos travaux.
Je souhaitais aussi remercier chaleureusement l’UFR de droit et sciences politiques d’Amiens, et particulièrement mon ami Rodolphe Bigot que j’ai eu à connaître en d’autres endroits, et à d’autres moments, car si certains l’ignorent Rodolphe est un formidable joueur de squash, ancien pensionnaire de l’équipe de France.
L’annonce de ma présence lors de ce colloque n’est pas totalement exacte puisque si je suis bien candidat depuis quelques temps à la fonction de Bâtonnier de l’Ordre de Paris, je ne le serai pas pour la prochaine élection qui se tiendra en novembre 2020, mais pour celle d’après en 2022.
Du fait de mon passé sportif que Rodolphe connaît bien, je souhaiterais humblement avoir la chance, la prise de fonction s’effectuant en janvier 2024, d’être le Bâtonnier olympique.
Le sujet qui nous occupe aujourd’hui, et que j’ai à traiter est, d’une certaine façon, l’un des marronniers de notre profession.
En effet, l’avocat en entreprise déchaîne les passions des avocats depuis plusieurs décennies.
Lors de chaque vote au conseil national des barreaux depuis trois ou quatre mandatures, le résultat est toujours le même : 40 pour… et 40 contre…
Certains y voient une formidable chance pour la profession d’avocat, et un développement qu’on ne peut ignorer, alors que d’autres croient en la création de « sous avocats » qui feront peser des risques économiques sur les avocats actuels.
Je l’ai écrit à plusieurs reprises, dit et redit, et cela ne vous surprendra pas, je fais partie de la première catégorie.
La question que l’on peut et doit se poser à ce stade est de savoir si une profession, quelle qu’elle soit, peut elle-même se réformer de l’intérieur ou, si toute évolution ne peut venir que des pouvoirs publics.
L’exemple assez récent de la profession d’avoué en est une belle illustration.
Alors qu’il leur était simplement demandé d’abandonner leur droit proportionnel que des abus fréquents avaient rendus économiquement impossible, cette profession n’a pas voulu le faire, et a été purement et simplement supprimée.
Quel paradoxe aujourd’hui que d’observer, qu’avec la complexification incessante de la procédure d’appel cette activité s’est purement et simplement recréée, la plupart des praticiens souhaitant transférer les risques inhérents à cette procédure d’appel à un autre professionnel.
Ce ne sont plus donc des avoués qui interviennent en appel, mais des avocats spécialisés en procédure d’appel…
Le risque d’affaiblissement de la profession d’avocat, dans l’hypothèse où elle n’intégrerait pas l’avocat en entreprise est considérable, ne serait-ce que pour les quelques raisons suivantes.
Premièrement, de nombreux pays de la communauté européenne acceptent depuis fort longtemps, l’avocat en entreprise comme : le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne ou encore le Portugal.
Ainsi, et afin de se conformer aux règles européennes, dès 2017, le barreau de Paris a reconnu la possibilité aux avocats du barreau de Paris d’exercer en entreprise… à la condition qu’ils exercent sur le territoire d’un autre État membre reconnaissant cette possibilité…
Un avocat parisien peut donc être avocat en entreprise en gardant son titre, ses droits et ses privilèges, en Allemagne ou en Espagne mais ne pourrait pas l’être en France.
Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que cette situation ne pourra durer indéfiniment, et que ce n’est simplement qu’une question de temps : la durée restant à définir.
Le second risque colossal pour la profession d’avocat résulte des revendications qui peuvent sembler légitimes des juristes d’entreprises.
En effet, ceux-ci revendiquent de pouvoir bénéficier de ce que l’on appelle le legal privilege.
Comme nous le savons, les deux grands obstacles à la reconnaissance du statut de l’avocat en entreprise sont l’indépendance, et le secret professionnel que dans les pays de common law on assimile, plus ou moins, au legal privilege…
Nous reviendrons tout à l’heure sur le premier.
Concernant le legal privilege, à savoir le droit de ne pas communiquer les avis juridiques donnés à un client dans les procédures américaines de discovery, ou anglaises de disclosure, la demande des juristes salariés en France est prégnante.
Il s’agit ici de bon sens.
Soit les avocats en entreprise dans les pays les autorisant disposent de ce secret professionnel, soit les juristes en entreprise, notamment dans la tradition anglo-saxonne peuvent bénéficier de ce legal privilege.
Pour sa part, le juriste français exerçant en entreprise n’en bénéficiant pas, non seulement son influence sur les décisions seront moindres, mais encore son, ou ses employeurs, se méfieront de toutes consultations ou conseils qu’il pourrait être amené à donner, et ainsi en cas de litige, divulgués.
N’y allons pas par quatre chemins, cette insécurité juridique, et nous savons tous que le monde économique déteste cela plus que tout, ne peut se résoudre que de deux façons.
Soit l’acceptation en France de l’avocat en entreprise, soit, et dans cette deuxième hypothèse la profession d’avocat aura énormément à perdre, le légal privilège est octroyé aux juristes en entreprise qui ainsi n’auront plus aucun intérêt à devenir avocat, et qui même en deviendront des concurrents.
Troisième risque clairement identifié et non des moindres, la concurrence d’autres professions.
Chaque profession, ou corps social, réagit dans sa propre vision, ou paradigme.
Or, il est démontré de longue date, que les véritables concurrents d’une entité sont ceux qui se situent à sa marge, ou même souvent qui ne font pas partie de son monde.
On en voudra pour exemple ce qui s’est passé dans l’industrie horlogère à la fin des années 70.
Les fabricants suisses représentaient près de 95 % du marché de l’horlogerie dans le monde, et étaient alors dans une situation florissante qu’aucune ombre réelle ne venait menacer.
Comme on le sait, les mouvements étaient alors traditionnels et mécaniques.
L’industrie japonaise qui n’existe pas alors réellement sur le marché de l’horlogerie crée à cette époque la miniaturisation du quartz qui va révolutionner, notamment les montres.
Ce procédé est alors proposé à l’horlogerie suisse qui, fort de son monopole sur le marché préfère en ricaner.
10 ans plus tard, ce sont les Japonais qui détiendront 90 % du marché.
Les concurrents identifiés et actuels des avocats sont en premier lieu les experts-comptables qui doivent se réinventer du fait des atteintes constantes à leur sphère d’intervention.
Mais il s’agit aussi et de longue date des notaires qui font preuve d’un entrisme et d’un lobbying bien supérieurs à ce que proposent les avocats.
Enfin, et surtout devons-nous dire, il s’agit de tous les sites, et start-ups qui se développent et viennent concurrencer la profession d’avocat sur ses activités qui ne sont pas protégées ou monopolistiques, à savoir le conseil et les avis juridiques.
À ces concurrences multiples et variées, identifiées ou non encore identifiées à ce jour, la seule réponse est une grande profession d’avocat : forte, jeune et dynamique.
L’avocat en entreprise, permettra aux jeunes, et plus particulièrement aux femmes qui en sont demanderesses, d’avoir des carrières variées passant du cabinet à l’entreprise à la satisfaction des uns et des autres, ne serait-ce que par les synergies ainsi créées.
On le sait, la plupart du temps dans les entreprises, les perspectives d’évolution sont plus rapides que dans les cabinets d’avocats, et les opportunités plus fréquentes.
C’est toujours la mort dans l’âme, qu’un avocat envisage de quitter la profession qu’il a choisie, le titre, les droits et les devoirs qui l’accompagnent, pour entrer en entreprise et n’être plus… qu’un ancien avocat.
Mais c’est une réalité que nous devons prendre en considération.
Il y a 30 ans, tout jeune qui se destinait à la profession d’avocat n’envisageait pas d’autre choix que de devenir, d’être, et de finir avocat.
Aujourd’hui la très grande majorité des futurs avocats entrant en école de formation du barreau pensent qu’ils ne resteront pas avocat toute leur vie.
Ne pas en tirer les conséquences sclérosera purement et simplement la profession d’avocat qui n’aura plus du tout le capital d’attirance qu’elle a encore aujourd’hui, mais pour combien de temps ?
Après cette première question du legal privilege qui comme on vient de le voir pourrait se résoudre assez rapidement avec un peu de logique et de concertation, le deuxième point de blocage identifié à l’acceptation de l’avocat en entreprise est celui de l’indépendance.
Je vous propose d’y réfléchir au travers de ce que pourrait être un contrat type d’avocat en entreprise.
En 2018, plusieurs rapporteurs, dont mon amie Nathalie Attias de l’ACE, ont proposé au barreau de Paris un contrat type de cette nature dans le but de faire avancer la réflexion en la matière.
En effet, il était alors apparu de façon assez évidente, que la meilleure façon de traiter l’indépendance de l’avocat en entreprise était de concevoir des clauses d’un contrat type.
Vous trouverez ce contrat type en annexe du présent exposé.
L’indépendance y est définie en article 4 et s’inspire des clauses existantes dans les contrats élaborés pour les médecins salariés, par le conseil de l’Ordre des médecins.
Il est prévu que l’indépendance de l’avocat salarié sera garantie par une clause contractuelle d’ordre public de protection, celle-ci étant obligatoire à peine de nullité du contrat lui-même.
Il est ainsi rappelé que l’avocat exerce son activité et ses missions en toute indépendance vis-à-vis de l’entreprise, conformément aux principes essentiels de la profession.
Ceux-ci comme le savent beaucoup d’entre nous, sont décrits à l’article 1.3 de notre Règlement Intérieur National des avocats (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8).
Il s’agit ici de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
On peut y ajouter les suivants qui font l’objet d’un second paragraphe à savoir : l’honneur, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie.
Puis un peu plus loin : le dévouement, la diligence et la prudence.
Surtout, cet article 4 du contrat type prévoit que l’employeur ne peut imposer à l’avocat l’accomplissement d’une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience ou à ses opinions et surtout que l’avocat ne peut en aucune façon être sanctionné pour l’expression d’une opinion.
Ainsi, cet article en est l’illustration, mais le reste du contrat le démontre aussi, l’idée principale est que la déontologie de l’avocat entre à l’intérieur, et au cœur des entreprises.
Le secret professionnel de l’avocat qui devrait être sanctuarisé constitutionnellement comme il l’est dans certains pays, est protégé dans ce contrat type :
- Accès aux fichiers informatiques distinct du reste de l’entreprise.
- Espace clos permettant de garantir le secret professionnel.
- Personnel instruit et formé aux règles du secret professionnel de l’avocat.
- Confidentialité des correspondances et des archives.
- Sécurité et confidentialité des données.
- Sécurisation des échanges au sein de l’entreprise.
L’article 6 qui répond à une forte demande de certains avocats, surtout ceux intervenant au judiciaire, qualifie l’obligation de distance qui interdit à l’avocat en entreprise de représenter en justice la société qui l’emploie.
Néanmoins, vis-à-vis de son Ordre, l’avocat en entreprise conservera ses obligations de formation ainsi que celle en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office.
Ces dernières obligations sont l’exception liée aux obligations professionnelles de tout avocat, à l’interdiction pour l’avocat en entreprise de traiter une clientèle personnelle.
En ce qui concerne l’application des conventions collectives, il est retenu qu’afin de ne pas léser l’avocat en entreprise par rapport à ses autres collègues, c’est celle de l’entreprise qui trouvera application.
Cependant, tous les éventuels manquements déontologiques de l’avocat en entreprise restent soumis au conseil de l’Ordre du barreau dont il relève.
De même, si le conseil des prud’hommes reste compétent pour traiter de la cessation du contrat de travail néanmoins, lorsqu’il s’agira d’une interprétation ou du respect d’une obligation professionnelle celle-ci sera soumise à l’arbitrage du Bâtonnier.
Enfin, les rédacteurs de ce contrat type ont tenu à stipuler que : « toute clause contraire aux stipulations non déclarées sera tenue pour nulle et non avenue »
Il s’agit ici d’empêcher toute contre-lettre qui entrerait de ce fait en contradiction avec les dispositions contractuelles.
On voit ici, que les risques potentiels ; notamment sur le plan déontologique ou professionnel, que l’avocat en entreprise pourrait représenter sont facilement contournables avec un tant soit peu de bonne volonté et d’analyse de la situation.
L’avocat en entreprise est indispensable à l’avenir de la profession d’avocat.
En aucune façon il ne peut être un risque pour celle-ci, mais bien une chance à saisir… vite…
La profession d’avocat a réussi sa première mutation avec l’intégration des avoués de première instance en 1971, puis la deuxième avec celle des conseils juridiques en 1991, il est temps, il est grand temps d’envisager celle avec les avocats d’entreprises.
À chacune de ces mutations, de ces changements par fusions avec d’autres professions, on a promis à la profession d’avocat un effondrement, ainsi que la perte de ses valeurs et de son identité.
Comme chacun le sait, il en a été tout autrement, et au contraire ces mutations ont renforcé une profession qui attire chaque année plus de 3000 futurs jeunes avocats.
Néanmoins, et soyons-en persuadés, comme le dit l’adage populaire plein de bon sens : « qui n’avance pas recule… »
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476011
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Les risques de l'appel
Lecture: 24 min
N6028BYW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Paul Giraud, Professeur à l'Université d'Amiens
Le 03 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
Il faut renoncer à interjeter appel ! Tel était le sentiment d’Ulpien, pour qui l’appel comportait le risque majeur que le juge d’appel réforme, en pire, la sentence de première instance [1]. L’assemblée constituante a partagé, seize siècles plus tard, la même préoccupation : comment être certain que le jugement d’appel sera meilleur que celui de première instance ? [2] Malgré cette crainte, l’appel a traversé le temps. Apparu dans sa plénitude judiciaire à Rome, sous l’Empire [3], il est adopté par l’Église dans la procédure canonique [4]. En France, il est un enjeu de pouvoir lors de l’affirmation de la souveraineté royale en permettant au roi de s’affirmer comme fontaine de justice face aux juridictions seigneuriales et ecclésiastiques [5]. Sous l’Ancien Régime, l’appel se déploie en une multiplicité de degrés de juridictions qui allongent la durée des procès. Afin d’endiguer les risques de procédures sans fin, la Révolution limite le droit d’appel en 1790 par l’instauration d’un double degré de juridiction [6] selon le mécanisme de l’appel circulaire : tous les juges étant égaux, l’appel d’un jugement rendu par un tribunal de district est porté devant un autre tribunal de district. Dix ans plus tard, le Consulat instaure vingt-neuf juridictions d’appel qui prendront le nom, en 1804, de cours d’appel.
L’appel n’est pas une voie juridictionnelle apaisée : il est battu par des vents multiples. Un premier vent, ancien, est celui du débat sur la nature de cette voie de recours [7]. L’appel doit-il être une ambitieuse voie d’achèvement afin de régler en une fois toutes les dimensions du litige, ou ne peut-il raisonnablement être qu’une voie de réformation des aspects jugés en première instance ? La réponse législative a varié : la voie de réformation a régné jusqu’au Nouveau Code de procédure civile, avant d’être remplacée par la voie d’achèvement ; depuis dix ans, la recherche d’un compromis entre ces deux conceptions fait de l’appel une « voie d’achèvement maîtrisée » [8].
Un deuxième vent, plus récent, est celui de la gestion financière de la justice. Certes, l’appel contribue à une justice de qualité par la possibilité d’un réexamen, en fait et en droit, du jugement de première instance. Mais l’appel est un luxe : il n’est d’ailleurs pas une exigence du procès équitable. La tentation est grande, sinon de le supprimer – cela serait politiquement délicat – mais de restreindre son accès et de dissuader son utilisation. Il s’agit là d’un drame récurrent de l’appel ; comme le soulignaient Serge Dauchy et Yves-Marie Serinet, « historiquement, les voies de recours ont toujours été conçues par la puissance publique comme une affaire d’administration de la justice » [9].
Outre ces deux vents, l’appel doit composer avec un bouillonnement d’études et de réformes législatives. En effet, de nombreux rapports furent consacrés à l’appel : rapport de la Mission Magendie en 2008 [10], de l’IHEJ en mai 2013 [11], de la commission Delmas-Goyon en décembre 2013 [12] et, le même mois, celui de la commission Marshall [13], le rapport de l’Inspection générale de la Justice en 2019 [14], jusqu’au très récent rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, dirigée par Dominique Perben [15].
Conséquences de ces réflexions et des propositions formulées dans les rapports, l’appel a été l’objet de nombreuses réformes législatives : décret dit « Magendie » n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW), décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L9934INA), loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel (N° Lexbase : L2387IP4) et le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel (N° Lexbase : L0080IT7), décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A) qui applique les « décrets Magendie » aux chambres sociales des cours d’appel, décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile (N° Lexbase : L2696LEL), décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3) et, en 2020, les ordonnances COVID qui modifient les délais de procédure [16].
Dans ce bouillonnement d’idées, de propositions, de préconisations et face à ces vagues successives de réformes, trois individus cherchent à garder la tête hors de l’eau : le justiciable, le juge et l’avocat. Tous trois confrontés au défi de l’assimilation de ce droit changeant. L’avocat est au quotidien confronté à la procédure d’appel et engage sa responsabilité professionnelle en cas d’erreur. Si les subtilités de l’appel justifiaient jusqu’en 2012 le monopole des avoués, ils ont désormais disparu : l’avocat doit faire face, seul, aux risques de l’appel.
Ces risques trouvent leurs causes dans la grande technicité et les sanctions de la procédure d’appel. S’ils se manifestent par le nombre élevé de sinistres, ils ne sont toutefois pas inévitables car des remèdes existent.
Appréhender ces risques pour l’avocat implique d’étudier les origines de ces risques (I) et leur devenir (II).
I – L’origine des risques
Les risques causés par la procédure d’appel sont à la fois présents (A.) et futurs (B.).
A. Des risques présents
Les risques présents proviennent du cadre textuel (1°) ainsi que de la pratique (2°) de la procédure d’appel.
1. Les risques issus des textes relatifs à la procédure d’appel
Depuis le décret « Magendie » du 9 décembre 2009 [17], la procédure d’appel [18] connaît des délais procéduraux contraignants et des sanctions rigoureuses de caducité et d’irrecevabilité. Ce mouvement fut accentué par le décret du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) qui instaure une procédure d’appel au formalisme exigeant, aux délais stricts et aux sanctions sévères. Ainsi, premièrement, la déclaration d’appel doit respecter, à peine de nullité pour vice de forme, un formalisme précis et – innovation de 2017 – mentionner les chefs de jugement critiqués [19], c’est-à-dire les énonciations du dispositif de la décision que l’appelant entend soumettre à la cour d’appel. Cette énonciation n’est pas anodine car l’objet du litige soumis à la cour d’appel sera limité aux seuls chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel [20]. L’appel devient une voie d’achèvement encore plus maîtrisée du litige. Le risque pour l’avocat est de ne pas critiquer, au moment de la rédaction de sa déclaration d’appel, un des chefs du jugement. Passé le délai d’appel, il sera forclos à le faire.
Deuxièmement, les délais sont sévèrement sanctionnés. Le décret du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) uniformise les délais pour conclure à trois mois dans la procédure ordinaire ; un mois pour la procédure à bref délai. Le délai est de seulement dix jours pour signifier la déclaration d’appel dans la procédure à bref délai [21]. La violation de ces délais est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions. Ces délais constituent un risque majeur pour l’avocat. Risque de l’oublier, risque de la sanction, risque de l’action en responsabilité menée par le client. Ces délais rigoureux reposent sur la conviction que l’avocat est l’unique responsable d’une procédure qui s’éternise ; il faut pourtant aussi tenir compte de la lenteur du client à fournir une pièce ou des très longs délais d’audiencement.
Troisièmement, le formalisme des conclusions est rendu plus rigoureux. Le décret du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) poursuit l’œuvre du décret Magendie de 2009 qui avait refaçonné la répartition des charges processuelles entre le juge et les parties et dont les exigences formelles demeurent. Les conclusions doivent être qualitatives (formulant expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée) et récapitulatives (par la reprise intellectuelle des conclusions antérieures [22]). En outre, les conclusions doivent renvoyer à la pièce invoquée au soutien et être complétées d’un bordereau récapitulatif des pièces [23]. Trois nouveautés apparaissent en 2017. Tout d’abord, un principe de concentration temporelle des prétentions impose d’exposer l’ensemble des prétentions sur le fond dès les premières conclusions [24], sanctionné par le fait que la cour d’appel ne tranchera pas une prétention exprimée postérieurement. Ensuite, l’exigence que les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures et soulevés dans la discussion soient présentés de manière formellement distincte [25]. Enfin, la structuration des conclusions par un exposé des faits et de la procédure distinct, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La sanction est précisée : la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion [26].
Quatrièmement, les sanctions sont variées et rigoureuses. Les articles applicables à la procédure d’appel utilisent un large arsenal de sanctions procédurales : nullité [27] ou caducité de la déclaration d’appel [28], irrecevabilité des conclusions [29], péremption de l’instance. La rigueur de ces sanctions se marque par le fait que, depuis 2017, la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité de l’appel privent du droit de former un nouvel appel [30], indépendamment de l’expiration du délai de forclusion de l’appel, ce qui est même valable pour l’appelant incident [31]. L’enchainement des sanctions procédurales s’avère redoutables pour les parties, voire pour leurs conseils et les assureurs de ces derniers.
Un dernier risque textuel provient du régime particulier des appels contre un jugement statuant sur la compétence. Cette particularité est une cause de risque pour l’avocat. Le rapport de l’Inspection générale de la Justice de 2019 consacré à l’appel préconise de supprimer cette procédure spéciale au profit de la procédure ordinaire à bref délai [32].
2. Les risques issus de la pratique de la procédure d’appel
- Les risques issus des incertitudes
La réforme de l’appel a créé des zones d’incertitude qui sont source de risques pour l’avocat. Ainsi, Natalie Fricero débute son panorama annuel de procédure civile de janvier 2019 par ces mots : « la réforme de la procédure d’appel a généré d’importantes hésitations pratiques dans sa mise en œuvre […]. La jurisprudence rendue en 2018 a permis de sécuriser certains aspects, sans résoudre toutes les difficultés » [33].
Ces incertitudes proviennent par exemple des difficultés techniques liées à la communication électronique. En effet, l’appel formé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) dans les procédures avec représentation obligatoire ne permet l’envoi que de 4080 caractères. Ce nombre est parfois insuffisant pour inscrire l’intégralité des chefs du jugement que l’appelant entend critiquer. Or si ces chefs ne sont pas exhaustivement énumérés, la cour d’appel ne sera pas saisie de ces aspects du jugement de première instance. Cette impossibilité technique a suscité des interrogations pratiques et a causé une incertitude et donc des risques pour les avocats. Finalement, une circulaire du 4 août 2017 [34] autorise l’adjonction d’une pièce jointe énumérant l’ensemble des chefs du jugement critiqués.
- Les erreurs des praticiens
Dans ce contexte, les risques d’erreurs sont légion. Ainsi, l’appelant qui signifie l’avis de l’inscription au rôle de l’affaire, adressée par le greffe, et non la déclaration d’appel proprement dite viole l’article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7237LER) et sa déclaration d’appel est frappée de caducité [35]. En outre, l’avocat qui signifie ses conclusions à l’avocat adverse de 1ère instance, et non à l’avocat adverse constitué en appel viole l’article 911 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7242LEX) qui impose de signifier les conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; sa déclaration d’appel est frappée de caducité [36].
- Les risques issus d’une jurisprudence rigoureuse
L’avocat qui a respecté les délais pour conclure n’est pas à l’abri de tout risque procédural. Il lui faut encore respecter le délai de péremption, dont la Cour de cassation fait une application d’une très grande sévérité. Ainsi, l’avocat qui a correctement établi sa déclaration d’appel, conclu dans les temps, qui a donc le sentiment d’avoir respecté les charges processuelles qui pèsent sur lui, qui constate que le greffe a porté la mention « à fixer » dans le dossier visible des parties via le RPVA, et qui attend que le conseiller de la mise en état fixe la date d’audience, court un grand risque : celui de la péremption de l’instance. En effet, la Cour de cassation juge qu’en l’absence de fixation de l’affaire par le conseiller de la mise en état, les parties sont tenues de prendre des initiatives pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation ; à défaut, l’instance est périmée [37]. L’avocat doit donc pallier les absences du juge.
La rigueur jurisprudentielle s’illustre également en matière de délai de communication des conclusions. Ainsi, en cas de longue maladie, l’hospitalisation de l’intimé ne constitue pas une situation de force majeure excusant le retard de communication [38]. De plus, la notification des conclusions d’appel à un confrère qui n’est pas encore constitué est inopérante, même si cette notification a été faite dans le délai et même si l’avocat destinataire a accusé réception des conclusions. La Cour de cassation y voit en effet une irrégularité de fond qui, même en l’absence de grief, prive la notification de tout effet [39].
Très récemment, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour explique qu’il s’agit là d’une « interprétation nouvelle » [40]. Consciente de la rigueur de cette solution, qui aboutit, selon la Cour elle-même, à « priver les appelants du droit à un procès équitable », la Cour diffère l’application de la règle à l’espèce. La solution ainsi dégagée ne sera applicable qu’aux déclarations d’appel effectuées à compter de la date de cet arrêt.
B. Des risques futurs
Certaines préconisations de réforme accentueront les risques que la procédure d’appel fait courir aux avocats. Ainsi, les préconisations du rapport sur l’appel de l’Inspection générale de la Justice [41] accentueraient les sanctions pesant sur les avocats, comme en témoignent les quatre premières préconisations de ce rapport :
« Préconisation n° 1. Modifier le CPC pour prévoir que l’appel dit « total » ou « général » est sanctionné par une irrecevabilité prononcée d’office ou à la demande des parties par le président de chambre, le magistrat délégué par le premier président et/ou le CME
Préconisation n° 2. Permettre aux présidents de chambre, au stade de l’orientation des affaires, de prononcer d’office la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel sans avoir à recueillir les observations des parties ni à organiser un débat : laisser néanmoins à ces dernières la possibilité de contester ses ordonnances par voie de déféré
Préconisation n° 3. Augmenter les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour lui permettre de :
- prononcer d’office ou à la demande des parties, l’irrecevabilité des prétentions nouvelles
- prononcer l’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 910-4 du CPC (N° Lexbase : L9354LTM), sur demande des parties ou d’office
Préconisation n° 4. Compléter le CPC pour prévoir que les parties ne sont plus recevables à soulever un incident, fondé sur les dispositions des articles 770 (N° Lexbase : L9312LT3) et 771 (N° Lexbase : L9313LT4) du CPC, après l’expiration des délais règlementaires pour signifier et conclure. »
Chacune de ces quatre premières préconisations vise à donner au juge une nouvelle possibilité de sanctionner le justiciable. Ensemble, elles illustrent une tendance lourde de la procédure d’appel : réformer par l’instauration de sanctions procédurales, ce qui conduit à accentuer les risques que fait courir la procédure d’appel à l’avocat.
En conclusion, l’appel est marqué par deux risques majeurs. La restriction du droit d’appel, tout d’abord, sous le double mouvement, cohérent, de la concentration temporelle des prétentions dès les premières conclusions et de la restriction de l’appel aux seuls chefs du jugement critiqués. Les sanctions procédurales, ensuite, dont l’enchaînement peut être redoutable pour les parties, voire pour leurs conseils et les assureurs de ces derniers.
II – Le devenir des risques
Ces risquent se concrétisent-ils ? Et si oui, peuvent-ils être limités ? Répondre à ces deux questions conduit à envisager la manifestation des risques (A.) puis les remèdes aux risques (B.).
A. La manifestation des risques
La manifestation est judiciaire (1°) et assurantielle (2°).
1. Une manifestation judiciaire
Les risques se manifestent tout d’abord par l’explosion des irrecevabilités que souligne Jacques Pellerin, ancien président de la chambre des avoués près la cour d’appel de Paris [42]. Ils se manifestent ensuite par le très grand nombre d’arrêts de cours d’appel « statuant sur déféré formé contre des ordonnances du conseiller de la mise en état en matière de caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité des conclusions » [43]. Ces déférés s’expliquent par la rigueur de la sanction attachée au prononcé d’une irrecevabilité ou d’une caducité [44].
2. Une manifestation assurantielle
Les risques de l’appel se traduisent par une sinistralité forte. En effet, les sanctions prononcées par le juge conduisent à des actions en responsabilité contre les avocats et des déclarations de sinistres. Pour 2018 et pour 2019, un quart des dossiers de sinistres ouverts sont relatifs à des erreurs de procédure en appel, ce qui représente environ 600 dossiers ouverts par an [45]. Si la proportion d’un quart avait déjà été constatée par Rodolphe Bigot et Pierre Roger pour la période 2004-2008 [46], l’augmentation du nombre total de dossiers implique qu’en absolu le nombre de sinistres liés à l’appel ait été multiplié par quatre en dix ans.
La thèse de Rodolphe Bigot souligne en revanche la très faible sinistralité de feu les avoués, l’expliquant par leur faible nombre, leurs connaissance personnelle les uns des autres qui conduisait à ce qu’ils se préviennent de la survenue de sinistres et à leur proximité avec les magistrats qui permettait de corriger très tôt les erreurs [47].
Dès lors, le gain économique vanté lors du vote de la loi de suppression des avoués [48] est amoindri par l’augmentation des primes d’assurance des avocats pour couvrir ce risque (une augmentation qui est soit refacturée au client, soit qui renchérit les coûts fixes de l’avocat et réduit ses gains).
B. Les remèdes aux risques
Pour remédier à ces risques, des avocats pourraient rêver d’un remède suprême : en appeler aux garanties fondamentales du procès pour dire que tant de rigueur viole les droits du procès équitable. D’ailleurs, même si l’appel n’est pas une obligation, la Cour de Strasbourg explique que lorsque cette voie de recours existe, elle doit respecter les principes du procès équitable. Toutefois cette piste semble de peu d’espoir à la lecture d’un arrêt Glykantzi c/ Grèce du 30 octobre 2012 (N° Lexbase : A1437IW7) où la Cour de Strasbourg fait état des mécanismes créés en vue de permettre l’accélération des procédures civiles, cite explicitement la France où le conseiller de la mise en état peut « prononcer la caducité de l’appel, l’irrecevabilité de l’appel ou déclarer les conclusions des parties irrecevables pour non-respect des délais » [49] et ne formule aucune critique.
De même la Cour de cassation, interrogée sur la conformité à l’article 6§1 CEDH (N° Lexbase : L7558AIR) de l’article 901 4° du CPC (N° Lexbase : L9351LTI) qui exige que la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués, estime dans un arrêt du 30 janvier 2020 que cet article « encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel » et exclut toute violation conventionnelle [50].
Des remèdes existent pourtant.
1. les remèdes des acteurs du droit :
i. les remèdes de la jurisprudence
La jurisprudence a un rôle positif par la levée des incertitudes, comme ce fut le cas des trois avis donnés le 20 décembre 2017 à propos des compléments à la déclaration d’appel [51].
Elle a également un rôle positif par la souplesse [52] voire la mansuétude de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Un exemple de cette mansuétude est donné par un arrêt rendu le 15 novembre 2018 [53]. L’appelant avait signifié le récapitulatif de la déclaration d’appel qui lui avait été adressée par un message électronique du greffe par le RPVA, et non pas la déclaration d’appel elle-même. La cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait déclaré caduque la déclaration d’appel. Cette mansuétude est d’autant plus notable que, comme vu précédemment, la même deuxième chambre civile avait sanctionné par la caducité l’avocat qui avait signifié l’avis de l’inscription au rôle de l’affaire adressé par le greffe [54].
ii. les remèdes des avocats.
« L’avoué est mort ; vive l’avoué ! » Dans certains cabinets, le recours à des anciens avoués est devenu la norme : soit par externalisation (recours à un autre cabinet composé d’anciens avoués, ou de spécialistes de la procédure d’appel), soit par internalisation (les anciens avoués intégrant le cabinet). L’objectif est de diminuer le risque d’erreur bien sûr, mais aussi, en cas d’externalisation, pour externaliser le risque et donc l’engagement de la responsabilité du cabinet. Dans ce cas, le gain économique pour le justiciable n’est pas équivalent à celui qui aurait été le sien si son avocat de première instance avait assuré seul l’intégralité du procès.
iii. les remèdes de l’université
L’université doit prendre sa part de responsabilité et accentuer la formation procédurale des étudiants, notamment en veillant que l’enseignement de la procédure civile soit complété par des travaux dirigés.
2) les remèdes de fond
Les difficultés exposées trouvent leur origine dans la volonté de régler les maux de la justice en dissuadant les justiciables de la saisir et, plus largement, de la conception de la réforme de l’instance d’appel sous un angle budgétaire [55]. Les risques de l’avocat en appel viennent pour beaucoup de ce que le législateur fait peser sur les parties et leurs conseils des charges processuelles toujours plus lourdes, bien conscient, d’une part, que l’Etat n’a pas les ressources – humaines et financières – pour accentuer les charges déjà lourdes des juridictions et, d’autre part, qu’il s’agit là d’une variable d’ajustement indolore pour le budget de l’Etat. Il en va différemment du justiciable qui in fine paie ce risque via l’augmentation des primes d’assurance, répercutée dans les honoraires des avocats.
L’accentuation des charges processuelles en appel pourrait être acceptable si les délais rigoureux imposés aux avocats réduisaient la durée des procédures. Or les cours d’appel ne jugent pas rapidement les affaires en état d’être jugées et la durée moyenne des affaires terminées, en appel, est passée de 11,7 mois en 2012 à 14 mois en 2019 [56]. Peut-être est-ce la démonstration de ce que le temps du procès ne dépend pas uniquement des avocats mais également des moyens alloués au service public de la justice. Face à ce constat, le rapport Perben suggère de revenir sur le caractère automatique des sanctions attachées au respect des délais [57]. Conscient que cette suggestion n’entre pas dans le cadre de ses attributions, la mission recommande, à court terme, d’allonger les délais sanctionnés à peine de caducité et d’irrecevabilité en appel, dans l’attente d’une réforme de plus grande ampleur de la procédure d’appel. En ce domaine, la cohérence est à privilégier : le maintien de délais courts et de sanctions automatiques est acceptable si les audiences se tiennent peu de temps après l’ordonnance de clôture et si les arrêts sont rendus rapidement. A défaut, les contraintes pesant sur les avocats apparaissent injustifiées et la répartition des charges processuelles disproportionnée.
Par ailleurs, l’une des pistes maintes fois évoquée serait d’améliorer la qualité de la justice de première instance [58]. Tel fut le sens des préconisations du rapport Agostini-Molfessis et tel fut le sens de la loi du 23 mars 2019. Cet axe de réforme peut être poursuivi, par exemple en s’attaquant aux matières dans lesquelles le taux d’appel est le plus élevé. Ce taux varie fortement en fonction des matières : 23,3 % pour les tribunaux de grande instance en 1er ressort, 5,5 % pour les tribunaux d’instance, 61,2 % pour les conseils de prud’hommes en 1er ressort et 14,8 % pour les tribunaux de commerce en 1er ressort [59]. A l’issue du processus d’appel, au niveau de la reddition de l’arrêt, ces disproportions sont conservées. Ainsi, plus d’un tiers des appels concernent les relations de travail et la protection sociale [60]. Dans les contentieux pour lesquels il est de notoriété publique que la première instance est un passage obligé et que la véritable discussion juridique aura lieu en appel, l’amélioration de la justice de première instance contribuera à la réduction des flux et des risques en appel.
[1] Digeste, L. XLIX, tit. I, lex 1.
[2] J. Hilaire, Un peu d’histoire, in Justice et double degré de juridiction, Justices, n° 4, juillet-décembre 1996, p. 9, sp. p. 11.
[3] J. Guyader, L’appel en droit canonique médiéval, in J.-L. Thireau, Les voies de recours judiciaires, instruments de liberté, PUF, 1999, p. 31.
[4] Une décision peut être contestée devant le supérieur immédiat de celui qui l’a rendue. La hiérarchie juridictionnelle est le décalque de la hiérarchie ecclésiastique puisqu’à chaque échelon correspond une officialité. Si, à certaines époques anciennes, les curés, archiprêtres, archidiacres, chapitres cathédraux et abbayes ont pu avoir leur propre officialité, l’organisation se simplifie avec le Concile de Trente qui confie ce rôle à l’évêque. L’appel de ses décisions est porté devant l’archevêque métropolitain, puis le primat (peu respecté en France) et, in fine, le pape (Tribunal de la Sainte Rote romaine). V. J. Guyader, L’appel en droit canonique médiéval, préc., pp. 34 et s.
[5] J. Hilaire, Un peu d’histoire, préc, sp. p. 10. V. également, J. Hilaire, La construction de l’Etat de droit dans les archives judiciaires de la cour de France au XIIIème siècle, Dalloz, 2011, pp. 37 et s..
[6] J. Hilaire, Un peu d’histoire, préc, p. 9.
[7] Repenser l’appel, actes du colloque du 7 octobre 2016, Gaz. Pal., octobre 2016, n° hors-série.
[8] Mission Magendie II, Célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel - Rapport au garde des Sceaux, 24 mai 2008, sommaire, p. 5.
[9] S. Dauchy et Y.-M. Serinet, Notion et fonction des voies de recours, in L. Cadiet, S. Dauchy et J.-L. Halpérin (dir.), Itinéraires d’histoire de la procédure civile – 1. Regards français, coll. Bibliothèque André Tunc, IRJS éditions, tome 52, 2014, p. 109.
[10] Mission Magendie II, Célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel - Rapport au garde des sceaux, 24 mai 2008.
[11] A. Garapon (dir.), La prudence et l’autorité - l’office du juge au XXIe siècle, IHEJ, mai 2013.
[12] P. Delmas-Goyon (dir.), « Le juge du 21ème siècle » Un citoyen acteur, une équipe de justice, décembre 2013, sp. pp. 85-91.
[13] D. Marshall, Les juridictions du XXIe siècle, décembre 2013, sp. pp. 69-74.
[14] Inspection générale de la Justice, Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives, juillet 2019.
[15] Rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, présidée par Dominique Perben, juillet 2020.
[16] Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5722LWT) ; ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire (N° Lexbase : L9169LWI).
[17] Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW), applicables aux appels formés à compter du 2 janvier 2011.
[18] En 2016, il fut étendu aux chambres sociales des cours d’appel par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A).
[19] Tant pour la procédure avec représentation obligatoire (CPC, art. 901, 4° N° Lexbase : L9351LTI) que pour la procédure sans représentation obligatoire (CPC, art. 933 N° Lexbase : L9352LTK). Cette exigence est toutefois exclue si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
[20] La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (CPC, art. 562 N° Lexbase : L7233LEM).
[21] CPC, art. 905-1, al. 1er (N° Lexbase : L7035LEB).
[22] CPC, art. 954, al. 4 (N° Lexbase : L7253LED) : « Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
[23] CPC, art. 954 (N° Lexbase : L7253LED).
[24] CPC, art. 910-4, al. 1er (N° Lexbase : L9354LTM).
[25] CPC, art. 954, al. 2 (N° Lexbase : L7253LED).
[26] CPC, art. 954, al. 3 (N° Lexbase : L7253LED).
[27] CPC, art. 901 (N° Lexbase : L9351LTI).
[28] En cas de violation du délai de l’appelant pour conclure, CPC, art. 908 (N° Lexbase : L7239LET).
[29] En cas de violation du délai de l’intimé pour conclure, CPC, art. 909 (N° Lexbase : L7240LEU).
[30] CPC, art. 911-1, al. 3 (N° Lexbase : L7243LEY).
[31] CPC, art. 911-1, al. 4 (N° Lexbase : L7243LEY).
[32] Inspection générale de la Justice, Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives, juillet 2019, Préconisation n°10.
[33] N. Fricero, Panorama de procédure civile, D., 2019, p. 555, et les arrêts cités.
[34] relative à la présentation du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL).
[35] Cass. civ. 2, 1 juin 2017, n° 16-18.212, F-P+B (N° Lexbase : A2584WGS) D. 2017. 2192, note G. Bolard.
[36] Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-23.151, F-P+B (N° Lexbase : A5917WTC).
[37] Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-27.917, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2215SXC).
[38] Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-17.839, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6543ZYY).
[39] Cass. civ. 2, 17 octobre 2019, n° 18-19.263, F-D (N° Lexbase : A9301ZRW).
[40] Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I (N° Lexbase : A88313TA).
[41] Inspection générale de la Justice, Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives, juillet 2019.
[43] N. Fricero, Transformations de l’appel, bilan et perspectives, Procédures, n° 1, janvier 2015, dossier 2, § 11.
[44] Comme vu précédemment, l’alinéa 3 de l’article 911-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7243LEY) prévoit que « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité […] ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ».
[45] Sur les 2.300 dossiers ouverts par an pour toute la France. Le Barreau de Paris ne communique pas ses chiffres mais les statistiques apparaissent sensiblement identiques (1/4 des sinistres ouverts en lien avec la procédure d’appel).
[46] R. Bigot et P. Roger, L’assurance des professionnels du procès, R.G.D.A., 2010, n° 3, p. 904, sp. p. 926 : la sinistralité de l’appel représentait la moitié de la sinistralité de l’activité judiciaire qui elle-même représentait 54% de la sinistralité totale ; soit un quart des 650 dossiers annuels, soit environ 160 dossiers par an liés à la procédure d’appel.
[47] R. Bigot, L’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle : L’exemple des professions du chiffre et du droit, Defrénois, 2014, sp. § 99 et s.
[48] L’exposé des motifs évoque « la nécessité de simplifier la démarche du justiciable et de réduire le coût du procès en appel » (Texte n° 1709 de Mme Rachida DATI, garde des Sceaux, ministre de la Justice, déposé à l’Assemblée Nationale le 3 juin 2009). Les rapports des commissions parlementaires abordent également cet objectif, notamment le rapport n° 139 (2009-2010) de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 8 décembre 2009, accessible sur le site du Sénat, [en ligne].
[49] CEDH, 30 octobre 2012, Req. 40150/09, Glykantzi c. Grèce, sp. § 30 (N° Lexbase : A1437IW7).
[50] Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528, FS-P+B+I (N° Lexbase : A89403C4).
[51] Cass. civ. 2, 20 décembre 2017, n° 17-70.034 (N° Lexbase : A7024W9Z) ; Cass. civ. 2, 20 décembre 2017, n° 17-70.035 (N° Lexbase : A7027W97) et Cass. civ. 2, 20 décembre 2017, n° 17-70.036 (N° Lexbase : A7025W93).
[52] L’appelant qui, pour une raison technique qui lui est étrangère, ne peut transmettre électroniquement sa déclaration d’appel, peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l’expiration du délai qui lui est accordé pour accomplir la diligence considérée (Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-14.056, F-P+B N° Lexbase : A7227X33). L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel (Cass. civ. 2, avis, 12 juillet 2018, n° 18-70.008).
[53] Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-27.424, F-D (N° Lexbase : A7874YL9).
[54] Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-18.212, F-P+B (N° Lexbase : A2584WGS), D. 2017. 2192, note G. Bolard.
[55] C. Brenner, Le point de vue d’un universitaire, in F. Ferrand et B. Pireyre (dir.), Prospective de l’appel civil, coll. Colloques, vol. 29, Société de législation comparée, 2016.
[56] Durée moyenne des affaires terminées (en mois) pour les cours d’appel (justice civile uniquement) : 2012, 11.7 ; 2013, 11.7 ; 2014, 11.8 ; 2016, 12.7 ; 2017, 13.3 ; 2018, 13.5 ; 2019 : 14. Sources : Sous-direction de la Statistique et des Études du Ministère de la Justice, Les chiffres-clé de la Justice.
Ces durées sont encore plus longues (15 à 16 mois) selon l’annexe 4 du Rapport d’exécution établi au titre de l’année 2020 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, [en ligne].
[57] Rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, dirigée par Dominique Perben, juillet 2020, p. 26.
[58] Voir, parmi d’autres, les débats lors du colloque Prospective de l’appel civil, et notamment l’intervention de C. Chainais, reproduits in F. Ferrand et B. Pireyre (dir.), Prospective de l’appel civil, coll. Colloques, vol. 29, Société de législation comparée, 2016.
[59] Les chiffres-clés de la Justice 2019, p. 12.
[60] Les chiffres-clés de la Justice 2019, p. 10.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476028
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - La responsabilité pénale de l’avocat
Lecture: 23 min
N6098BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Elise Letouzey, maître de conférences en droit privé à l’Université d’Amiens
Le 03 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à écouter en podcasts sur Lexradio.
L’avocat est-il un responsable pénal comme les autres ? La mobilisation du droit commun pour appréhender les agissements délictueux qu’il pourrait commettre incline à penser que l’on est dans une responsabilité professionnelle somme toute assez classique [1]. À la différence du notaire, ses agissements ne sont pas appréhendés au titre de délits attitrés, c’est-à-dire applicables ès qualités. Nous ne sommes pas en présence d’une responsabilité d’appartenance. En effet, l’avocat peut être un malandrin comme les autres : il est pénalement responsable des infractions par lui commises, qu’elles le soient indépendamment de sa qualité d’avocat, ou bien à raison même de sa qualité d’avocat.
L’avocat peut être poursuivi au même titre que n’importe quel quidam pour un abus de confiance en plaçant, sur un compte personnel rémunéré, des fonds destinés à un compte CARPA [2] ; il peut aussi être poursuivi pour une escroquerie [3], pour des faits de corruption [4], pour la remise illicite de biens à un détenu [5], ou encore pour des violences [6]. Les agissements sont ainsi d’une banale originalité : si l’on prend l’exemple du délit de prise illégale d’intérêts, il pourrait en théorie être commis par un avocat élu public. Illustration en est de la volonté du législateur, neutralisée par le Conseil constitutionnel [7], de limiter l’activité de conseil des parlementaires qui sont par ailleurs avocats. À défaut donc de prévenir le conflit d’intérêts, il pourra être appréhendé par le prisme de la répression.
En dehors de la spécificité de certains domaines, inhérents à la responsabilité professionnelle [8], l’avocat est donc décidément un responsable pénal comme les autres.
En réalité, les particularités de la responsabilité pénale s’expriment essentiellement dans sa mise en œuvre, c’est-à-dire au moment de la procédure pénale. Comme le journaliste, le médecin ou tout autre professionnel dépositaire d’un secret, les poursuites engagées à l’encontre d’un avocat se font pour des faits commis par une personne protégée. Les règles afférentes à la perquisition [9], aux écoutes [10] ou encore aux fadettes [11], ces factures détaillées consistant en des relevés de communications téléphoniques, prévoient des conditions précises, ne permettant de retenir que des éléments liés aux faits poursuivis [12]. Cela conduit parfois à l’intervention du Bâtonnier, lequel remplit le rôle de vigie lors de la perquisition d’un cabinet d’avocat. En effet, il pourra - et peut-être devra - discuter la saisie de biens et documents, lesquels seront alors immédiatement placés sous scellés et feront intervenir le juge des libertés et de la détention qui devra rapidement se prononcer sur leur lien avec la procédure [13]. Toutefois, l’on ne saurait se contenter d’un simple inventaire des infractions et des règles de poursuite applicables : en réalité, la responsabilité pénale de l’avocat entretient des rapports ambigus avec le droit commun.
Ce dernier vient parfois heurter de plein fouet les principes forts règlementant la profession d’avocat et l’on pense naturellement au secret professionnel ; mais le droit commun est aussi parfois détourné, quelque peu contorsionné, pour envisager une répression efficace de certains agissements, aussi élémentaires que le devoir de conseil ou le fait de percevoir des honoraires, qui vont aisément relever de la complicité ou du blanchiment.
À dire vrai, la difficulté est qu’il n’y a pas de conception de la responsabilité pénale de l’avocat ; seul apparaît l’emprunt d’infractions pouvant être imputées à l’avocat, dont le statut particulier s’estompe.
Dès lors, l’enjeu de la responsabilité pénale de l’avocat ne réside pas tant dans les infractions classiques que tout un chacun peut commettre et qui seront éventuellement facilitées par sa fonction ; l’enjeu de la responsabilité pénale de l’avocat est de mesurer le risque réel encouru par le seul exercice de sa fonction.
Quel est le contenu concret de la responsabilité pénale de l’avocat ? Si l’ombre de la responsabilité pénale est immense au regard du contentieux observé, il a pu être justement dit qu’en la matière « le droit interprété est plus riche que le droit légiféré » [14]. Autrement dit, la responsabilité pénale de l’avocat est davantage théorique que performative comme on dirait en linguistique : il ne suffit pas de dire pour que ce soit.
Mais ce constat somme toute rassurant pourrait progressivement être remis en cause. En ce sens, les évolutions de la responsabilité pénale de l’avocat tendent à incriminer ce qui pourrait relever de la réalisation des missions essentielles de l’avocat. Ces missions sont définies à l’article 412 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6513H7D) : « La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger ».
Notre hypothèse est alors de dire qu’un risque pénal semble, à bas bruit, se développer dans les missions de défense du justiciable en premier lieu (I), mais aussi dans les missions de conseil de l’avocat en second lieu (II).
I. La risque pénal généré par l’activité de défense
Le risque pénal suscité par les fonctions de défenseur de l’avocat apparaît dès lors que l’avocat est dans une mission de représentation. On peut ainsi observer d’une part, une parole interdite dans le respect du secret professionnel (A) et d’autre part la répression d’une parole déplacée (B).
A. La parole interdite
La parole interdite d’abord, conduit tout autant à obliger qu’à protéger l’avocat. Précisons d’emblée que l’avocat n’est pas soumis au secret de l’enquête ou de l’instruction en application de l’article 11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7022A4T) qui ne vise que les personnes qui « concourent à la procédure ». Le fondement est celui de l’article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), lequel punit d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». Naturellement, le texte ne peut pas être mobilisé lorsque l’avocat livre des éléments de la procédure pénale à son client.
En ce sens, les textes règlementaires organisant la profession d’avocat assujettissent explicitement l’avocat au secret de l’enquête et de l’instruction, que ce soit sur le fondement de l’article 160 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), de l’article 5 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) ou de l’article 2 bis du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (N° Lexbase : L4063IP8).
La Cour de cassation est constante et très claire sur ce point [15] : l'avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et il ne peut, notamment, communiquer à quiconque, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements concernant des procédures pénales. S’il serait piquant d’imaginer qu’un avocat puisse être cité comme témoin et être ainsi tenu de prêter serment, cela ne l’empêche pas de s’abstenir de toutes les réponses que la loi lui interdit [16]. La Cour de cassation le rappelle depuis le 19ème siècle, et elle a même pu affirmer en 1862 à ce sujet que l’avocat a toujours été tenu de garder un secret inviolable sur tout ce qu'il apprend et que cette obligation absolue est d’ordre public [17]. L’on comprend alors logiquement que l’audition comme témoin d’une personne tenue au secret professionnel encourt la nullité lorsque ses déclarations comportent la révélation d’informations protégées [18].
En allant un peu plus loin dans le dévoilement des éléments d’une procédure, est incriminée à l’article 434-7-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3739HGL) la divulgation d’éléments de la procédure dans le but d’entraver l’action de la justice. Cette disposition issue de la loi n° 2004-204 dite « Perben II » du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8) avait, dans un premier temps, été établie dans des termes relativement larges qui ont suscité la mobilisation de la profession à la suite de la mise en cause d’une avocate sur ce fondement. La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 (N° Lexbase : L4971HDH) en a alors réduit le périmètre en imposant un dol spécial [19] et en diminuant les peines encourues [20]. L’exigence de ce dol spécial a conduit à passer d’une révélation directe ou indirecte de nature à entraver le déroulement de la justice…à une révélation réalisée sciemment dans le dessein d’entraver le déroulement de la justice. Cette modification minime semble toutefois avoir une incidence : en exigeant la démonstration de cette finalité, on exige une preuve très difficile à rapporter mais implicitement déduite de l’agissement. Dès lors, soit on présume cette finalité avec la théorie de la connaissance obligée (l’auteur ne pouvait ignorer) ; soit le texte est désamorcé en raison de cette probatio diabolica. Il n’en demeure pas moins que le dispositif est très peu sollicité : trois arrêts de la Cour de cassation sur ce fondement concernent un avocat, dont une question prioritaire de constitutionnalité écartée [21], un arrêt de rejet contre un arrêt de condamnation et un pourvoi contre une décision de renvoi de la chambre de l’instruction [22]. La question n’est toutefois pas purement théorique et l’incrimination semble poser un interdit très important à des moments-clé de la procédure, empêchant par exemple l’avocat d’informer quiconque, c’est-à-dire les éventuels complices ou coauteurs, qu’il s’est entretenu avec une personne placée en garde à vue. Si l’on adopte l’hypothèse de la neutralisation, que reste-t-il ? Lorsque le droit spécial s’effondre ou s’évapore, il est toujours possible de revenir au texte général de la violation du secret professionnel.
B. La parole déplacée
À côté de la parole interdite liée au secret, l’on peut trouver d’autre part une parole déplacée qui pourrait engager la responsabilité pénale de l’avocat. Il s’agit ici notamment de la diffamation et de l’outrage à magistrat.
La diffamation consiste en toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, en application des articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881.
L’outrage implique une atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction. Si le texte est souvent illustré par l’insolence du prévenu, l’article 434-24 du Code pénal (N° Lexbase : L1937AMP) a aussi pu être employé à l’endroit d’un avocat.
Face à ce risque pénal, et de manière générale, le principe est celui de l’immunité judiciaire de l’avocat, prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Le texte dispose que « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Toutefois, cette immunité est loin d’être absolue en ce que le propos doit être tenu à l’audience et que la bonne foi implique, pour être admise, la prudence et la circonspection des propos.
L’on pourrait ensuite trouver appui sur un fondement légal en matière de diffamation et mobiliser le fait justificatif spécial de l’article 35 de la loi de 1881. Ce dernier prévoit en son dernier alinéa que « Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. ». On comprend ici que l’absence de poursuite pour recel de violation d’un secret protégé par la loi ne vise pas l’avocat dès lors que la jurisprudence n’admet pas l’auto-recel.
Une question survient alors : à ces dispositions réprimant la parole interdite ou la parole déplacée, peut-il être opposé le fait justificatif général de l’exercice des droits de la défense ? Rien ne semble formellement s’y opposer et l’avocat pourrait ainsi légitimement révéler une information protégée pour sa défense lorsqu’il est mis en cause (l’avocat agit alors en défendeur). Mais la question vient aussi légitimement se poser pour la défense de son client (l’avocat agissant alors en défenseur), dès lors que cette divulgation serait strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense.
Ainsi, le fait justificatif général de l’exercice des droits de la défense consacré par la jurisprudence [23] et appliqué depuis longtemps au plaideur auteur d’un vol, d’un recel de violation du secret de l’instruction ou encore d’un abus de confiance pourrait être utilement invoqué.
De manière isolée, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, Mor contre France [24] dans une affaire où une avocate était mise en cause pour s’être exprimée sur un rapport d’expertise couvert par le secret de l’instruction dans une affaire en cours concernant le vaccin de l’hépatite B, avait conduit la cour à faire primer la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention (N° Lexbase : L4743AQQ) sur la violation du secret professionnel, notamment en se fondant sur le respect des droits de la défense, mais également sur l’enjeu du débat d’intérêt général.
Plus précisément, il s’agit de savoir si l’on peut sérieusement envisager ce fait justificatif pour l’avocat en vue de la défense de son client. En apparence, rien ne s’y oppose, sous réserve d’un examen de la proportionnalité de l’atteinte à justifier, comme l’exige tout fait justificatif. En effet, le fait justificatif de l’exercice des droits de la défense a été consacré par la jurisprudence pour pallier une rupture d’égalité des armes, particulièrement au regard du contentieux prud’homal. Or, est-ce qu’une inégalité probatoire peut être établie au détriment de l’avocat ? Rien n’est moins sûr et le fait justificatif pourrait alors ne pas être retenu et la responsabilité pénale de l’avocat serait engagée.
Ainsi, l’activité de défense est susceptible de générer un risque pénal essentiellement caractérisé par la teneur des paroles prononcées par l’avocat en dehors du prétoire.
Si un risque pénal peut être suscité par l’activité de défense, il faut aussi envisager la teneur du risque pénal induit par l’activité de conseil.
II. Le risque pénal généré par l’activité de conseil
Le risque pénal généré par l’activité de conseil mérite attention notamment au regard de ses récentes évolutions, pour ne pas dire glissements. En effet, l’avocat, au regard de sa fonction va devoir respecter plusieurs obligations : il d’abord devoir s’abstenir (A), il va ensuite être tenu de déclarer (B), mais il devra enfin mesurer ses conseils au risque de trop en dire (C).
A. L’obligation de s’abstenir
D’abord, l’obligation de s’abstenir réside dans le fait que l’avocat va être confronté, lorsqu’il assure la défense de clients impliqués dans une procédure pénale, à des agissements frauduleux dont il ne doit pas profiter. En ce sens, il ne saurait, par sa fonction ou ses compétences, faciliter la dissimulation de l’origine infractionnelle d’un bien, au risque de se voir reprocher le délit de blanchiment [25]. Or, il ne faudrait pas tomber dans un cercle vicieux mettant en péril les droits de la défense et consistant à admettre le blanchiment dès lors que l’avocat accepte par exemple le paiement de ses honoraires en ayant défendu l’auteur d’un trafic de stupéfiants ou un proxénète. Et ce d’autant plus que l’agissement semble systématiquement aggravé par les facilités conférées par la fonction [26], sans compter qu’il existe une présomption d’origine délictueuse des fonds [27]. La Chambre criminelle, dans une décision rendue le 20 mai 2009 [28], a pu rejeter le pourvoi formé contre un arrêt qui avait retenu la responsabilité pénale du conseil, notamment « au regard de la particularité des faits s'inscrivant dans le contexte de la défense de celui qui a été déclaré pénalement responsable ». Une telle motivation par les juges du fond, implicitement validée par la Cour de cassation, interroge même si elle demeure isolée. Mais l’actualité, du blanchiment est ailleurs. En effet, en qualité de confident, l’avocat est l’oreille de l’auteur de l’infraction, et le législateur a souhaité l’ériger en relai informel, en véritable indicateur, en vue de prévenir et de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
B. L’obligation de vigilance
C’est ensuite une obligation de dire qui va s’imposer à l’avocat. Une double obligation repose sur lui. D’un côté, l’avocat est assujetti à une obligation de vigilance et d’identification de ses clients [29]. Concrètement, ce sont les fameuses obligations de KYC « know your client » : il doit connaître ses clients et les co-contractants de ses clients, à savoir les bénéficiaires effectifs des opérations dans lesquelles il peut être amené à conseiller ou assister son client. L’impossibilité de recueillir de telles information constituent un obstacle dirimant à l’avocat qui doit cesser toute mission.
Le champ de vigilance de l’avocat concerne des opérations limitativement énumérées par la loi [30] et qu’il mène en qualité de mandataire ou en tant qu’assistant préparant la rédaction d’actes ou encore lorsque l’avocat intervient en qualité de fiduciaire mais aussi depuis l’ordonnance du 12 février 2020 [31] (N° Lexbase : L9352LUW) en matière de conseil fiscal. Par exemple, sont ainsi concernés l’achat ou la vente immobilière ou de fonds de commerce, l’ouverture d’un compte en banque, l’organisation des apports en sociétés et plus largement, la gestion et la direction des sociétés.
En revanche, l’avocat qui intervient dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou d’une consultation juridique n’est pas soumis à l’obligation de vigilance, sauf naturellement si la consultation a précisément pour conséquence le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.
D’un autre côté, l’avocat est soumis à une obligation de déclaration en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Cette déclaration n’est pas faite directement à Tracfin mais transite par le bâtonnat : il n’y a en réalité aucune relation directe entre Tracfin et l’avocat qui, par cette déclaration, enfreint le secret professionnel et bénéficie en contrepartie d’une immunité. Il va sans dire que ce dispositif place l’avocat dans une position suffisamment inconfortable pour que, sur l’année 2019, Tracfin n’ait recensé que douze déclarations provenant des avocats (sur 56 000 signalements) [32]. Conscient de cette difficulté, et comme une marque de défiance à l’endroit des avocats, le législateur en transposant la 5ème directive anti-blanchiment par l’ordonnance du 12 février 2020 (N° Lexbase : L9352LUW) a élevé les CARPA au rang d’assujetties, au même titre que les avocats.
Il faut alors bien comprendre qu’une déclaration de soupçon par l’avocat ne le protège que d’une violation du secret professionnel. Il n’en demeure pas moins qu’ici, le secret de l’avocat fond devant l’impératif de l’intérêt général et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, sans que la Cour européenne des droits de l’homme n’y voit une atteinte disproportionnée au secret professionnel, comme elle a pu l’affirmer dans l’arrêt Michaud contre France rendu le 23 juillet 2010 [33].
Que se passe-t-il en cas de non-respect de l’obligation de déclaration à TRACFIN ?
En soi, l’abstention n’est pas érigée en délit mais il est indéniable qu’une telle omission constituerait une preuve préconstituée permettant d’établir l’élément intentionnel de la complicité de blanchiment, en passant là-encore par la théorie de la connaissance obligée et des présomptions en chaîne : l’avocat ne pouvait ignorer l’origine ou la destination infractionnelle des fonds. Or, nous avons rappelé que dès lors que l’avocat est soupçonné d’avoir commis une infraction, la perquisition de son cabinet est possible [34], ou encore des écoutes lesquelles pourraient inclure des conversations relevant des échanges avec son client puisqu’en la matière, seule leur retranscription est impossible à peine de nullité [35]. C’est dire qu’il reste peu de chose du secret des avocats, lequel devient perméable.
À ce stade, les mauvaises langues diraient que l’avocat peut être aisément appréhendé en qualité de suspect ou bien de délateur d’un agissement pénal. Mais c’est sans compter la complicité dont l’avocat - et même le très bon avocat - pourrait être suspecté en cas de fraude fiscale.
C. L’obligation de conseil légal
Enfin, l’obligation de ne pas trop en dire implique pour l’avocat de ne pas aller sur le terrain glissant qui serait celui de l’optimisation fiscale car, à trop bien conseiller la réduction de l’impôt, il pourrait conduire son client à éviter cet impôt. Ainsi, de l’optimisation à la fraude, la ligne de démarcation est floue au regard du droit pénal. Deux formes de complicités de fraude fiscale fondées sur l’article 1741 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6015LMQ) apparaissent : une complicité pénale et une complicité fiscale.
Classiquement, la complicité pénale pourrait être celle d’une fraude fiscale en application de l’article 1742 (N° Lexbase : L1734HNK) qui prévoit que « Les articles 121-6 (N° Lexbase : L2282AMH) et 121-7 (N° Lexbase : L5525AIH) du Code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741 (N° Lexbase : L6015LMQ) ». L’avocat fiscaliste est ainsi, de manière assumée par les pouvoirs publics, expressément visé et suspecté lorsqu’il est l’avocat d’un contribuable qui s’est frauduleusement soustrait à l’impôt. Or, l’établissement de la soustraction frauduleuse à l’impôt, qui va jouer ici le rôle de fait principal punissable indispensable à l’établissement de la complicité, implique surtout de démontrer la matérialité du fait. En effet, pour ce qui est de son intention, elle est déduite de cette même matérialité et ne soulève pas grande difficulté. Aussitôt le fait principal punissable établi, l’acte de complicité va résider dans une aide et plus précisément dans une assistance à la réalisation d’actes comme la constitution d’une société ou la déclaration d’impôts.
Mais ce peut aussi être de simples conseils que le client aura suivi. Est-il alors possible d’écarter l’élément intentionnel du contribuable qui aurait aveuglément suivi les conseils de son avocat ? Si le cas d’école venait à se réaliser, il est peu probable que l’absence d’infraction effectivement réprimée pour l’auteur principal soit un obstacle dirimant pour appréhender l’avocat complice dès lors la Cour de cassation depuis un arrêt du 8 janvier 2003 [36] admet la complicité d’un fait qui ne peut pas être reproché à l’auteur principal faute d’élément moral.
Concrètement, l’acte doit être antérieur ou concomitant mais s’il ne l’est pas, autrement dit si le fait est postérieur, demeure la possibilité d’envisager le recel [37] et cela conduit à faire de la circonstance temporelle un obstacle facilement surmontable.
De manière plus atypique, à côté de la complicité pénale classique, une complicité dite fiscale de fraude fiscale existe depuis peu. En effet, la loi du 23 octobre 2018 (N° Lexbase : L5827LMR) [38] a créé un article 1740 A bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L0572LZ9) prévoyant que : « lorsque l'administration fiscale a prononcé à l'encontre du contribuable une majoration de 80 % […], toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende [égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable, sans que son montant ne puisse être inférieur à 10 000 euros] ». C’est bien par abus de langage que l’on parle de complicité fiscale puisque le fait principal ne doit pas seulement être punissable, mais il doit avoir été effectivement puni.
Toutefois la coloration pénale du texte réapparaît lorsque l’on comprend que cette forme de complicité ne peut pas être retenue lorsque le professionnel fait déjà l’objet de poursuites fondées sur l’article 1742 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1734HNK), à savoir la vraie complicité pénale. En revanche, le cumul est toujours possible avec d’éventuelles poursuites de l’avocat pour blanchiment de fraude fiscale, délit qui n’est pas soumis au verrou de Bercy et qui voit sa caractérisation d’autant plus facilitée par l’existence d’une présomption d’origine illicite de capitaux de l’article 324-1-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9415IYD).
Il ressort de ce panel très incomplet du risque pénal encouru par l’avocat un secret professionnel considérablement affaibli et une responsabilité pénale qui, petit à petit, vient se déployer sur les missions mêmes de l’avocat.
[1] La responsabilité pénale de l’avocat et du notaire (dir.) M. Bénéjat, Travaux de l’Institut de Sciences Criminelles et de la Justice de Bordeaux, vol. 3, éd. Cujas, 2011.
[2] Cass. crim., 27 mai 2013, bull. 112, n° 12-83.667.
[3] Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 98-81762 (N° Lexbase : A5591AWY).
[4] Cass. crim., 17 décembre 2003, n° 02-87151.
[5] C. pén., art. 434-35 (N° Lexbase : L1228LDT) (la peine encoure étant aggravée lorsque l’auteur est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus), Cass. crim., 12 mai 1992, n° 91-82.973 (N° Lexbase : A0614ABD).
[6] Cass. crim., 24 janvier 2018, n° 16-83045, FS-P+B (N° Lexbase : A8519XB7).
[7] Cons. const., décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, cons. 52 et 53 (N° Lexbase : A4215KM3). En effet, le texte législatif soumis au contrôle a priori du conseil constitutionnel (devenue la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 pour la transparence de la vie publique N° Lexbase : L3622IYS) contenait une disposition modifiant l’article L.O. 146 du Code électoral (N° Lexbase : L7397LG3) qui avait pour objet d'interdire à un parlementaire de continuer à exercer une fonction de conseil, quelle qu'en soit la nature, lorsqu'il ne l'exerçait pas avant le début de son mandat dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Le conseil a ainsi estime que « le législateur a institué des interdictions qui, par leur portée, excèdent manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d’intérêts ». Et ce alors qu’en toute hypothèse, l’article L.O. 149 du Code électoral (N° Lexbase : L9621LE3) interdit à tout avocat élu de plaider ou consulter pour des entreprises publiques dès lors qu’il n’était pas leur conseil habituel avant l’élection.
[8] M. Bénéjat, La responsabilité pénale professionnelle, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque des Thèses, vol. 111, 2012.
[9] C. proc. pén., art. 56-1 (N° Lexbase : L0488LTA) et s..
[10] C. proc. pén., art. 100-7 (N° Lexbase : L5915DYQ).
[11] C. proc. pén., art. 60-1 (N° Lexbase : L7424LPN) et s. et 77-1-1 (N° Lexbase : L5533LZX) et s.
[12] Et ce quand bien même les conditions renforcées des fadettes impliquant le consentement de la personne protégée ne sont pas applicables lorsque les factures détaillées visent une personne protégée mais sont livrées par son opérateur par exemple, Cass. crim., 14 mai 2013, n° 11-86.626, FS-P+B (N° Lexbase : A5105KDG), Procédure 2013, n° 220 ; AJ Pénal 2013. 467.
[13] C. proc. pén., art. 56-1 (N° Lexbase : L0488LTA).
[14] D. Bouthors, La responsabilité des avocats. Les frontières entre civil, pénal et disciplinaire, RLDC 2020, n° 179, p. 25. Dans le même sens, M. Bénéjat, La responsabilité pénale de l’avocat, in La responsabilité pénale de l’avocat et du notaire (dir.) M. Bénéjat, Travaux de l’Institut de Sciences Criminelles et de la Justice de Bordeaux, vol. 3, éd. Cujas, 2011, p. 13.
[15] Cass. crim., 18 décembre 2001, n° 01-84.170, FS-P+F (N° Lexbase : A8328AXQ).
[16] C. proc. pén., art. 103 (N° Lexbase : L3436AZB), 331 (N° Lexbase : L7526LPG) et 437 (N° Lexbase : L3445IGP), ce dernier dispose que « Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 (N° Lexbase : L5524AIG) et 226-14 (N° Lexbase : L8549LXW) du Code pénal ».
[17] Cass. crim. 24 mai 1862, S. 1862.1.995.
[18] Cass. crim., 30 octobre 2001, n° 01-84.779 (N° Lexbase : A5873CKQ).
[19] La loi a modifié le champ de l’intention, passant d’une révélation « de nature à » à une révélation faite sciemment « dans le but d’entraver ».
[20] Lesquelles étaient à l’origine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ; elles ont été abaissées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
[21] Cass. crim., 7 juin 2011, n° 10-88.260, F-D (N° Lexbase : A8460HTI).
[22] Cass. crim., 27 mars 2012, n° 11-88.321, F-P+B (N° Lexbase : A9846III), Bull. crim., n° 82 ; Cass. crim., 8 novembre 2011, n° 10-88.260, F-D (N° Lexbase : A7667H8H).
[23] Cass. crim., 11 mai 2004, n° 03-80.254, FS-P+F+I (N° Lexbase : A5245DCA), D. 2004. 2326 ; RSC 2004. 635 et 866 ; JCP 2004. II. 10124 ; Dr. pénal 2004. 122 ; LPA, septembre 2004.
[24] CEDH, 15 décembre 2011, n° 28198/09, Mor c. France (N° Lexbase : A6142IAQ), D., 2012, 100 ; JCP, 2012, 26. Dans le même sens, pour ce qui concerne l’affaire dite du juge Borrel, CEDH, 23 avril 2015, n° 29369/10, Morice c. France (N° Lexbase : A0406NHI), D., 2015, 974 ; AJ pénal, 2015, 428 ; RSC, 2015, 740 ; D., 2016, 225.
[25] C. pén., art. 324-1 (N° Lexbase : L1789AM9) en ses alinéas 1 et 2 réprime « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. »
[26] C. pén., art. 324-2 (N° Lexbase : L1958AMH).
[27] C. pén. art. 324-1-1 (N° Lexbase : L9415IYD).
[28] Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-86.786, F-D (N° Lexbase : A5986EIK) ; E. Daoud et M. Sobel, La fraude fiscale, le blanchiment et l’avocat, AJ pénal, 2013, 648.
[29] C. mon. fin., art. L. 561-2, 13° (N° Lexbase : L0451LZQ).
[30] C. mon. fin., art. L. 562-3 (N° Lexbase : L6209LYM).
[31] Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L9352LUW).
[32] Il faut toutefois noter que douze déclarations en 2019, c’est douze fois plus qu’en 2018, Rapport d’activité et d’analyse de Tracfin, 2019.
[33] CEDH, 6 décembre 2012, n° 12323/11, Michaud c. France (N° Lexbase : A3982IY7), AJDA, 2012, 165 ; D., 2013, 284 et 1647 ; D., 2014, 169 ; AJ pénal, 2013, 160 ; Dalloz. avocats, 2013, 8 et 96 ; RFDA, 2013, 576 ; RSC, 2013,. 160 ; RTD eur., 2013, 664 ; Rev. UE, 2015, 353.
[34] C. proc. pén., art. 56-1 (N° Lexbase : L0488LTA).
[35] C. proc. pén., 100-5 (N° Lexbase : L3498IGN).
[36] Cass. crim., 8 janvier 2003, n° 01-88.065, F-P+F (N° Lexbase : A5987A4I), JCP G, 2003, II, 10059 ; D., 2004, 310 ; D., 2003, 2661.
[37] C. pén., art. 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS).
[38] Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 48413228, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "LOI n\u00b0 2018-898 du 23 octobre 2018 relative \u00e0 la lutte contre la fraude (1)", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L5827LMR"}}).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476098
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - La responsabilité disciplinaire de l’avocat
Lecture: 36 min
N6071BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jean-Marie Brigant, Maître de conférences en droit privé Le Mans Université, Membre du THEMIS-UM, Membre associé de l’Institut François Geny
Le 04 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
Comme l’annonce le programme de ce colloque, la responsabilité de l’avocat se conjugue au pluriel, l’obligation de répondre de ses actes peut le conduire devant le juge civil afin de réparer le dommage causé par sa faute ou devant le juge pénal pour répondre de l’infraction commise en subissant la sanction pénale prévue par le texte qui la réprime. Mais cette obligation peut également le conduire devant le juge disciplinaire : l’objectif n’est alors ni de réparer, ni de sanctionner au nom de la société. En effet, l’avocat, membre d’une profession doit répondre de sa faute qui sera sanctionnée d’une peine disciplinaire au nom de ladite profession [1].
En raison de ce caractère répressif, la responsabilité disciplinaire présente « un air de famille » avec la responsabilité pénale. Comme l’a souligné Michel Foucault, « au cœur de tout système disciplinaire fonctionne un petit système pénal » [2]. Ces deux droits ont en effet le même objectif : assurer l’ordre au sein d’un groupement. La différence réside dans le domaine d’application : alors que le droit pénal a vocation à s’appliquer à tous les citoyens sans exception, le droit disciplinaire a pour seuls sujets les membres d’un corps intermédiaire [3]. Ainsi, le droit disciplinaire apparaît comme « un droit pénal en réduction » [4].
S’inspirant du droit pénal, le procès disciplinaire et plus largement la procédure disciplinaire s’est depuis longtemps pliée aux exigences de la CESDH [5]. Néanmoins, comme l’a souligné le Conseil National des Barreaux : « la procédure disciplinaire actuelle est inadaptée aux besoins de la profession pour une mise en œuvre efficace. L’engagement de la procédure disciplinaire est lourd, complexe et parsemé d’embuches pour l’autorité de poursuite » [6]. La responsabilité disciplinaire présente elle aussi des similitudes avec la responsabilité pénale même si elle conserve encore un certain nombre de particularités qu’il convient d’envisager. Ces spécificités de la responsabilité disciplinaire de l’avocat concernent d’une part, la faute disciplinaire (I) d’autre part, l’action disciplinaire qui en résulte (II) et enfin la sanction encourue (III).
I. La faute disciplinaire de l’avocat
De manière très générale, la faute disciplinaire peut se définir comme le non-respect des règles par un membre du groupe social. Pour l’avocat, il s’agira de la violation de son serment, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), de celui n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) ainsi que du Règlement intérieur National [7]. D’ailleurs, selon ce RIN « La méconnaissance d’un seul de ces principes (essentiels de la profession), règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire » [8]. Cette disposition réglementaire laisse entrevoir que la faute disciplinaire de l’avocat ne pas fera l’objet d’une définition exhaustive, à la différence de l’infraction pénale, mais plutôt d’une délimitation sommaire (A) permettant ainsi d’appréhender les comportements les plus variés (B).
A. Une définition limitée
En droit disciplinaire, il est plus habituel de parler de faute disciplinaire que d’infraction, sans doute parce que la matière ne reproduit pas à l’identique le principe de légalité. Selon le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), « toute contravention aux les lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires » [9]. Il ressort de cette disposition que la faute disciplinaire de l’avocat apparaît doublement limitée puisqu’elle fait l’objet d’une définition réglementaire (1) et rudimentaire (2).
1) Une définition réglementaire
Premièrement, ce n’est pas la loi du 30 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui vient définir la faute disciplinaire de l’avocat mais bien le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) en son article 183. En confiant au pouvoir réglementaire le soin d’établir les règles de déontologie, et les sanctions disciplinaires applicables aux avocats, le législateur n’a-t-il pas méconnu la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution ? A cette question, le Conseil constitutionnel a apporté une réponse négative en estimant que la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relève ni du droit pénal, ni de la procédure pénale au sens de l’article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC). Elle relève de la compétence réglementaire dès lors ne sont mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi [10]. Entre temps, le Conseil constitutionnel a pu affirmer que le principe de légalité des délits et des peines ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, tel que les peines disciplinaires [11]. Pour autant, en 2017, les sages ont estimé que cette décision ne constitue pas un changement de circonstances justifiant le réexamen de l’article 53 de la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) dont le seul objet est de renvoyer au pouvoir réglementaire de la compétence pour fixer les sanctions disciplinaires des avocats [12].
2) Une définition rudimentaire
Deuxièmement, la définition de la faute disciplinaire est non seulement réglementaire sur la forme mais rudimentaire sur le fond faisant dire à certains que ce principe de légalité disciplinaire semble beaucoup plus proche de la textualité que de la clarté et de la précision exigées en droit pénal [13]. En effet, le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) se borne à énoncer une formule générale, prévoyant que « tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires » [14]. Or il faut bien reconnaître qu’« il n’est sans doute pas de notion plus difficile à cerner que la probité, l’honneur et la délicatesse car leur contenu est plus moral et sociologique que juridique » [15]. Cependant, la jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer que les dispositions du décret de 1991 ne violent pas le principe de légalité des délits qui « est satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l’institution dont ils relèvent » [16]. La Cour de cassation estime même que « les termes de modération et de délicatesse sont suffisamment précis dans la langue française et les usages, spécialement en matière de déontologie, pour exclure tout arbitraire » [17]. Ainsi, l'avocat, qui prête serment et qui s'oblige à respecter des principes essentiels dont il ne peut ignorer le sens et la portée, est en mesure de connaître à l'avance la nature et la cause du manquement qui peut lui être reproché. En résumé, la faute disciplinaire est suffisamment prévisible pour les avocats, prévisibilité qui dépend, dans une large mesure, du contenu du texte ainsi que de la qualité de ses destinataires [18].
B. Des manifestations variées
Le corpus des règles que l'avocat doit observer sous peine de sanctions disciplinaires apparaît extrêmement large. À la qualification de « faute », on lui préfère d’ailleurs celle de « manquement », plus à même d’exprimer ce « domaine indéfini du non conforme » [19]. Si la faute représente la ligne entre l’interdit et le permis, le manquement, quant à lui, symbolise l’écart entre l’être et le devoir être. Devant cette logique du flou, « la règle selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi devient vaine lorsque la « loi » n’est pas claire » [20]. Ainsi, la faute disciplinaire se manifeste de manière diverse et variée, tant en ce qui concerne son contenu (1) et son étendue (2).
1) Variation dans son contenu
Tout d’abord, il faut bien admettre qu’avec une définition aussi sommaire, la faute disciplinaire se révèle difficile à systématiser surtout lorsqu’elle s’appuie des notions floues telles que l’honneur, la probité ou la dignité. En survolant une jurisprudence abondante et casuistique [21], il est néanmoins possible de tirer « trois enseignements ». En premier lieu, la faute disciplinaire est aussi protéiforme que les très nombreux principes essentiels qui gouvernent la profession d’avocat [22] : Il peut donc s’agir d’un manquement à la dignité [23], l’indépendance [24], la probité [25], l’honneur [26], la loyauté [27], l’égalité et la non-discrimination, le désintéressement [28], la confraternité [29], la délicatesse [30], la modération [31], la courtoisie [32], la compétence [33] et la prudence [34]. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive puisque la jurisprudence se contente parfois de viser des « manquements aux principes généraux de la déontologie » [35]. En deuxième lieu, cette faute disciplinaire de l’avocat concerne les rapports avec ses clients, ses confrères, les instances professionnelles mais également les magistrats. Enfin, la faute disciplinaire est dépourvue de tout élément moral : l'infraction disciplinaire n’est qu’un manquement qui ne requiert pas la constatation d'une intention frauduleuse [36]. Pire, la jurisprudence ne retient aucune cause d’exonération pour des faits commis sous l’empire d’un trouble mental [37].
2) Variation dans son étendue
Ensuite, comme l’avait relevé André Damien, « Avec une définition aussi large de l’infraction disciplinaire, on peut dire que l’avocat est soumis au régime de l’infraction indéterminée. Tout fait quelconque même non professionnel, commis à l’importe quel moment, n’importe où, dès que l’auteur est avocat, peut être justiciable de sanctions disciplinaires » [38]. En premier lieu, on peut constater que la jurisprudence n’hésite pas à retenir la faute disciplinaire pour des faits extra professionnels dès lors qu’ils sont de nature à porter atteinte à la dignité de la profession ou qu’ils tendent à la déconsidérer. Cette extension disciplinaire s’explique par le fait qu’avocat n’est pas un métier mais bien « un état » qui impose un devoir être dans la vie professionnelle et personnelle. D’une certaine manière, « la profession (d’avocat) veut son homme tout entier » [39]. A titre d’illustration, la responsabilité disciplinaire a été retenue pour : l’avocat candidat à une élection politique qui fait usage d’un exhibitionnisme indécent et provocateur [40], celui qui commet un vol de bouteilles de spiritueux dans un supermarché et constaté dans un procès-verbal de gendarmerie [41], ceux qui en couple refuse de payer leur réception de mariage malgré les décisions de justice et les exhortations de leurs pairs [42] ou bien encore celle qui sollicite la générosité du public en jouant de l’accordéon dans les rues et sur les marchés [43]. En second lieu, la jurisprudence retient la faute disciplinaire non seulement pendant la période durant laquelle l’avocat en fait partie mais également pour des faits qui lui sont antérieurs. Ainsi, il peut s’agir de faits antérieurs à son inscription dès lors que les faits ne sont pas compatibles avec l’exercice des fonctions et que l’Ordre l’ait ignoré lors de l’inscription, à l’instar d’une dissimulation frauduleuse lors de l’inscription [44]. Il peut s’agit également de faits antérieurs à sa démission car les tribunaux ont considéré qu’il fallait éviter que grâce à une démission un avocat puisse échapper à une sanction disciplinaire et conserve éventuellement le droit de s’inscrire à un autre barreau [45]. Enfin, il convient de préciser que « l’avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat » [46]. Tel est le cas de l’avocat à la retraite depuis plus de deux ans qui fait état de la qualité d’avocat pour rendre visite à un ancien client détenu, manquant ainsi à la probité [47].
II. L’action disciplinaire à l’encontre de l’avocat
La décision d’engager des poursuites à l’encontre d’un avocat soupçonné d’avoir commis une faute disciplinaire appartient à deux autorités : « directement ou après enquête déontologique, le Bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé » [48]. Si l’action disciplinaire n’est pas de nature pénale ou civile, elle ne présente plus depuis longtemps un caractère familial [49]. Aujourd’hui, ces poursuites disciplinaires exercées à l’encontre d’un avocat posent deux difficultés théoriques mais également pratiques, difficultés qu’il convient d’aborder : la question de la prescription de l’action disciplinaire (A) et celle du cumul des actions pénale et disciplinaire (B).
A. La prescription de l’action disciplinaire
Un avocat qui commet une infraction peut échapper à la répression pénale en raison de la prescription de l’action publique. En revanche, pour le même comportement, ce praticien ne sera jamais véritablement à l’abri d’un déclenchement (délibérément) tardif des poursuites disciplinaires. En effet, la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne comporte aucune disposition prévoyant la prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats. Cette imprescriptibilité disciplinaire est une solution qui ne laisse personne indifférent [50]. Une telle question ne pouvait donc échapper au contrôle du Conseil constitutionnel, qui à la suite d’une QPC, a validé cette imprescriptibilité disciplinaire (1) qui pourrait, selon nous, à l’avenir être remise en cause (2).
1) Une imprescriptibilité validée
Le 11 octobre 2018 [51], le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats. Pour conclure à la conformité de l’article 23 de la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) à la Constitution, le Conseil constitutionnel a tout d’abord procédé de manière classique à un double rappel. D’une part, il n’existe aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les poursuites disciplinaires seraient nécessairement soumises à une règle de prescription [52] . D’autre part, les sages ont constaté que « ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative n’enferment dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire » [53]. Sur ce point, le Conseil n’a fait que reprendre une solution dégagée par le Conseil d’État soixante ans auparavant concernant les fonctionnaires : « aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’action disciplinaire » [54]. Cette justification textuelle se double d’une justification institutionnelle qui permet de mieux comprendre l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires : « l’exigence de défense des intérêts de l’institution justifie qu’une action punitive puisse être exercée à tout moment pour y maintenir la discipline, si celle-ci a été violée » [55].
Ensuite, le Conseil constitutionnel a entériné cette imprescriptibilité, en rejetant les critiques tirés d’une méconnaissance des droits de la défense et du principe d’égalité devant la loi. Les sages ont ainsi estimé que « la faculté reconnue au procureur général ou au Bâtonnier, par les dispositions contestées, de poursuivre un avocat devant le conseil de discipline, quel que soit le temps écoulé depuis la commission de la faute ou sa découverte ne méconnaît pas, en elle-même, les droits de la défense » [56]. L’atteinte aux droits de la défense doit donc s’apprécier uniquement dans le cadre d’une procédure disciplinaire et ne peut résulter du temps écoulé depuis les faits reprochés. Toutefois, le Conseil en se fondant le principe de proportionnalité, précise que « les exigences constitutionnelles qui découlent de l'article 8 de la Déclaration de 1789, impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction » [57]. Enfin, toute atteinte au principe d’égalité devant la loi a été écarté par le Conseil constitutionnel qui a estimé que la profession d'avocat n'est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées. L’égalité requiert ainsi que les règles soient les mêmes au sein de chaque profession et non au sein de chaque catégorie professionnelle. Ainsi, chaque profession a ses propres règles déontologiques, procédurales et disciplinaires.
2) Une imprescriptibilité menacée ?
En dépit de ce brevet de constitutionnalité, cette imprescriptibilité des poursuites disciplinaires contre les avocats pourrait être remise en cause principalement pour deux raisons.
La première raison tient au fait que l’imprescriptibilité des avocats tend à faire figure d’exception dans le paysage disciplinaire français [58]. En effet, de plus en plus de professions réglementées se sont dotées d’une règle de prescription des poursuites disciplinaires : deux mois pour les salariés [59], trois ans pour les professionnels des marchés financiers [60], dix ans pour les commissaires aux comptes, les greffiers des tribunaux de commerce [61], et trente années pour les notaires [62]. Autrefois, soumis à un régime d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires, les fonctionnaires ainsi que les magistrats connaissent désormais un délai de prescription de trois ans à compter du jour où l’autorité compétente a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction [63]. Une même démarche pourrait être entreprise pour enfermer dans le temps l’action disciplinaire des avocats. En ce sens, la Conférence des doyens a proposé que les contraventions aux lois et règlements ainsi que les infractions aux règles professionnelles se prescrivent par trois ans, les manquements à la probité et l’honneur étant soumis à un délai de dix ans [64]. Cette distinction nous paraît trop subtile sachant qu’un même fait peut constituer une contravention aux lois et règlement et un manquement à la probité, un seul et même délai serait plus lisible et accessible, qu’il soit de 10, 20, voire 30 ans.
La seconde raison réside dans l’application du droit au procès équitable consacré à l’article 6§1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Certes, la jurisprudence européenne en matière de prescription reconnaît au bénéfice des États-membres une marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de dire comment circonscrire le droit d’accès à un tribunal par les délais de prescription [65]. Si la Cour européenne a reconnu que « l’introduction d’un délai de prescription ne doit pas avoir pour effet de limiter ou de restreindre le droit d’accès à un tribunal, de telle façon ou à un degré tel qu’il s’en trouverait atteint dans sa substance même [66], elle également pu conclure en 2013 à une violation de l’article 6 §1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) en raison de l’atteinte portée au principe de la sécurité juridique par l’absence de délai de prescription [67].
B. La question du cumul des poursuites pénales et disciplinaires
Le cumul de poursuites pénales et disciplinaires à l’encontre d’un avocat conduit à évoquer la question de l’application de Non bis in idem [68]. L’objectif de cette règle de forme, fondée sur l’équité, est d’interdire après un jugement définitif d’acquittement ou de condamnation, de nouvelles poursuites pour les mêmes faits à charge de la même personne. Ce cumul répressif s’explique naturellement par l’appartenance d’une même personne à plusieurs institutions que sont ici l’État et la profession. Si ce cumul répressif peut apparaître d’une extrême sévérité, il s’explique par ce « vieux » principe d’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires (1) qui n’est pas sans conséquence sur le procès disciplinaire (2).
1) La justification
La possibilité de cumuler les poursuites pénales et disciplinaires à l’encontre d’un avocat, au mépris de la règle Non bis in idem s’explique de manière classique par le principe d’indépendance qui caractérise les relations entre ces deux répressions qui relèvent d’ordres juridiques distincts [69]. Cette autonomie des poursuites pénales et disciplinaires est même parfois reprise par certaines dispositions légales [70], ce qui n’est pas (hélas) le cas pour les textes réglementant la profession d’avocat qui ne font pas expressément référence à une telle indépendance. En revanche, il n’est pas inutile de souligner au passage que les poursuites pénales et disciplinaires à l’encontre d’un avocat ne paraissent pas constituer des procédures parallèles ou mixtes considérées comme conformes au principe Non bis in idem, à défaut de présenter entre elles « un lien matériel et temporel suffisamment étroit » [71]. En réalité, les sanctions pénales et disciplinaires sont infligées à l’avocat sans que les procédures aient le moindre lien entre elles, chacune suivant son propre cheminement et prenant fin indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, le seul caractère simultané de ces deux procédures est insuffisant en l’absence de lien matériel. La possibilité pour le conseil de l’Ordre de recourir à une mesure de suspension provisoire à l’encontre d’un avocat « qui fait l’objet de poursuite pénale ou disciplinaire » [72] confirme cette relative autonomie des poursuites.
2) Les manifestations
Ce cumul des poursuites disciplinaire et pénale qui frappe un avocat se manifeste de deux manières. En premier lieu, il découle de cette indépendance que « le disciplinaire ne tient pas le pénal en l’état et le pénal ne tient pas le disciplinaire en l’état » [73]. L’action disciplinaire exercée contre l’avocat ne se trouve pas sous la domination d’instances civiles [74], administratives [75] ou pénales. Sur ce dernier point, un même fait peut donc constituer un manquement disciplinaire et ne pas recevoir de qualification pénale et inversement.
Comme l’a relevé la doctrine, en s’appuyant sur la jurisprudence [76], « une décision de relaxe de la juridiction pénale n’empêche pas une sanction disciplinaire si les faits, bien que ne souffrant pas une qualification pénale, constituent un manquement aux principes essentiels » [77]. En réalité, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le disciplinaire se trouve réduite à la seule constatation matérielle des faits, ce qui limite le risque de contradiction totale résultant de défaut de synchronisation entre les décisions répressives. Le juge disciplinaire conserve ainsi toute latitude pour qualifier les faits au regard des règles déontologiques et déterminer la sanction applicable. Ainsi que l’a résumé M. Bernard Blanchard, « il y a tuilage mais non superposition entre le domaine des infractions pénales et celui des infractions disciplinaires » [78].
En second lieu, la juridiction disciplinaire n’a pas l’obligation de surseoir à statuer lorsqu’une instance pénale est saisie ne parallèle. De manière constante, la jurisprudence affirme que le juge disciplinaire n’a pas l’obligation de surseoir à̀ statuer lorsqu’une instance pénale est en cours et qu’en le faisant il méconnaît sa propre compétence [79]. La Cour de cassation considère également qu’en refusant de surseoir à statuer jusqu’à la décision sur l’action pénale engagée relativement à d’autres infractions, la cour d’appel n’a violé ni le principe de contradiction, ni l’article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) [80]. Toutefois, de manière exceptionnelle, la Cour de cassation a considéré que le sursis à statuer sur l’action disciplinaire s’impose « lorsque les faits pénalement poursuivis s'identifient de façon précise et totale avec le comportement reproché à l'avocat sur le plan disciplinaire » [81] (ce qui est rare en pratique voire exceptionnel). Tel le sera le cas du conseil de discipline qui est dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale qui porte sur les faits ayant motivé le renvoi en disciplinaire de l’avocat [82].
III. La sanction disciplinaire de l’avocat
Toute faute disciplinaire « expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184 » [83]. Tout en se conformant au principe de légalité, la répression disciplinaire présente un certain nombre de particularités qu’il convient de présenter (A) avant d’aborder la question (plus délicate) du cumul de sanctions disciplinaire et pénale au regard du principe de proportionnalité (B).
A. Les particularités de la répression
Les particularités de la répression disciplinaire de l’avocat repose une nomenclature des peines (1), proche du droit pénal, qui présente encore quelques imperfections (2).
1) La classification
Par contraste avec le principe de légalité des délits, le principe de légalité des peines paraît mieux respecter par le droit disciplinaire de l’avocat. Elle s’impose évidemment au législateur qui doit énumérer de manière claire et précise les différentes sanctions disciplinaires pour exclure l’arbitraire. Ce que fait parfaitement l’article 184 du Décret 1991 (N° Lexbase : L8168AID) organisant la profession d’avocat qui prévoit de manière exhaustive les peines disciplinaires qui sont « l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire qui ne peut excéder trois années et la radiation du tableau des avocats ou le retrait de l’honorariat » [84]. De manière plus générale, à la différence du droit pénal, la nomenclature des peines disciplinaires présente plusieurs particularités qu’il convient d’exposer.
Tout d’abord, Il n’y a pas de distinction entre les peines principales et les peines complémentaires. Néanmoins, le concept de peine accessoire est présent dans les textes disciplinaires même si son emploi est mal maîtrisé. Ainsi, l’inéligibilité aux institutions représentatives de la profession se présente comme une peine facultative [85]. En réalité, il s’agit bien d’une mesure de sûreté qui a pour « objet de garantir la moralité des membres qui composent les organes d'un ordre professionnel, dont la mission est notamment de veiller au maintien des principes de moralité dans tous les actes de la profession, ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition » [86]. Ensuite, l’échelle des peines disciplinaires pour les avocats n’est pas, en droit disciplinaire, la plus étoffée, ni la plus pauvre mais dans la majorité des répressions disciplinaires. Ainsi, elle se compose de quatre sanctions présentées par ordre croissant de gravité avec d’un côté, l’avertissement et le blâme qui sont des peines purement morales ne produisant aucun effet particulier [87] et de l’autre côté, l’interdiction temporaire d’exercer une activité professionnelle et celle à titre définitif (encore appelée « radiation ») qui sont des peines plus graves qui auront une incidence réelle sur la vie professionnelle du praticien. Ces différentes sanctions sont prévues sans aucune référence expresse à un quelconque critère d’individualisation de la peine. Enfin, chez les avocats, une échelle des peines peut en cacher une autre …. En effet, depuis 2018, il est prévu que « Tout manquement aux obligations de vigilance en matière de blanchiment et de financement du terrorisme » [88] peut donner lieu à trois sanctions : une injonction, une interdiction temporaire d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une de ces personnes et enfin une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros [89]. Pour cette échelle des peines « bis », il est prévu une motivation de la sanction en fonction de trois critères : la gravité et de la durée des manquements, le degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains ou pertes et enfin, le cas échéant, les préjudices subis par des tiers du fait des manquement. Soulignons enfin que les deux échelles disciplinaires peuvent se cumuler au mépris de la règle non bis in idem.
2) Les imperfections
En dépit de nombreux emprunts au droit pénal, le droit disciplinaire de l’avocat connaît plusieurs lacunes que le législateur pourrait tout à fait combler.
En premier lieu, l’échelle des peines disciplinaires pourrait être étoffée en introduisant, par exemple, l’équivalent de la peine de stage, qui pourrait être prononcée, à la place ou en même temps que les peines de blâme ou d’interdiction d’exercer. Celle-ci qui consisterait pour l’avocat ayant manqué à l’un de ses devoirs à suivre une formation continue sur la thématique concerné.
En second lieu, l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0172LKL) prévoit que « l’instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire » [90]. Or, en l’état actuel, cette peine de publicité de la décision disciplinaire présente deux défauts. Tout d’abord, les dispositions réglementaires ne précisent ni les modalités matérielles (affichage, diffusion, extraits, intégralité), ni les modalités temporelles (durée, périodicité), ni les modalités factuelles (frais et coût éventuel) de cette sanction disciplinaire, ce qui nous paraît peu conforme aux exigences qui découlent du principe de légalité des peines. En l’état actuel, c’est l’insécurité ou plutôt le risque d’arbitraire qui prédomine puisque la jurisprudence estime d’un côté que la publicité ne peut avoir lieu que dans les locaux de l’Ordre [91] et de l’autre, elle a pu considérer que qu’il était possible de faire ordonner la publication dans un journal local [92]. Sans forcer, le décret de 1991 (N° Lexbase : L0172LKL) pourra largement s’inspirer des dispositions de l’article 131-35 du Code pénal (N° Lexbase : L3255IQM). Ensuite, la peine de publicité de la décision disciplinaire est en pratique peu voire pas prononcée par la juridiction ordinale ce qui conduit à s’interroger sur son efficacité ou plutôt son efficience [93]. Là aussi, à l’instar de nos cousins québécois [94] ou de l’exemple du droit pénal de la consommation [95] ou du droit boursier [96]. Il ne semble pas incongrue de rendre obligatoire par principe son prononcé et de permettre à la juridiction disciplinaire, par une décision motivée, de reporter la publication ou de ne pas procéder à la publication.
Enfin, l’un des effets les plus redoutables que fait naître le prononcé d’une interdiction d’exercer à titre de sanction disciplinaire pour un avocat, ce sont les incapacités professionnelles en cascade qui vont découler de cette condamnation disciplinaire. Or, actuellement un avocat condamné n’a pas la possibilité de soustraire à cette interdiction par le biais d’une procédure de relèvement. Certes, le Code pénal prévoit la possibilité d’obtenir la mainlevée d’une interdiction professionnelle pour une « personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale » [97]. Cette dernière exigence exclut donc du bénéfice de la mesure les interdictions qui seraient consécutives à une condamnation autre que pénale : à savoir une sanction disciplinaire [98]. Par conséquent, les interdictions disciplinaires d’exercer resteront hors de portée des dispositions prévues par le législateur et ce, en raison de la nature de sanction prononcée. Cette différence de traitement opérée par le législateur entre condamnations pénale et disciplinaire serait justifiée par le respect de l’autonomie du droit disciplinaire. Toutefois, à la différence d’autres droits disciplinaires (professions médicales, fonctionnaires), le droit disciplinaire de l’avocat ne prévoit pas de procédure de relèvement ce qui est tout à fait regrettable. Sur ce point, le décret de 1991 (N° Lexbase : L0172LKL) pourrait utilement reprendre la procédure mise en place par la loi dite « Sapin 2 » (N° Lexbase : L6482LBP) en matière boursière [99].
B. La proportionnalité de la répression
En raison de la faute commise, un avocat peut être sanctionné pénalement et disciplinairement d’une interdiction d’exercer une même activité professionnelle. Au regard des jurisprudences françaises et européennes, un tel cumul répressif est tout à fait justifié (1) mais devrait logiquement être plafonné ce qui n’est pas le cas actuellement (2).
1) Un cumul de sanctions justifié
L’exclusion de la règle Non bis In idem dans l’hypothèse d’une pluralité de sanctions disciplinaires et pénales à l’encontre d’un avocat est validée par les jurisprudences française et européenne.
Pour les premières, la méconnaissance de la règle Non bis in idem se justifie par l’existence d’une différence de nature entre les sanctions disciplinaires et pénales qui peuvent donc se cumuler. Ce raisonnement s’appuie sur la réserve formulée par la France en marge du protocole n° 7 additionnel de la CESDH selon laquelle seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 et 4 du présent Protocole » [100]. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation retient de manière continue que la peine prononcée par le juge pénal et les sanctions disciplinaires étant de natures différentes, leur cumul n’est pas concerné par les dispositions de l’article 4 du Protocole n° 7 à la CEDH [101]. Cette solution a d’ailleurs été réaffirmée à propos d’un notaire sanctionné pénalement et disciplinairement pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance dans l’exercice de ses fonctions. La Cour a donc considéré que « la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire de destitution susceptible de frapper un notaire sont de nature différente » [102]. Cette solution autorisant une entorse à la règle non bis in idem est reprise, dans des termes similaires, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation [103] mais également par le Conseil d’État [104]. De manière étonnante, on comprend donc que les interdictions d’exercer une même profession prononcées par les juridictions pénales et disciplinaires, bien qu’ayant le même objet, ne sont pas des sanctions de même nature. En effet, « la différence de nature, sur laquelle elle se fonde, renvoie à la différence de nature des infractions qu'elles sanctionnent au regard de la catégorie professionnelle concernée et des valeurs et intérêts protégés » [105]. La différence de nature renvoie en réalité à une différence de finalité : « Le fait est alors considéré sous un autre rapport. L’intérêt du corps et l’honneur de la profession prennent la place de l’intérêt social proprement dit » [106]. Cette solution n’a pas été démentie par le Conseil constitutionnel qui avait pourtant dès 2014 reconnu que les peines disciplinaires instituées par l’ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires (N° Lexbase : L7650IGG) – en l’occurrence l’interdiction temporaire et la destitution – relèvent de la catégorie de « sanction ayant le caractère d’une punition » [107]. Dès lors, à partir du moment où l’interdiction disciplinaire et l’interdiction professionnelle prévue par le Code pénal peuvent être qualifiées de sanction ayant le caractère d’une punition, c’est-à-dire de peine, on peut donc conclure qu’elles devraient être logiquement considérées comme de même nature au regard de la règle Non bis in idem. C’était sans compter sur l’affaire EADS qui a permis au Conseil constitutionnel le 18 mars 2015 de subordonner l’interdiction du cumul répressif à un quadruple examen : identité des faits, identité de finalité, identité de sanctions et enfin identité de juridictions [108]. Or, appliqué aux avocats, les conditions risquent de ne pas être remplies : si les deux répressions pénale et disciplinaire peuvent protéger les mêmes intérêts sociaux (intégrité d’une profession), elles ne présentent une identité de sanctions puisqu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer à toute personne [109].
L’avocat qui fait l’objet d’un cumul de sanctions pénales et disciplinaires ne peut espérer mieux de la jurisprudence européenne en dépit des arrêts Gradinger [110] et Grande Stevens [111]. En effet, la mise en œuvre de Non bis in idem suppose en effet que les interdictions disciplinaires d’exercer relèvent de la « matière pénale » au sens de la CESDH [112]. Si la Cour européenne a considéré que certains contentieux disciplinaires relèvent bien de la matière pénale, à l’instar du droit disciplinaire militaire et du droit pénitentiaire, tel n’est pas le cas pour les avocats [113]. Ainsi, n’appartient pas à la matière pénale la procédure ayant abouti à une interdiction d’exercer pour une avocate : « De par sa nature et son but, la sanction infligée à la requérante revêt donc un caractère typiquement disciplinaire. En conséquence, la Cour considère que la requérante ne peut se prétendre « accusée d’une infraction [114]. De la même manière, ne peut être considérée comme une accusation en matière pénale une procédure disciplinaire ayant abouti à un blâme infligé à un avocat par le conseil de l’Ordre des avocats à la suite de sa condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique [115] ou celle ayant abouti à la destitution d’un notaire [116].
2) Un cumul de sanction non plafonné
Si le cumul des sanctions pénales et disciplinaires est validé en son principe, il devrait logiquement être plafonnée sans sa mise en œuvre. En effet, le Conseil constitutionnel a assorti ce cumul répressif d’un correctif qui s’inspire non pas de la règle Non bis in idem toujours mise à l’écart mais du principe de proportionnalité déduit de la nécessité des peines qui trouve son fondement dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Ce correctif a pris la forme d’une réserve d’interprétation qui a conduit à un plafonnement des sanctions. Ainsi, « lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues » [117].
Cette réserve formulée à propos du cumul des sanctions en matière boursière a logiquement été déclinée par la suite au cumul des sanctions pénales et disciplinaires :
« Lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues » [118]. De manière quasi automatique, le Conseil constitutionnel a jugé nécessaire d’assortir ce plafonnement d’une obligation à la charge des autorités juridictionnelles et disciplinaires. En effet, il appartient donc à celles-ci de « veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu’elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées » [119]. Cette exigence formulée par le Conseil constitutionnel est-elle respectée par les autorités compétentes ?
Si la jurisprudence administrative a apporté une réponse positive en affirmant que le principe de proportionnalité implique que la durée cumulée des interdictions d’exécution des interdictions d’exercer prononcées à l’encontre d’un pharmacien n’excèdent pas le maximum légal le plus élevé [120], le juge judiciaire se montre particulièrement hostile à mettre en œuvre ce principe de proportionnalité en cas de cumul de sanctions pénales et disciplinaires [121]. En effet, pour les avocats, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que la peine disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer doit s’exécuter à compter de la date à laquelle la sanction pénale a pris fin [122]. Elle a également affirmé que l’article 131-27 du Code pénal (N° Lexbase : L9467IYB) qui limite la durée de la peine complémentaire d’interdiction professionnelle n’est pas applicable en matière disciplinaire [123]. En définitive, il est regrettable que le juge judiciaire ne tiennent pas compte de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel pour limiter les effets du cumul des interdictions d’exercer.
[1] Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, art. 183 (N° Lexbase : L8168AID).
[2] M. Foucault, Surveiller et Punir. Naissance de la prison. Gallimard, 1975, p. 180.
[3] En ce sens, A. Legal, J. Brethe de la Gressaye, Le pouvoir disciplinaire dans les institutions privées. Etudes de sociologie juridique, Sirey, 1938, p. 123.
[4] J.-F. Pillebout, Discipline – Principes – Mesures de sûreté, JCl. Notariat, 2013, Fasc. 30, § 22.
[5] Cf. not. P. Lambert, La Convention européenne des droits de l’Homme et les procédures disciplinaires au sein des professions libérales, RTDH, 1990, p. 35 ; J. Pralus-Dupuy, L’article 6 de la CEDH et les contentieux de la répression disciplinaire, RSC, 1995, p. 723 ; D. Imbert, L’influence conventionnelle sur le droit disciplinaire, p. 275 in Vers un droit commun disciplinaire ?, (dir. P. Ancel et J. Moret-Bailly), Presses Universitaires de Saint-Étienne, 2007, 339 p.
[6] CNB, Propositions d’adaptation et de réforme de la procédure disciplinaire applicable aux avocats, résolution, 3 avril 2020.
[7] sans oublier les règlements intérieurs des barreaux.
[8] R.I.N., art. 1.4 (N° Lexbase : L4063IP8).
[9] Décret n° 91-1197, art. 183 (N° Lexbase : L8168AID).
[10] Cons. const., décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 (N° Lexbase : A1170HYY).
[11] Cons. const., décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 (N° Lexbase : A9892MHT).
[12] Cons. const., décision n° 2017-630 QPC du 19 mai 2017 (N° Lexbase : A4791WDS).
[13] A. Damien, H. Ader, Les règles de la profession d’avocat, Dalloz action, 2011-2012, p. 684, n° 81.08.
[14] Décret n° 91-1197, art. 183 (N° Lexbase : L8168AID).
[15] J. de Poulpiquet, La responsabilité civile et disciplinaire des notaires : de l’influence de la profession sur les mécanismes de la responsabilité, thèse, Nice, 1973, L.G.D.J., 1974, p. 398.
[16] CE 6 SS, 22 juin 2012, n° 353854 (N° Lexbase : A5196IP7) ; CE 6 SS, 26 décembre 2013, n° 363310 (N° Lexbase : A2483KT7) ; CE, 12 octobre 2009, n° 31164 : LPA, 5 mai 2010, p. 6, concl. M. Guyomar ; CE ass., 7 juillet 2004, n° 255136 (N° Lexbase : A7719KHD) : RFDA, 2004, p. 913, concl. M. Guyomar ; AJDA, 2004, p. 1695, comm. C. Landais et F. Lenica.
[17] Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-19284 F-P+B (N° Lexbase : A4344MUG) : BICC, du 1er décembre 2014, n° 11467 ; Bull. civ. I., n° 137 ; Gaz. Pal., 11 octobre 2014, n° 284, p. 19, comm. J.-M. Brigant.
[18] J.-M. Brigant, Les barbares, le traître et la délicatesse : fin de la saga française, Gaz. Pal., 11 octobre 2014, n° 284, p. 19.
[19] J. Pralus- Dupuy, Discipline, Rép. pén. Dalloz, octobre 1997, n° 34.
[20] J.-P. Markus, Les juridictions ordinales, L.G.D.J., 2003, p. 56.
[21] R. Martin, Avocats – Obligations et prérogatives, JCl. Procédure civile, Fasc. 200-90, 2019, § 155.
[22] Pas moins de 16 principes.
[23] Cass. civ. 2, 6 septembre 2017, n° 16-24.664 : Gaz. Pal., 5 décembre 2017, p. 28, obs. Landry (propos antisémites), CNB, Comm. RU, avis n° 2011-037, 23 septembre 2011 (pratique de la cartomancie et passes énergétiques), CA Bordeaux, 3 juin 2003, n° 02/06127 (N° Lexbase : A6032C8W) : D., 2004, somm. 2825, obs. Blanchard (sollicitation de la générosité du public en jouant de la musique).
[24] CA Colmar, 1 juillet 2015, n° A14/04926 (N° Lexbase : A9769R8C) : Gaz. Pal., 11 décembre 2015, p. 17, note Landry (avocat devenu intermédiaire de son client, escroc notoire, aux fins de blanchiment).
[25] CA Rennes, 12 juillet 1985 : Gaz. Pal., 12 juillet 1985 ; Gaz. Pal., 10 décembre 1985, note Y. Avril (appropriation de fonds de l’association dont il est associé) ; Cass. civ. 1, 21 mai 1990, n° 88-19.218 (N° Lexbase : A4053AHL) (le fait d’attendre d’être l’objet d’une réclamation pour restituer des frais).
[26] Cass. civ. 1, 26 janvier 1999 : JCP, 1999, I, 126, n° 24, obs. Martin (recrutement comme juriste salarié un ancien Bâtonnier condamné pénalement pour des fautes graves et contre l’avis du conseil de l’Ordre).
[27] Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 05-18.795 (N° Lexbase : A0278D3P) (conseil à un client une opération de lotissement au profit d’une société dont il est le dirigeant sans révéler ce conflit d’intérêts).
[28] Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 03-14.530 (N° Lexbase : A3897DBX) (versement d’honoraire par des clients relevant de l’aide juridictionnelle sans l’accord du Bâtonnier).
[29] Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 01-12.473, F-D (N° Lexbase : A3788DBW) (défaut de réponse aux demandes successives du Bâtonnier).
[30] Cass. civ. 1, 11 juillet 1983, Bull. civ. I., n° 202 (affirmation à son client qu’il plaiderait personnellement son affaire alors qu’il ne pouvait être présent à l’audience).
[31] Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-19284, F-P+B (N° Lexbase : A4344MUG) (abus dans la liberté d’expression en traitant un magistrat de « traitre génétique »).
[32] Cass. civ. 1, 22 janvier 1985, n° 84-10.160 (N° Lexbase : A0646AHE) : Bull. civ. n° 30 (lettre envoyée à un greffier l’accusant d’avoir démarché un témoin et lui indiquant qu’il se contrefout de ses explications et le menaçant de poursuites).
[33] CA Bordeaux, 14 octobre 2008, JCP, 2009, I, 120, obs. Bortoluzzi (non-respect de l’obligation de formation continue).
[34] CA Pau, 11 juin 1981 (Avocat acceptant sans avoir présenté à son client la moindre observation afin de l’aviser du risque de diligenter une procédure d’exécution particulièrement rigoureuse et grave).
[35] CA Bordeaux, 20 décembre 1985, D., 1987, somm. 106, obs. Brunois.
[36] Cass. civ. 1, 10 mars 1992 : Bull. civ. I, n° 76 ; JCP G., 1992, IV, 1401 ; Gaz. Pal., 1992, 2, pan. p. 210 ; D., 1992, IR, p. 21.
[37] CA Paris, 24 novembre 1993 : D., 1995, somm. p. 195, obs. Brunois.
[38] A. Damien, Les règles de la profession d’avocat, Dalloz action, 2011-2012, p. 465.
[39] Citation de Loysel reprise par Henri Ader, La déontologie des avocats, p. 65 in Éthique et professions judiciaires (dir. N. Fricero), Actes du colloque de Nice, 16 et 17 avril 2004, 86 p.
[40] Cass. civ. 1, 1 février 1983 : Gaz Pal., 1983, 1, pan. 172.
[41] Cass. civ. 1, 12 avril 1983 : Gaz. Pal., 1983, 2, 436.
[42] CA Paris, 30 avril 1997 : Gaz. Pal., 1997, 2, somm. p. 333.
[43] CA Bordeaux, 3 juin 2003, D., 2004, somm. 2825, obs. Blanchard.
[44] Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, D., 2012, 337, note Avril.
[45] Cass. civ. 1, 24 avril 1974, n° 72-13400 (N° Lexbase : A8161CI4) : Bull. civ. I, n° 111.
[46] R.I.N, art. 13.1 (N° Lexbase : L4063IP8).
[47] Cass. civ. 1, 10 décembre 2002, n° 99-12.842 (N° Lexbase : A4444A4D) : D., 2003, 104.
[48] Décret n° 91-1197, art. 188 (N° Lexbase : L8168AID).
[49] Y. Avril, Responsabilité des avocats, Dalloz action, 4ème éd., 2020, § 60.00.
[50] Pour les uns, il y va de l’honneur de la profession qui est « une valeur intemporelle, dont la protection peut et doit être indéfiniment assurée contre tout comportement l’entachant, sans considération de date » (J.-P. Markus, Les juridictions ordinales, L.G.D.J., 2003, p. 74). Pour les autres, il s’agit « une épée de Damoclès perpétuelle placée au-dessus de la tête du professionnel fautif » qui démontre que le droit disciplinaire peut se montrer beaucoup plus sévère que le droit crimineL (B. Lapérou-Scheneider et L. Mordefroy, L’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires engagées contre les professionnels de santé, in (dir. Leonhard J., Py B. et Vialla F), Mélanges en l’honneur de Gérard Mémeteau, vol. I, 2015, LEH, p. 527.
[51] Cons. const., décision n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018 (N° Lexbase : A0164YG8).
[52] Cons. const., décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, cons. 5 (N° Lexbase : A9851HZU).
[53] Cons. const., décision du 11 octobre 2018, § 9 (N° Lexbase : A0164YG8).
[54] CE, ass., 27 mai 1955, Deleuze, Rec. CE, p. 276. Voir auparavant CE, 18 janvier 1901, Walsin-Estherasy, mentionné aux tables du recueil Lebon, p. 36. Selon le Commissaire du Gouvernement de l’époque, « en l’absence de dispositions législatives imposant, à peine de nullité, un terme à la procédure disciplinaire, il n’appartient pas au juge d’instituer un délai à l’expiration duquel l’action disciplinaire serait frappée de forclusion » (Concl. Laurent sur CE, ass., 27 mai 1955, Deleuze, AJDA, 1955, p. 275).
[55] F. Laurie, Faut-il mettre fin à l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dans la fonction publique ?, AJDA, 2002, p. 1386.
[56] Cons. const., décision du 11 octobre 2018, § 10 (N° Lexbase : A0164YG8).
[57] Cons. const., décision du 11 juillet 2018, § 11 (N° Lexbase : A0164YG8) ; Cons. const., décision n° 2011-199 du 25 novembre 2011, cons. 10 (N° Lexbase : A9851HZU).
[58] Pour approche in concreto de la prescription disciplinaire, Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 18-21.966 (N° Lexbase : A0061ZRP).
[59] C. trav., art. L. 1332-4 (N° Lexbase : L1867H9Z).
[60] C. mon. fin., art. L. 621-15 (N° Lexbase : L0163LT9).
[61] C. com., art. L. 743-4 (N° Lexbase : L0385LTG).
[62] Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, art. 47 (N° Lexbase : L7650IGG).
[63] Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, art. 36 (N° Lexbase : L7825K7X) ; Loi n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et aux recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, art. 47 (N° Lexbase : L6579K9K).
[64] J.-J. Taisne, Déontologie de l’avocat, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 11ème éd., 2019, p. 186.
[65] CEDH, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et n° 22095/93, Stubbings et autres c/ R-U (N° Lexbase : A8348AW4).
[66] CEDH, 11 mars 2014, n° 52067/10, Howald Moor et autres c/ Suisse (N° Lexbase : A2773S4H).
[67] CEDH, 9 janvier 2013, n° 21722/11, Oleksandr Volkov c. Ukraine, § 139 (N° Lexbase : A6689ZEH) : « Il ressort de la décision rendue par la Cour administrative supérieure dans l’affaire du requérant et des observations du Gouvernement que le droit interne ne prévoit pas de délais de prescription pour la révocation d’un juge pour « rupture de serment ». Si elle ne juge pas approprié d’indiquer quelle devrait être la durée du délai de prescription, la Cour considère néanmoins qu’une approche aussi illimitée des affaires disciplinaires concernant des membres de l’ordre judiciaire menace gravement la sécurité juridique ».
[68] Sur le sujet, H. Matsopoulou, La règle ne bis in idem. Concordances et discordances entre les jurisprudences européenne et constitutionnelle, Mare & Martin, 2019 ; D. Brach-Thiel, Existe-t-il encore un seul non bis in idem aujourd’hui ?, L’Harmattan, 2017.
[69] CE, 12 janvier 1917, Letrillard, mentionné aux tables du recueil Lebon, 33 ; Cass. civ., 28 juillet 1902, DP, 1904, 2, p. 187.
[70] Voir égal. CSP, art. L. 4126-5 (N° Lexbase : L2982DLZ) – Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi « Le Pors », art. 29 (N° Lexbase : L6938AG3).
[71] CEDH, 15 novembre 2016, n° 24130/11 et 29758/11, A et B contre Norvège (N° Lexbase : A9900SGR), Revue des sociétés, 2017, 99, comm. H. Matsopoulou ; RD bancaire et fin., n° 259, comm. P. Pailler ; JCP G, 2017, 32, chron. F. Sudre., n° 21.
[72] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 24 (N° Lexbase : L6343AGZ).
[73] R. Chapus, Droit administratif général, t. 2, 15ème éd., Paris, L.G.D.J., Montchrestien, p. 346.
[74] Cass. civ. 1, 18 avril 1961, JCP G, 1961, II, 12184, note J. Savatier ; Cass. civ. 1, 1 juillet 1958, D., 1959, 283, note J. Brethe de La Gressaye ; Cass. civ., 4 janvier 1950, D., 1950, J., p. 174.
[75] CE, 19 juin 1964, Teboul, mentionné aux tables du recueil Lebon, 989 ; CE, 28 février 2000, n° 193122 (N° Lexbase : A0414AUU).
[76] Cass. req., 16 juillet 1946, D., 1946, 375 ; Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-13.624 (N° Lexbase : A1174WRW).
[77] H. Ader, A. Damien, S. Bortoluzzi, Règles de la profession d’avocat, Dalloz action, 2018-2019, § 321-62.
[78] B. Blanchard, La discipline de l’Ordre, in Droit et déontologie de la profession d’avocat, (dir. B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque), Paris, L.G.D.J., 2008, n° 397.
[79] CE, 28 janvier 1994, n° 126512 (N° Lexbase : A9226AR7), RFDA, 1994, p. 459, concl. R. Schwartz.
[80] Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 10-15444 (N° Lexbase : A5370HPL) ; Cass. civ. 1, 18 mai 1989, n° 97-15.084, Bull. civ., n° 201 ; Cass. civ. 1, 31 octobre 1989, n° 88-14.042 (N° Lexbase : A6571CKL) : Bull. civ. I., n° 334 ; Cass. civ. 1, 2 avril 1997, n° 95-13.599 (N° Lexbase : A0427ACS) : Bull. civ. I., n° 115.
[81] Cass. civ. 1, 14 juin 1988, n° 86-19.184 (N° Lexbase : A2257AH3).
[82] Cass. civ. 1, 22 mai 2002, n° 99-13.871 (N° Lexbase : A6945AYU) et 99-13.872 (N° Lexbase : A8378AYX) : Bull. civ. I., n° 1401.
[83] Décret n° 91-1197, art. 183 (N° Lexbase : L8168AID).
[84] Décret n° 91-1197, art. 184 (N° Lexbase : L8168AID). En revanche, on peut regretter, contrairement au Conseil constitutionnel, que la détermination des sanctions disciplinaires relève de la compétence du pouvoir réglementaire alors même qu’il s’agit de sanction ayant le caractère d’une punition.
[85] Décret n° 91-1197, art. 184 (N° Lexbase : L8168AID) : « L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ».
[86] CE, 2 mars 2011, n° 339595 (N° Lexbase : A3036G49) : RDSS, 2011, 682, note Eoche-Duval ; Cons. const., décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012, § 4 (N° Lexbase : A4116IB3) : Dr. pén., 2012, comm. 36, obs. J.-H. Robert ; JCP G, 2012, 338, comm. J.-M. Brigant.
[87] B. Blanchard, La discipline de l’Ordre, in Droit et déontologie de la profession d’avocat, (dir. B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque), L.G.D.J., 2008, n° 390.
[88] Décret n° 91-1197, art. 184-1 (N° Lexbase : L8168AID) (créé par décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L0172LKL) – en application de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme N° Lexbase : L4816LBY).
[89] Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, cette sanction peut être au plus le double du montant de cet avantage.
[90] Décret n° 91-1197, art. 184 (N° Lexbase : L8168AID).
[91] CA Montpellier, 15 novembre 1991, n° 98/03190.
[92] CA Fort France, 25 mai 2012, n° 12/00018.
[93] H. Ader, A. Damien, S. Bortoluzzi, Règles de la profession d’avocat, Dalloz action, 2018-2019, § 523.155.
[94] Y. Avril, Responsabilité des avocats, Dalloz, 3ème ed., 2014, § 62.97.
[95] C. consom., art. L.132-4 (N° Lexbase : L6893LMA).
[96] C. mon. fin., art. L. 621-15, V (N° Lexbase : L0163LT9).
[97] C. pén., art. 132-21 (N° Lexbase : L3759HGC).
[98] Cass. crim., 4 janvier 1990, Bull. crim., n° 3 (destitution d’un notaire).
[99] C. min. fin., L. 621-15, VI (N° Lexbase : L0163LT9) : « Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État ».
[100] Réserve contenue dans l’instrument de ratification, déposé le 17 février 1986 – Décret n° 89-37 du 24 janvier 1989 portant publication du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984, ainsi que des déclarations et réserves accompagnant l’instrument français de ratification et de la déclaration française du 1 novembre 1988.
[101] Cass. civ. 1, 17 mai 1988, n° 86-15.067 (N° Lexbase : A1984AHX) : Bull. civ. I., n° 145 ; Cass. civ. 1, 3 février 1998, n° 96-12.035 (N° Lexbase : A2205ACN) : Bull. civ. I, n° 43 ; D., 1998, 77 ; Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 98-18.770 (N° Lexbase : A1120ATN) : Bull. civ. I, n° 85 – Cass. civ. 1, 26 octobre 2004, n° 02-17.903 (N° Lexbase : A6674DDK).
[102] Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-50.012 (N° Lexbase : A5344NGZ), JCP N, 2015, n° 17, act. 535, obs. J.‑M. Brigant ; Defrénois, 2016, n° 12, p. 703, obs. M. Latina ; D., 2015, p. 1192, note O. Décima ; Gaz. Pal., 30 mai 2015, p. 14, note R. Evans.
[103] Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 15-85.519 (N° Lexbase : A0852S83) ; Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-87.121 (N° Lexbase : A2432SIW) ; Cass. crim., 19 février 2014, n° 12-87.558 (N° Lexbase : A7727MEW) ; Cass. crim., 3 mai 2016, n° 15-84.171 (N° Lexbase : A3404RNE); Cass. crim., 7 septembre 2004, n° 04-80.010 (N° Lexbase : A4279DDT) : Bull. crim., n° 200, D., 2004, IR, p. 2691 ; RSC, 2005, p. 69, obs. E. Fortis ; Cass. crim., 7 avril 1999, n° 98-83.770 (N° Lexbase : A4488CGC).
[104] CE, 27 janvier 2006, n° 265600 (N° Lexbase : A6391DMN).
[105] J.-P. Sudre, Le principe non bis in idem et le cumul des sanctions pénales et disciplinaires applicables aux notaires, D., 2015, p. 1187.
[106] R.-T. Troplong, note sous Cass. req., 6 mai 1844, D.P, 1844, I, 193.
[107] Cons. const., décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 (N° Lexbase : A9892MHT), JO 30 mars : Dalloz actualité, 2014, 784 ; Defrénois, 2015, 199, obs. M. Latina ; JCP N, 2014, n° 14, act. 467.
[108] Cons. const., décisions n° 2014-453 QPC, n° 2014-454 QPC et n° 2015-462 QPC du 18 mars 2015 (N° Lexbase : A7983NDZ), M. John L. et les autres, JCP G, 2015, 368, F. Sudre ; JCP G, 2015, 369, J.-H. Robert ; Revue des sociétés, 2015, p. 380, note H. Matsopoulou ; RLDA, 2015, 105, n° 5611, note F. Stasiak.
[109] Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-80.694 (N° Lexbase : A4016RYE), publié au bulletin.
[110] CEDH, 23 octobre 1995, n° 33/1994/480/562, Gradinger c/ Autriche (N° Lexbase : A8370AWW).
[111] CEDH, 4 mars 2014, n° 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, Grande Stevens et autres c/ Italie (N° Lexbase : A1275MGC) ; Revue des sociétés, 2014, 675, note H. Matsopoulou ; RSC, 2014, 110, obs. F. Stasiak.
[112] CEDH, 8 juin 1976, Engel et a. c/ Pays-Bas, § 81 (N° Lexbase : A5111AYX). La matière pénale est une « notion autonome » qui suppose de satisfaire à trois critères alternatifs : la qualification juridique de l’infraction dans le droit national, la nature de l’infraction litigieuse et enfin la nature et la gravité de la sanction encourue.
[113] Pour les médecins : CEDH, 2 mars 1994, n° 18441/91, Ouendedo c/ France ; CEDH, 29 septembre 2020, n° 59389/16 et 59392/16, Faller et Steinmetz c. France (N° Lexbase : A8349394).
[114] CEDH, 3 mai 2011, n° 46227/08, Zerouala c/ France.
[115] CEDH, 3 novembre 2005, n° 12922/03, Tabet c/ France .
[116] CEDH, 31 janvier 2012, n° 10212/07, Durand c/ France.
[117] Cons. const., décision n° 89-260 DC - Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier du 28 juillet 1989, cons. 22.
[118] Cons. const., décision n° 2014-423 QPC - M. Stéphane R. et autres du 24 octobre 2014, cons. 37 (N° Lexbase : A0011MZG) – Cons. const., décision n° 2016-550 QPC - M. Stéphane R. et autres du 1er juillet 2016, cons. 8 (N° Lexbase : A9977RU3).
[119] Cons. const., décision n° 2014-423 QPC - M. Stéphane R. et autres du 24 octobre 2014, cons. 37 (N° Lexbase : A0011MZG) – Cons. const., décision n° 2016-550 QPC - M. Stéphane R. et autres du 1er juillet 2016, cons. 8 (N° Lexbase : A9977RU3).
[120] CE, 21 juin 2013, n° 345500, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2085KHP) ; AJDA, 2013, 2209, note L. Seurot.
[121] Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 98-18.770 (N° Lexbase : A1120ATN) : Bull. civ. I., n° 84.
[122] Cass. civ. 1, 17 mai 1988, n° 86-15.067 (N° Lexbase : A1984AHX), Bull. civ., I, n° 145.
[123] Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 04-15.215 (N° Lexbase : A0305DLU), Bull. civ. I, n° 367 ; D., 2005, 2901 ; Cass. crim. 26 janvier 2011, n° 10-85340 (N° Lexbase : A3304HWB), Dalloz actualité, 15 février 2011, obs. S. Lavric.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476071
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Les préjudices réparables par l’avocat : entre certitude et incertitude
Lecture: 28 min
N6047BYM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Hadi Slim, Professeur à l’Université de Tours
Le 04 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
Parmi les caractères généralement attribués au préjudice réparable, c’est incontestablement le caractère certain de ce dernier qui suscite le plus de difficultés [1]. Cette constatation, souvent mise en exergue dans tous les domaines où le droit de la responsabilité civile est appelé à être appliqué, est particulièrement vraie lorsqu’il s’agit de la responsabilité civile des avocats.
Certes, pour être réparable, le préjudice invoqué à l’occasion d’une action en responsabilité civile dirigée contre un avocat doit également répondre aux autres caractéristiques dégagées en droit commun. Il doit ainsi non seulement être certain, mais également actuel et licite. Ces deux dernières exigences ne soulèvent toutefois pas de complications particulières en matière de responsabilité civile des avocats.
En outre, si le préjudice généralement invoqué dans ce domaine est un préjudice matériel, il n’est pas exclu qu’il puisse également s’agir d’un préjudice moral. La demande en réparation d’un tel préjudice est, par exemple, susceptible de prospérer, comme l’a récemment rappelé le Conseil d’Etat [2], lorsque la responsabilité d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est recherchée. Il est vrai toutefois que ces derniers sont soumis à un régime spécifique de responsabilité et que le préjudice allégué à leur encontre constitue souvent la perte de chance sérieuse d’obtenir la cassation.
Quant au caractère « direct » du préjudice, la doctrine a depuis longtemps démontré qu’il s’agit moins d’un caractère du préjudice réparable que du lien de causalité. Dire qu’un préjudice est direct, c’est dire qu’il est lié à la faute par un lien de causalité.
A ce stade, l’on doit s’interroger sur les raisons qui font que le caractère certain du préjudice est celui qui suscite le plus de difficultés dans le domaine de la responsabilité civile des avocats.
Même si la certitude, envisagée comme étant la caractéristique essentielle que doit présenter le préjudice, constitue, somme toute, un attribut que les juristes utilisent par habitude sans approfondir son sens véritable, la réponse n’est pas difficile à trouver. D’une part, la certitude s’oppose à l’hésitation ou à l’ambiguïté, notamment lorsqu’un choix est possible. Dès lors, lorsqu’il existe une voie de droit, autre que l’action en responsabilité civile dirigée contre l’avocat, la certitude du préjudice dont la réparation est demandée à ce dernier, peut être, dans une certaine optique, mise à mal. D’autre part, la certitude s’oppose à l’aléa. Or, les prestations que les avocats sont appelés à exécuter sont souvent teintées d’une forte dose d’aléa, notamment dans les hypothèses où le résultat de ces prestations dépend du pouvoir décisionnel du juge.
Au regard de l’une et l’autre de ces deux approches de la certitude, la situation des avocats, compte tenu des prestations qu’ils sont appelés à fournir, est spécifique. La première correspond au cas où la faute commise par l’avocat et le préjudice subi par le client sont avérés, mais où ce dernier dispose de la possibilité de poursuivre non seulement l’avocat, mais une autre personne et d’obtenir de cette dernière la réparation de son préjudice. Dans ce type d’hypothèses, ce n’est pas la certitude du préjudice en soi qui est en cause, mais l’absence de certitude que la réparation de ce préjudice est susceptible d’être réclamée et obtenue d’une personne autre que l’avocat. Doit-on, dans ces hypothèses, permettre au client de poursuivre l’avocat avant d’avoir au moins tenté d’obtenir réparation de son préjudice par l’autre débiteur potentiel ? C’est le problème du caractère subsidiaire ou non de la responsabilité des avocats (I).
La seconde a trait au fait que très souvent un aléa affecte non seulement le résultat de la prestation que l’avocat s’engage à fournir mais également le résultat de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de cette prestation. Le résultat d’un procès n’est ainsi jamais acquis. De même, le résultat d’un mauvais conseil n’est jamais sûr. Cet aléa rejaillit sur le type de préjudice invoqué à l’encontre de l’avocat qui se présente souvent comme une perte de chance (II).
- La certitude du préjudice en présence d’une pluralité de voies de droit à la disposition de la victime
Lorsqu’un avocat et plus généralement un professionnel du droit est poursuivi en responsabilité par son client mais que ce dernier dispose d’un débiteur auquel il peut réclamer le paiement de la somme qu’il prétend avoir perdue par la faute dudit avocat, la question se pose de savoir si le préjudice invoqué par le client peut être considéré comme un préjudice certain.
Dans cette hypothèse, le client dispose de plusieurs moyens de droit pour faire valoir ses droits : une action en responsabilité civile contre l’avocat et une autre action qui peut être de nature très variable contre un autre débiteur en vue d’être rétablie dans ses droits. Tant que cette dernière voie de droit n’a pas été exercée, est-il légitime d’ouvrir à la victime une action en responsabilité contre le professionnel fautif ? Le préjudice invoqué est-il certain vis-à-vis de l’avocat ? On peut hésiter parce que tant que l’autre voie n’a pas été épuisée, il subsiste un moyen d’éviter que la réparation du préjudice soit mise à la charge de l’avocat.
La jurisprudence relative à cette question n’est pas facile à cerner dans la mesure où elle repose sur une notion qui ne manque pas d’équivoque, celle de « situation dommageable » (B). On ne peut d’ailleurs, à propos de cette jurisprudence, évoquer la responsabilité des avocats sans tenir compte des solutions admises dans le domaine voisin de la responsabilité notariale (A).
- L’exemple de la créance de restitution dans le domaine de la responsabilité notariale
Lorsqu’on évoque la question de la subsidiarité de l’action en responsabilité civile des professionnels du droit, on ne peut que penser, en premier, à la jurisprudence relative à la créance de restitution à laquelle un vendeur peut-être condamné à la suite de l’annulation d’une vente en matière de responsabilité notariale. La Cour de cassation décide depuis 1997 que cette créance ne constitue pas pour l’acquéreur un préjudice indemnisable pouvant être mis à la charge du notaire dont la responsabilité est retenue en relation avec cette annulation [3], sauf si cette restitution s’avère impossible ou définitivement compromise, par exemple, du fait de l'insolvabilité du vendeur, de sorte que les acquéreurs, privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient ainsi d'une perte subie équivalente au prix de la vente annulée [4].
Il n’est pas inutile de relever que la jurisprudence applique cette règle non seulement aux restitutions susceptibles de résulter de l'annulation d'un contrat, mais également à celles susceptibles de résulter d'un partage erroné de succession [5] ou de l'anéantissement d'un contrat de prêt [6].
Il ne s’agit d’ailleurs pas du seul cas où la jurisprudence admet, sous couvert de l’incertitude du dommage, une forme de subsidiarité lorsque le client dispose d’un débiteur auquel il peut réclamer le paiement de la somme qu’il prétend avoir perdue par la faute du notaire [7].
En réalité, s’agissant des notaires, la jurisprudence a eu l’occasion d’admettre dans certains cas, sous couvert de l’incertitude du dommage, une certaine subsidiarité de la responsabilité de ces derniers et de statuer, dans d’autres cas, en sens contraire. La Cour de cassation a ainsi retenu qu’aucun préjudice certain ne peut être invoqué lorsqu’un notaire ayant prêté son concours à la vente d’un fonds de commerce a distribué le prix de cession sans tenir compte de l’inscription d’un nantissement dès lors que le bénéficiaire de ce nantissement disposait d'autres sûretés personnelles et réelles garantissant le paiement de sa créance [8]. La même solution a été adoptée à propos d’un notaire qui, ayant prêté son concours à la vente d’un immeuble faisant l’objet d’une hypothèque, a remis le prix de la cession au vendeur, dès lors que le créancier hypothécaire pouvait obtenir la reconnaissance de sa créance en exerçant son droit de suite contre l'acquéreur de l'immeuble [9]. De même, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, pour refuser de retenir la responsabilité d’un notaire, avait considéré que le manquement par ce dernier à son obligation d’information n’avait pas entraîné pour lui une perte de chance d’obtenir d’autres sûretés en garantie du prêt qui, de surcroit, avait été conclu antérieurement à l’établissement de la reconnaissance de dette par le notaire [10]. En sens contraire, la Cour de cassation a décidé que la victime ne peut se voir imposer, à la suite de la faute commise, « l’exercice de voies de droit autres que celles qui avaient pu être initialement prévues » [11] ou l'épuisement des voies de droit dont elle pouvait disposer pour le recouvrement de sa créance [12].
Cette jurisprudence, qui repose sur une casuistique déroutante, est désormais concurrencée par une construction jurisprudentielle qui, rejetant en principe la subsidiarité des actions en responsabilité dirigées contre les professionnels de droit, repose en réalité sur une articulation entre cette subsidiarité et la notion de « situation dommageable ».
- Articulation de la subsidiarité avec la notion de « situation dommageable »
Depuis une vingtaine d’année, on a pu remarquer que la première chambre civile de la Cour de cassation, rejointe par la troisième chambre, opère une distinction entre la situation dans laquelle la voie de droit dont dispose le client est la conséquence de la « situation dommageable » résultant de la faute du professionnel de droit et celle dans laquelle la voie de droit existerait dès l’origine. Pour la Cour de cassation, le dommage serait certain dans le premier cas[13] et ne le serait pas dans le second [14].
Cette distinction a, semble-t-il, été mise en lumière par le doyen Aubert [15]. Elle oppose, s’agissant des voies de droit offertes à la victime, celles qui sont préexistantes à la faute du professionnel du droit et celles qui sont consécutives à la faute de ce professionnel. Ce n’est qu’en cas de « concours » avec des voies de droit du second type que la victime est fondée à agir immédiatement contre le professionnel fautif. Dans l’autre cas, elle doit au contraire exercer préalablement les voies de droit préexistantes, ce qui confère alors à la responsabilité du professionnel un caractère subsidiaire.
Plusieurs arrêts qui s’insèrent dans ce courant jurisprudentiel ont été rendus récemment à propos des avocats, notamment un arrêt du 19 décembre 2013 et un autre du 22 septembre 2016. Ces arrêts ont attiré l’attention par la formule choc qu’ils comportent selon laquelle la responsabilité des professionnels de droit n’est pas subsidiaire. Mais, une lecture attentive de ces arrêts révèle qu’ils font référence à la notion de « situation dommageable ».
Dans l’arrêt du 19 décembre 2013, pour débouter le client d’un avocat de ses demandes tendant à l’indemniser de la perte de chance de recouvrer sa créance consacrée par un jugement réputé contradictoire obtenu à l’encontre d’un débiteur, en raison notamment du défaut de notification de ce jugement, une cour d’appel avait retenu que le client disposait d’une action non prescrite à l’encontre de son débiteur, dont il n’établissait pas l’insolvabilité. En d’autres termes, selon la cour d’appel, le préjudice invoqué par le client n’était pas certain en raison de l’existence d’un débiteur, autre que l’avocat, susceptible d’être poursuivi. Cette argumentation a été censurée par la Cour de cassation. Pour cette dernière, le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit est certain, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la « situation dommageable » née de la faute de ce professionnel et propre à assurer la réparation du préjudice. Comme le préjudice invoqué en l’espèce était une perte de chance, la Cour de cassation a pris soin d’ajouter que l’action que le client était susceptible d’exercer contre son débiteur pour être rétabli dans son droit « n’était pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain ». [16]
Dans l’arrêt rendu le 22 septembre 2016, l’avocat d’une compagnie d’assurance (Aviva) n’avait pas invoqué en première instance le plafond de garantie figurant dans le contrat d’assurance liant celle-ci à un sous-traitant poursuivi en responsabilité à la suite d’un incendie avec l’entrepreneur principal. Aviva avait alors été condamnée à régler à Axa, assureur de l’entrepreneur principal, une somme supérieure à son plafond de garantie. En dépit du fait que la décision n’était pas assortie de l’exécution provisoire, Aviva avait réglé à Axa l’intégralité des sommes, sous réserve de l’issue de son appel. Devant la cour d’appel Aviva, assistée d’un nouveau conseil, avait obtenu la limitation de sa condamnation au plafond de sa garantie et, de plus, la condamnation de Axa au remboursement de l’excédent de ce plafond. L’arrêt d’appel avait néanmoins été censuré par la Cour de cassation et la cour de renvoi avait déclaré Aviva irrecevable en sa demande de prise en compte de son plafond. C’est dans ses conditions qu’Aviva, attribuant la cause de ses déboires à son premier avocat, a introduit à son encontre une action en responsabilité. Ce dernier s’est défendu en soulignant qu’Aviva, en réglant de sa propre initiative, en dépit du fait que jugement rendu à son encontre n’était pas assorti de l’exécution provisoire, était tout aussi responsable que lui. Retenant partiellement son argumentation, la cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 28 avril 2015, a octroyé à Aviva une somme forfaitaire en guise de réparation. Cet dernier arrêt qui a été censuré par la Cour de cassation, laquelle après avoir visé l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L0866KZ4) (dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK) énonce qu’il résulte de ce texte « que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un avocat n’est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu’est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice » [17].
Dans la période séparant ces deux arrêts, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts en matière de responsabilité notariale s’inspirant des mêmes principes [18].
Il est reproché à cette distinction entre la situation dans laquelle la voie de droit dont dispose le client est la conséquence de la « situation dommageable » résultant de la faute du professionnel de droit et celle dans laquelle la voie de droit existerait dès l’origine d’être trop subtile [19].
A cela, il convient surtout d’ajouter que l’affirmation selon laquelle la responsabilité des professionnels de droit n’est, de manière générale, pas subsidiaire ne semble pas tenir compte de la jurisprudence développée en matière de responsabilité notariale relative aux restitutions. Si certains auteurs ont émis, dès 2005, le vœu que la Cour de cassation apporte une clarification à sa position dans ce domaine [20], les arrêts susmentionnés rendus récemment sont loin d’en fournir une.
Ce sentiment de confusion se retrouve également à propos de la réparation du préjudice de perte de chance.
- La certitude du préjudice et la perte de chance
La question du caractère subsidiaire de l’action en responsabilité dirigée contre un professionnel du droit ne se pose généralement que lorsque le préjudice est actuel et que sa survenance ne fait pas de doute. La certitude de ce dernier n’est pas susceptible de degrés mais est envisagée de manière globale. Soit, il ne peut être réparé que par le biais de la mise en cause de la responsabilité du professionnel, soit, une autre voie de droit est de nature à permettre l’évitement de cette action.
Tel n’est pas le cas lorsque le préjudice de perte de chance est invoqué. Dans cette hypothèse, la certitude du préjudice est, en soi, en cause.
Si le domaine d’élection de la perte de chance est celui de la responsabilité des avocats, c’est que l’activité de ces derniers repose, dans une large mesure, comme il a déjà été indiqué, sur une part d’aléa, compte-tenu de l’incertitude qui entoure les règles de droit, de plus en plus difficiles à saisir [21], et du pouvoir souverain d’appréciation des faits qui appartient aux juges du fond. Cet aléa est d’ailleurs reconnu par la Cour de cassation elle-même pour justifier la réparation de la perte de chance [22].
En d’autres termes, compte tenu de l’aléa qui affecte l’activité de l’avocat, il n’est souvent pas sûr que, si l’avocat avait agi autrement, le client aurait été dans une situation différente de celle dans laquelle il se trouve. La seule certitude est que la faute de l’avocat est venue s’immiscer dans un processus de réalisation des chances et peut ainsi être rattachée, non pas à ce qui a été perdu mais, en amont, à ce qu’il était possible d’espérer ne pas perdre. La perte de chance permet, en somme, que soit prise en compte la simple probabilité perdue par la victime de voir se réaliser un évènement favorable.
Appliquée à la perte d’une chance, l’exigence de certitude du préjudice mérite d’être abordée sous deux angles différents : celui de la chance susceptible d’être perdue (A) et celui de l’intensité que devrait revêtir cette chance (B).
- La chance susceptible d’être perdue
L’identification du préjudice de perte de chance et sa réparation reposent sur la reconstitution de la situation qui serait probablement advenue si le fait générateur de responsabilité n’avait pas perturbé le cours normal des choses. Or, des chances aussi nombreuses que diversifiées peuvent être invoquées à l’occasion de la construction de ce scénario contrefactuel [23].
Selon une formule utilisée par la Cour de cassation et largement répétée, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable [24]. Au-delà de l’ambiguïté dont souffre cette formule [25], elle signifie clairement qu’aucune réparation ne peut être allouée en l’absence d’une chance concrète de voir se réaliser l’événement escompté.
Les exemples de perte de chance qui ont été admis par la jurisprudence sont nombreux. Il en est ainsi de la perte de chance d'éviter le renouvellement d'un bail aux conditions de loyer antérieures au moyen d'une procédure en fixation judiciaire du loyer [26], de la perte de chance de voir une procédure, interrompue par un désistement prématuré, se poursuivre [27], de la perte de chance d’obtenir le règlement de sa créance [28], de la perte de chance d'obtenir gain de cause ou d'éviter une condamnation [29] et, surtout, de la perte de chance offerte par les voies de recours ou les voies de droit de manière générale, telle que la perte de chance d'obtenir la réformation d’un jugement [30] ou d'avoir gain de cause devant la Cour de cassation [31].
L’existence d’une chance susceptible d’être perdue ne peut être appréciée qu’in concreto selon une approche au cas par cas. Il appartient ainsi aux juges du fond lorsque le préjudice allégué relève d’une procédure judiciaire de rechercher qu'elles étaient les chances d'une réformation d'un jugement [32] ou les chances du succès de l'action que l'avocat était chargé d'engager [33] ou la probabilité du succès d'un pourvoi [34] en procédant, comme le souligne la Cour de cassation, à la reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer entre les parties et de tenir compte du moment auquel les indemnités auraient pu être payées [35]. Dans l’appréciation de la perte de chance de l’obtention d’une décision plus favorable, les juges de fond ne doivent pas tenir compte des perspectives de recouvrement [36]. En outre, si cette reconstitution fait intervenir des facteurs juridiques, l'appréciation qui en est faite par les juges du fond est contrôlée par la Cour de cassation [37].
Le processus devrait être identique lorsque le préjudice allégué résulte d’une information non-délivré ou d’un conseil erroné. Perdre la chance d’agir différemment parce qu’une information n’a pas été donnée ou un conseil délivré n’est pas en soi un préjudice. Ce qui est préjudiciable, c’est d’avoir été empêché d’opter en faveur d’une solution qui aurait permis de réaliser un gain ou d’éviter un dommage. Aussi, pour vérifier l’existence d’un préjudice, convient-il non seulement d’établir la perte d’une chance d’agir différemment mais encore l’avantage qu’aurait retiré le créancier à entreprendre cette action alternative.
Pour caractériser la chance ainsi prise en considération, on souligne fréquemment que celle-ci doit être réelle et sérieuse. En réalité le caractère « sérieux » de la perte de chance manque de précision et ne suffit pas pour servir de critère de sélection dans la mesure où ce critère ne peut résider que dans l’aléa sous-tendant la chance [38]. De plus, le caractère « sérieux » souvent attribué à la chance semble beaucoup plus se rapporter à son intensité qu’à son existence.
- L’intensité de la chance perdue
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette dernière si elle s'était réalisée. Pour évaluer cette chance les juges du fond doivent donc préalablement déterminer la probabilité de sa réalisation, puis indemniser la victime en proportion [39]. Il est donc nécessaire de déterminer à partir de quel seuil une chance mérite d’être protégée.
Sur ce terrain, la jurisprudence offre un tableau contrasté, difficile à cerner. Si on a pu relever, au cours des dernières années des hypothèses où la Cour de cassation a admis l’indemnisation de la perte d’une chance purement hypothétique ou nulle [40], ce sont surtout plusieurs arrêts rendus à partir de 2013 qui sont venus ajouter de la confusion à une matière déjà très embrouillée.
Dans l’affaire qui a conduit à l’arrêt rendu le 16 janvier 2013, les fautes commises par l’avocat n’étaient pas contestées. Il s’était abstenu de régulariser un appel contre un jugement rendu par un tribunal de commerce à l’encontre de ses anciens clients, après avoir omis de se présenter, pour leur compte, à l’audience devant ce tribunal. Ces derniers soutenaient, entre autres arguments, que ledit avocat, en négligeant de suivre leurs instructions, leur avait fait perdre la chance d’obtenir la réformation du jugement. Pour rejeter cet argument, la cour d’appel de Paris, qui a commencé par rappeler que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée », a toutefois conclut, après avoir analysé les arguments invoqués devant elle, que « la perte de chance alléguée apparaît faible ». Saisi d’un pourvoi, la Cour de cassation a sèchement censuré les motifs développés par la cour d’appel au motif qu’ils sont « impropres à démontrer l’absence de toute probabilité de succès de l’appel manqué » car « la perte certaine d’une chance même faible, est indemnisable » [41].
Les réactions suscitées par cet arrêt ont été vives. Certains auteurs ont relevé que la prise en compte d’une chance faible serait de nature à mettre en cause le caractère sérieux et partant certain de la perte de chance. Pour ces auteurs, à défaut de chance réelle et sérieuse, l’éventualité favorable relèverait d’un simple espoir, de sorte que le préjudice résultant de sa disparition serait trop hypothétique pour être réparé.
En 2014, dans deux arrêts qui ne concernaient pas la responsabilité des avocats (le premier était relatif à un salarié accidenté qui avait été licencié par son employeur et le second un notaire), la Cour de cassation avait semblé faire un pas en arrière. Dans les deux affaires, les pourvois formés contre les arrêts d’appel ont été rejetés par la première chambre civile qui a utilisé la même formule selon laquelle, d’après les faits relevés, les juges pouvaient estimer que les victimes ne justifiaient pas « d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable » [42].
Au vu de ces arrêts, certains auteurs avaient considéré qu’une jurisprudence était en voie de formation autour de la notion de raisonnable [43]. Pour ces auteurs, l’indemnisation débridée de la perte de chance serait une incitation au procès et la chance « raisonnable » devrait alors s’entendre non seulement d’une chance qui existe mais encore d’une chance présentant une certaine importance quantitative.
Néanmoins, le fait d’exiger que la chance perdue soit « raisonnable » pour être prise en compte ne suffit pas à fixer le seuil à partir duquel une chance mérite d’être protégée. On comprend ainsi que d’autres auteurs aient émis des doutes sur le fait que l’exigence du caractère « raisonnable » de la chance perdue soit de nature à dissuader les plaideurs d’agir en responsabilité. À cela s’ajoute le fait que toute restriction dans l’indemnisation de la perte de chance crée une certaine immunité difficilement explicable au profit du responsable. Ces derniers auteurs ont ainsi relevé que la voie dans laquelle semblait s’engager la première chambre civile était une voie étroite, dont le seul bénéfice était de dispenser les juges du fond d’avoir à distinguer une chance faible d’une chance inexistante.
Dans un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a maintenu sa référence au caractère raisonnable de la perte de chance. S’agissant d’une action en responsabilité civile contre un avocat, la Cour de cassation a énoncé, que la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée par son client que si ce dernier justifie « d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès de ses prétentions » [44].
Le recours au critère du raisonnable fut toutefois de courte durée et, dans un arrêt du 12 octobre 2016, la cour de cassation a jugé que « toute perte de chance ouvre droit à réparation » [45].
Ensuite, dans un arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de cassation a réitéré sa position [46]. Dans l’affaire ayant conduit à cet arrêt, une dame prétendant être créancière de la liquidation judiciaire d’une autre personne avait mandaté un avocat aux fins de déclarer sa créance. La créance n’avait toutefois pas été déclarée, faute pour ledit avocat d’avoir produit au juge-commissaire les pièces demandées par ce dernier. En définitive, après avoir confié son dossier à un autre avocat, la créancière avait obtenu l’admission de la créance en cause d’appel. Estimant que le premier avocat avait manqué à ses obligations, la créancière lui a alors réclamé non seulement les honoraires versés inutilement, mais également tous les frais supplémentaires, pour arriver à faire admettre sa créance. De plus, elle a soutenu que si la créance avait été admise plus tôt, elle aurait eu des chances de se faire désigner contrôleur à la procédure de liquidation et d’empêcher ainsi le juge-commissaire de signer avec la bailleresse de la personne déclarée en liquidation une transaction qui, selon elle, avait affecté ses espoirs d’être réglée de la totalité de sa créance. Saisie du dossier, la cour d’appel de Paris avait estimé que la perte de chance invoquée ne reposait que sur une succession d’événements incertains, voire hypothétiques de sorte qu’elle s’avérait dépourvue de tout caractère sérieux. Saisie d’un pourvoir, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel au motif que « toute perte de chance ouvre droit à réparation ».
Dans les deux arrêts rendus en 2016, la Cour de cassation a donc non seulement écarté le critère du « raisonnable » qu’elle avait utilisé en 2014 et 2015, mais est allée bien plus loin que l’arrêt du 16 janvier 2013 dans lequel elle avait affirmé que « la perte certaine d’une chance, même faible, était indemnisable ». Au vu des deux arrêts rendus en 2016, la faiblesse ou la robustesse de la chance ne sont plus exigées. Seule compte son existence.
Il convient de remarquer que dans un arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a réitéré cette dernière solution à l’occasion d’une action introduite par un assuré contre son assureur [47].
Que signifie cette salve d’arrêts qui semble adopter des solutions différentes. La Cour de cassation a-t-elle vraiment changé plusieurs fois de cap ? Envoie-t-elle des messages subliminaux aux assureurs en les rappelant à l’ordre ? S’agit-il d’une querelle de mots ? Toutes les hypothèses sont envisageables et peuvent être défendues. La conclusion qui en découle, en somme, est que l’incertitude qui affecte souvent les règles juridiques et qui offre de plus en plus d’occasions pour retenir la responsabilité des avocats [48] ne concerne pas uniquement celles que ces derniers doivent maîtriser pour faire preuve à l’égard de leurs clients de compétence et de diligence, mais également celles relatives à l’appréciation des préjudices qu’ils sont susceptibles d’être appelés à réparer.
[1] Certains auteurs considèrent d’ailleurs que c’est « le seul caractère essentiel » du préjudice, P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats ; Régimes d’indemnisation, 11 éd. Dalloz, 2018/2019, n° 2123.61.
[2] CE 6° et 1° s-s-r., 11 décembre 2015, n° 384242, mentionné aux tables du recueil Lebon, (N° Lexbase : A2058NZA). V. également, Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-50056, F-P+B (N° Lexbase : A8787YY4).
[3] Cass. civ. 1, 25 novembre 1997, n° 96-10207 (N° Lexbase : A0989ACM), Bull. civ. I, n° 330 ; Cass. civ. 1, 13 octobre 1999, n° 97-14295 (N° Lexbase : A7225CSE) ; Cass. civ. 1, 1er juin 1999, n° 97-14063 (N° Lexbase : A6675CEX), Bull. civ. I, n° 184, RTD civ., 2000, p. 121, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 1, 10 mai 2005, n° 03-12496 (N° Lexbase : A2249DI7), Bull. civ. I, n° 203, JCP G, 2006, I, 111, n° 1, obs. P. Stoffel-Munck ; Cass. civ. 3, 8 avril 2009, n° 07-19690 (N° Lexbase : A4969EG7), D., 2009, AJ p. 1356, obs. G. Forest ; Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-14417, F-D (N° Lexbase : A7299EI8) ; Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 10-26790, F-D (N° Lexbase : A1242IIT) ; Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-14495, F-D (N° Lexbase : A7068ILD) ; Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 12-28615, F-P+B (N° Lexbase : A2611MTU) ; Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-11441, FS-P+B (N° Lexbase : A0754RQY) ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-24170, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3672W77) ; Cass. civ. 3, 3 mai 2018, n° 17-11132, FS-P+B (N° Lexbase : A4287XMQ) ; Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 17-13422, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3213XRG).
[4] Cass. civ. 1, 18 juin 2002, n° 99-17122 (N° Lexbase : A9475AYL), Bull. civ. I, n° 168 ; Cass. civ. 1, 10 juillet 2002, n° 01-10501 (N° Lexbase : A1384AZB) ; Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 01-16382, F-P+B (N° Lexbase : A8397DDD), Bull. civ. I, n° 259, JCP G 2005, I, 114., obs. P. Grosser ; Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 07-14545 et 07-17516, FS-P+B (N° Lexbase : A5155EBK) ; Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-14792 et 08-15429, FS-D (N° Lexbase : A3002EIZ) ; Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-66282, F-P+B (N° Lexbase : A1684EUW) ; Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 10-23442, F-D (N° Lexbase : A1054IIU) ; Cass. civ. 3, 18 février 2016, n° 15-12719, FS-P+B (N° Lexbase : A4691PZR).
[5] Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 07-20774, F-P+B (N° Lexbase : A5127EEM). La Cour de cassation a pris dans cet arrêt soin de relever que le notaire pouvait seulement être condamné à garantir la restitution à la mesure de l'insolvabilité des personnes condamnées à y procéder. Dans le même sens, Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 09-12481, F-D (N° Lexbase : A0744EXT).
[6] Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 12-28615 et 13-17280 (N° Lexbase : A2611MTU).
[7] Cass. civ. 1, 2 avril 1997, n° 94-20352 (N° Lexbase : A0097ACL), Bull. civ. I, n° 116 ; Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 98-13432 (N° Lexbase : A7751AHK), Bull. civ. I, n° 277; Cass. civ. 3, 10 octobre 2012, n° 11-17627, FS-D (N° Lexbase : A3484IUL).
[8] Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-14032, F-D (N° Lexbase : A5813ELU).
[9] Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 02-11288, FS-P (N° Lexbase : A4615DDB), Bull. civ. I, n° 213, RTD civ., 2005, p. 401, obs. P. Jourdain; Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-16891, F-P+B (N° Lexbase : A8818I84), RTD civ., 2013, 609, obs. P. Jourdain.
[10] Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 07-12665, F-D (N° Lexbase : A6123D7W).
[11] Cass. civ. 1, 19 décembre 2000, n° 98-14105 (N° Lexbase : A2141CI7), Bull. civ., I, n° 333.
[12] Cass. civ. 1, 26 octobre 2004, n° 02-20471, F-D (N° Lexbase : A6684DDW).
[13] Cass. civ 1. 19 décembre 2000, n° 98-14105 (N° Lexbase : A2141CI7), Bull. civ., I, n° 333, D. 2001, p. 3482, note I. Ardeeff, RTD civ., 2001, p. 370, obs. P. Jourdain, Defrénois 2001, 258, obs. J.-L. Aubert ; Cass. civ. 1, 2 octobre 2002, n° 99-14656, F-P+B (N° Lexbase : A9145AZQ), Bull. civ., I, n° 226, RTD civ. 2003, p. 97, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 1, 7 mai 2002, n° 99-14675, FS-P (N° Lexbase : A6196AY7), Bull. civ. I, n° 121 ; Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-16288 et 14-20683, F-D (N° Lexbase : A9292NGA), AJDI, 2015, p. 857, obs. J.-P. Borel ; Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25883, F-D (N° Lexbase : A1990NZQ). Dans cet arrêt la Cour de cassation a souligné que « l’existence de voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n’est pas de nature à priver de son caractère actuel et certain le préjudice né de la faute (…) du notaire, lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par celui-ci ». V. également, Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, n° 13-11807, F-P+B+I (N° Lexbase : A7375KSX), LPA, mars 2014, p. 17, note A.-L. Fabas-Serlooten ; Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 13-26181, F-D (N° Lexbase : A2919M8M). Dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation a souligné qu’est « certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute ».
[14] Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-16891, F-P+B (N° Lexbase : A8818I84) ; Cass. civ. 3, 17 décembre 2014, n° 13-20.515, FS-D (N° Lexbase : A2721M8B) ; Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-16891, F-P+B (N° Lexbase : A8818I84), RTD civ., 2013, p. 609, note P. Jourdain. Dans ce dernier arrêt, rendu en matière de responsabilité notariale, la Cour de cassation a décidé que si la victime dispose d’un recours qui n’est pas « une voie de droit qui ne serait que la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute du notaire », elle doit préalablement l’exercer, faute de quoi son préjudice ne serait pas certain.
[15] Parmi les nombreuses observations de l’auteur relatives à cette question, v. spéc. J.-L. Aubert, obs. sous Cass. civ. 1, 19 décembre 2000, Defrénois 2004, p. 1738.
[16] Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, n° 13-11.807, F-P+B+I (N° Lexbase : A7375KSX), D. 2014, p. 256, note Yves Avril.
[17] Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-20565, FS-P+B (N° Lexbase : A0127R4H).
[18] Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I (N° Lexbase : A7765NXU) ; Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 15-11115, F-D (N° Lexbase : A0753NYK) et Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25854, F-D (N° Lexbase : A1877NZK).
[19] P. Jourdain, note sous Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-16891, RTD civ., 2005, p. 400. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 4ème éd., 2013, n° 287-1.
[20] P. Jourdain, obs. RTD civ., 2005, 400.
[21] H. Slim, La responsabilité professionnelle des avocats à l’épreuve des incertitudes du droit, Rev. Lamy dr. civ., 2013, n° 5116 ; H. Slim, Les professionnels du droit et le devoir d’anticipation, Rev. Lamy dr. civ., 2018, n° 6421.
[22] Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-69191, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3358GLX).
[23] L. Vitale, La perte de chances en droit privé, L.G.D.J., 2020, n° 388.
[24] Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-15674, F-P+B (N° Lexbase : A5286DSL), à propos de la perte de chance d’obtenir une cassation.
[25] J.-S. Borghetti, La perte d’une chance au carré, ou la perte d’une chance certaine, note sous Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-69195, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7906GBG), RDC, 2011, p. 77.
[26] Cass. civ. 1, 18 juin 1996, n° 94-12646 (N° Lexbase : A4804CWT).
[27] Cass. civ. 1, 2 février 1994, n° 92-12467 (N° Lexbase : A6157AHI).
[28] Cass. civ. 1, 16 septembre 2010, n° 09-65909, FS-P+B (N° Lexbase : A5866E97), Bull. civ. I, n° 172.
[29] Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 05-15139 (N° Lexbase : A4158DYN), Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-30086, F-P+B (N° Lexbase : A9379N3R).
[30] Cass. civ. 1, 2 février 1994, n° 92-12467 (N° Lexbase : A6157AHI).
[31] Cass. soc., 14 février 2001, n° 99-12620 (N° Lexbase : A3481ARD) ; Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-15674, F-P+B (N° Lexbase : A5286DSL) ; Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 04-19774, FS-P+B (N° Lexbase : A7068DZS).
[32] Cass. civ. 2, 15 janvier 1997, n° 95-13481 (N° Lexbase : A2254AZI) ; Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-12848, F-P+B (N° Lexbase : A5253EEB).
[33] Cass. civ. 1, 2 avril 1997, n° 95-11287 (N° Lexbase : A0306ACC).
[34] Cass. civ. 1, 8 juillet 1997, n° 95-14067 (N° Lexbase : A0446ACI) ; CE, 3/8 SSR, 2 octobre 2006, n° 270103 (N° Lexbase : A6875DR3), Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-24554, F-P+B+I (N° Lexbase : A6115HY7), JCP G, 2011, n° 1380, p. 2463, note N. Gerbay ; Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-50058, F-D (N° Lexbase : A8595NHS).
[35] Cass. civ. 1, 4 avril 2001, n° 98-11364 (N° Lexbase : A2125ATU), RCA 2001, comm. 296, note P. Vaillie ; Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-12848, F-P+B (N° Lexbase : A5253EEB) ; Cass. civ. 1,, 1er juin 2016, n° 15-20397, F-D (N° Lexbase : A8740RR7) ; Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 15-24061, F-D (N° Lexbase : A2782UCZ).
[36] Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-69191, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3358GLX).
[37] Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-13.235, F-P+B ([LXB=A9097DCW) ; Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-17778, FS-P+B (N° Lexbase : A5045EGX), rendu en matière fiscale
[38] L. Vitale, thèse préc. n° 391.
[39] Cass. civ. 1, 9 mai 2001 ; Cass. civ. 1, 4 avril 2001, n° 98-11364 (N° Lexbase : A2125ATU) préc.
[40] Par ex. Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-14879, F-D (N° Lexbase : A5931MR4) ; Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26809, F-D (N° Lexbase : A8659IXY) ; Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-23974, F-D (N° Lexbase : A7124IUE). V. Cependant Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-18323, F-D (N° Lexbase : A1525RCH) (rejet de la réparation d’une chance nulle) ; Ass. Plén. 3 juin 1988, n° 87-12433 (N° Lexbase : A8911CER) (rejet de l’action en responsabilité dirigée contre un avocat au Conseil qui n’avait pas présenté un moyen de cassation au motif que ce dernier « ne présentait aucune chance de succès ») ; Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 06-14836, FS-D (N° Lexbase : A4367D8A) (Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel qui retient que « la chance perdue apparaissait très faible », ne caractérise pas « une chance sérieuse »). Le conseil d’Etat semble plus strict que la Cour de cassation dans ce domaine puisqu’il continue d’évoquer la perte d’une « chance sérieuse » (CE, 28 juillet 2017, n° 402053 N° Lexbase : A0685WQG).
[41] Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14439, F-P+B+I (N° Lexbase : A4084I3N), JCP G 2013, p. 98, obs. H. Slim, et p. 619, note M. Bacache ; Gaz. Pal., avril 2013, p. 14, note A. Guégan-Lécuyer ; Gaz. Pal., juin 2013, n° 157, p. 19, obs. M. Mekki ; LPA, mars 2013, p. 9, note A. Bascoulergue ; JCP G 2013 p. 1291, n° 1, obs. P. Stoffel-Munck ; RCA 2013, comm. 108, obs. F. Leduc ; D. 2014, p. 47, obs. P. Brun. Un arrêt plus ancien, mais moins clair, peut également être cité : Cass. civ. 1, 8 juillet 1997, n° 95-14067 (N° Lexbase : A0446ACI).
[42] Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-16380, F-P+B+I (N° Lexbase : A6870MKN) et n° 12-22567, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6831MK9).
[43] O. Deshayes, obs. sous Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 12-22567, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6831MK9) et Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-16380 (N° Lexbase : A6870MKN), RDC, 2014, p. 610., p. 610
[44] Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-25109, F-P+B (N° Lexbase : A0822NY4).
[45] Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-23230, F-P+B (N° Lexbase : A9746R74), D., 2017, p. 46, note J. Traullé, RDC, 2017, obs. J.S. Borghetti.
[46] Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 16-12686, F-P+B (N° Lexbase : A2314SXY).
[47] Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-25.440, FS-P+B+I (N° Lexbase : A06243M3) : « en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel, qui a exigé de l'assuré qu'il démontre que s'il avait été parfaitement informé par la banque sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
[48] H. Slim, La responsabilité professionnelle des avocats à l’épreuve des incertitudes du droit, Rev. Lamy dr. civ., 2013, n° 5116.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476047
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Le bénéficiaire des obligations de l’avocat (vidéo)
Lecture: 1 min
N6283BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maître Jean de Salve de Bruneton, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Le 03 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
L'intervention en vidéo de Maître Jean de Salve de Bruneton est à retrouver en intégralité sur la WebTV de l'Université de Picardie Jules Verne.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476283
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - La faute civile de l'avocat
Lecture: 22 min
N6016BYH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par François Viney, Maître de conférences à l’université d’Amiens
Le 04 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
Le contexte de l’engagement de la responsabilité civile de l’avocat est généralement banal. Un avocat commet une négligence dans l’exercice des missions que lui a confiées son client : par exemple, en laissant courir un délai de procédure. L’affaire, qui aurait pu être gagnée, est perdue. Par sa faute, il cause préjudice à ce dernier – la perte de chance de gagner le procès – ; parfois, il cause préjudice à des tiers.
L’engagement de la responsabilité civile de l’avocat n’est pourtant pas une démarche systématique pour le client déçu, notamment lorsqu’il s’agit d’un particulier. Plusieurs explications sont données à cela [1]. Tout d’abord, le justiciable, souvent profane des questions juridiques, ne se figurera pas que son avocat a pu commettre une faute. L’ayant choisi et lui ayant accordé sa confiance, il aura souvent du mal à admettre sa propre erreur et n’attaquera pas son avocat. Enfin, même s’il est conscient des négligences du professionnel, il ne tentera souvent rien, pensant agir à peine perdue, s’imaginant parfois une indulgence mutuelle entre les gens de justice. Il arrive que certains professionnels se montrent particulièrement convaincants et dissuadent le client d’agir à leur encontre.
Paradoxalement, on peut relever que la mise en cause de la responsabilité civile de l’avocat est assez simple. Les conditions de la responsabilité civile de l’avocat ne diffèrent guère de celles requises par le droit commun de la responsabilité. Par ailleurs, la profession d’avocat s’est dotée d’assurances – assurance responsabilité civile professionnelle et de représentation des fonds – rendues obligatoire par le législateur en 1971, qui protègent les clients des incuries ou même de l’éventuelle malveillance de leur avocat [2]. La faute de l’avocat est donc très généralement couverte, sauf lorsque celle-ci revêt – rarement – un caractère intentionnel [3], ce qui entraine une exclusion de garantie par l’assurance de responsabilité civile professionnelle [4].
L’engagement de la responsabilité civile n’implique pas nécessairement d’opérer une réclamation par voie judiciaire en assignant le professionnel. Dans une démarche amiable, il suffit au client d’écrire à son avocat en le mettant en cause, en expliquant que celui-ci a failli à ses missions, a commis une faute lui ayant causé préjudice. L’avocat déclare le sinistre auprès du Bâtonnier et de l’assurance de son ordre, qui prend en charge le dossier. En cas de faute avérée après instruction, l’assurance proposera au client une indemnisation de son préjudice (au moyen de protocoles généralement soumis aux art. 2044 et s. du Code civil N° Lexbase : L2431LBN). En tout état de cause, si une contestation naît, ou si le client refuse la proposition amiable, les tribunaux peuvent être saisis de l’affaire [5].
Tout ceci concourt à expliquer l’essor de la responsabilité civile de l’avocat. Toutefois, le recours à l’assurance n’est pas sans répercussions sur la responsabilité civile à laquelle elle est adossée. Le phénomène a été décrit dès la fin du XIXème siècle, lorsque la Cour de cassation a admis la licéité du contrat d’assurance de responsabilité civile [6]. La faute se trouve ici au cœur des enjeux. On peut, d’un côté, se demander ce qui empêche réellement les magistrats de retenir avec largesse des « poussières de faute » afin de satisfaire aux demandes des victimes [7], surtout si l’admission de la responsabilité ne constitue plus une charge lourde pour les professionnels, tenus d’acquitter la seule franchise [8]. On peut d’un autre côté, s’interroger sur les effets déresponsabilisants pour les professionnels assurés d’une telle tendance, une importante sinistralité étant de surcroit nuisible à l’indemnisation ; ce qui invite à une plus grande rigueur dans la caractérisation de celle-ci.
Poser quelques balises permettant de circonscrire la faute sur le plan civil représente un intérêt fondamental. La faute intentionnelle de l’avocat ne présentant pas de particularité, nous cantonnerons notre étude à la faute commise de bonne foi. Pour donner un aperçu de celle-ci, j’aborderai successivement les caractéristiques de la faute civile de l’avocat (I) puis la méthode d’appréciation de la faute civile de l’avocat (II).
I. Les caractéristiques de la faute civile de l’avocat
Après avoir étudié la question de la nature de la faute (A), j’examinerai la question de la diversité des fautes retenues en jurisprudence (B).
A. Nature de la faute
La nature de la relation envisagée dicte celle de la faute civile. Dans la relation avec son client, la responsabilité de l’avocat est contractuelle, car elle est la conséquence d’une inexécution contractuelle [9]. Analysée comme un mandat ou un contrat d’entreprise, la convention passée entre le professionnel et son client repose sur la confiance ; ces contrats de service (économique pour le contrat d’entreprise ou juridique pour le mandat) étant d’ailleurs un terrain d’élection de l’intuitu personae [10]. La rémunération de l’avocat y est justifiée – au moins en partie – par « la compétence personnelle » ou « la valeur de celui qui rend service » [11].
Le contrat oscille entre mandat et contrat d’entreprise, chacune des qualifications correspondant mieux à différentes missions de l’avocat. La mission de l’avocat simplement consulté s’apparente à celle de l’entrepreneur du contrat d’entreprise, mais il ne faut pas en pour autant déduire que la représentation en justice et les missions judiciaires de l’avocat relèvent parfaitement du régime du mandat. Plus précisément, l’avocat qui accepte de plaider pour son client, lui rend, comme l’écrit M. Sériaux « le service de la parole. Mais il s’agit au fond d’un service économique qui relève du contrat de louage d’ouvrage ou d’industrie, voire du contrat de travail : le client fait l’économie de l’apprentissage de la parole devant le juge et il fait simplement une mauvaise affaire s’il s’aperçoit qu’il aurait pu parler lui-même aussi bien. Lorsque le même avocat, en vue de réaliser certaines formalités nécessaires à la conduite du procès, se fait donner procuration par son client, il s’agit au contraire d’un service proprement juridique » [12]. La responsabilité de l’avocat sera réglée selon les dispositions relatives à ces contrats spéciaux, ou fondée sur le droit commun de la responsabilité, spécifiquement l’article 1231‐1 du Code civil (N° Lexbase : L0613KZQ).
Il est fréquemment relevé en doctrine que le contenu de convention conclue entre l’avocat et son client échappe en grande partie à la liberté contractuelle des parties, la profession d’avocat étant aujourd’hui précisément réglementée [13]. Les obligations résultant de cette réglementation impérative viennent donc enrichir le contenu du contrat de devoirs d’origine « déontologique » [14] ou plus spécifiquement juridiques (par ex., le droit de la consommation s’applique lorsque le client de l’avocat est un particulier [15], RGPD). La greffe de ces obligations, exogènes à la volonté des parties, conduit certains auteurs à proposer un dépassement du clivage entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, d’autant que la distinction est d’un intérêt pratique limité depuis la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), le délai de prescription de l’action n’étant plus impacté par la nature de la responsabilité de l’avocat. La responsabilité de l’avocat est ici un exemple assez topique des responsabilités professionnelles [16]. Cette intuition est renforcée par l’analyse de la responsabilité de l’avocat envers les tiers.
Envers les tiers, la responsabilité de l’avocat est naturellement délictuelle, fondée sur les articles 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) et suivants du Code civil. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’avocat est assigné par un confrère [17], par le créancier de son client [18], par les cautions de son client [19] ou encore la personne qu’il poursuit [20]. On sait qu’en matière délictuelle, les fautes les plus légères peuvent être retenues. Il n’est a priori pas concevable cependant qu’un avocat puisse être tenu plus strictement à l’égard des tiers qu’à l’égard de son client, puisque l’accord génère lui-même des obligations qui, en raison de l’effet relatif des conventions, ne sont dues qu’au bénéfice du client contractant. Ces obligations viennent donc s’« ajouter » aux devoirs de civilité envers autrui sanctionnés par le jeu des articles 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) et 1241 du Code du civil (N° Lexbase : L0949KZ8).
Toutefois, bien que n’étant pas partie au contrat, le tiers, victime d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution, peut tirer argument du contenu de celui-ci pour engager la responsabilité de l’avocat. Depuis l’arrêt rendu en Assemblée plénière par la Cour de cassation le 6 octobre 2006 [21], et confirmé récemment [22], on sait que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un « manquement contractuel », dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La Cour de cassation avait d’ailleurs admis auparavant, qu’un tiers puisse invoquer la faute commise par l’avocat dans l’exécution du mandat le liant à son client [23]. Délictuelle comme contractuelle, la faute civile de l’avocat pourra donc être mesurée à l’aune de la mission spécifiquement confiée à l’avocat.
B. Diversité des fautes
Les fautes retenues sont le reflet des principales missions acceptées par l’avocat. Quantitativement, les manquements sanctionnés le plus souvent en jurisprudence semblent être les erreurs de procédure (principalement le respect des délais pour agir) ; les erreurs lors de la rédaction d’actes et de leurs suites et le manquement au devoir de conseil.
L’avocat est tenu, d’une manière générale, d’un devoir de conseil et d’un devoir de compétence. Le devoir de conseil consiste pour l’avocat à indiquer à son client les procédures à engager, l’informer des risques et de ses réserves au regard de ses prétentions. Le devoir de compétence impose à l’avocat de déployer dans la pratique de son art, toutes ses connaissances techniques et son expérience professionnelle, conformément au droit positif en vigueur – « aux données acquises du droit », comme il est souvent écrit. Il est surtout une traduction « rehaussée » des devoirs de prudence et de diligence qui s’imposent socialement à tout agent, pour les professionnels du droit dans le cadre de l’exercice de leur activité. Ces devoirs de conseil et compétence résultent du déséquilibre de connaissances et d’expérience supposé entre l’avocat et son client (qualités sur la foi desquelles le client est venu le consulter) et aussi par nature de la convention [24] établie entre le professionnel et son client [25].
Cependant, certains devoirs spécifiques dépendent directement du contenu de la mission qu’ont façonné les parties. Ils sont définis au cas par cas par la convention ; il faudra distinguer si l’avocat assume une mission en matière judiciaire ou uniquement en matière de d’assistance juridique et de conseil [26]. En revanche, que la faute soit contractuelle ou délictuelle à l’égard des tiers ne change pas fondamentalement la méthode d’appréciation. Il est généralement enseigné que l’avocat est débiteur d’une obligation de moyens [27] mais il arrive que la qualification d’obligation de résultat soit retenue lorsque des diligences précises et non aléatoires sont mises à la charge de l’avocat [28], comme exercer un recours dans les délais [29].
En matière judiciaire, la mission de l’avocat se dédouble : il assiste (CPC, art. 412 N° Lexbase : L6513H7D) et représente (CPC, art. 411 N° Lexbase : L6512H7C) son client. L’assistance implique un devoir de conseil accessoire, puisque l’avocat est alors sollicité plus généralement pour aiguiller le client dans la conduite d’un procès, ce qui implique l’accomplissement de diverses prestations de services, comme par ex. la rédaction de requêtes, conclusions. L’avocat doit informer son client de toutes les actions et les recours juridiques envisageables, à l’exception des recours abusifs, dilatoires ou voués à l’échec, qu’il est tenu de déconseiller [30]. Il doit déployer sa compétence pour faire en sorte de l’emporter, mais ne garantit pas de gagner le procès : son obligation est de moyens. La représentation est plus exigeante. L’avocat va accomplir des actes de procédure au nom et pour le compte de son client. Dans le cadre de cette mission, le relâchement sera facile à établir : l’avocat doit se présenter à l’audience, respecter les délais pour agir ou exercer des voies de recours conformément à l’état du droit positif en vigueur. Finalement, la réussite de la mission ne dépend pas d’un élément aléatoire, ce qui consacre une obligation de résultat. Les exemples sont nombreux : mauvaise saisine de juridiction [31], omission à diligenter les voies de recours dont il est chargé par le client [32], etc.
L’expertise de l’avocat peut aussi être sollicitée dans le cadre d’une consultation juridique. L’avocat est alors tenu d’un devoir de conseil à titre principal. En principe, la faute de l’avocat devrait être prouvée [33]. Cependant, la jurisprudence a admis que l’avocat débiteur d’un devoir de conseil doit être en mesure d’établir qu’il a délivré à son client un conseil pertinent et précis quant à l’état du droit [34], même lorsque le droit positif était incertain, ce dont il devait faire état [35]. Le conseil doit donc être délivré avec une certaine précision technique. Même si l’avis est erroné, ce que le client doit établir [36] et qui n’est pas forcément retenu à faute, l’obligation de conseil sera réputée accomplie si le renseignement est étayé, avec une référence aux textes de loi ou à la jurisprudence. Si la preuve peut être fournie par tous moyens [37], la forme du conseil est importante, aussi la pré-constitution d’un écrit comme une lettre de reconnaissance de conseil donné, constitue sans doute le moyen le plus sûr de se prémunir de contestations relatives à l’absence de délivrance d’information [38].
Dans le cadre de la rédaction d’actes, la responsabilité de l’avocat se rapproche de l’obligation de résultat. Outre une obligation de conseil, ici accessoire, l’avocat rédacteur d’acte est tenu d’assurer la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Cela implique la réalisation des formalités nécessaires pour faire en sorte que l’acte produise concrètement les effets escomptés, par exemple, en inscrivant les sûretés qui en garantissent l’exécution [39]. La jurisprudence considère que la seule constatation de l’inefficacité de l’acte est de nature à établir la responsabilité de l’avocat, qui doit répondre de ses conséquences dommageables [40] dès lors qu’il a participé à la rédaction l’acte [41], ce qui en fait une obligation particulièrement rigoureuse. L’avocat ne peut, en effet, en échapper qu’en établissant que l’acte litigieux est régulier et efficace [42], ou qu’il a été établi dans l’ignorance d’informations sciemment dissimulées ou de déclarations erronées [43]. Cette dernière constatation, qui permet un effacement de la faute, nous conduit à aborder plus généralement les méthodes d’appréciation de la faute de l’avocat.
II. La méthode d’appréciation de la faute civile de l’avocat
Mesurer la prudence et la diligence, par rapport aux données spécifiques d’une cause, nécessite d’établir au préalable ce que pouvait savoir l’agent. Hier comme aujourd’hui, « la faute est opposée à la diligence, cette dernière étant intimement liée à la prévoyance » [44]. La prudence est aussi, depuis l’Antiquité, la vertu du calcul (de risques, d’opportunité, d’anticipation), qui nécessite des informations précises. Établir la faute d’un avocat, à travers le standard du « bon professionnel », implique donc avant toute chose de vérifier ce qu’il savait ou ce que l’on peut supposer qu’il savait, les connaissances supposées (A), avant de déterminer un niveau de soins exigible (B).
A. Établir les connaissances de l’agent
La faute du professionnel du droit s’apprécie à l’aune de ses connaissances supposées, notamment au regard du droit positif, surtout de la connaissance de l’état de la jurisprudence – laquelle est dépendante de son information. Cette donnée est importante. En effet, dans certains arrêts, la Cour de cassation subordonne l’effectivité d’une jurisprudence nouvelle à la vérification de l’existence d’une publication ou d’une mesure d’information, ainsi que de l’écoulement d’un délai pour en prendre connaissance. Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui, pour retenir la faute d’un professionnel du droit (il s’agissait ici d’un notaire), avait omis de rechercher si « l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1988 avait fait l’objet, à la date de l’intervention (de celui-ci), d’une publication ou de toute autre mesure d’information » [45]. Cette décision, qui contredit les analyses classiques relatives à l’application dans le temps d’un revirement de jurisprudence [46], est forte intéressante, car elle découle de la méthode employée par le juge – le standard du bon professionnel dans le cadre de l’appréciation de la faute, de la culpabilité : le caractère occulte de l’information initiale empêche que l’on puisse considérer l’ignorance fautive [47]. Hors faute, s’agissant de la loi, cette exigence est bien connue [48]. On pourrait se demander si la question de la transmission de l’information et du délai pour en prendre connaissance demeurerait essentielle demain, alors que les arrêts sont mis en ligne presque en temps réel, mais certaines expériences récentes, notamment la mise en ligne d’une nouvelle version du site Légifrance, nous conduisent à répondre par l’affirmative.
Sous cette réserve de l’information, il est, en effet, acquis que la jurisprudence doit être prise en compte dans ses derniers développements [49], mais en revanche, l’avocat n’est pas tenu d’anticiper un revirement de jurisprudence [50] ou à plus forte raison, une évolution du droit « imprévisible » [51]. L’ « évolution prévisible » est, en revanche, celle que l’avocat se doit de devancer. Ainsi, l’avocat doit faire valoir tous les moyens possibles, y compris « une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge, a des chances de la faire prospérer » [52]. Pareillement, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance d’une jurisprudence postérieure à son intervention pour s’exonérer de sa responsabilité, si celle-ci « ne constituait ni un revirement, ni même l’expression d’une évolution imprévisible de la jurisprudence » [53]. Pourtant, l’« évolution prévisible » du droit évoquée nous semble devoir être comprise très strictement. En effet, indépendamment des faits d’une cause, une évolution jurisprudentielle, comme une réforme éventuelle ou même annoncée, n’est jamais certaine tant qu’elle n’est pas intervenue… Il ne peut donc s’agir que de l’extension d’une jurisprudence acquise aux circonstances factuelles du litige dont est saisi l’avocat ou la transposition d’une jurisprudence établie dans une cause où celle-ci a des chances d’être accueillie. Et quand bien même un revirement serait intervenu, faut-il rappeler que les juges ne se prononcent pas au-delà de l’espèce dont ils sont saisis ? Est-ce une faute juridique de se tromper sur une évolution du droit, même prévisible ?
B. Déterminer le degré de soins « raisonnable »
Pour apprécier la faute du professionnel, il est nécessaire de procéder à une appréciation qui dépasse la simple méconnaissance par le professionnel du droit positif. Le relâchement d’attention, l’imprévoyance, la négligence voire la déloyauté d’un avocat ne constituent pas systématiquement une faute juridique. Le juge, saisi d’un écart de conduite, précisément à l’aune des connaissances et de l’expérience de l’avocat, vérifie si cet écart est contraire aux exigences de l’ordre juridique. Outil de la mise en équilibre des intérêts en présence, le standard du bon professionnel, lui fournit une marge d’appréciation [54].
La faute civile est éminemment relative, ce qui signifie qu’elle dépend de l’activité exercée et de la mission définie par la convention [55] – qui pour être menée à bien exige de déployer quelque diligence –, mais également de la relation de confiance qui unit le client avec l’avocat.
Cette dernière ressurgit ainsi sur l’exigence de prudence et de diligence, qui peut être accrue en présence de certaines circonstances objectives. « La comparaison à partir de laquelle sera déterminé in abstracto si le comportement de l’agent est conforme ou non à la loyauté », écrit M. Stoffel-Munck, « devra donc veiller à intégrer ces circonstances si elles se présentent dans la réalité » [56]. Dans cette perspective, l’économie de la convention conclue entre l’avocat et son client peut être une première donnée importante dans la fixation du degré de diligence exigible. On dit quelquefois que la responsabilité de l’avocat est calquée sur celle du mandataire salarié que le code traite plus sévèrement que le mandataire gracieux [57]. C’est ici l’intérêt commun qui relèverait le niveau d’exigence dans l’appréciation des négligences : « quiconque fait des affaires doit être sur ses gardes » [58]. De la même manière, il ne paraît pas inconcevable d’imaginer que l’ancienneté de la relation contractuelle d’un avocat et de son client, au fil des consultations successives, impacte l’étendue des informations exigibles au titre du devoir de conseil. En revanche, le degré de diligence exigé semble moins impacté par des considérations plus subjectives. Ainsi, les compétences personnelles du client ne déchargent pas l’avocat de ses obligations professionnelles [59], de même que l’intervention aux côtés du client d’un autre professionnel du droit [60].
L’exercice de certaines activités spécifiques emporte une soumission à des règles de nature extra-juridiques. Lorsque le juge civil doit déterminer le degré de soin exigible d’un professionnel, il trouvera souvent une indication utile et « positive » en se référant aux corps de règles, de nature variée, qui peuvent s’appliquer à l’activité considérée [61]. Ainsi, les règles déontologiques de l’avocat ont pour finalité spécifique de fixer les devoirs des membres de la profession dans le cadre de son exercice et sont assorties de sanctions disciplinaires. Le règlement du barreau ne saurait générer en principe d’obligation civile ou contractuelle à l’égard du client de l’avocat. Cependant, le « Code de déontologie » des avocats ou « RIN » adopté en 2015 consacre une certaine porosité des fautes civile et déontologique [62]. Récemment, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle a affirmé que : « Si l’action disciplinaire prévue à l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) se distingue de l’action en responsabilité civile, la méconnaissance des dispositions du RIN (Règlement intérieur national) peut être invoquée à l’appui d’une demande indemnitaire » [63]. Le constat d’une faute disciplinaire peut suffire à établir une faute civile et engager la responsabilité civile de son auteur, si elle a causé un préjudice au demandeur.
Plus précisément, l’avocat peut être actionné par son client ou par un tiers, au gré des circonstances, et se voir reprocher des manquements « techniques » ou « éthiques ». Les premiers seront sanctionnés indépendamment de tout reproche disciplinaire : l’oubli d’un délai ou d’une mention obligatoire ne traduit pas un mépris du serment. Les seconds seront sanctionnés civilement parallèlement au contentieux disciplinaire, par ex., si l’avocat dissipe les fonds de son client ou les remet à quelqu’un d’autre qui les détourne, ou encore si l’avocat omet de prévenir son client en temps utile qu’il se décharge du dossier. L’avocat, le professionnel du droit, le joueur sportif, l’homme de l’art, se préserve souvent de l’engagement de sa responsabilité civile [64] s’il observe les usages de sa profession, les règles de l’art ou du sport qu’il pratique. Et certains arrêts déduisent à l’inverse la qualification de faute civile d’un manquement aux règles déontologiques [65]. Mais cela ne doit pas être systématique. Les deux instances, civile et disciplinaire, poursuivent des finalités différentes, de sorte que les fautes civiles et disciplinaires ne se recoupent qu’imparfaitement. Toute entorse à la déontologie ne constitue pas une faute civile [66] et l’absence de poursuites disciplinaires, elle n’exonère pas civilement l’auteur du dommage, c’est ici une autre illustration de la relativité de la faute.
**
[1] H. Causse, Consultation juridique sur la faute et la responsabilité de l'avocat (ou autre professionnel du droit). Une mission presque facile ? A propos de quelques arrêts de 2010., 15 novembre 2010, [en ligne].
[2] Une assurance de représentation des fonds garantit le client contre la malhonnêteté de l’avocat, qui pourrait consister en un abus de confiance, dans le cas de figure par exemple ou l’avocat détournerait des fonds de leur usage normal.
[3] R. Bigot, La faute intentionnelle ou le phœnix de l’assurance de responsabilité civile professionnelle, RLDC, 2009, 59, n° 3406, p. 72-77 ; Le radeau de la faute intentionnelle inassurable, bjda.fr, 2018, n° 57.
[4] Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 18-19.782 et 18-19.832, F-D (N° Lexbase : A46743AD), Lexbase avocats, 6 février 2020, n° 300, obs. R. Bigot : « […] de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a pu déduire que M. R... avait eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, commettant ainsi une faute intentionnelle exclusive de la garantie de l’assureur, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) ».
[5] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 26 (N° Lexbase : L6343AGZ) dispose que « les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure ».
[6] A. Tunc, À propos de la responsabilité civile, RTD civ., 1992, 356, concernant la licéité du contrat d’assurance de responsabilité civile : « on pourra désormais, par une cotisation annuelle, s’éviter l’application de l’article 1382, ne plus répondre du dommage que l’on cause à autrui par sa faute ».
[7] Certains clients, conscients de ces facilités, n’hésitent plus à mettre en cause la responsabilité civile de leur avocat, afin d’obtenir indirectement une compensation du préjudice qu’ils rattachent à la faute de leur avocat.
[8] Y. Avril, La responsabilité civile de l’avocat : première partie, Gaz. Pal., 2002, n° 346, p. 6, spéc. n° 4.
[9] Faute de contrat, la responsabilité de l’avocat désigné par le bâtonnier en suppléance de son confrère est en revanche de nature délictuelle à l’égard du client de ce dernier : Cass. civ. 1, 5 mai 2004, n° 01-15.925, F-P+B (N° Lexbase : A0453DCR).
[10] « Même s’il se voit attribuer une valeur marchande et prend ainsi une coloration économique, un service se prête ou se rend, mais il ne se vend pas, car c’est avant tout la personne qui sert par sa compétence et son savoir-faire, et le travail ne se vend pas. » : A. Sériaux, Contrats civils, coll. Droit fondamental, P.U.F., 1ère éd., 2001, n° 110, p. 261.
[11] Ibidem.
[12] A. Sériaux, op. cit., n° 132, p. 329, note n° 2 ; v. CPC, art. 411 (N° Lexbase : L6512H7C) : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. » Ce mandat est appelé mandat ad litem. V. égal., H. Croze, Le partage de responsabilité entre les avocats et les autres auxiliaires de justice (avoués à la cour, huissiers de justice), Justice, 1997, n° 5, p. 79.
[13] F. G’sell, La responsabilité de l’avocat, entre droit commun et droit spécial, in Actes du colloque organisé à la Faculté de Droit, de sciences économiques et de gestion de l'Université de Rouen le 3 octobre 2019 en hommage au Professeur Suzanne Carval, RLDC, 2020, n° 179.
[14] Par ex., avec le décret n° 2005‐790 du 12 juillet 2005 portant règlement intérieur national (N° Lexbase : L6025IGA). Le manquement à certaines de ces obligations déontologiques peut entraîner une responsabilité déontologique et une responsabilité civile de l’avocat si les conditions de cette dernière sont réunies.
[15] CJUE, 15 janvier 2015, aff. C‐537/13, Birute iba c/ Arunas Devenas (N° Lexbase : A1934M9I) : la directive 93/13, relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7) s’applique à des contrats standardisés de services juridiques, conclus par un avocat avec une personne physique qui n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. On peut aussi douter de la validité des clauses élusives ou limitatives de responsabilité insérées par l’avocat professionnel à l’encontre de son client particulier : M. Béhar-Touchais, La responsabilité des professionnels du droit : rapport français, in La Responsabilité, aspects nouveaux, Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées panaméennes, t. 1, 1999, spéc. p. 513, n° 16.
[16] V. par ex., G. Viney, Introduction à la responsabilité, in Traité de droit civil, dirigé par J. Ghestin, 4ème éd. 2020, n° 345.
[17] Cass. civ. 2, 7 octobre 2004, n° 02-14.264, F-P+B (N° Lexbase : A5588DDC).
[18] Cass. civ. 1, 6 octobre 1993, n° 91-16.658 (N° Lexbase : A3696ACU).
[19] CA Nîmes, 11 septembre 2007, n° 2007, — n° 34-3804.
[20] Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 05-20.715, F-D (N° Lexbase : A4577DXS).
[21] Ass. Plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255 (N° Lexbase : A5095DR7).
[22] Ass. Plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 (N° Lexbase : A85133AK).
[23] Cass. civ. 1, 18 mai 2004, n° 01-13.844, F-P (N° Lexbase : A1912DCS).
[24] Cf. C. civ., anc. art. 1135 : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » ; comp. la rédaction du nouvel art. 1194 C. civ. (N° Lexbase : L0910KZQ) : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
[25] Le décret n° 2005‐790 du 12 juillet 2005, portant « code de déontologie » (N° Lexbase : L6025IGA) prévoit que « l’avocat fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence » (art. 3, al. 3), ce qui introduit une confusion dans la mesure où ces devoirs de compétence et de prudence et diligence sont tout autant, si ce n’est plus, juridiques que proprement déontologiques.
[26] Dans le même sens, v. F. G’sell, art. préc.
[27] Cass. civ. 1, 7 octobre 1998, n° 96‐13.614 (N° Lexbase : A5096CGT). Sur l’appréciation de la faute, v. infra, II.
[28] H. Mazeaud, Essai de classification des obligations : obligations contractuelles et extra-contractuelles ; « obligations déterminées » et l’ « obligation générale de prudence et de diligence », RTD civ., 1936, pp. 1-58, spéc. n° 50 : « on peut dire (…) que chaque fois qu’il s’agit d’une « entreprise aléatoire » (guérison, défense d’intérêts en justice, etc.), l’obligation doit, en principe, être considérée comme une simple obligation générale de prudence et de diligence ».
[29] Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-18.613, F-D (N° Lexbase : A3006ZGG).
[30] Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-15.090 et n° 03‐16.565 (N° Lexbase : A0372DEI).
[31] Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-15.453, F-D (N° Lexbase : A8633GBD).
[32] Cass. civ. 3, 1 décembre 2004, n° 03-14.033, F-S-P+B (N° Lexbase : A1310DEA).
[33] F. Viney, À propos de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information, JCP, 2014, 879, spéc. n° 6 s..
[34] Cass. civ. 1, 29 avril 1997, Bull. civ. I, n° 132. – V. C. civ., art. 1112-1, al. 4 (N° Lexbase : L0598KZ8) issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK) : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie ».
[35] Cass. civ. 1, 6 février 2013, n° 12‐14.433, F-D (N° Lexbase : A6372I77).
[36] Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-17.627, F-D (N° Lexbase : A6747KCU).
[37] Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.193, F-P+B+I (N° Lexbase : A9962KBL), Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-14.598, F-D (N° Lexbase : A0763MKH).
[38] F. Viney, art. préc., spéc. n° 16 et s., M. Béhar-Touchais, art. préc., spéc. n° 13, p. 513.
[39] Cass. civ. 1, 5 février 1991, n° 89‐13.528 (N° Lexbase : A4419AH7).
[40] Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-13.840, F-P+B (N° Lexbase : A8623GBY).
[41] Cass. civ. 1, 9 mars 2004, n° 01-17.951, F-D (N° Lexbase : A4832DBL).
[42] Cass. civ. 1, 19 mars 2002, n° 99-17.886 (N° Lexbase : A2999AYQ).
[43] Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-70.767, F-P+B+I (N° Lexbase : A3360GLZ), Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-22.665, F-D (N° Lexbase : A5485KIY).
[44] J.-P. Dunand, B. Schmidlin et B. Winiger, Droit privé romain, II, Obligations, Bruylant, Schulthess, 2010, p. 204. – Sur l’appréciation de la faute civile en général, v. F. Viney, La personne raisonnable [Le bon père de famille et le plerumque fit], Contribution à l’étude de la distinction des standards normatifs et descriptifs, thèse, Paris I, (dir.) G. Loiseau, 2013.
[45] Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-18.659, F-P+B (N° Lexbase : A9748R78) (notaire). V. sur cet arrêt, notre note : Nul professionnel n’est censé ignorer… la jurisprudence ?, Les Petites Affiches, 2017, n° 101, 18.
[46] V. F. Viney, note préc.
[47] V. Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-70.767, F-P+B+I (N° Lexbase : A3360GLZ), Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-22.665, F-D (N° Lexbase : A5485KIY), précités.
[48] Ainsi, l’entrée en vigueur d’une loi est en principe prévue au lendemain de sa publication au JORF (C. civ., art. 1er), lorsqu’elle est censée être connue des personnes qu’elle intéresse. – Sur ce point, v. F. Viney, note préc.
[49] Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07‐20.196, F-P+B (N° Lexbase : A9489ECG), Cass. civ. 1, 5 mars 2009, n° 07-21.116 (N° Lexbase : A17564ER).
[50] Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10‐24.550, F-P+B+I (N° Lexbase : A2907H88).
[51] Cass. civ. 1, 5 février 2009, préc (N° Lexbase : A9489ECG).
[52] Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15‐27.234 (N° Lexbase : A9674R7G) et n° 15-18.659 (N° Lexbase : A9748R78), Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-15.899, FS-P+B (N° Lexbase : A9822EGU).
[53] Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-17.080, FS-D (N° Lexbase : A7013D8A).
[54] F. Viney, La personne raisonnable, thèse préc., spéc. part. II, titre II.
[55] V. supra, spéc. IB.
[56] V. Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat, thèse, préf. R. Bout, coll. Bibliothèque de droit privé, tome 337, L.G.D.J., 2000, n° 247 p. 215. Pour M. Stoffel-Munck, ces circonstances objectives sont « l’ancienneté dans les rapports d’affaires, de la communauté d’intérêts, et de la situation de dépendance dans laquelle l’un se trouve à l’égard de l’autre » (ibidem).
[57] C. civ., art. 1992 (N° Lexbase : L2215ABN) : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion (al. 1er). Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. » (al. 2)
[58] Ihering l’expliquait à merveille à propos des contrats en droit romain : « quiconque veut réaliser des bénéfices doit être sur ses gardes. Pour faire des affaires, il faut déployer le zèle et l’intelligence de l’homme d’affaires (diligens pater familias). Dans tous les contrats onéreux, donc, les deux parties répondent de culpa levis : ce n’est que dans ceux qui établissent ou supposent un certain rapport personnel plus étroit, comme dans la société et la dot, que la culpa levis se tempère jusqu’à la diligentia quam suis rebus. Dans les rapports gratuits, au contraire, celui qui reçoit une libéralité, qui réalise un gain, est tenu de culpa levis, tandis que celui qui fait la libéralité, c’est-à-dire celui qui fait un sacrifice ne doit répondre que de la culpa lata » et a fortiori du dol (dolus) : R. V. Ihering, De la faute en droit privé, in Études complémentaires de l’Esprit du droit romain, traduction O. de Meulenaere, Paris, 1880, spéc. pp. 60-61.
[59] Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-18.968, F-D (N° Lexbase : A1157IQW) ; Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-28.100, F-D (N° Lexbase : A8823XAZ).
[60] Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 11-10.893, F-D (N° Lexbase : A3668ICT).
[61] N. Dejean de la Bâtie, Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en droit civil français, thèse, préf. H. Mazeaud, coll. Bibliothèque de droit privé, tome 57, L.G.D.J., 1965, n° 206 et s.
[62] V. supra, note 25.
[63] Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-23.858 (N° Lexbase : A6551ZSG).
[64] V. par ex., Cass. Req., 6 janvier 1947, Gaz. Pal., 1947., 1., 119.
[65] Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-15.090 et 03-16.565, F-P+B (N° Lexbase : A0372DEI).
[66] Cass. civ. 1, 4 mai 1982, D., 1983., IR, 378, Cass. com., 21 juin 1988, Bull. civ. IV, n° 210.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476016
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Les mécanismes de garantie obligatoire des risques
Lecture: 14 min
N6010BYA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Rodolphe Bigot, Maître de conférences en droit privé, UFR de Droit - Le Mans Université, Membre du Themis-UM, Membre associé du Ceprisca
Le 03 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
La prise en charge des risques que génèrent les avocats en lien avec leurs activités, certains évoqués ce matin, et bien d’autres, fait l’objet de mécanismes de garantie, à titre obligatoire [1]. Parmi les professions réglementées, à raison de leur histoire et de leur évolution, les avocats bénéficient d’un système de garanties bicéphales (I). Le squelette de ce système demeure néanmoins fragile (II).
I - Un système de garanties bicéphale
Ce système s’inscrit dans un dualisme de garanties (A), dont l’obligatoriété de souscription est à double détente (B)
A. Le dualisme des garanties
Coexistent chez les avocats deux mécanismes de garanties, car « deux risques sont susceptibles d’être couverts par une assurance : un risque de responsabilité et un risque d’insolvabilité » [2].
D’une part, l’assurance de responsabilité civile professionnelle protège non seulement le patrimoine de l’assuré - avocat, collaborateur ou préposé - pour sa dette de responsabilité, mais aussi la créance indemnitaire de la clientèle voire des tiers qui bénéficient ainsi d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur.
D’autre part, le risque de non-représentation des fonds connaît sa propre dualité en termes de mécanismes de garantie.
Primo, l’assurance de représentation de fonds, autorisée par l’article L. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0052AA8), vise à garantir « la victime contre les détournements volontaires du dépositaire ou du mandataire. La stipulation pour autrui permet d’échapper à la nullité d’assurance : la garantie profite directement à la victime. Néanmoins, cette dernière ne devra pas perdre de vue qu’elle est l’assurée, que l’assurance lui profite, et ainsi ne jamais oublier la prescription biennale susceptible d’être encourue » [3]. Il s’agit d’une assurance pour le compte de qui il appartiendra, autrement dit un tiers généralement indéterminé qui ne participe pas au contrat et n’y est pas représenté [4]. Ce format résulte de l’impossibilité d’ordre public de s’assurer pour un fait volontaire [5], laquelle oblige à formuler une stipulation pour autrui [6]. Cette police de représentation de fonds ne peut être souscrite à titre individuel mais doit l’être par le barreau [7].
Secundo, la garantie financière est un procédé alternatif permis à l’avocat. Elle peut être prise « aussi bien dans une banque, un établissement de crédit, qu’une société de caution mutuelle – tous établissements habilités à donner caution » [8]. Malgré son intérêt en présence d’une procédure collective, grâce à sa qualification de garantie autonome [9] et non de cautionnement, sa complexité paraît conduire à son inutilisation [10]. Pour la mise en œuvre de ces deux derniers mécanismes, le client n’a qu’à justifier, outre la défaillance de la personne garantie, que la créance est certaine, liquide et exigible. L’assureur pour compte ou le garant financier peut exercer un recours subrogatoire [11] contre tout responsable de la défaillance.
B. Un obligatoriété à double détente
En 1828, Louis Basse, avocat et ancien maire du Mans, a fondé la Mutuelle Immobilière Incendie par promulgation d’une ordonnance royale signée par Charles X pour garantir les risques de destruction des archives des professionnels du droit notamment. C’est l’ancêtre de MMA, assureur historique de ces professionnels. L’assurance et les risques des avocats forment un vieux couple, assez mal connu. Il s’est transformé peu à peu. Installé en union libre depuis le début du 19ème siècle, il est devenu une sorte de mariage forcé avec l’instauration de l’assurance obligatoire en 1971. Une grande complicité a été sauvegardée, mais il n’est pas à l’abri de quelques disputes générées par certains conflits d’intérêts intrinsèques, que la création d’un courtier captif de la profession – d’assurance et non matrimonial – n’a pas su parfaitement endiguer.
Mise à part la garantie financière ne pouvant être prise qu’à titre individuel, l’assurance de l’avocat – RC ou NRF –, si elle est obligatoire, préserve théoriquement une certaine flexibilité dans sa souscription [12]. En effet, la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) dispose qu’ « Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. Le Bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées » [13].
Il s’agit bien d’un contrat imposé. Néanmoins, il est assorti d’une liberté légale quant à la modalité de souscription, pouvant être prise à titre individuel ou à titre collectif, en d’autres termes par l’avocat ou par le barreau. Le système étant ancien, son squelette demeure fragile, déminéralisé par l’usure du temps.
II. Un système au squelette fragile
Bien qu’il ait rendu obligatoire près de deux cents assurances en France, le législateur n’a cependant aucune doctrine harmonieuse en la matière. Les garanties des avocats n’échappent pas à cette ossature légale légère, souvent « plâtrée » (A). La jurisprudence lui a néanmoins prescrit un programme de renforcement (B).
A. Une ossature légale légère
Les garanties des avocats ont été étendues par le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Y est prévu que « La responsabilité civile professionnelle de l’avocat membre d’une société d’avocats ou collaborateur ou salarié d’un autre avocat est garantie par l’assurance de la société dont il est membre ou de l’avocat dont il est le collaborateur ou le salarié. Toutefois, lorsque le collaborateur d’un avocat exerce en même temps la profession d’avocat pour son propre compte, il doit justifier d’une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir du fait de cet exercice » [14].
L’avocat qui s’initie à certaines activités non couvertes par l’assurance ordinaire, du type tout sauf, devra contracter une assurance spécifique. Qu’il s’agisse de devenir administrateur dans une société anonyme [15] ou fiduciaire [16], activité ouverte à la profession d’avocat en 2009 [17], l’assurance de responsabilité dédiée à cette fonction ou activité devra impérativement être souscrite.
Avec la suppression par la loi du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC) de l’obligation pour les avocats d’exercer exclusivement dans une seule structure d’exercice [18] puis la création, dans la foulée, des sociétés pluri-professionnelles d’exercice ou SPE [19], la révolution des modes d’exercice des professions du droit a eu des répercussions sur l’assurance professionnelle [20]. La SPE peut accomplir les actes d’une profession déterminée, certes par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession [21]. La doctrine a pu s’en inquiéter : « Le texte est très laconique sur la question de l’assurance. L’ordonnance de 2016 se contente en effet d’annoncer que la société souscrit une assurance couvrant les risques relatifs à sa responsabilité civile professionnelle, sans se soucier des particularismes de l’assurance de chacune des professions du droit. L’article 30 du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2487LET) précise finalement que ce contrat d’assurance « est conclu dans le respect des dispositions relatives aux obligations d’assurance de responsabilité professionnelle, propres à chacune des professions correspondant à l’objet social de la société ». La société pluri-professionnelle d’exercice doit donc souscrire une assurance destinée à couvrir les conséquences pécuniaires de sa propre responsabilité civile distincte de celle de ses membres, chacun de ses associés conservant l’obligation de souscrire une assurance. Les textes ignorent cependant certaines réalités » [22]. Dans les polices collectives, la SPE a désormais la qualité d’assuré, et dispose d’une assurance autonome de 4 millions d’euros à Paris par exemple.
Par ailleurs, le niveau des garanties des polices n’est pas toujours suffisant. Le décret du 23 décembre 2009 a relevé l’ancien minima, qui ne devait pas être inférieur à 300 500 euros par année pour un même assuré, à 1 500 000 euros [23]. Mais, depuis fort longtemps, les garanties sont bien plus élevées que la réglementation, assez obsolète au regard des risques connus. Par exemple, le contrat du barreau de Paris stipule une garantie de 4 millions d’euros en première ligne. En province, elle est généralement de 3 millions d’euros. Des lignes complémentaires peuvent être souscrites jusqu’à près de 200 millions d’euros. Dans tous les cas, il revient à chaque avocat de mesurer les risques encourus et d’accorder sa couverture assurantielle en fonction. Selon le RIN (N° Lexbase : L4063IP8) en effet, « L'avocat doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l'importance des risques encourus » [24].
Parfois, enfin, c’est la victime qui essuie les plâtres des pratiques [25]. La franchise à la charge de l’assuré, non obligatoire, est néanmoins réglementée. Si elle stipulée dans la police d’assurance, elle ne peut dépasser 10 % des indemnités dues, dans la limite de 3 050 euros, au prix d’une pratique de franchise aggravée [26] condamnée pour les agents immobiliers par exemple [27]. A l’instar de ce qu’il a pu faire à l’égard des notaires, le législateur serait bien inspiré d’instaurer un découvert obligatoire que les parties au contrat d’assurance ne pourraient ni aménager ni éluder. En revanche, la réglementation relative aux avocats fait figure de modèle pour les autres professions sur un point : la franchise est inopposable aux tiers lésés. Regrettablement cette disposition n’est pas toujours appliquée en pratique, en particulier en présence d’une transaction [28]. Un degré supérieur d’obligatoriété, mêlée à l’inopposabilité, est donc souhaitable, sans faculté d’aménagement [29].
B. Un programme de renforcement jurisprudentiel
Le Bâtonnier Yves Avril a pu souligner que « le décret de 1991 (N° Lexbase : L8168AID) prévoit une exigence qui paraît aussi peu connue des Bâtonniers que des parquets généraux : « Le Bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées ». Il est vrai que rien n’est dit de la périodicité de cette information » [30]. Yves Bot, lorsqu’il était encore Procureur général de Paris, avait pu me confirmer la faible effectivité de cette disposition.
Le législateur a certes rendu l’assurance obligatoire, mais s’est peu préoccupé de son organisation. Cette carence a été compensée par le rôle important joué par les Conseils de l’Ordre, auxquels la jurisprudence a reconnu et étendu les pouvoirs. A cette fin, les magistrats du Quai de l’Horloge n’hésitent pas à se promener sur la pyramide des normes et à consolider celle-ci.
Par arrêt en date du 5 octobre 1999, la Cour de cassation a reconnu, en dépit de l’article 27 de la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui autorise chaque avocat à souscrire une assurance à titre individuel, qu’ « un conseil de l’Ordre peut, sans excéder ses pouvoirs, d’une part, décider que l’obligation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle devra être satisfaite par une assurance collective à laquelle chaque avocat membre du barreau sera tenu d’adhérer, d’autre part, fixer le montant de la garantie à un taux supérieur au minimum réglementaire » [31]. A cet effet, l’avocat général avait émis que « dans la pratique, l’assurance de groupe apparaît en tout cas comme la seule option possible pour les barreaux d’une certaine importance. Elle facilite en effet le contrôle que doit exercer le conseil de l’Ordre sur le respect des obligations mises à la charge des avocats en matière d’assurance. Elle donne aussi au Bâtonnier le moyen d’informer sans difficulté le procureur général des garanties constituées et d’être informé lui-même de la survenance des sinistres ».
Peu de temps après, la Haute Cour en a tiré comme conséquence l’obligation pour les avocats de payer les primes d’assurance auprès de l’Ordre sous peine d’être omis du tableau [32]. Elle a encore décidé qu’un conseil de l’Ordre a le pouvoir de répartir les primes d’assurance entre les différents membres du Barreau [33], puis admis, en 2014, une demi-cotisation pour les avocats salariés non associés [34] et enfin, en 2015, une assurance collective obligatoire « perte de collaboration » avec une répartition des primes en équité [35]. Le rapport « Perben » recommande d’ailleurs d’ « inscrire dans le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) une disposition rendant obligatoire la souscription par les barreaux d’une assurance perte de collaboration. Le coût de cette assurance serait intégré à la cotisation ordinale fixée par les Ordres » [36]
A la différence des autres professions du droit, on assiste en pratique à un éclatement des polices collectives à adhésion obligatoire par barreau, ce qui n’est pas sans soulever des difficultés en termes de mutualisation des risques dans les barreaux de petite dimension [37] et même dernièrement dans un grand barreau de province, où le comportement réitéré d’un seul assuré a mis en péril l’assurabilité du risque.
Il n’est alors plus incongru de suggérer, sur fond de projet lié à une gouvernance nationale de la profession regroupant l’ensemble des barreaux français, qu’on intègre le pouvoir de souscrire un contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire de l’ensemble des membres de la profession, pour mutualiser sa sinistralité, améliorer et harmoniser le niveau des garanties, et gagner en transparence, tel que le professeur Philippe Brun a pu le revendiquer dans un colloque sur un thème voisin [38].
Dans cette voie, la loi n° 2014-344 dite « loi Hamon » du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX) ayant introduit l’article L. 129-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L7683IZL) et définit l’assurance collective de dommages en excluant les risques professionnels, est un acte manqué.
Les assureurs du marché ont conservé leur totale liberté de contracter [39] et peuvent décider, du jour à l’autre, de l’abandonner. Seul l’avocat a l’obligation de contracter. Or rien n’est prévu dans ce cas de désintéressement des assureurs, comme cela peut l’être pour six autres grands risques, dont l’assurance de responsabilité médicale ou de construction, où une procédure spéciale pour imposer un assureur est mise en place auprès du Bureau central de tarification [40]. Certes, ce BCT ne relève toujours pas, malgré la réforme opérée par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (N° Lexbase : L5685LCK), de la catégorie des autorités administratives indépendantes. Resterait alors à vider de sa composition les représentants des compagnies pour limiter les éventuels conflits d’intérêt.
En l’attente d’hypothétiques améliorations législatives, vous allez immédiatement pouvoir découvrir, avec l’œil averti d’Yves Avril, que c’est le cœur même de ces garanties, au titre de l’exécution des contrats d’assurance, qui pose encore certaines difficultés dans la prise en charge des risques. Et pour l’actualité, bien sûr, le risque d’avoir une directrice de l’ENM [41] ou un garde des Sceaux avocat n’est pas couvert !
[1] A été conservé le style oral de la conférence donnée lors du colloque du 25 septembre 2020, sous la présidence de Madame le professeur Sophie Pellet.
[2] L. Mayaux, Les assurances professionnelles de l’avocat, in La responsabilité des gens de justice, XXIIème colloque des Instituts d’études judiciaires, Justices, n° 5, janvier-mars 1997, p. 70.
[3] Y. Avril, Responsabilité des avocats, Dalloz Référence, 4ème éd., 2020, n° 41.32, p. 284. – Comp. S. Cabrillac, Les garanties financières professionnelles, thèse, Montpellier, 2000, préf. Ph. Pétel, Litec, bibl. droit de l’entreprise, t. 49, n° 442, p. 334 : « les garanties financières n’ont pas été instaurées dans le dessein de protéger le patrimoine des professionnels en cause, mais ceux des tiers vulnérables avec lesquels ils traitent ».
[4] S. Cabrillac, op. cit., n° 411 et s..
[5] C. assur., art. L. 113-1, al. 2. (N° Lexbase : L0060AAH) – cf R. Bigot, La consécration de la théorie dualiste des fautes volontaires inassurables, sous Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I (N° Lexbase : A06493MY), Dalloz actualité, 9 juin 2020 ; La faute intentionnelle de l’avocat, sous Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-18.909, F-D (N° Lexbase : A92593BK), Lexbase Avocats, février 2020, n° 300 ; Le radeau de la faute intentionnelle (A propos de Cass. civ. 1, 29 mars 2018, n° 17-11886, 17-16558 N° Lexbase : A8705XIA) », bjda.fr, 2018, n° 57 ; La faute intentionnelle ou le phœnix de l’assurance de responsabilité civile professionnelle, RLDC, 2009, 59, n° 3406, pp. 72-77.
[6] Y. Avril, op. cit., n° 41.72.
[7] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 27 (N° Lexbase : L6343AGZ).
[8] Y. Avril, Responsabilité des avocats, Dalloz Référence, 4ème éd., 2020, n° 41.32, p. 284.
[9] Ass. plén., 4 juin 1999, n° 96-18.094 (N° Lexbase : A8184AHL), Bull. ass. plén., n° 4.
[10] Les avocats n’appartenant pas à un barreau garantissant les maniements de fonds par l’assurance doivent organiser eux-mêmes leur propre garantie financière et surtout en justifier.
[11] C. assur., art. L. 121-12 (N° Lexbase : L0088AAI).
[12] H. Slim, Les garanties d’indemnisation, in S. Porchy-Simon et O. Gout (coord.), La responsabilité liée aux activités juridiques, Bruylant, coll. du GRERCA, 2016, pp. 191-206, spéc. n° 14.
[13] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 27 (N° Lexbase : L6343AGZ).
[14] Décret n° 91-1191 du 27 novembre 1991, art. 206 (N° Lexbase : L8168AID).
[15] Décret n° 91-1191 du 27 novembre 1991, art. 112 (N° Lexbase : L8168AID). - cf. Y. Avril, L’assurance de responsabilité obligatoire pour l’avocat, Dalloz avocats, 2017, p. 180.
[16] Ph. Delebecque, La responsabilité du fiduciaire, Dr. & patr., novembre 2009, n° 186, pp. 42-44.
[17] Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009, portant diverses mesures relatives à la fiducie (N° Lexbase : L6939ICY), JO. 31 janvier 2009, p. 1854 ; JCP, 2009, I, 120, n° 5, obs. S. Bortoluzzi. - Décret n° 2009-1627 du 23 novembre 2009 (N° Lexbase : L1259IGQ) ; JO. 26 décembre 2009.
[18] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), JO. 5 janvier 1972, art. 7 ; Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016, art. 1, 5° et 6° (N° Lexbase : L1249K97) ; Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2477LEH) ; v. égal. CE, 1/6 ch.-r., 5 juillet 2017, n° 403012 (N° Lexbase : A7769WLC).
[19] Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 (N° Lexbase : L3874K7M), JO. 1 avril 2016 ; pour les décrets d’application précisant les modalités particulières d’exercice : Décret n° 2017-796 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2521LE4) ; Décret n° 2017-797 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2500LEC) ; Décret n° 2017-798 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2475LEE) ; Décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2468LE7) ; Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2489LEW) ; Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2477LEH), JO. 7 mai 2017.
[20] F. Arhab-Girardin, L’assurance et la responsabilité civile des professions du droit, questions choisies, RLDC, n° 157, mars 2018, n° 6424, p. 49 et s., spéc. p. 50.
[21] Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, art. 1er (N° Lexbase : L3874K7M) ; JO. 1 avril 2016.
[22] F. Arhab-Girardin, op. cit. : « Quelle que soit la forme qu’emprunte la société pluri-professionnelle d’exercice, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui (Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, art. 16 N° Lexbase : L3046AIN). S’agissant de l’assurance de la société elle-même, la pluri-professionnalité impose la conception de nouveaux contrats d’assurance. En effet, le contrat d’assurance collective responsabilité civile professionnelle traditionnel ne couvre pas la responsabilité des membres qui y sont étrangers. (…) De la même façon, lorsque l’assurance de la société est insuffisante en raison d’un dépassement du plafond de garantie ou d’une exclusion de garantie, les associés sont solidairement responsables. Or, leur assurance, telle qu’elle est conçue actuellement, ne couvre pas les actes étrangers à la profession » - Adde L. Mayaux, Assurances de la responsabilité civile professionnelle : en marche vers la pluri-professionnalité ?, RGDA, 2017, p. 81. – C. Jeanson, Quelles sont les difficultés soulevées par l’interprofessionnalité des professions du chiffre et du droit telle que souhaitée dans le projet de loi Macron, en particulier pour le notariat ?, Dr. & patr., 2015, n° 248, p. 63.
[23] Décret du 27 novembre 1991, art. 205 (N° Lexbase : L8168AID).
[24] RIN, art. 21.3.9-1 (N° Lexbase : L4063IP8).
[25] Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-28301 (N° Lexbase : A0792S8T) ; R. Bigot, Les principes de l’assurance obligatoire de professions du droit chahutés par une pratique séculaire. À propos d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2017, RGDA, 2017, n° 7, p. 395 et s. : « Elle a dû se prononcer sur l’application du contrat d’assurance de non-représentation des fonds par les avocats souscrit par le barreau de Paris, lequel stipule non seulement que « l’Ordre arrête en accord avec l’assureur, la suite à donner à la réclamation », mais encore qu’« un Comité de conciliation [est] chargé notamment de “ décider de l’opportunité d’une transaction ou de l’engagement d’un procès” ». Il s’agit d’un filtrage de la réclamation. (…) La Haute juridiction a ajouté sur le ton d’un principe qu’une clause ne peut pas ajouter aux conditions légales ou réglementaires impératives des exigences plus sévères qui auraient pour effet de réduire les droits ou d’aggraver les obligations des parties au contrat souscrit ou de ses bénéficiaires. Le cas échéant, elle est sans effet, dit autrement elle est réputée non écrite. Une telle procédure contractuelle peut, au mieux, avoir une vocation incitative. Elle ne peut constituer un préalable à la mise en œuvre de la garantie, déterminée par les seules dispositions impératives des textes en vigueur. Transposé aux assurances de responsabilité des professions juridiques, le jeu de ce type de clause ne doit pas retarder l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable du dommage ».
[26] R. Bigot, Sens et non-sens de la responsabilité civile des professions juridiques (Partie 2 – Chapitre 9), in Sens et non-sens de la responsabilité civile (coord. J. Le Bourg et C. Quézel-Ambrunaz), Presses de l'Université Savoie Mont Blanc, 2018, pp. 359-432, spéc. p. 428.
[27] Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-20.504 (N° Lexbase : A3274KM9), RCA, 2014, com. 17 : « Qu'en statuant ainsi, quand la franchise contractuelle excédant le plafond réglementaire de 10 % des indemnités dues, n'était opposable à l'assuré, et partant aux tiers victimes, que dans cette limite, qu'il lui appartenait de rétablir, la cour d'appel a violé les textes susvisé ». – cf. L. Grynbaum (dir.), Assurances, éd. L’Argus, Droit & pratique, 2017-2018, n° 2681.
[28] Y. Avril, L’assurance de responsabilité obligatoire pour l’avocat, Dalloz avocats, 2017, p. 180 : « lorsqu’on aura convenu d’une transaction, la victime aura la surprise de ne pas recevoir la totalité de son montant. L’indemnité étant amputée de la franchise due par l’avocat, le créancier devra encore attendre le bon vouloir de celui-ci, même s’il est impécunieux, négligent ou rétif. Pourtant, la franchise est clairement et légalement inopposable à la victime ».
[29] R. Bigot, L’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle. L’exemple des professions du droit et du chiffre, avant-propos H. Slim, préface D. Noguéro, Defrénois, coll. Doctorat & Notariat, t. 53, 2014, n° 1040.
[30] Y. Avril, L’assurance de responsabilité obligatoire pour l’avocat, Dalloz avocats, 2017, p. 180.
[31] Cass. civ. 1, 5 octobre 1999, n° 96-11.857 (N° Lexbase : A2318CGX), Bull. civ. I, n° 255 ; JCP, 1999, p. 2036, concl. J. Sainte-Rose. – Comp. Cass. civ. 1, 23 février 1999, n° 96-15.214 (N° Lexbase : A6669CIT), Bull. civ. I, n° 63, D., 2000, Somm 145, obs. Blanchard : un conseil de l’Ordre peut imposer un montant minimal de garantie à tous les avocats exerçant dans le ressort, notamment ceux qui ont un cabinet secondaire. En 2003, le Conseil de la concurrence a encore estimé que l’assurance collective imposée aux membres d’un barreau d’avocats était permise au titre des dérogations prévues par le Code de commerce (Cons. conc. n° 03-D03 du 16 janvier 2003, BOCC, 16 juin 2003 ; JCP, 2003, II, 10051, note R. Martin).
[32] Cass. civ. 1, 29 octobre 2002, n° 99-14.837, F-P (N° Lexbase : A4023A3E), RCA, 2003, comm. 55. - A. Cayol, L’assurance de responsabilité professionnelle, RLDC, mars 2020, n° 179, p. 42 et s.
[33] Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 97-22.401 (N° Lexbase : A7772AHC), Bull. civ. I, n° 276.
[34] Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 13-10.185, F-D (N° Lexbase : A9756MCC) : sur renvoi la Cour d’Aix-en-Provence a approuvé la décision du Conseil de l’Ordre répartissant les primes.
[35] Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.536, FS-P+B (N° Lexbase : A5182NLI), Bull. civ. I, n° 142.
[36] Mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, présidée par M. Dominique Perben, Rapport à M. le garde des Sceaux, juill. 2020, p. 22-23.
[37] R. Bigot et P. Roger, L’assurance des professionnels du procès, RGDA, 2010, n° 3, p. 933.
[38] Ph. Brun, Propos conclusifs, in Actes du colloque - La responsabilité des professionnels du droit, RLDC, n° 157, mars 2018, n° 6424, p. 47 et s., spéc. p. 49 : « Si la responsabilité civile nous dit des choses intéressantes sur ce que sont les professions qu’elle régit, l’assurance est également assez intéressante à analyser de ce point de vue. Ainsi, l’organisation particulièrement aboutie de la profession notariale trouve une traduction dans le système à la fois sophistiqué et manifestement très efficace de la garantie collective. Un taux de contentieux significativement inférieur au taux de sinistre : autrement dit, une politique résolument tournée vers la transaction. Quid des avocats ? À en juger par le contentieux somme toute assez faible qu’engendre la responsabilité civile des avocats, on serait tenté de subodorer la même politique (et ce d’autant que c’est le même assureur qui officie). Faut-il y ajouter l’effet d’inhibition liée à la confraternité ? Quoi qu’il en soit, et c’est un regret que je formulerai en guise de conclusion, au risque de paraître déceptif : à la notable exception des éléments fort intéressants qu’a pu fournir la thèse soutenue en 2012 à Tours par M. Rodolphe Bigot sur l’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle (prenant pour objet plus spécifique les professionnels du chiffre et du droit), on manque d’éléments statistiques régulièrement mis à jour sur ces aspects pourtant essentiels. N’y aurait-il pas là une discrétion excessive des professions concernées ? ».
[39] A. Favre-Rochex, G. Courtieu, Le droit des assurances obligatoires, préf. G. Durry, L.G.D.J, coll. Droit des affaires, 2000, pp. 38 et s..
[40] BCT Auto ; BCT médical, BCT Construction ; BCT habitation ; BCT Catnat.
[41] P. Gonzalès, Natahlie Roret, une avocate à la tête de l’Ecole nationale de la magistrature, Le Figaro.fr, 21 septembre 2020.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476010
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Le concours des barreaux dans le règlement des sinistres
Lecture: 6 min
N5996BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yves Avril, ancien Bâtonnier, avocat honoraire, Président d’honneur du Conseil régional de discipline, docteur en droit
Le 03 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
Dans un régime d’assurance obligatoire le concours des barreaux est incontournable. En effet, si la loi a rendu l’assurance de responsabilité civile obligatoire [1], rapidement les barreaux se sont dotés d’une assurance collective quand elles n’existaient pas déjà. L’Ordre est alors le titulaire de la police et la jurisprudence reconnait régulièrement aux conseils de l’Ordre le pouvoir d’imposer une adhésion aux avocats inscrits [2]. Dans ce contexte l’Ordre paraît devoir centraliser les déclarations de sinistre, qu’elles proviennent du réclamant ou soient transmises par l’avocat mis en cause. On rappellera en outre que le Bâtonnier a un rôle incontournable : toute réclamation [3] et toute assignation [4] reçue par l’avocat doit lui être transmise.
Pour aider le Bâtonnier à exécuter ces obligations, la pratique a créé, de façon formelle ou informelle, des « commissions sinistres ». Elles sont composées d’avocats expérimentés, de préférence compétents en droit des obligations et en droit des assurances. Les commissions sinistres ont pu avoir la faveur des assureurs puisque les polices souscrites par la Compagnie Allianz précisent que l’assureur ne peut invoquer une déclaration tardive de sinistre tant que la commission compétente a été saisie, sauf l’hypothèse où une assignation a été délivrée. En ce cas elle doit être transmise sans attendre à l’assureur.
Une « commission sinistres » ne peut pas être le conseil des réclamants qui ont la faculté de se faire assister ou représenter par l’avocat de leur choix. Une telle conduite, de surcroît chronophage, serait une approche masochiste : encourager les réclamants. En revanche elle se doit d’éviter de décourager par principe. En un mot la probité intellectuelle et la diligence doivent être de règle. Elle ne peut pas utiliser des procédés dilatoires, ni analyser la responsabilité de l’avocat aux lieu et place de l’assureur.
En réalité, l’instruction des sinistres par les Ordres est une création d’intérêt commun. Bien comprise, elle favorise d’abord une image positive de la profession. Il est de l’essence d’une profession indépendante de rendre des comptes. « Il n’est d’homme véritable que responsable, que revendiquant d’être responsable : sa dignité réside par excellence en cela » [5].
En outre, l’assurance de responsabilité garantit une réparation effective puisqu’elle fait échec à l’insolvabilité éventuelle de l’avocat. La franchise est inopposable à la victime et se trouve plafonnée dans le pire des cas à 3050 euros [6]. Dans cette optique, il faut rechercher une démarche cohérente. On ne peut revendiquer la force exécutoire pour l’acte d’avocat en mettant en avant que la responsabilité du rédacteur est garantie par une assurance obligatoire et ensuite utiliser les procédures de plaideurs de mauvaise foi pour chercher à éluder la responsabilité encourue. On admet que l’image de marque de l’avocat est médiocre [7] et l’instruction loyale par des avocats diligents contribuera à la rehausser. A ce stade la réception physique des réclamants et la réponse aux communications téléphoniques est une démarche qui n’a rien d’incongru.
Il entrera dans les tâches de la « commission sinistres » de vérifier l’existence d’un sinistre en examinant s’il répond à la définition du Code des assurances [8]. Avant d’adresser la déclaration de sinistre à l’avocat, dans un court laps de temps, il faudra rassembler pièces et renseignements permettant à l’assureur d’instruire rapidement le sinistre. En outre le coût de l’instruction sera diminué en dégageant de tâches fastidieuses les gestionnaires de sinistres, professionnels de l’assurance.
Contrairement à une opinion répandue l’utilisation de manœuvres dilatoires n’a même pas pour justification l’aspect économique, le coût de la prime [9]. En effet les transactions, quand elles aboutissent, coûtent moins cher à l’assureur qu’un procès mené parfois jusque devant la Cour de cassation. On laissera de côté l’image désastreuse pour la profession. Le courtier qui écrit qu’il doit en référer à une « commission sinistres » qui n’existe pas, que la responsabilité suppose l’existence d’« une faute suffisamment grossière », qu’il faut en référer à des « consultants spécialisés », dont on se refuse à donner l’identité, ne satisfait pas pour le moins à ces exigences.
Ainsi les « commission sinistres », bien comprises et bien pensées, correspondent donc à l’intérêt commun des avocats, des assureurs et des réclamants.
Dans le même esprit, qui relève incidemment de l’accès au droit [10], l’information des clients de l’avocat et des justiciables permet une clarification utile à tous. Les réclamations traduisent souvent des doléances mélangées, voire confuses, qui correspondent à des compétences et des procédures diverses pour y apporter une solution. Un Bâtonnier est compétent suivant une procédure particulière pour les honoraires, les restitutions de pièces, les plaintes déontologiques. L’instruction des litiges de responsabilité civile, si elle doit conduire à une instance, relève en revanche des procédures de droit commun [11]. Il n’y aurait donc qu’avantage à ce que des modèles de lettres présentent, avec une brève explication, les possibilités offertes aux réclamants.
On voit, en effet, des modèles disponibles sur Internet, mais les erreurs ou approximations ne permettent pas d’atteindre l’objectif souhaité. Que dire en effet d’une recommandation qui propose, face au silence du Bâtonnier, de s’adresser au président de l’Ordre national des avocats ? Il n’y a jamais eu d’Ordre national dans la profession. Une clarification à la portée des réclamants va rejoindre la satisfaction des mêmes intérêts. Elle facilitera la tâche des Bâtonniers, envahis de réclamations à instruire, des avocats auxquels on ne pourra plus reprocher le déni, aux assureurs qui n’auront plus à se pencher sur des réclamations qui échappent à leur compétence (les litiges d’honoraires) et aux réclamants qui agiront dans la clarté… ou renonceront à réclamer.
Ainsi, pour un règlement rapide et honnête des sinistres, la profession peut créer et développer des outils qui, ayant déjà fait leur preuve, méritent d’être mieux connus.
[1] Loi du 31 décembre 1971, art. 27 (N° Lexbase : L6343AGZ).
[2] Voir par exemple : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-23786 (N° Lexbase : A0704NYQ], à paraître au Bulletin.
[3] Loi du 31 décembre 1971, art. 21 (N° Lexbase : L6343AGZ).
[4] Décret du 27 novembre 1991, art. 163 (N° Lexbase : L8168AID).
[5] Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2014/2015, n° 21.
[6] Décret du 27 novembre 1991, art. 205 (N° Lexbase : L8168AID).
[7] Voir les chroniques régulières de D. Soulez-Larivière à La Gazette du Palais.
[8] C. assur., art. L. 121-1 (N° Lexbase : L0077AA4).
[9] R. Bigot, L’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle. L’exemple des professions du droit et du chiffre, avant-propos H. Slim, préface D. Noguéro, Lextenso, éd. Defrénois, coll. Doctorat & Notariat, t. 53, 2014.
[11] Loi du 31 décembre 1971, art. 26 (N° Lexbase : L6343AGZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475996
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - L’appréhension des risques par l’assureur dominant
Lecture: 2 min
N6094BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Pierre Roger, Responsable souscription des grands comptes professions du chiffre et du droit, MMA
Le 03 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici N° Lexbase : N6281BYB.
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio
Les enjeux du risque avocat par MMA
Reconstitution nationale des sinistres - Responsabilité civile professionnelle (RC PRO) « Avocats »
- La série est constituée par les dossiers gérés par MMA (représentant 76%) complétée par les données de deux autres assureurs communiquées lors d’appels d’offre.
- L’année d’ouverture correspond à la date à laquelle l’assureur enregistre la déclaration du sinistre
- Le 1er janvier 2012 marque la suppression de la profession d’avoué et le début d’une dérive des ouvertures de dossiers
Sinistralité sur l’activité juridique
- Les sinistres liés à la procédure d’appel contribue fortement à l’aggravation constatée, particulièrement marquée sur les années d’ouverture 2018 et 2019.
- La progression moyenne annuelle observée depuis le 1er janvier 2012 sur le volet judiciaire atteint pratiquement +15%/an (+45%/an pour la procédure d’appel _ + 8%/an hors procédure d’appel)
Analyse en nombre des dossiers RC classés de 2016 à 2019
- Les réclamations classées sans suite ne donnent lieu à aucun règlement. Elles correspondent principalement à des dossiers avocats sans faute, ou accessoirement sans préjudice. Elles commandent néanmoins une instruction et une réponse probante.
- Les dossiers amiables peuvent marginalement induire des frais d’expertise pour évaluer le préjudice dont il est demandé réparation et/ou d’avocat pour sécuriser un protocole.
- Les dossiers judiciaires gagnés ont une durée de vie moyenne supérieure à cinq années avec un appel formé dans 80% des dossiers. Le débat porte essentiellement sur la faute ou le lien causal.
- Les dossiers judiciaires donnant lieu à indemnisation font l’objet d’un accord transactionnel dans 30% des cas en cours de procédure. Le débat porte essentiellement sur le préjudice allégué.
Analyse en montant des dossiers RC classés de 2016 à 2019
Synthèse des indicateurs
- Le montant moyen des réclamations formulées amiablement sont significativement inférieures à celles faisant l’objet d’une procédure judiciaire.
Réclamations supérieures à la garantie
- Le nombre réclamations dont le montant est supérieure à la garantie souscrite par le barreau connaît une inflation constante, directement corrélée avec la croissance du poids des opérations économiques auxquelles les avocats prêtent leur concours.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476094
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Le point de vue des responsables de formation (vidéo)
Lecture: 1 min
N6286BYH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Morgane Daury, Professeur, UPJV, Directrice de l’IEJ d’Amiens et Maître Patrick Delahay, président honoraire d’IXAD et président de l’AFEDA (association des écoles d’avocats) (vidéo)
Le 03 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
Les interventions de Morgane Daury et de Maître Patrick Delahay sont à retrouver en intégralité sur la WebTV de l'Université de Picardie Jules Verne.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476286
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Prévention des risques par la formation de l’avocat (Le point de vue d’un Bâtonnier)
Lecture: 11 min
N5995BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maître Fabrice Bertolotti, Président du Conseil Régional de Discipline des Avocats du ressort de la cour d'appel d’Amiens
Le 03 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
Merci de me donner la parole.
Comme disait Monsieur le Bâtonnier Yves Avril lors de son intervention, « Il y a des clients paranoïaques » mais il y a aussi sans doute des avocats schizophrènes.
En me demandant de donner mon point de vue en qualité de Président du Conseil Régional de Discipline sur ce sujet, compte tenu de sa nature, j’ai moi-même redouté un instant de tomber dans une attitude schizophrénique.
En effet, je me suis interrogé sur le point de savoir si j’étais le plus qualifié pour m’exprimer sur la prévention, quant à la formation disciplinaire on associe plutôt le mot « répression », nos fonctions s’exerçant par essence lorsque la prévention a échoué.
J’essaierai donc modestement d’apporter ma contribution « thérapeutique » en lien évidemment avec celle du contentieux disciplinaire qui, à sa façon, constitue une photographie, un marqueur de ce que la formation n’a peut-être pas toujours su apporter.
Les décisions disciplinaires agissent, il est vrai, comme des témoins de nos activités.
Sans faire une étude épistémologique de celle-ci, l’on doit sans doute tirer les conséquences de certains phénomènes et faits rencontrés afin de s‘interroger sur les orientations de la formation.
Une formation pour quel avocat ?
Former l’avocat à être un avocat, et j’ajouterai à demeurer un avocat.
Le Code de la route a bien évolué depuis que l’on a passé notre permis de conduire et je ne suis pas certain de ne pas échouer aujourd’hui l’examen du code.
Notre Code de déontologie, notre déontologie elle-même a beaucoup évolué et pourtant, combien d’entre nous, combien de nos confrères ont suivi un enseignement de déontologie, une formation au-delà des premières années ?
Sans doute faudrait-il s’interroger sur le fait de rendre obligatoire un certain volume d’enseignement déontologique par an pour l’avocat ou de réfléchir sur l’actualisation de la connaissance de nos règles.
Ces observations liminaires effectuées, pour comprendre les enjeux de la formation, je ferai un bref détour par l’Histoire.
Ce sera l’occasion une nouvelle fois pour moi de parler de Compiègne, ma ville d’exercice.
Quand on parle de Compiègne, on pense à Napoléon mais l’on doit aussi penser à l’impératrice Marie-Louise, sans laquelle peut-être le barreau lui-même n’aurait pas été rétabli.
Vous connaissez l’histoire.
Il pleut à torrents comme à Saint-Brieuc, le mardi 27 mars 1810, lorsque Marie-Louise y rencontre Napoléon venu au-devant d’elle dans un petit village à Braine à la sortie de la forêt de Compiègne.
Vous connaissez la suite, après leur séjour à Compiègne et un voyage de noces, presqu’une campagne, quelques mois plus tard, le 12 novembre 1810, l’Empereur informera le Sénat de la grossesse de l’Impératrice.
Un mois plus tard, sans doute encore tout ardent, bouillonnant, ou enthousiaste de cette nouvelle, il rétablira les avocats par la loi du 22 ventôse en 12 et le tableau des avocats en justifiant celle-ci dans son préambule :
« Comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l’amour de la vérité et de la Justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état.
En retraçant aujourd’hui les règles de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, il convient d’assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle ; nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d’avocat, en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l’insubordination ».
Et l’article 23 de donner à l’équivalent du conseil de l’Ordre de l’époque une orientation sur la personne des avocats et leur formation avec un attachement aux mœurs :
« 23. Le conseil de discipline sera chargé,
De veiller à la conservation de l’honneur de l’Ordre des avocats ;
De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession ;
De réprimer ou de faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l’action des tribunaux, s’il y a lieu.
Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage ; il pourra dans le cas d’inexactitude habituelle ou d’inconduite notoire prolonger d’une année la durée de leur stage ou même refuser l’admission au tableau ».
Quelles mœurs ? Quelle conduite ? Quelle formation aujourd’hui pour quels avocats ?
La manière de voir l’avocat, la représentation de l’avocat, le paradigme de celui-ci du 19ème n’est pas le même qu’au 20ème et encore moins celui du 21ème siècle à l’heure de la justice prédictive, de l’intelligence artificielle, de WhatsApp, TikTok,… etc.
Et pourtant nos principes qui doivent nous guider, sont intangibles.
Rappelons à cet égard que l’avocat n’est pas placé dans la même situation que les autres professionnels du droit.
C’est presque le « surhomme » de Nietzche « l’idéal de l’humanité ».
On doit former quelqu’un, un « sur-être » juridique parmi les professions judiciaires et c’est tout l’enjeu de la formation.
Ce n’est pas moi qui dessine les contours de celui-ci mais la jurisprudence et la loi elle-même.
Si les magistrats sont dépositaires de la Justice, les avocats sont les auxiliaires de la Justice.
Je vous invite à relire la motivation de la décision du Conseil Constitutionnel du 11 octobre 2018 à la suite de la saisie par la Cour de cassation d’une QPC sur l’absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats.
Je vous rappelle que les notaires, les huissiers, connaissent une prescription en matière disciplinaire que ne connaissent pas les avocats.
Cette décision déclare précisément conforme à la Constitution l’absence de prescription des poursuites disciplinaires chez les avocats, notamment car, et c’est important, « la profession d’avocat n’est pas placée au regard du droit disciplinaire dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées.
Dès lors, la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les avocats et les membres des professions judiciaires ou juridiques règlementées dont le régime disciplinaire est soumis à des règles de prescription repose sur une différence de situation.
En outre, elle est en rapport avec l’objet de la loi.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté ».
L’avocat n’est pas placé dans la même situation que les autres professions judiciaires.
Notre formation doit être à la mesure de ces exigences.
Comme disait Maurice Garcon, dans son ouvrage, L’avocat et la morale, « il ne doit pas se contenter d’être honnête, il doit pousser le scrupule jusqu’à l’excès ».
C’est que la loi elle-même habille l’avocat d’un état singulier.
Les mots ont un sens. L’article 5 de la loi du 31.12.1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) énonce que les avocats « exercent leur ministère (…) ».
Je n’ai pas dit un ministère, même l’actualité récente et la nomination d’un de mes confrères a pu crisper…
L’article 10 du décret du 12.07.2005 (N° Lexbase : L6025IGA) rappelle également que l’avocat a une mission.
Mission, ministère, on voit bien qu’il y a autre chose dans les qualités attendues de l’avocat qui vont au-delà des connaissances juridiques ou techniques.
On doit mettre en perspective l’obligation de formation avec notre déontologie, et les obligations principales qui sont autant de devoirs, vertus ou qualités morales que doit respecter chaque avocat.
On dénombre ainsi pas moins de vingt obligations, deux ayant été nouvellement rajoutées en 2019, qui constituent autant de principes et essentiels dont le manquement est susceptible de poursuites disciplinaires :
L’indépendance, la dignité, la conscience, la probité, l’humanité, l’honneur, la délicatesse, le respect du secret professionnel, la compétence, le dévouement, la diligence, la prudence, la modération, le désintéressement, l’évitement du conflit d’intérêt, la loyauté, la confraternité, la courtoisie, la non-discrimination et l’égalité, ces deux derniers principes ayant en effet été ajoutés en 2019.
Ils doivent guider l’avocat aux termes de l’article 1er du décret du 12.07.2005 (N° Lexbase : L6025IGA), en toute circonstance.
Ces éléments de contexte rappelés, ils renvoient à mon sens à deux objectifs de la formation :
La nécessité de former l’avocat aux savoirs et l’impérieuse nécessité également de former l’avocat aux humanités.
On s’est trop longtemps focalisés sur le premier terme pour oublier le second.
Le rapport de mon confrère Kami Haeri de 2017 au Garde des Sceaux de l’époque, fait le constat d’une formation inadaptée aux enjeux de la profession.
« La formation du jeune avocat concentre toutes les espérances et les frustrations de la profession.
Etape essentielle sur le plan de l’apprentissage, comme sur celui de l’intégration, de la création d’un sentiment d’appartenance, la formation du jeune avocat fabrique un étrange paradoxe : jamais une profession aussi désirée et respectée par celles et ceux qui souhaitent la rejoindre n’a été précédée d’un espace-temps de formation aussi décrié.
Les élèves avocats semblent majoritairement attendre avec résignation que leur formation initiale s’achève...
La formation est perçue assez unanimement comme une suite d’enseignements trop variés pour permettre de dégager une stratégie d’apprentissage et dont le contenu est de qualité très inégale ».
Un virage récent a été opéré de ne pas refaire ce que l’on avait fait souvent mieux d’ailleurs ou ce que l’on était censé avoir fait à l’Université.
La décision du Conseil National des Barreaux 2020-001 définit les nouveaux programmes de formation.
Prévenir les risques suppose de mieux former avec un enseignement renouvelé et adapté alors que jamais la profession n’a été confrontée à de tels changements, dans un contexte technique, technologique radicalement nouveau et même de Co-vid, qui impose de nouveaux modèles.
Toutes les écoles d’avocats ont entamé leur évolution.
Je cite pour extrait le livret d’accueil de l’EFB de Paris pour la rentrée 2020 : les objectifs des enseignements : « la période d’enseignement n’est pas une redite de l’Université…».
En témoigne également l’IXAD, l’Ecole des Avocats du Nord-Ouest, qui met en place des parcours dynamiques.
Exemple des parcours : oralité, digital numérique, sans oublier la déontologie.
C’est le rôle des écoles d’avocats de former les avocats aux savoirs et aux humanités.
C’est le rôle également de l’avocat de se former lui-même pendant toute sa vie professionnelle.
Il existe bien entendu l’obligation de formation continue et les 20 heures par année civile ou 40 heures annuelles prévues à l’article 14-2 de la Loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui rappellent qu’elle est obligatoire.
La sanction du non-respect de l’obligation de formation continue n’a pas été formellement prévue par les textes, mais l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) expose de manière générale que tout avocat qui contrevient aux lois et aux règlements, ou qui commet une infraction aux règles professionnelles est soumis à des sanctions disciplinaires.
Plusieurs jurisprudences ont condamné des avocats n’ayant pas respecté leur obligation de formation continue à des sanctions disciplinaires.
Ils sont pourtant rares les Bâtonniers qui prennent l’initiative de poursuites sur ce seul fondement.
Souvent d’ailleurs, ce manquement, dans les décisions des conseils régionaux de discipline, coexiste avec d’autres.
Il rejoint également souvent le manquement au devoir de compétence dont le non-respect commence aussi à donner lieu à des poursuites disciplinaires autonomes.
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les statistiques de l’assureur sur les sinistres et leur nombre annuel sur l’ensemble de la population des avocats.
Il manque une donnée, celle des statistiques par avocat car nous savons, les Bâtonniers le savent, que certains vont avoir une sinistralité plus forte.
Je conclurai par cette formule d’Einstein « L’école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes » tout en vous disant que je ne la partage pas.
Car à l’instar du Bâtonnier Yves Avril, j’ai l’espoir, oui j’ai l’espoir d’avocats à la personnalité harmonieuse et spécialistes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475995
[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Propos conclusifs (vidéo)
Lecture: 1 min
N6287BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Florence G’sell, Professeur à l’Université de Lorraine
Le 03 Février 2021
Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
L'intervention en vidéo de Florence G’sell est à retrouver en intégralité sur la WebTV de l'Université de Picardie Jules Verne.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476287
[Brèves] Un agent de droit privé peut-il bénéficier de la passerelle d’accès à la profession d’avocat des fonctionnaires ?
Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-18.273, F-P (N° Lexbase : A89494B3)
Lecture: 2 min
N6017BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 13 Janvier 2021
► Le juriste non soumis à un statut de droit public et qui relève du groupe des agents de droit privé ne peut être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de catégorie A et, par conséquent, bénéficier de la passerelle de l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID).
Procédure. Le demandeur au pourvoi avait sollicité son inscription au tableau de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle, et à l’article 98, 4°, du même texte pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant, en cette qualité, exercé des activités juridiques pendant la même durée. Le juriste faisait, notamment, grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 14 mars 2019, n° 18/19278 N° Lexbase : A4945Y8N) de rejeter sa demande d’inscription au barreau sous le bénéfice de l’article 98, 4° précité. Il considérait notamment, contrairement à ce qui avait été retenu par la cour d’appel, que l'assimilation à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de cet article, n’était pas réservée au salarié relevant d'un statut de droit public.
Réponse de la Cour. Ayant énoncé que, selon l’article L. 224-7 du Code de la santé publique, le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique, des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret, et des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de Sécurité sociale, et constaté que, selon les bulletins de salaire et le contrat de travail du demandeur, celui-ci était soumis à la convention collective du 8 février 1957, de sorte qu’il n’était pas soumis à un statut de droit public et relevait du groupe des agents de droit privé, la Cour conclut que la cour d’appel en a justement déduit que l'intéressé ne pouvait être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de catégorie A.
Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E43313RT). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476017
[Brèves] Irrégularité de la composition d’un jury d'examen d'entrée au CRFPA au sein duquel deux membres avaient siégé plus de cinq années consécutives
Réf. : CAA Versailles,10 décembre 2020, n° 18VE02368 (N° Lexbase : A08244B7)
Lecture: 5 min
N6299BYX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 03 Février 2021
►Les membres du jury d'examen d'entrée au CRFPA ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives ; cette limitation s’applique aussi également aux membres suppléants qui n'auraient pas effectivement été appelés participer à la délibération du jury.
Faits/Procédure. Un étudiant était inscrit au titre de l'année universitaire 2014/2015 auprès de l'Institut des études judiciaires (IEJ) de l'Université Paris-XI pour préparer l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Ayant obtenu la note de 4/20 à l'épreuve d'admission « exposé discussion », il a été ajourné par la délibération du jury du 1er décembre 2015. Le 4 décembre 2015, il a formé un recours gracieux. Le 5 janvier 2016, il a été reçu par la directrice de l'IEJ, le président du jury et le directeur des études de l'IEJ. Au terme de cet entretien, son ajournement a été confirmé. L’étudiant fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision portant désignation des membres du jury de l'examen d'entrée au CRFPA pour la session 2014-2015, d'annuler l'épreuve de l'exposé-discussion, la délibération du jury d'examen ayant prononcé son ajournement à l'examen, la décision du jury d'examen de l'Université Paris-Sud de lui attribuer la note de 4/20 à l'épreuve de l'exposé-discussion, et la décision orale du 5 janvier 2016 rejetant son recours gracieux.
- Sur la composition irrégulière du jury de l'examen d'accès au CRFPA
L’étudiant soutient que deux membres du jury ont siégé plus de cinq années consécutives en méconnaissance des dispositions de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). La cour administrative de Versailles rappelle les dispositions de l'article 53 précité. Elle relève qu’en l’espèce un des membres a été désignée par le Président de l'Université Paris-Sud en qualité de membre suppléant au titre des sessions 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, soit au cours de six années consécutives et que le magistrat administratif, désigné par le Président de la cour administrative de Versailles l'a été en qualité de suppléant au titre de 2010 et de titulaire pour les sessions 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Contrairement à ce que fait valoir l'Université Paris-XI, il résulte des dispositions précitées de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 que la limitation à cinq ans du nombre d'années au cours desquelles les membres du jury, à l'exception de ceux visés au 4°, peuvent siéger s'applique également aux membres suppléants qui n'auraient pas effectivement été appelés participer à la délibération du jury. Au demeurant, l'Université n'établit pas que la présidente n'aurait pas siégé au cours des années concernées alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière a paraphé le procès-verbal définitif de délibération d'admission et signé le relevé de notes et résultats sur lesquels figure l'ajournement de l’intéressé. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir que la composition du jury de l'examen d'accès au CRFPA était irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération du 1er décembre 2015 prononçant son ajournement.
- Sur l’absence de signature de la délibération du jury
La cour administrative d’appel de Versailles rappelle qu’aux termes de l'article L. 221-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1825KNW) : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S'agissant de la délibération d'un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Or, en l’espèce, la cour constate que le procès-verbal définitif de délibération d'admission du contestée n'est revêtu que des initiales de quatre personnes et ne comprend aucune mention des noms, prénoms et qualité de ses signataires et notamment du président du jury. Dans ces conditions, et alors que ce vice fait obstacle à l'identification des personnes ayant délibéré sur l'admission du requérant à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats, le requérant est fondé à soutenir que cette irrégularité entache d'illégalité la délibération contestée et à demander, pour ce second motif, son annulation. Elle conclut, que le requérant est fondé à demander à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération prononçant son ajournement à l'examen d'entrée au CRFPA.
Annulation. Le requérant est donc fondé à demander à l'annulation du jugement ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération prononçant son ajournement à l'examen d'entrée au CRFPA. La cour précise que l’exécution du présent jugement implique que le requérant soit autorisé à se présenter de nouveau, selon les modalités de contrôle des connaissances actuellement en vigueur, à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats organisé par l'Université par l'Université Paris-XI.
| Pour aller plus loin : V. ETUDE : La formation professionnelle des avocats, La formation initiale de l'avocat, Les conditions d'accès à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocats, in La profession d'avocat, N° Lexbase : E32993RM). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476299
[Brèves] Passerelle « juriste/avocat » : les huit années d’exercice doivent être postérieures à l’obtention du diplôme de Master 1
Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2021, n° 19/13559 (N° Lexbase : A64254DC)
Lecture: 3 min
N6302BY3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 03 Février 2021
► Si le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) admet la prise en considération combinée des activités de juriste d'entreprise et de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoués ou d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, c'est à la condition que ces périodes d'activité soient postérieures à l'obtention d’une maîtrise en droit ou de titre ou diplôme reconnu comme équivalent.
Textes. La cour rappelle les dispositions de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
[…] 6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ». C’est-à-dire « 2° Être titulaire sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la Directive 2005/36/CEE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée ([LXB=L6201HCN), et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé des Universités ».
Argumentation de l'appelante. L’appelante fait valoir qu'elle a débuté son exercice professionnel le 2 décembre 2002, jusqu'au 11 février 2009, soit 6 années pleines, en qualité de juriste-collaborateur au sein du département « Corporate & Litigation » de la société Price Waterhouse Coopers (PWC) et que du 2 février 2012 jusqu'au 23 novembre 2014, soit deux années pleines, elle a occupé les fonctions de responsable juridique au sein du service juridique du groupe EMERA.
Réponse de la cour. Mais la cour relève que l’appelante ayant obtenu son Master en droit en 2017, elle ne justifie pas de la condition de l'article 98-6° relative aux 8 années de pratique postérieure à l'obtention du diplôme exigé. Elle fait sienne l’argumentation de l'Ordre des avocats qui fait valoir que si le décret précité admet la prise en considération combinée des activités de juriste d'entreprise et de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoués ou d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est à la condition que ces périodes d'activité soient postérieures à l'obtention du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi de 1971, de sorte que n'ayant obtenu son diplôme qu'en 2017, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice du 6° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Confirmation. La délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Grasse qui a refusé de la dispenser de l'examen du CRFPA est donc confirmé.
| Pour aller plus loin : V. ETUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Les juristes salariés des avocats et des anciens avoués, in La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E33503RI). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476302
[Brèves] Modification du RIN afin d'inciter les avocats à recourir aux MARD
Réf. : Décision du 18 décembre 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : Z947691A).
Lecture: 2 min
N6103BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 20 Janvier 2021
► A été publié au Journal officiel du 17 janvier 2021, la décision du 18 décembre 2020 portant modification des articles 6.1 et 8.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) relatifs à la mission générale de l’avocat et au règlement amiable.
Sur la base d’un rapport de son groupe de travail « RIN et MARD », l’assemblée générale du CNB avait adopté le 18 décembre 2020, après concertation de la profession, la décision à caractère normatif n° 2020-004 portant modification des deux articles précités. L’objectif affiché : inciter les avocats à recourir aux MARD et à mieux les intégrer dans leurs réflexes.
- L'article 6.1
Après le troisième alinéa de l'article 6.1, il est inséré un alinéa désormais ainsi rédigé :
« Lorsque la loi ne l'impose pas, il est recommandé à l'avocat d'examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d'une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d'un acte juridique en introduisant une clause à cet effet. »
- L’article 8.2
La première phrase du premier alinéa de l'article 8.2 est, elle, remplacée par les dispositions suivantes :
« Avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat peut, sous réserve de recueillir l'assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend. ».
| Pour aller plus loin : v., ÉTUDE : Les rapports entre avocats et avec les professionnels de Justice, Le règlement amiable avec la partie adverse, in La profession d'Avocat, Lexbase (N° Lexbase : E39473RM). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476103
[Textes] La médiation ne sera pas obligatoire ou elle ne sera pas… décryptage
Réf. : Décision du 18 décembre 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : Z947691A)
Lecture: 15 min
N6340BYH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Michèle Jaudel, Avocat au barreau de Paris Médiateur référencé au CNMA (Conseil national des barreaux), inscrit sur les listes des cours d’appel de Paris et Angers Médiateur agréé auprès du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP)
Le 29 Juillet 2021
Mots-clés : texte • avocats • RIN • MARD • responsabilité • déontologie • pédagogie • formation
Le développement des modes amiables de règlement des différends (MARD) est aujourd’hui une évidence. Ce qui n’implique pas pour autant que l’on puisse constater un recours très significatif à ces outils.
J’entends vous parler de mon expérience en ce domaine, plus particulièrement dans celui de la médiation, ayant suivi une formation de médiateur, auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP), il y a quinze ans et pratiquant depuis, toujours avec autant d’enthousiasme, ma profession d’avocat conseil, de contentieux et maintenant aussi d’avocat prescripteur et accompagnateur de mes clients en médiation, ainsi que de médiateur désigné par les juridictions et conventionnellement par les parties directement.
Alors oui, je n’hésiterai pas à l’affirmer : magistrats, avocats et justiciables, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, dorénavant tous connaissent l’existence de la médiation, ce qui ne veut pas dire qu’ils la prescrivent, la pratiquent ou la connaissent vraiment, tout simplement.
Le Conseil national des barreaux (CNB) s’est emparé du sujet, de son paradoxe et des difficultés qui en découlent inéluctablement.
Il est grand temps en effet que les MARD soient reconnus pour ce qu’ils sont véritablement, à savoir un outil favorisant la qualité de solutions adaptées aux besoins du justiciable et de la société. Il ne suffit pas d’en parler et d’exprimer une reconnaissance de leur utilité… pour les autres, il convient avant tout de reconnaître les raisons pour lesquelles la performance est réelle et pour cela de se former pour les appréhender, les pratiquer effectivement et à bon escient.
Un groupe de travail [1] a été constitué au sein du CNB à l’effet de réfléchir à l’opportunité ou non d’une modification du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (R.I.N.) (N° Lexbase : L4063IP8), pour donner un écho à l’élaboration d’un article 3.7.1 du Code de déontologie des avocats européens, ce Code de déontologie étant, pour mémoire, annexé au R.I.N.
L’article 3.7.1 dispose :
« L’avocat doit essayer à tout moment de trouver une solution au litige du client qui soit appropriée au coût de l’affaire et il doit lui donner, le moment opportun, les conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de recourir à des modes alternatifs de règlement des litiges. »
Le groupe de travail a eu pour objectif de faire des MARD un axe majeur dans l’avenir de l’avocat et, pour l’inciter à y recourir et renforcer le recours par ce-dernier aux MARD, il a suggéré d’insérer un nouvel alinéa 4 à l’article 6.1 du R.I.N. et il a proposé une rédaction plus claire et positive de l’actuel alinéa 1 de l’article 8.2 du R.I.N.
Le groupe de travail a également, en vue de garantir la proportionnalité de la mesure proposée à l’Assemblée générale, comme l’impose désormais la Directive (UE) 2018/958 du 28 juin 2018 relative au contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions (N° Lexbase : L3560LLG), évalué les différentes options envisageables pour inciter les avocats à adopter une conduite adaptée par rapport à l’efficacité des MARD, dans l’objectif de promouvoir une meilleure protection du justiciable et une meilleure administration de la justice.
A l’issue de ces travaux, le groupe de travail a opté pour la voie de la recommandation, de l’incitation, sans obliger l’avocat, de manière à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi sans excéder ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
Le 18 décembre 2020, l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux a adopté une décision à caractère normatif n°2020-004 portant réforme du règlement intérieur national de la profession d’avocat en ses articles 6.1 et 8.2, ce qui a fait l’objet d’une publication au Journal officiel du 17 janvier 2021.
L’article 6.1 du R.I.N. est complété (en gras dans le texte) comme suit :
« 6.1 MISSION GENERALE
Partenaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale. Il est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu’il assiste ou représente en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public comme à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial.
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies, que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
Lorsque la loi ne l’impose pas, il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d’une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d’un acte juridique en introduisant une clause à cet effet.
Dans l’accomplissement de ses missions, l’avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s’assurer de son indépendance, et de l’application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d’intérêts ».
L’article 8.2 du R.I.N. est modifié (en gras dans le texte) comme suit :
« 8.2 REGLEMENT AMIABLE
Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. Avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat peut, sous réserve de recueillir l’assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure.
L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier.
La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil.
Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut prendre l’initiative. »
Afin de décrypter les motivations et les effets de ces travaux et résolutions, je vais m’attacher à réaliser un bref constat quant au rôle joué par les avocats dans le domaine de la médiation jusque dans un passé récent (I) afin de souligner ensuite ce que la modification du R.I.N. change (II) et envisager enfin ce qui peut et doit encore changer (III).
Cet exercice n’a pour seul objectif que de convaincre avec pragmatisme et humilité que les avocats, de par leur engagement, leur responsabilité et leur éthique [2] ont un rôle déterminant dans le succès du recours à la médiation, qui engendrera au demeurant un développement durable de leur activité professionnelle et la bonne marche de leur cabinet.
I - Le constat
Les avocats sont peut-être ceux qui se sont penchés le plus sur la médiation, mais sans jamais bien et complètement se l’approprier.
Si l’on laisse de côté les postures de principe résolument hostiles à la médiation et aux modes amiables en général - où ils sont perçus comme un mode de concurrence dans un monopole de la défense menacé -, on relèvera deux types de positionnement chez les avocats qui souhaitent investir ce champ, l’un renvoyant à une conception attributive de la compétence, l’autre à une conception de spécialisation.
Les premiers défendent l’idée qu’ils sont en capacité de résoudre des conflits à l’amiable sans une formation supplémentaire. D’autres avocats s’accordent à considérer que les seuls fondamentaux de la profession ne suffisent pas pour accomplir des médiations et/ou pour bien prescrire et accompagner le justiciable en médiation.
Le rattachement à l’une ou l’autre des postures n’a pas le même résultat en termes de promotion et d’incitation à la médiation. Dans la première il s’agit d’un investissement a minima, dans la seconde, considérer qu’il s’agit d’une spécialisation sous-entend que le professionnel s’est formé et par là-même peut adopter un discours, une rhétorique et une posture différente [3].
En dépit des colloques, conférences, publications et prolifération des formations de médiateur, ainsi que des actions de promotion courageuses et innovantes de représentants du barreau, on se retrouve confronté à la constatation suivante :
- soit l’avocat se dit faire de la médiation naturellement, comme s’inscrivant dans l’ADN de son exercice professionnel, et il n’a pas besoin de recourir aux services d’un tiers formé à cet effet,
- soit il se forme pour devenir médiateur en attendant ensuite que les médiations « tombent du ciel »…
Dans les deux cas, l’avocat qui croit faire de la médiation comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, passe à côté de son rôle de conseil et de prescripteur.
Moins l’avocat est formé, moins il n’a d’appétence pour la médiation.
En réalité, il croit connaître ce qu’il ne connaît pas ou a minima ne maîtrise pas.
Aujourd’hui, je constate que la sensibilisation à la médiation ne suffit pas. Si nous laissons bon nombre d’avocats mettre en exergue la posture du médiateur « naturel », considérant alors toute formation comme accessoire, l’implication efficace des avocats dans la médiation ne sera le fait que d’avocats convaincus.
Et tout un pan des devoirs et obligations de l’avocat restera occulté [4].
Il est vain de ne promouvoir qu’un processus pour lequel les potentiels médiés ne trouvent pas suffisamment d’avocats formés comme prescripteurs et accompagnateurs.
Un autre point que l’on constate au fil des années et des législations qui passent… c’est la difficulté pour l’avocat (et par ricochet le justiciable) de distinguer dans le flou autour de la définition de la médiation et des explications des outils qui la servent, les différences avec la transaction, la conciliation, la médiation des entreprises, la médiation de la consommation, etc.
Or, pour paraphraser Albert Camus, mal nommer les choses, c’est se condamner à mal faire.
II - Ce que la modification du R.I.N. change
Le CNB a franchi un cap essentiel. Il n’a pas hésité à dire que le recours à la médiation, à tous les MARD d’ailleurs, relevait d’une nécessaire incitation afin de créer une culture des modes amiables, un réflexe de nature à insuffler une ligne claire qui doit faire des MARD un axe majeur dans l’avenir de l’avocat.
Il a été délibérément proposé par le groupe de travail de ne pas aller au-delà de la recommandation à l’avocat de recourir aux MARD.
Il est pertinent d’inciter l’avocat à s’approprier les outils des MARD et notamment de la médiation pour accomplir l’oeuvre de justice en donnant à son client le conseil approprié. Ces outils, c’est en apprenant à les maîtriser que l’avocat, dans l’exercice en toute liberté et indépendance de sa mission, construira sa stratégie dans l’intérêt des besoins de son client.
L’Assemblée générale du CNB n’a pas hésité à adopter des textes qui énoncent clairement les démarches positives en faveur des MARD, que l’avocat entreprendra avec ses clients avant ou au cours du contentieux, qu’il engagera également dans un échange constructif avec son contradicteur, sans omettre d’insérer dans les actes juridiques des clauses de recours aux modes amiables préalablement à toute saisine du tribunal.
Une obligation de recourir aux MARD serait vouée à l'échec, en ajoutant un risque de sanction en cas de non recours aux MARD, ce qui est non seulement contraire au principe même de l’adhésion volontaire du justiciable au processus de médiation, mais encore une épée de Damoclès sur les épaules de l’avocat, inefficace et donc contreproductive (en termes de preuves et de poursuites notamment).
Il convient de rappeler, comme le soutient un ancien Président du CNB, que l’information à propos de la médiation relève d’une obligation de conseil qui pèse sur l’avocat et dont la méconnaissance peut d’ores et déjà ouvrir droit à réparation.
En tout état de cause, ce qu’il faut offrir à l’avocat, c’est :
- l’envie de s’engager sur la voie de ces outils performants,
- et la formation adaptée pour savoir faire et satisfaire son envie.
III - Ce qui peut et doit encore changer
Cet embarras face à la médiation, après cet aménagement en termes d’incitation au recours à la médiation, évoluera nécessairement au fur et à mesure que le justiciable sera assuré de son adaptation à ses besoins, à ceux d’une justice apaisée et rapide.
Cet embarras explique sans doute que l’avocat n’est pas encore le principal prescripteur, puisque de façon assez courante, certains avocats attendent que le magistrat use de son pouvoir de persuasion (l’impérium du juge) envers les justiciables pour ensuite soutenir – ou non – la proposition auprès de son client.
Combien de fois entendons-nous l’avocat dire à son client que de toute façon on n’a pas intérêt à refuser la proposition du juge, allons-y, on verra bien…
Or, c’est exactement l’opposé qu’il convient de faire rentrer dans les réflexes des avocats.
Il leur appartient d’analyser le dossier et d’amener leur client à prendre la décision d’engager ou non un processus de médiation. Ce n’est pas chose aisée, contrairement à ce que l’on imagine.
Le rôle d’un prescripteur, son savoir-faire, l’art de convaincre son client, de convaincre l’autre partie, son contradicteur, n’est pas une sinécure. Or, on ne conseille bien que ce que l’on connaît bien.
Je considère, quand je remplis mon rôle d'avocat et que je suis prescripteur d’une médiation, que je rentre déjà dans le processus pour convaincre l’autre. Les outils du médiateur me sont indispensables pour être à l’aise dans mon exercice et bien conseiller.
Ce sont ces outils, maniés avec discernement, qui permettront de développer le bon usage de la médiation. Il faut savoir faire la bonne recommandation au bon moment et ce sont des milliers d’avocats formés à la prescription et à l’accompagnement qui donneront leurs heures de gloire à la médiation.
La prescription et l’accompagnement passent donc par la formation.
On peut conclure à la nécessité de cultiver une « pédagogie » de la médiation qui gagnerait à être développée à l’ENM et dans les écoles d’avocats afin que cette formation dédiée, qui se distingue de la formation de médiateurs, permette aux magistrats et aux avocats de « toucher du doigt » ce qu’est une médiation et de savoir comment et pourquoi cela marche, et apprendre ainsi à bien la prescrire.
Nous traversons une période propice à ces défis puisqu’une avocate, en la personne de la Vice-bâtonnière du barreau de Paris, Nathalie Roret, dirige l’ENM, et qu’un magistrat, en la personne de Gilles Accomondo, Premier président de la Cour d’appel de Pau, prend ses fonctions comme directeur de l’EFB Paris.
Nathalie Roret s’est d’ailleurs exprimée en ces termes : « En 2021, nous allons pouvoir accélérer l’interprofessionnalité et les formations communes. »
Puisse l’avenir lui donner raison et permettre de placer « L’avocat au cœur de la médiation » !
| 👉 Une formation a d'ailleurs été élaborée par trois avocats médiateurs et accompagnateurs de leurs clients en médiation, et se tiendra pour la première fois les 4 et 5 mars prochains en visioconférence [lien vers le programme]. |
[1] Groupe co-animé par Catherine Peulvé et Dominique de Ginestet, avocates, membres du CNB.
[2] Nos obs., Ethique et responsabilité : l’engagement des juges et des avocats dans le développement de la médiation, désormais une évidence, RLDA, n° 166, janvier 2021, p. 37.
[3] Fathi Ben Mrad, docteur en sociologie, Sociologie des pratiques de médiation: entre principes et compétences, L'Harmattan.
[4] Nos obs., Ethique et responsabilité : l’engagement des juges et des avocats dans le développement de la médiation, désormais une évidence, RLDA, n° 166, janvier 2021, p. 37.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476340
[Le point sur...] Le principe de courtoisie
Lecture: 14 min
N6268BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Pierre-Louis Boyer, Maître de conférences HDR, ThémisUM Le Mans Université (EA4333), IODE Rennes I (UMR CNRS 6262)
Le 23 Mai 2022
Mots-clés : étude • avocat • déontologie • principes essentiels • courtoisie
Cet article est initialement paru dans la revue Lexbase Avocats n° 311 du mois de février 2021.
Si l’on comprend aisément ce que signifie la courtoisie dans nos relations humaines, celle propre aux avocats dépasse de loin la simple politesse des rapports sociaux ou la bienséance due en certaines occasions, qui surpasse même la « civilité raffinée » [1] dont de nombreux avocats font montre en toute situation, car ce principe de courtoisie appelle des comportements et des actes propres à la profession d’avocat.
Le principe identifié en tant que tel de « courtoisie » dans la profession d’avocat n’est pas particulièrement ancien, les traités et ouvrages du XIXe et de la première partie du XXe siècle relatifs à la profession d’avocat et à sa déontologie ne mentionnant que très rarement celui-ci. Toutefois, il nous faut souligner que cette courtoisie est inhérente et intrinsèque à la profession, car, dès la période du Dominat sous l’Empire romain, les empereurs vont rappeler ce devoir spécifique de l’avocat. Ainsi Valentinien, au IVe siècle, exhorte-t-il :
« Qu’ils ne négligent rien de ce qui est utile à la cause, mais qu’ils s’abstiennent des injures. Car que celui qui sera assez impudent pour croire qu’une cause doive se défendre plutôt par des injures que par des raisons, souffre l’infamie. On ne doit pas tolérer de même qu’un avocat après l’affaire finie, continue, soit publiquement ou en secret, à injurier son adversaire » [2].
Au XIIIe siècle, dans les Établissements de Saint-Louis [3], on trouve cette obligation pour les avocats d’agir avec courtoisie en s’abstenant de toute injure ; « courtoisement et sans vilenie » peut-on y lire. Et, toujours à la même époque, Philippe de Beaumanoir rappelait dans la Coutume de Beauvaisis que « néanmoins comme l’avocat peut se tromper lui-même dans son jugement, il doit effectuer ce délaissement avec circonspection et courtoisie » [4].
Si le terme de « courtoisie » est peu présent dans les manuels, traités et autres ouvrages des XIXe et XXe siècles, c’est sans doute que ce principe est tellement naturel à toute sociabilité, et si essentiel à la profession d’avocat, qu’il était inutile de le rappeler. Ce principe de la courtoisie est tellement propre à la profession d’avocat qu’il dépasse les frontières, l’association du barreau de l’État de New York s’étant donnée pour but, dès sa fondation à la fin du XIXe siècle, de « cultiver la science du droit, promouvoir les réformes législatives, faciliter l’administration de la justice, élever le niveau des qualités d’intégrité, d’honneur et de courtoisie parmi les membres de la profession, entretenir entre eux un esprit de fraternité » [5].
C’est avec Fernand Payen que la courtoisie est clairement exposée dans la doctrine du barreau comme un principe découlant de la confraternité, et donc de la fonction même d’avocat. Payen souligne d’ailleurs que cette courtoisie, comme d’autres principes, sont issus « des traditions » et de « l’obscur travail des siècles pour créer, dans ces Palais de Justice où les avocats travaillent côte à côte, l’atmosphère d’estime mutuelle, d’égalité absolue, de courtoisie et de cordialité disciplinée en quoi consiste la confraternité » [6]. Payen fait de la courtoisie un principe corrélatif de l’égalité qui existe entre les avocats, d’où la nécessité d’une « égale politesse et d’une égale courtoisie » [7] entre les confrères. Il s’appuie notamment pour cela sur l’article 6 du décret du 21 juin 1920 ainsi que sur un arrêté du 14 juillet 1874 qui dispose que « le confrère qui se laisse emporter jusqu’à provoquer son adversaire […] est l’objet de mesure disciplinaire » et que l’« on ne doit jamais oublier les égards dus à un confrère et le respect de la robe d’avocat » [8]. Payen fait aussi remarquer, chose qui devrait être rappelée régulièrement dans les écoles d’avocats, que le devoir de courtoisie implique une véritable « déférence des jeunes pour les anciens ».
Enfin, on relèvera que des traditions courtoises sont de moins en moins en usage, le temps et les mœurs faisant leurs (basses ?) œuvres. Quand un avocat plaidait une affaire dans laquelle l’adversaire était un confrère, il lui faisait habituellement une « visite de courtoisie » [9], chose que nous aborderons par la suite. De même, il arrivait régulièrement, et ce jusque dans la seconde partie du XXe siècle, que des avocats s’appellent ou se rencontrent, la veille de l’audience, pour informer leur confrère de la teneur de leur plaidoirie, par simple souci de confraternité et, de fait, de courtoisie.
Aujourd’hui, le principe de courtoisie se matérialise dans les relations qu’un avocat peut entretenir avec ses confrères (1), avec son Bâtonnier (2), mais aussi avec les magistrats (3), toujours dans des liens étroits avec des principes fondamentaux de la profession d’avocat comme la modération, la délicatesse, la diligence, l’honneur, l’humanité, la loyauté, voire le désintéressement, en bref, la confraternité. C’est ce que l’on observe dans la liste de ces principes énumérés à l’article 1er du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat au 1.3, la courtoisie ponctuant, comme une apothéose, ces « principes essentiels de la profession d’avocat » [10], ces principes de la déontologie qui découle « du respect dû ensemble par le juge et l’avocat à l’institution judiciaire », comme le rappelait le président Guy Canivet [11].
I. À l’égard des confrères
La courtoisie entre avocats, compte tenu de la promiscuité qui existe au sein des barreaux (hors période de crise sanitaire…), est au cœur des relations cordiales et pacifiées que se doivent d’entretenir des confrères pour le bien de l’Ordre, celui de leurs clients, et le leur. Si fermeté et pugnacité ne sont pas à évincer pour autant – bien au contraire – les insultes et menaces sont bien évidemment à proscrire [12]. Outre la politesse de leurs échanges, le devoir de courtoisie entre avocats peut se manifester de différentes manières.
Si la visite de courtoisie d’un confrère à un autre, dans le cas où il voudrait introduire une procédure contre lui, n’est plus d’actualité, reste que le principe de courtoisie impose au minimum que l’avocat prévienne son confrère de cette procédure à venir, en lui communiquant aussi l’assignation ou la plainte [13].
De même, si certains s’impatientent parfois de voir des visages inconnus leur passer sans arrêt devant le nez en audience et retarder ainsi leur plaidoirie, il nous faut ici rappeler que le principe de courtoisie exige que la détermination des ordres de passage à l’audience se fasse soit au regard des règles propres à chaque barreau, soit, dans le cas de règles non édictées au sein d’un règlement intérieur, au regard des règles morales que la courtoisie impose aux rapports confraternels, chose qui arrive le plus souvent dans les barreaux français [14]. Et, toujours dans le cadre du comportement à l’audience, on s’abstiendra de plaider sans son confrère si ce dernier est en retard, et l’avocat qui ne pourra respecter son devoir de ponctualité aura à cœur d’en informer au minimum son confrère :
« Il convient donc de refuser de plaider tant que le confrère n’est pas arrivé ; cette règle est exigeante pour l’avocat ponctuel, et la courtoisie minimale exige, de celui qui sait ne pouvoir être à l’heure, de l’indiquer en temps utile à son confrère » [15].
Un avocat ne peut pas non plus, comme l’a relevé la cour d’appel de Lyon, quitter la barre au cours d’une suspension d’audience sans donner de motif à cette désertion, faute de quoi il ne respecterait pas le principe de courtoisie tant à l’égard de son contradicteur qu’à l’égard du magistrat qui préside l’audience [16]. Si les avocats arrivent à conserver ces pratiques respectueuses liées au principe de courtoisie, ils conserveront une véritable indépendance à l’audience car les magistrats n’auront alors pas à veiller de manière excessive au bon déroulement de celle-ci : ces petites règles de sociabilité sont un gage de liberté.
La courtoisie confraternelle veut aussi que « l’on n’adresse pas ses conclusions la veille au soir » [17], chose qui, de fait, est en lien avec le principe de « loyauté » qui vaut entre avocats, que l’on prévienne son contradicteur d’une demande de renvoi, ou encore que l’on fasse « honneur à la robe » [18], c’est-à-dire que l’avocat en tenue de ville laisse la place à celui qui serait « robé ».
II. À l’égard du Bâtonnier
Si le principe de courtoisie s’applique entre confrères, il s’applique aussi bien évidemment à l’égard du confrère par excellence qu’est le Bâtonnier de l’Ordre, à qui tout avocat doit la déférence qui découle de son titre et de ses fonctions. Sa place dans l’ordre de passage à l’audience – en premier – révèle cela, l’adage « le Bâtonnier plaide quand il peut » mettant en exergue cette prérogative particulière.
Évoquons à présent les visites de courtoisie, tradition qui semble malheureusement désuète dans de nombreux barreaux, et qu’il serait bon de maintenir et de promouvoir, pour rappeler l’essentielle confraternité existante entre les avocats. Si ces visites de courtoisie ne sont plus que rarement effectuées par l’avocat d’un barreau extérieur qui doit normalement se présenter au Bâtonnier du barreau dans lequel il vient plaider ainsi qu’au du chef de juridiction [19], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une pratique déontologiquement formalisée au sein du Règlement Intérieur National en son article 1 bis qui dispose :
« En application du principe de courtoisie, l’avocat doit, lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au Bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse ».
Il est vrai que, en cas de manquement à ce devoir qui relève du principe de courtoisie, on ne lui tiendra officiellement pas rigueur de cette défaillance déontologique… pourvu, toutefois, qu’il ne se permette pas d’être désobligeant avec le Bâtonnier du barreau local, faute de quoi l’avocat pourrait être suivi disciplinairement [20]. Reste toutefois que cette règle de courtoisie, prévue au sein du RIN et conforme à une véritable éthique confraternelle, malgré tous les bienfaits qu’elle peut apporter, « se maintient difficilement » [21].
A l’égard du Bâtonnier et de l’ensemble de l’Ordre, un avocat ne saurait se dérober à ses obligations professionnelles vis-à-vis de la commission déontologique du barreau en ne se rendant pas devant ladite commission s’il est convoqué devant elle, faut de quoi, il manque à son devoir de courtoisie. C’est ce que rappelle la Cour de cassation quand elle indique que :
« la convocation devant la commission de déontologie, en dehors de toute poursuite disciplinaire, n'est soumise à aucune règle de forme ; que manque ainsi à ses devoirs de confraternité, de délicatesse et de courtoisie, l'avocat qui, quoiqu'informé de cette convocation, ne se présente pas en séance ni ne sollicite un report pour un juste motif » [22].
Plus spécifiquement, la cour d’appel de Montpellier a relevé qu’un avocat qui ne se présentait pas devant son Bâtonnier dans le cadre d’une procédure disciplinaire ne manquait pas à son devoir de courtoisie si, d’une part, le Bâtonnier était « averti » préalablement de ce défaut de présentation, et si, d’autre part, le refus de présentation était motivé par des éléments propres à la défense de l’avocat, en l’espèce l’impossibilité pour lui d’être assisté et de mettre en œuvre ce qu’il « estimait le plus approprié à l’exercice de son droit de défense » [23].
La Cour de cassation a aussi rappelé que des correspondances adressées à l’Ordre ou au Bâtonnier en des « termes fermes et vifs » ne relèvent pas d’un « défaut de courtoisie » [24] ; là, tout est dans l’appréciation réelle et concrète de ces termes « fermes et vifs »… Il conviendra cependant de veiller à s’adresser à l’Ordre comme au Bâtonnier, à l’oral comme à l’écrit – car la courtoisie n’est pas uniquement une vertu orale de sociabilité – avec délicatesse, prévenance et donc courtoisie…
III. À l’égard des magistrats
En 1869, un manuel de la profession d’avocat soulignait déjà que l’avocat, à l’égard des magistrats, doit faire preuve d’une « courtoisie parfaite où se révèle la preuve qu’il comprend la hauteur de leur mission et l’importance de leur ordre dans l’organisation sociale » [25]. Mais les rapports entre avocats et magistrats sont extrêmement fluctuants suivant les périodes et suivant les ressorts… Et même si le « le respect des tribunaux » ne fait plus partie du serment depuis la mise en place du « serment Badinter » et la loi du 15 juin 1982, les avocats doivent cependant agir avec courtoisie envers les magistrats, ce qui vaut aussi pour ces derniers. C’est ainsi que, si la critique est autorisée, tout comme le bénéfice de l’immunité de la plaidoirie prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le devoir de courtoisie impose que l’avocat n’injurie pas les magistrats ou qu’il ne commette pas d’attaque ad hominem, et ce en adéquation aussi avec les principes de modération et de délicatesse.
Nous mentionnions, ci-avant, les liens existants entre ce principe de la courtoisie et les autres principes essentiels à la profession d’avocat ; l’exemple de la diligence dont doit faire preuve un avocat dans la procédure ou de la ponctualité qu’il doit avoir aux audiences sont d’autres signes de cette imbrication des principes au sein d’une déontologie unifiée. Le cas de la jurisprudence lyonnaise susmentionnée dans laquelle un avocat avait déserté la barre pendant une suspension d’audience souligne que cette attitude, cette « insultante désinvolture », était autant un manque de courtoisie à l’égard de son confrère qu’à l’égard du magistrat qui tenait l’audience [26].
Le devoir de courtoisie à l’égard des magistrats vaut tant pour ceux du siège que pour ceux du parquet : « la courtoisie consistera à les informer [les magistrats du ministère public] de ce qu’il entend soutenir la relaxe ou l’acquittement, en leur indiquant les moyens » [27].
Notons aussi que cette obligation de courtoisie vaut pour tous les avocats, en ce compris les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui doivent respecter, dans l’exercice de leurs fonctions, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie [28], cette courtoisie étant aussi due « aux juridictions » [29] ainsi qu’avec les avocats aux barreaux [30] et les tiers [31].
Conclusion de courtoisie
Le principe de courtoisie était normativement constitué dès l’article 6 du décret du 21 juin 1920 précité, repris par ailleurs dans la loi du 26 juin 1941, le décret du 10 avril 1954 sur l’organisation de la profession d’avocat [32], le décret du 9 juin 1972 [33] qui rappelait en son article 87 l’obligation de présentation de l’avocat plaidant devant une juridiction extérieur au chef de juridiction et au Bâtonnier du lieu, ainsi que le décret du 27 novembre 1991 dans son article 158.
Il est vrai que cet article a été abrogé par le décret du 12 juillet 2005 [34] ; mais il n’en demeure pas moins que le principe de courtoisie reste toujours présent en tant que loi écrite dans le Règlement Intérieur National, mais aussi en tant que loi « non écrite » dans la nature même des activités des plaideurs.
Sans doute la courtoisie de l’avocat est-elle à rapprocher du sens que l’on retrouve dans « l’amour courtois » médiéval, aussi appelé « fin’amor », cette courtoisie qui, au-delà de la finesse, implique « la purification et la perfection », une « conception qui met le raffinement, la patience et l’ascèse au cœurs des préoccupations » [35] de l’avocat.
[1] Dictionnaire de l’Académie française.
[2] C. 2, 6, 6.
[3] Texte édité entre 1272 et 1273. Voir l’édition annotée de P. Viollet, Les établissements de Saint Louis, t. II, Paris, Renouard, 1881.
[4] Cité en français moderne dans F.-E. Mollot, Règles sur la profession d’avocat, Paris, Joubert, 1842, p. 61.
[5] Cité dans J. Appleton, Traité de la profession d’avocat. Organisation, règles et usages, technique professionnelle, Paris, Dalloz, 1928, p. 104.
[6] F. Payen, Le barreau. L’art et la fonction, Paris, Grasset, 1934, p. 172.
[7] Ibid., p. 173.
[8] Arrêté du 14 juillet 1874, cité dans E. Cresson, Usages et règles de la profession d'avocat, jurisprudence, ordonnances, décrets et lois, Paris, Larose et Forcel, 1888, p. 175 et p. 367.
[9] F. Payen, op. cit., p. 174.
[10] Voir aussi article 3 du décret n°2005-790, du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.
[11] Cité dans P. Chatel, Les valeurs déontologiques à protéger, Journal des Bâtonniers et des Ordres, n° 13, 2012, p. 26-27.
[12] CA Paris, 26 février 2003.
[13] CNB, avis déontologique de la Commission des Règles et Usages, n° 2004-072 du 3 mai 2004.
[14] CNB, avis déontologique de la Commission des Règles et Usages, n° 2009-030 du 17 juin 2009.
[15] Règlement intérieur du barreau de Paris, Annexe XIV - Vade-mecum du Barreau - adoptée par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 13 février 2007, Bulletin du barreau du 20 février 2007, n° 6, 2007, p. 50.
[16] CA Lyon, 14 juin 1993.
[17] J.-J. Taisne, La déontologie de l’avocat, 10e éd., Paris, Dalloz, 2017, p. 156.
[18] H. Ader, A. Damien, T. Wickers, S. Bortoluzzi et D. Piau, Règles de la profession d’avocat 2018/2019, 16e éd., Paris, Dalloz, 2018, n° 315-37.
[19] J.-J. Taisne, op. cit., p. 164.
[20] Cass. civ. 1, 7 juillet 1987, n° 86-10.729, publié N° Lexbase : A1816AHQ. L’avocat avait été, vis-à-vis du Bâtonnier, « insolent et désagréable, critiquant même l’utilisation des fonds provenant des cotisations des avocats » !
[21] H. Ader, A. Damien, T. Wickers, S. Bortoluzzi et D. Piau, op. cit., n° 337-34.
[22] Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.219, F-P+B+I N° Lexbase : A9493HXU.
[23] CA Montpellier, 23-02-2017, n° 16/07398, F-P+B N° Lexbase : A4344MUG.
[24] Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-21.768 N° Lexbase : A8260WLI.
[25] G. Duchaine et E. Picard, Manuel pratique de la profession d’avocat, Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1869, p. 262-263
[26] CA Lyon, 14 juin 1993.
[27] P. Chatel, op. cit., p. 27.
[28] Règlement général de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (2 décembre 2010) au 5 novembre 2020, art. 4.
[29] Règlement général de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (2 décembre 2010) au 5 novembre 2020, art. 31.
[30] Règlement général de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (2 décembre 2010) au 5 novembre 2020, art. 88.
[31] Règlement général de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (2 décembre 2010) au 5 novembre 2020, art. 89.
[32] Voir l’article 6 du décret n° 54-406, du 10 avril 1954, portant règlement d’administration publique sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau.
[33] Décret n° 72-468, du 9 juin 1972, organisant la profession d’avocat, JORF, 11 juin 1971, p. 5884 sq.
[34] Voir l’article 22 du décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005.
[35] A. Corbellari, Retour sur l’amour courtois, Cahiers de recherches médiévales, n° 17, 2009, p. 375-385.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476268
[Brèves] Procédure devant la cour d'appel en matière disciplinaire : observations du Bâtonnier et principe du contradictoire (rappel)
Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-21.943, F-D (N° Lexbase : A587339E)
Lecture: 3 min
N6081BYU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 03 Février 2021
► L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le Bâtonnier conclut ou présente des observations, l'arrêt précise si ces conclusions ou observations sont orales ou écrites, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.
Faits et procédure. Un avocat, exerçait en qualité d'associé au sein d’une société dont il était le gérant. Sur des poursuites engagées par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, il avait été condamné à une peine disciplinaire pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession, notamment aux obligations financières au titre de l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris et aux obligations visées à l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ainsi qu'à la probité et à l'honneur. Devant la Cour de cassation, l'avocat fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 2, 1, 13 juin 2019, n° 17/21296 N° Lexbase : A0435ZHL) de rejeter les fins de non-recevoir par lui soulevées, de confirmer l'arrêté disciplinaire sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la sanction à titre accessoire, la publicité et la publication de la décision dans le bulletin du barreau, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de prononcer à son encontre la sanction principale de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée d'un an, entièrement assortie du sursis et dire n'y avoir lieu à révocation d'un sursis antérieur, alors « que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si le Bâtonnier a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et si, dans l'affirmative, l'avocat en a reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, a été rendu en violation des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile ».
Réponse de la Cour. La Cour rappelle, au visa des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR] et 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN) que, l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le Bâtonnier conclut ou présente des observations, l'arrêt précise si ces conclusions ou observations sont orales ou écrites, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-16.426, FS-P+B N° Lexbase : A2160NK9 ; rappr., Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 14-10.683, F-D N° Lexbase : A4459M9Z). Or, en l’espèce, l'arrêt mentionne que le Bâtonnier, représenté et plaidant par un avocat au barreau de Paris, a demandé la confirmation de la décision de culpabilité, s'en rapportant à l'appréciation de la cour pour la sanction, sans préciser s'il l'a fait par écrit.
Cassation. Dès lors, pour la Haute Cour, en procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476081
[Brèves] Refus de réinscription au tableau de l’Ordre après une omission : l’un n’empêche pas l’autre
Réf. : CA Besançon, 15 décembre 2020, n° 20/01137 (N° Lexbase : A67514AB)
Lecture: 4 min
N6254BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 03 Février 2021
► L'avocat, omis du barreau aux motifs du non-paiement des cotisations annuelles et de la prime d'assurance responsabilité professionnelle, peut se voir refuser sa réinscription au tableau de l’Ordre en raison d’éléments de comportement contraires aux principes régissant la profession d'avocat ; l'appréciation des manquements postérieurs ne relève pas d'une approche disciplinaire mais bien de l'obligation faite au conseil de l'Ordre de vérifier l'intégralité des conditions requises pour être inscrit au tableau.
Faits/procédure. Aux motifs du non-paiement des cotisations annuelles et de la prime d'assurance responsabilité professionnelle, le conseil de l'Ordre des avocats de Besançon, avait prononcé l'omission d’un avocat de son barreau. Celui-ci avait sollicité sa réinscription aux motifs que les causes matérielles et financières de la décision d'omission, de nature administrative, avaient été couvertes. Le conseil de l'Ordre avait refusé la demande. A l'appui de son recours, l'avocat omis rappelle que la décision d'omission prise à son encontre est de nature administrative et non disciplinaire et qu'il peut y être mis fin à tout moment dès lors que le motif de l'omission a disparu. Il fait valoir que la décision entreprise aborde deux problématiques distinctes et incompatibles entre elles et que la procédure de réinscription sur omission ne saurait être conduite pour prononcer un refus de réinscription pour des motifs disciplinaires.
Textes. La cour rappelle que, par application des articles 107 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) organisant la profession d'avocat, la réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'Ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription le conseil de l'Ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Elle rappelle aussi que les conditions requises pour figurer au tableau relèvent tant des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) relatives à la capacité de la personne que de celles de l'article 17-3 de la même loi, relatives aux principes sur lesquels repose l'exercice de la profession d'avocat. Ces conditions sont cumulatives, ainsi même si le candidat satisfait aux conditions de capacité, il appartient au conseil de l'Ordre comme à la cour d'appel saisie d'un recours de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité.
Disparition des circonstances ayant justifié l'omission. La cour d'appel se prononce en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. En l'espèce, elle relève qu’il n'est pas contesté que les circonstances ayant justifié l'omission ont disparu.
Existence de manquements postérieurs à l’omission. La cour note ensuite que pour fonder sa décision, le conseil de l'Ordre a retenu des éléments de comportement de l’intéressé contraires aux principes régissant la profession d'avocat. Elle ajoute que si certains des comportements évoqués pour motiver la décision de refus de réinscription sont antérieurs à la décision d'omission, le conseil de l'Ordre relève aussi des manquements postérieurs à cette celle-ci. L'appréciation des manquements postérieurs ne relève pas d'une approche disciplinaire mais bien de l'obligation faite au conseil de l'Ordre de vérifier l'intégralité des conditions requises pour être inscrit au tableau. Elle constate que malgré la décision d'omission l’intéressé a refusé de ne plus intervenir aux intérêts d'une de ses clientes dans une procédure en cours mettant celle-ci dans une grave difficulté procédurale. Il a par ailleurs adressé plusieurs mails à la Bâtonnière en exercice mettant en cause son honnêteté dans le traitement de sa situation. Il a aussi envoyé un mail virulent à un confrère revendiquant sa qualité d'avocat et fustigeant la Bâtonnière en exercice invoquant son inconséquence, ses carences allant jusqu'à la faute grave. Au travers de ces mails, il est justifié que celui-ci a fait fi de la décision du conseil de l'Ordre, qu'il a tenu et réitéré des propos outranciers à l'encontre de la Bâtonnière en exercice. En agissant ainsi l’appelant a commis, selon la cour, des manquements graves aux principes de modération et de confraternité justifiant le rejet de sa demande de réinscription.
Confirmation. La cour confirme la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau Besançon ayant refusé la réinscription de l’appelant au tableau du barreau de Besançon (v., déjà Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 16-12.810, F-D N° Lexbase : A1958TCI).
| Pour aller plus loin : v., ETUDE : L’admission au tableau de l’Ordre, in "La profession d'avocat", Lexbase (N° Lexbase : E43303RS) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476254
[Questions à...] Avocat en entreprise : "Il n'est pas neutre de toucher à la profession d'avocat en période d'état d'urgence sanitaire" - Questions à Jérôme Gavaudan, nouveau président du CNB
Lecture: 1 min
N6360BY9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lexbase Avocats X Lexradio
Le 04 Février 2021
Jérôme Gavaudan, avocat au Barreau de Marseille, ancien Bâtonnier et ancien président de la Conférence des Bâtonniers, succède à Christiane Féral-Schuhl et devient le nouveau président du Conseil national des Barreaux pour la mandature 2021-2023.
Pour rappel, cette institution a pour vocation de porter la voix des avocats devant les pouvoirs publics. Le précédent mandat avait été marqué par la réforme des retraites et l’opposition massive des avocats contre ce projet. Le CNB avait à cette occasion piloté des manifestations et engagé des discussions avec le Gouvernement à ce sujet. Jérôme Gavaudan, prend donc la relève dans un contexte sanitaire inédit et a dû, dès son premier mois de mandature, faire face à un serpent de mer qui divise la profession : l’avocat en entreprise.
Il a accepté, pour la revue Lexbase Avocats et Lexradio, d’évoquer ces sujets et ses projets.
⇒ Cette interview est à retrouver en podcast sur Lexradio.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476360
[Brèves] Grève des avocats : le refus de renvoi en raison de l’absence de l’avocat doit aussi être motivé !
Réf. : Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-83.590, F-D (N° Lexbase : A73664CS)
Lecture: 2 min
N6370BYL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 03 Février 2021
► Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l’avocat du prévenu qui avait informé de son absence en raison d’un mouvement de grève national de la profession.
Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi avait été poursuivi devant le tribunal de police du chef de manœuvre irrégulière par le conducteur d’un véhicule quittant une route sur sa gauche. Le moyen critiquait le jugement en ce qu’il l’avait déclaré coupable des faits poursuivis, sans motiver le refus d’accéder à la demande de renvoi formulée par son avocat, absent à l’audience.
Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu’il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l’avocat du prévenu. Par courrier adressé au greffe du tribunal de police avant l’audience, l’avocat avait demandé le renvoi de l’affaire en exposant que compte tenu d’un mouvement de grève national, il ne serait pas présent à l’audience. Or, le juge avait retenu l’affaire, le jugement énonçant sans autre précision que la demande de renvoi avait été rejetée. Dès lors, en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les motifs de ce refus, la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le tribunal de police a méconnu les textes et le principe précités.
Cassation. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476370
[Jurisprudence] La trajectoire de l’intervention principale
Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 18-22.984, F-P+I (N° Lexbase : A22974C3)
Lecture: 8 min
N6260BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Romain Laffly, avocat au barreau de Lyon.
Le 04 Février 2021
Mots-clefs : Commentaire • avocat • CNB • intervention principale • condition
L’intervention du CNB, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d'avocat, doit être qualifiée de principale dès lors qu’il élève une prétention indemnitaire à son profit.
Distinguer l’intervention principale de l’intervention accessoire et le sort qui en dépend n’est pas toujours chose aisée. Une société de conseil assigne devant le Tribunal de commerce son co-contractant en paiement de ses honoraires d’intervention au titre d’un contrat destiné à la réalisation d’économies de charges liées à la rémunération du travail. Reconventionnellement, la société défenderesse argue de la nullité de la convention pour exercice illégal, par la société́ de conseils, d'une consultation juridique en violation des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). En cause d’appel, alors que le Conseil National des Barreaux avait régularisé une intervention volontaire aux fins d’obtenir un euro symbolique en réparation de son préjudice moral sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1018KZQ) et 1383 (N° Lexbase : L4419C33) du Code civil, un accord intervient entre les deux parties au contrat. La cour d’appel de Paris estime irrecevable l’action du CNB dès lors que « son intervention ne peut être qualifiée que d’accessoire à la demande en nullité de la convention litigieuse », la demande accessoire disparaissant par l’effet du désistement. Le CNB forme un pourvoi en cassation en avançant qu’il disposait d’un droit propre et que son intervention était bien principale et non accessoire. La 2ème chambre civile, au visa de l’article 329 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2005H4Z), casse et annule l’arrêt en ce que l’intervention a été déclarée irrecevable « alors que le CNB, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d'avocat, avait formé une demande de dommages-intérêts de sorte qu'il émettait une prétention à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
La cour d’appel de Paris, qui qualifiait l’intervention volontaire d’accessoire, avait estimé que l’extinction de la demande originelle au soutien de laquelle intervenait le CNB (c'est-à-dire la prétention relative à la nullité de la convention) ayant disparu par l’effet du désistement, l’intervention devenait de facto irrecevable. Comment qualifier l’intervention du CNB ? Pour répondre à l’interrogation, il est plus sûr de se fier au Code de procédure civile plutôt qu’à une mention figurant sur les conclusions, ce d’autant plus qu’au cours du procès l’intervention peut être mouvante. D’accessoire, l’intervention peut toujours devenir principale si une prétention propre est par la suite élevée. On sait que l’intervention est une demande incidente par application de l’article 66 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1272H4U), le tiers devenant partie engagée au procès initié entre d’autres parties. Elle est dite principale par application de l’article 328 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2003H4X) dès lors qu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme (C. proc. civ., art. 329 N° Lexbase : L2005H4Z) et accessoire si elle appuie les prétentions d’une partie (C. proc. civ., art. 330 N° Lexbase : L2007H44). Dans les deux cas, l’intervention doit se rattacher, selon leurs conditions propres, par un lien suffisant aux droits et obligations discutées à l’origine du litige. De même, et comme toujours, qualité et intérêt à agir de l’intervenant peuvent être examinés par le Juge. L’intervention peut avoir lieu dès la première instance mais aussi en appel, ce qui impose bien sûr, dans cette dernière hypothèse, que l’intervenant n’ait pas été partie en première instance, donc qu’il ne soit pas intervenu volontairement en première instance !
En l’espèce, l’intervention du CNB répondait sans doute un peu des deux critères de l’accessoire et du principal, mais en cette matière, comme souvent, l’accessoire suit le principal. Bien sûr le CNB était venu appuyer la demande de nullité de la convention, mais il avait, aussi, formulé une prétention propre, distincte de celles des autres parties, en sollicitant une condamnation à réparer son préjudice moral.
L’autre condition, également posée par les articles 328 et 329, ressortait de l’intérêt du CNB, lequel devait avoir intérêt à agir au regard de la prétention qu’il formulait si son intervention était principale, et intérêt, seulement dira-t-on, pour la conservation de ses droits à soutenir une partie si son intervention était accessoire. Or, ainsi que le rappelait le CNB, bien que tiers à la convention, il est un « établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale » et se trouve « chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics » par application de l'article 21-1 de la loi 1971-1130 du 31 décembre 1971 modifiée. Dès lors qu’était en question l’exercice illégal via des conseils juridiques ou des actes sous seing privé pour autrui à l’instar d’une consultation, l’intérêt à agir comme l’émission d’une prétention à son seul profit étaient à l’évidence marqués : l’intervenant agissait au nom de la profession d’avocat et formulait une demande de condamnation, fût-elle modeste, comme limitée à l’Euro symbolique. L’intervention n’était pas accessoire et ne pouvait qu’être qualifiée de principale.
Le second enseignement, majeur, de l’arrêt est le rappel de l’autonomie parfaite de l’intervention principale. Une fois qualifiée l’intervention de principale, et à cette condition seulement, son sort n’est plus lié à celui de l’appel. Le désistement de l’appel, comme au cas présent, ou même l’irrecevabilité de l’appel, sont sans emport sur son destin : il suit sa trajectoire. L’intervention principale peut en effet être recevable alors même que l’appel serait irrecevable (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-16.579, FS-P+B N° Lexbase : A5042DQS Procédures, 2006, n° 204, obs. R. Perrot ; Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-18.931, F-D N° Lexbase : A0918KCY ; JCP G, 2013, 1225, n° 6, obs. Serinet ; Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-24.474, FS-P+B+I N° Lexbase : A4716ZBB, Dalloz actualité, 18 juin 2019, obs. A. Bolze). Dès lors, l’intervenant volontaire principal peut user de toutes les voies de recours, ordinaires comme extraordinaires. Au contraire, l’extinction de l’instance, du fait d’une irrecevabilité de la demande principale, d’une transaction ou d’un désistement par exemple, entraîne celle de l’intervention accessoire. Et si celle-ci a été jugée recevable, l’intervenant accessoire ne peut que s’associer à une voie de recours sans pouvoir en prendre l’initiative.
Mais attention, la règle n’est pas, logiquement compte tenu des règles applicables devant elle, identique devant la Cour de cassation. En effet, du fait de sa qualité d’intervenant principal devant les juges du fond et de l’autonomie qui s’y rattache, le pourvoi principal du CNB était recevable. Mais à rebours, une intervention principale du CNB n’aurait pas été admise pour la première fois devant la Cour de cassation ! En effet, seule l’intervention accessoire est recevable pour la première fois en cassation par application de l’alinéa 2 de l’article 327 du Code de procédure civile, la Haute Cour exigeant alors « que la partie intervenante devant la Cour de cassation ne peut que s'associer aux moyens du demandeur au pourvoi sans invoquer de moyens distincts » (Cass. civ. 1, 6 juillet 2011, n° 08-12.648, F-P+B+I N° Lexbase : A9116HU8 Bull. civ. I, n° 145). Cassant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, la 1ère chambre civile, par cet arrêt publié, rappelait in fine qu’elle recevait la partie « ès qualités, en son intervention en tant qu'elle invoque le moyen du pourvoi, mais déclare irrecevable le moyen qu'elle invoque elle-même ». C’est ainsi qu’a pu être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt l'intervention de la Conférence des Bâtonniers au soutien d'un pourvoi d'un Ordre d'avocats contre un arrêt ayant annulé certaines dispositions de son règlement intérieur, chaque barreau arrêtant librement son règlement intérieur (Cass. civ. 1, 25 mai 1992, n° 89-10.096, publié au bulletin N° Lexbase : A4176AH7, JCP G, 1993, II, 22155, note J.-P. Woog), irrecevabilité encore relevée d’office à propos de l’intervention du Syndicat de la Magistrature qui ne justifiait pas d'un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie dans un litige qui n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pour l'ensemble de ses adhérents (Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 15-18.731, F-P+B N° Lexbase : A0904RP8). Comme vient de le rappeler récemment la Chambre commerciale cette fois, les interventions volontaires sont admises pour la première fois devant la Cour de cassation « si elles sont formées à titre accessoire à l’appui des prétentions d’une partie et si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie » (Cass. com., 8 juillet 2020, n° 19-25.065, F-D N° Lexbase : A11113RL). En procédure civile, aussi, la trajectoire se définit bien par le mouvement et celle de l’intervention principale, toujours évolutive, peut s’avérer complexe.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476260
[Brèves] Est principale l’intervention du CNB qui élève une prétention indemnitaire à son profit
Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 18-22.984, F-P+I (N° Lexbase : A22974C3)
Lecture: 2 min
N6140BY3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 11 Mars 2021
► L’intervention du CNB qui élève une prétention indemnitaire à son profit doit être regardée comme une intervention principale.
Procédure. Une société employeur avait conclu un contrat avec une société de conseils ayant pour objet de permettre à la première de réaliser des économies sur les charges liées à la rémunération du travail. La société employeur avait invoqué, reconventionnellement, la nullité de la convention pour exercice illégal, par la société de conseils, d'une consultation juridique en violation des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Le Conseil national des barreaux (le CNB) était intervenu à l'instance et avait sollicité la nullité de la convention pour les mêmes motifs ainsi que, notamment, l'allocation de la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral. Le CNB reproche à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de le déclarer irrecevable en son action.
Cour d’appel. Pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que son intervention ne peut qu'être accessoire à la demande en nullité de la convention formée par la société employeur et que le désistement, qui a emporté extinction de la demande originelle au soutien de laquelle est intervenu le CNB, a fait disparaître la demande accessoire de ce dernier.
Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu’aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2005H4Z), l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors que le CNB, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d'avocat, avait formé une demande de dommages-intérêts de sorte qu'il émettait une prétention à son profit, la cour d'appel a violé le texte précité.
Elle censure, par conséquent, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
|
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476140
[En librairie] Parution de la 4ème édition de l'ouvrage "Responsabilité des avocats" chez Dalloz
Lecture: 1 min
N6354BYY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lexbase Avocats
Le 04 Février 2021
Quarante ans après sa première édition, la quatrième édition de l'ouvrage "Responsabilité des avocats" écrit par Yves Avril, avocat honoraire et ancien Bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc est paru aux éditions Dalloz (1).
L’ouvrage propose de riches analyses et des réflexion approfondies sur les trois volets de la responsabilité de l’avocat : civile, pénale et disciplinaire. Dans cette nouvelle version, le lecteur pourra, notamment, retrouver une version refondue des chapitres sur les assurances de responsabilité. Les analyses du Bâtonnier Yves Avril en matière de responsabilité sont également à retrouver dans la revue Lexbase Avocats.
(1) Y. Avril, Responsabilité des avocats, Dalloz Référence, 474 pages, 78 euros.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476354
[Jurisprudence] Devoir de conseil de l’avocat en immobilier (et plus généralement de tout professionnel rédacteur d’actes)
Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2020, n° 19-17.617, F-D (N° Lexbase : A33333XQ)
Lecture: 18 min
N6269BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Francois de la Vaissière, avocat honoraire du barreau de Paris
Le 09 Février 2021
Mots-clefs : Jurisprudence • avocat • responsabilité • risques • immobilier
Le praticien de d’immobilier ne dispose pas d’un régime de responsabilité professionnelle différent des autres, mais la complexité de la discipline dans ses nombreuses facettes parfois hermétiques et changeantes (urbanisme, fiscalité, garanties de la construction,…) le vulnérabilise spécialement. Il doit demeurer prudent, vigilant sur les risques encourus par sa clientèle, et savoir quand il le faut prévenir par une conduite avisée les risques qu’il encourt lui-même pour défaut de conseil ou d’information, à travers un corpus de règles qui tend à devenir une responsabilité présumée, et sévère.
L’intérêt de l’espèce commentée qui mêle rédaction d’actes et procédure locative est de permettre d’aborder de façon pédagogique et exhaustive cette notion de RCP dont il n’est pas inutile de rappeler les lignes directrices, qui sont maintenant bien établies. Cela permet de qualifier de constante une jurisprudence qui couvre une multitude de situations distinctes, parmi lesquelles les plus virtuellement litigieuses sont celles où l’erreur commise débouche sur la caractérisation par la victime d’une qualité supposée de la transaction qui n’entre pas dans le champ contractuel. C’est ainsi que le devoir de conseil trouve sa limite en présence d’un vice du consentement, dol ou erreur sur la substance qui était imprévisible ou qui, ne l’étant pas, ne peut néanmoins faire l’objet d’une sanction même sur le fondement contractuel ou justifier une annulation a postériori, comme ce pourrait être le cas face à un défaut de rentabilité économique de l’opération, ou à une conséquence fiscale qui n’aurait de toute façon pu être contrariée.
I - Analyse factuelle
L’affaire concerne une cession globale de parts d’une société assimilable à une vente immobilière, et qui semble bien avoir été valorisée compte tenu d’une procédure d’expulsion en cours à l’égard du bail titrant le possesseur quant à son local d’exploitation, dont on sait qu’il est un élément indispensable du fonds de commerce, puisqu’à défaut de permanence du droit au bail, ou du droit de propriété direct sur les murs, l’activité est au pire condamnée et au mieux précarisée. En tous cas, l’acte rédigé par l’avocat contenait mention explicite de l’existence de ce contentieux, inachevé lors de la cession, et l’on peut estimer à première analyse que le Conseil de l’acquéreur des parts n’avait pas failli à ses obligations dès lors qu’en l’avisant expressément du conflit, il le mettait en mesure d’apprécier suffisamment le risque qui y était potentiellement attaché. Le contraire signifierait, en effet, que ce type de cession ou de vente ne pourrait jamais être entrepris, du moins avant que l’incertitude sur l’issue de la procédure en cours ne soit définitivement levée.
Ce fut d’ailleurs la solution retenue par les juges du fond, considérant en appel comme évident que le cessionnaire ne pouvait se méprendre sur la précarité de son acquisition, puisqu’il trouvait dans la clause habituelle sur la situation locative tous les éléments, soit pour y renoncer en vertu du principe de précaution, soit pour la maintenir dans une attitude en tous points conforme à la « théorie de l’acceptation des risques », et qu’en régularisant l’acte authentique il exerçait un choix éclairé. Cet acte n’était en aucun cas lacunaire, puisqu’il faisait mention du congé donné par la bailleresse et de la teneur de l’assignation en expulsion ayant amené le preneur à invoquer reconventionnellement le statut des baux commerciaux dont il entendait se prévaloir pour obtenir que le litige ne se traduise pas in fine par l’éviction de l’occupant sans la contrepartie d’une indemnité d’éviction, comme c’est le cas dans toutes les instances où se trouve allégué une faute du preneur, qu’elle qu’en soit la cause pourvu qu’elle soit grave, amenant les tribunaux à la sanctionner impitoyablement (pour défaut d’entretien, impayés de loyers, sous-location illicite, violation de la destination restrictive, etc…). Il peut également s’agir de revendiquer - comme ici - ou au contraire de contester l’application du régime protecteur ou l’un des droits qu’il ouvre (droit à une durée minimale de neuf ans du bail commercial, ou droit au renouvellement de celui-ci, tous deux d’ordre public).
II - Analyse objective de la motivation retenue
Honnêtement, l’avocat rédacteur pouvait faire le pari que la haute juridiction entérinerait cette approche orthodoxe reposant sur une information précise, au-delà de laquelle nul n’est tenu, encore qu’il convienne d’ajouter que la circonstance que le client soit lui-même particulièrement compétent n’est jamais prise en compte (Cass. civ. 1, 7 juillet 1998, n° 96-14.192 N° Lexbase : A4535AG3 et postérité) et que le partage de responsabilité est même hors d’atteinte en cas de négligence avérée du client informé (Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-28.100, F-D N° Lexbase : A8823XAZ et postérité). Mais la censure de la Cour de cassation vient pourtant démontrer que l’avocat assigné en responsabilité par son client cessionnaire évincé ne saurait invoquer une prétendue évidence de l’information, ici flagrante, et qu’il lui faut faire plus en portant une appréciation in concreto sur l’issue prévisible d’un tel litige, la mission de l’avocat et de tout juriste professionnel étant, comme chacun sait, d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il rédige. C’est ce qu’impose le règlement intérieur normalisé du barreau qui exige un devoir de compétence personnelle, et une jurisprudence commune aux notaires officiers ministériels qui évoque la protection de toutes les parties en présence, même si une seule rémunère la prestation (Cass. civ. 1, 1er octobre 1986, n° 84-13800, publié au bulletin N° Lexbase : A5384AAN, et postérité). Cette position exigeante de la cour suprême va même jusqu’à inverser la charge de la preuve au bénéfice de la victime en contraignant le professionnel à démontrer qu’il a avisé la partie lésée à défaut de quoi ses diligences ne seraient pas exonératoires (V., en matière médicale transposable : Cass. civ. 1, 25 février 1997, n° 94-19.685 N° Lexbase : A0061ACA, Bull. Civ. I n° 75, D., 1997, 319 ; ibid. 17 février 1998, n° 95-21.715, Bull. Civ. I n° 67, D., 1998, 81), par exemple par ce qu’on appelle une « décharge pour avis ou conseil donné », ou en décrivant les conséquences des risques identifiés. C’est donc un « supplément d’âme » qu’on a reproché au rédacteur de n’avoir pas manifesté, dans l’arrêt commenté, puisqu’il se devait d’écarter une vision neutre du contexte conflictuel et de prendre ouvertement parti sur son issue normalement prévisible sans s’en tenir à une description purement factuelle in abstracto, par exemple en insérant un paragraphe supplémentaire du type « le rédacteur du présent acte a personnellement avisé l’acquéreur qu’en l’état du droit applicable il lui apparaissait que la procédure d’expulsion engagée par la bailleresse avait de fortes chances d’aboutir favorablement, car l’action visant à la paralyser a été en l’occurrence engagée au-delà du délai de prescription biennale en vigueur pour les baux commerciaux, statut spécial qu’il revendique néanmoins aux termes de se demande de requalification du bail actuellement expiré… ». Cette motivation serait d’ailleurs susceptible d’obsolescence, car depuis le droit positif a évolué en soustrayant l’action en annulation pour méconnaissance du statut du domaine de la courte prescription qui lui est propre pour la faire entrer dans le réputé non écrit dès l’origine qui est de facto imprescriptible. Mais il semble qu’il faille encore faire la distinction entre l’action en annulation d’une clause contraire à l’ordre public partiel des articles L. 145-1 et s. du Code commerce (N° Lexbase : L2327IBS) qui n’est soumise à aucun délai, et l’action en requalification d’un bail dérogatoire en bail commercial qui relèverait encore du délai biennal spécifique de l’article L. 145-60 (N° Lexbase : L8519AID) du même Code. En toute hypothèse, l’appréciation d’un risque contentieux demeure par définition subjective, en raison même de l’aléa judiciaire qui plane sur la portée de toute prétention en justice. C’est pourquoi on peut hésiter sur l’étendue en pareil cas du devoir général de conseil et d’information.
III - Analyse critique de la solution
Pour notre part, nous sommes résolument hostiles à de telles obligations pesant sur le rédacteur, non seulement parce qu’elles excèdent le raisonnable, mais surtout parce qu’elles sont incompatibles avec le devoir parallèle de réserve et de neutralité bien pensé qui pèse sur le rédacteur unique d’un acte qui bénéficie à plusieurs parties. On sait que la question de la validité d’une telle intervention d’un seul professionnel en faveur de plus d’une partie, dans un contexte d’intérêts nettement divergents, a agité la doctrine lors de la réforme du droit contractuel opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, au point d’envisager de l’interdire en raison de ce qu’on appelle aujourd’hui, par un mot à la mode, le conflit d’intérêts, maintenant sanctionnable pénalement en diverses matières. Il est en effet impraticable pour un rédacteur unique de se positionner ouvertement en faveur d‘une partie, au surplus en pronostiquant le succès inévitable de l’une contre l’autre, car il trahit alors nécessairement la confiance qui a été placée en lui par celui qui va se trouver ostracisé négativement. Il est assez incompréhensible que la Haute juridiction, habituellement plus sourcilleuse du respect intangible de la loyauté judiciaire, ait ainsi « allongé la sauce » et n’ait pas semblé percevoir que cette norme prétorienne poussée à l’extrême revenait implicitement à proscrire l’unicité de rédaction pour tous les actes synallagmatiques. Il est vrai que qualifié « F-D » s’il s’agit d’un arrêt dit d’espèce et non de principe, mais tout de même ne donne-t-on pas à cette responsabilité qui reste délictuelle dans sa nature relevant du seul article 1240 nouveau du Code civil (Cass. civ. 1, 6 juin 2018, n° 17-13.975, FS-P+B N° Lexbase : A7348XQ9) une étendue manifestement excessive. Si l’on extrapole à propos de la responsabilité d’un avocats aux conseils, un arrêt récent (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-50.056, F-P+B N° Lexbase : A8787YY4) rejette une requête en indemnisation pour faute de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation en retenant que s’il est tenu d’une obligation de diligence et de prudence dans sa mission d’élaboration d’un pourvoi civil, et que lorsqu’il est consulté sur les chances de succès, il doit non seulement s’enquérir de la date d’expiration du délai de deux mois, mais aussi former à titre conservatoire ladite voie de recours extraordinaire en temps utile, il s’avère cependant qu’en se basant sur les différents moyens qui auraient pu être soutenus, aucun grief n’aurait pu effectivement permettre d’accueillir le recours. C’est faire la distinction classique et justifiée entre faute et préjudice dont la conjonction est nécessaire au succès de l’instance en responsabilité : si l’un manque, l’autre ne suffit pas ; l’existence d’un préjudice n’implique pas une responsabilité, et inversement une responsabilité ne crée pas toujours un préjudice, la liaison entre les deux concepts se faisant par le lien de causalité. Et on voit bien la limite qu’il y a à faire des chances de succès d’un litige non ouvert la clé de la responsabilité du juriste qui en a connaissance. La rédaction d’actes n’est pas de la même essence que le conseil sur le choix d’une voie contentieuse, car toute convention n’a pas vocation à dégénérer en litige, et lorsque le litige est effectif et non supposé réalisable, les éléments de réflexion sont sur la table et un acquéreur peut se déterminer en toute connaissance de cause. D’autant qu’une mutation n’a pas nécessairement un objectif spéculatif, mais peut couvrir d’autres desseins, quelquefois inavouables. Certes, il arrive que la Haute hiérarchie judiciaire ait vocation à censurer des motifs dans lesquels on prête gratuitement aux parties et par simple supposition d’avoir discuté de l’opportunité d‘une acquisition et d’en avoir écarté les obstacles, « les modalités de la vente en viager étant leur affaire… », hypothèse où le juge du fond imagine, au lieu de constater, qu’il a bien été conseillé de prévoir un « bouquet » (partie comptant du prix) en plus de la rente viagère (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-20.419, FS-P+B N° Lexbase : A4339XMN) mais alors la juridiction casse pour motifs impropres à caractériser le manquement du notaire à son devoir de conseil, et il n’y a rien à y redire.
IV - Autres hypothèses de recherche de la responsabilité professionnelle des juristes
C’est le plus souvent la responsabilité notariale qui est commentée lorsqu’il s’agit d’en déduire que la validité de l’acte reçu n’a pas été assurée. Un arrêt coté F-S-P+B+I et promis donc à une grande diffusion (Cass. civ. 3, 1er juin 2017, n° 16-14.428, FS-P+B+I N° Lexbase : A8539WEY) avait estimé que les conséquences de l’annulation d’une vente immobilière en réhabilitation (hypothèse dont on sait désormais qu’elle est inéluctablement liée à l’annulation du prêt qui a permis de la financer), pour le motif qu’elle n’avait pas pris la forme obligatoire d’une VEFA, contraignait le notaire fautif à rembourser à la banque les frais du prêt ainsi annulé, par le biais de la théorie de l’accessoire. L’espèce concernait aussi la perte des intérêts conventionnels non perçus, mais la cour de cassation s’en tient de ce chef à la solution de la cour d’appel qui avait appliqué la notion de perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, refusant de ce fait une indemnisation intégrale, en séparant toutefois le sort des intérêts déjà échus et restant totalement restituables. Mais la censure intervient par contre - pour la première fois - du chef de la restitution des frais de l’emprunt. Contrairement à une autre chambre de la Haute Cour (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 12-28.615, F-P+B N° Lexbase : A2611MTU) qui n’avait couvert que les frais de garantie que la banque avait été tenue de rembourser à l’emprunteur/acquéreur, dans le cadre de l’action récursoire contre le rédacteur, la 3° chambre civile à compétence partagée avec la première fait entrer dans le préjudice réparable les frais directement exposés par la banque ayant subi la double annulation. Cela constitue une tendance à ouvrir le champ de la réparation en pareil cas alors que la Cour de cassation nous a plutôt habitué au contraire en décrétant de plus en plus non indemnisables des préjudices pourtant en relation de causalité, à l’instar de la restitution du prix de vente proprement dit.
Mais fort heureusement, le devoir de conseil au sens large ne débouche pas sur l’indemnisation des tiers au contrat, qui ne disposent pas d’un droit opposable aux parties elles-mêmes (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-12.473, FS-P+B N° Lexbase : A4364XML ; et Cass. civ. 3, 3 mai 2018, n° 17-11.132, FS-P+B N° Lexbase : A4287XMQ). On excepte donc le cas où le notaire a connaissance de tiers qui peuvent être affectés, tels que les bénéficiaires d’un pacte de préférence ou les co-destinataires du prix encaissé et redistribué par l’office. Il faut, cependant, rappeler le principe général subsistant en droit positif selon lequel un manquement contractuel d’un tiers au contrat peut fonder contre lui une action en responsabilité quasi-délictuelle, de quelque partie qu’elle puisse émaner.
Enfin, il est opportun de souligner que le risque d’insolvabilité de l’acquéreur ou d’un débiteur quelconque reste très fréquemment mis en avant pour justifier une RCP, notamment lorsqu’il s’agit d’un agent immobilier, en profitant de la rigueur de la loi "Hoguet" qui le régit strictement (obligation de mise en garde du mandant, aptitude à rédiger, garantie financière, assurance de responsabilité, mandat écrit protecteur du client, carte professionnelle, etc…). Un arrêt coté F-P+B+I (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-24.381, F-P+B+I N° Lexbase : A9954Z7S) permet d’éclairer les conséquences de la qualité du professionnel concerné sur la nature juridique de ses devoirs, puisque l’existence d’un contrat de mandat formaliste et obligatoire fait de cette profession la débitrice d’une responsabilité contractuelle (C. civ., art. 1147 ; dans sa réaction antérieure à sa réforme dans le cas commenté). Cette qualification est contraire aux autres professions soumises aux mêmes contraintes, et plus spécialement le rédacteur d’actes - notaire ou avocat, voire juriste d’entreprises - que peut être occasionnellement l’agent immobilier dont la mission principale est l’entremise, ainsi que l’administrateur de biens, gérant un immeuble locatif et amené notamment à rédiger les baux commerciaux et d’habitation. L’obligation de mise en garde à propos d’une possible insolvabilité de l’acheteur existe indépendamment de la rédaction d’actes et partout, outre qu’elle constitue pour l’intermédiaire professionnel une source importante de contentieux, dans le mesure où l’imagination des intervenants pour tromper sur leur véritable envergure financière ne connait plus de bornes : cette « délinquance astucieuse » s’illustre par la production de fausses fiches de paie, de déclarations fiscales falsifiées, et même de fausses garanties bancaires ou de cautionnements imaginaires, et il arrive qu’un professionnel de l’immobilier en soit victime involontaire. Cela se termine par une condamnation pour imprudence dans la constitution du dossier d’usage et c’est l’assureur qui paie les pots cassés. Dans le dossier commenté, la cour d’appel d’Amiens avait fait preuve d’un certain laxisme libéral en observant que les vendeurs n’ignoraient pas la situation dégradée de leur jeune acquéreur ayant échoué d’ailleurs à obtenir un prêt partiel, et « que les vendeurs étaient demeurés libres de ne pas contracter s’ils estimaient les garanties produites insuffisantes », d’autant que « l’agent ne disposait pas de plus de moyens de contrôle qu’un simple particulier ». En d’autres termes et toutes proportions gardées, on est devant une motivation suspicieuse et très proche de celle analysée au début de cette chronique sauf qu’au lieu de traduire une erreur sur le danger potentiel d’une procédure engagée, et donc par une sorte d’erreur de droit, elle manifeste une absence de mise en garde du risque d’insolvabilité encouru, par une forme de carence dans l’exercice de ses fonctions courantes.
Autrement posé, le juge du fond estime dans les deux cas qu’il n’y a pas à dissuader - par pression sur un vendeur - l’acquéreur ou le cessionnaire de parts ou de fonds de commerce qui s’obstine à vouloir acheter s’il est conscient du danger, et qu’il n’appartient pas au professionnel qui s’est entremis, et qui a un intérêt pécuniaire à la réalisation de la transaction puisque la commission est subordonnée à son aboutissement, de s’interposer outre mesure. En quelque sorte, c’est « advienne que pourra » et cette attitude se défend, comme nous l’avons exprimé plus haut, d’autant que la compétence juridique de l’agent immobilier reste périphérique, malgré la récente obligation de formation continue. Mais la Cour de cassation, si elle ne fait pas de l’agent un devin omniscient tenu d’une garantie automatique de tout dommage quelconque, le crédite cependant d’un devoir supplémentaire de « curiosité », susceptible à défaut d’être mis pleinement en œuvre de donner une arme à la victime dans presque tous les cas. Par ailleurs, elle lui impartit de se ménager la preuve d’une mise en garde circonstanciée, même s’il a été mandaté par l’acquéreur, l’emprunteur ou le locataire dont il doit dénoncer les insuffisances. C’est une obligation de résultat pour la fourniture concrète et appropriée du conseil donné, et une obligation de moyens quant à sa pertinence, ce qui intègre l‘éventualité d’une manœuvre dolosive de celui qui a fraudé ou dissimulé sa réelle solvabilité (Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 07-21.186, F-D N° Lexbase : A5129EEP). La Cour de cassation a toujours imposé de « vérifier de manière sérieuse la solvabilité, au moins apparente, du co-contractant », et de plus fort lorsqu’il existe des indices d’anomalie. On ne peut se contenter d’un simple « pedigree » d’identification de l’individu ou de la personne morale concernés, et il faut, nous enseigne l’arrêt commenté, suggérer par exemple de prendre des garanties optionnelles (hypothèque, nantissement, assurance couvrant les impayés, cautionnement solidaire d’un établissement solvable ayant pignon sur rue, et qui peut ne pas être français), et peu importera ensuite qu’elles soient prises ou pas.
En définitive, on doit comprendre qu’un pourvoi pourra toujours prospérer à l’égard de la bienveillante mansuétude des juges du fond, enclins à plus de réalisme dans l’examen des rapports d’affaires, et ainsi à absoudre l’obstination d’un acteur, averti ou non, à s’exposer à un risque potentiel d’une certaine intensité, et dont il a pu prendre conscience par ses Conseils divers, même s’ils n’ont pas poussé la vigilance jusqu’à lui suggérer concrètement les moyens précis de s’en prémunir, et - précaution ultime - d’en conserver une trace ostensible ad probationem à l’égard de tous. C’est en effet vis-à-vis de l’ensemble des parties qu’il convient paradoxalement de veiller à l’équilibre des intérêts en présence, à peine de s’auto -investir en responsable final dans la chaine des recours, mais qu’il en est de même - si l’on suit la leçon de l’arrêt - si l’on s’abstient de privilégier la partie la plus faible dans l’exposition aux risques. Mission impossible ? Pénalisation outrancière ? Le lecteur jugera…
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476269
[Jurisprudence] Quelques rappels en matière de statut et de contentieux des collaborations libérales
Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, deux arrêts, F-P+B, n° 19-12.644 (N° Lexbase : A87963YG) et n° 19-11.459, F-P+B (N° Lexbase : A86403YN).
Lecture: 17 min
N6345BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Le 10 Février 2021
Mots-clefs : Collaborateur libéral • contentieux • appel • représentation des parties • protection de la maternité • procédures collectives • créances antérieures au jugement d’ouverture.
1. Lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le Bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne.
2. À compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité. Ce texte n'exclue pas la protection de la collaboratrice libérale qui a déclaré son état de grossesse au cours de la période d'essai.
Bien que l'article 14.1 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) dispose qu'elle « est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats », la collaboration libérale présente d’évidentes similitudes avec la collaboration salariée. Les avocats collaborateurs libéraux et salariés exercent naturellement les mêmes fonctions et consacrent tout ou partie de leur activité pour le compte d’un cabinet. La différence principale entre les uns et les autres tient à la faculté ou non de se constituer et de développer une clientèle personnelle propre. Cette capacité est caractéristique du lien de subordination qui peut ou non lier l’avocat au cabinet [1], étant observé qu’il s’agit d’une conception édulcorée, ce qui s’explique logiquement par la large autonomie, voire l’indépendance dont doit bénéficier l’avocat même lorsqu’il est salarié [2]. Parce que la collaboration libérale est à mi-chemin entre indépendance totale et subordination, son régime s’inspire parfois du salariat dont les règles jouent alors un rôle de modèle.
Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’extension aux collaborateurs libéraux de règles de protection initialement apparues en droit du travail. On peut évoquer, par exemple, la rétrocession d’un minimum d’honoraires (art. 14.3 du RIN) qui rappelle le mécanisme du salaire minimum légal (SMIC) ou l’obligation de respecter un délai de prévenance en cas de résiliation du contrat de collaboration (art. 14.4.1 du RIN). Mais c’est surtout la protection des libertés fondamentales de l’avocat collaborateur libéral qui semble être de mieux en mieux assurée [3], par exemple grâce à l’interdiction, sauf manquement grave aux règles professionnelles, de rompre le contrat pendant les périodes de suspensions liées à l’état de santé (art. 14.4.2) ou au développement important de protections de la parentalité (art. 14.5) [4]. C’est sans doute s’agissant de la protection de la maternité des collaboratrices libérales que l’analogie est la plus claire, ce dont témoigne un premier arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (I).
Cela est aussi perceptible s’agissant des règles de procédure applicables aux contentieux qui peuvent s’élever entre un collaborateur libéral et son cabinet. Celles-ci présentent bien sûr d’importantes spécificités, la plus notable étant sans doute que le litige doit être soumis à l’arbitrage du Bâtonnier en première instance après l’échec d’une tentative de conciliation. En cause d’appel toutefois, on retrouve des raisonnements et des principes directeurs qui ne vont pas sans rappeler la procédure prud’homale d’hier et d’aujourd’hui. Cette question est parfaitement illustrée par un second arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (II).
I - Protection de la maternité d’une collaboratrice libérale
A. L’affaire
Une avocate exerçant à titre individuel recrutait une collaboratrice libérale le 26 janvier 2016 par contrat stipulant une période d’essai de trois mois. Le 9 février 2016, la collaboratrice annonçait son état de grossesse à l’avocate qui décidait, par courrier du 15 février 2016, de rompre le contrat de collaboration. Après que la collaboratrice lui a adressé une lettre de contestation de la rupture, l’avocate lui répondait par courrier qu’elle lui reprochait de graves manquements professionnels. Le 5 avril 2016, la collaboratrice saisissait le Bâtonnier du barreau Paris pour contester la rupture du contrat. Le 29 septembre suivant, l’avocate était placée en redressement judiciaire.
En appel, la cour de Paris décidait d’annuler la rupture du contrat de collaboration et de condamner l’avocate à payer à la collaboratrice les sommes de 37 027 euros et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. L’avocate et le mandataire judiciaire contestent cette décision et forment pourvoi en cassation.
Le premier moyen soutient, pour l’essentiel, que l’article 14.5.3 du RIN relatif à l’interdiction de rompre le contrat d’une collaboratrice en état de grossesse n’est pas applicable à la rupture de la période d’essai. Subsidiairement, si la protection devait s’appliquer, les demandeurs reprochent aux juges du fond de ne pas avoir démontré pourquoi les insuffisances professionnelles reprochées à la collaboratrice n’étaient pas caractérisées.
Le quatrième moyen reprochait la condamnation au paiement de dommages et intérêts alors que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire implique l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ainsi que les créances postérieures qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure.
La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le premier moyen. Elle observe qu’en application de l’article 14.5.3 du RIN, à compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité. Ce texte n'excluant pas la protection de la collaboratrice libérale qui a déclaré son état de grossesse au cours de la période d'essai, la cour d'appel en a, à bon droit, fait application. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, elle a pu considérer que l’avocate n’apportait pas d’éléments suffisants pour démontrer l’existence de manquements graves de la collaboratrice à ses obligations professionnelles.
Elle décide en revanche de casser la décision d’appel sur le quatrième moyen au visa de l’article L. 622-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7285IZT). Ce texte prévoit que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, pour le débiteur, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. La condamnation au paiement de dommages et intérêts résultant de l’annulation de la rupture du contrat de collaboration et de son caractère discriminatoire, la cour d’appel ne pouvait sans violer ce texte condamner l’avocate au paiement de ces sommes. La première chambre civile choisit de ne pas renvoyer l’affaire, de statuer au fond et d’inscrire les créances résultant de la condamnation au passif du redressement judiciaire de l’avocate.
B. L’interprétation des règles protectrices de la maternité
Le contrat de collaboration libérale, conclu sans détermination de durée, peut toujours prendre fin à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Cette faculté de résiliation unilatérale, parfaitement logique au regard du principe de prohibition des engagements perpétuels, est expressément prévue par l’article 14.4.1 du RIN qui dispose que « sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance ». Le texte précise toutefois que cette faculté de résiliation unilatérale ne s’applique que « sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité ».
La maternité a été le premier risque social encouru par les collaboratrices libérales à être pris en compte par le RIN [5]. L’article 14.5.1 autorise la collaboratrice libérale à suspendre l’exécution de son contrat pendant 16 semaines dont un minimum de 10 semaines après l’accouchement [6]. Surtout, l’article 14.5.3 du RIN dispose qu’ « à compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité ». La rupture intervenue au mépris de cette interdiction est « nulle de plein droit ». Les collaboratrices libérales bénéficient ainsi d’une protection qui s’inspire clairement de celle offerte aux salariées enceintes ou qui viennent d’accoucher par les articles L. 1225-4 et suivants (N° Lexbase : L7160K93) et L. 1225-17 (N° Lexbase : L5727IAD) du Code du travail. La sanction de la nullité de la rupture diffère toutefois. Alors que les salariées bénéficient d’un droit à réintégration dans leur emploi en application de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1441LKL), les collaboratrices libérales ne peuvent obtenir qu’une indemnisation du fait de la rupture, le RIN ne prévoyant pas le principe de la réintégration. La réintégration n’est pas inenvisageable sur le plan technique puisque la nullité détruit rétroactivement l’acte illicite. Son efficacité serait toutefois fortement limitée en pratique puisque les parties disposent d’un droit de résiliation unilatérale qui n’a pas à être motivé ni justifié.
La formule employée par l’article 14.5.3 du RIN est très vaste : le contrat de collaboration « ne peut être rompu par le cabinet ». Cela semble ainsi concerner toute résiliation unilatérale du contrat [7] et il n’est donc guère étonnant que la première chambre civile en retienne une interprétation large, comme elle l’avait d’ailleurs déjà fait dans une affaire similaire jugée en 2016 [8].
Au-delà de la lettre du texte, son esprit devait aussi guider cette interprétation. La première chambre civile de la Cour de cassation prend généralement en considération les finalités protectrices de ces règles pour leur donner la plus grande effectivité. Dans une affaire jugée en 2014, elle refusait par exemple de restreindre les conditions d’application du texte. Une collaboratrice avait été remerciée pendant les périodes de protection en raison de comportements que lui reprochait le cabinet mais qui dataient d’une période antérieure à la grossesse. Le cabinet soutenait que la restriction du droit de résiliation au seul cas de « manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité » ne s’appliquait pas lorsque des manquements antérieurs à l’état de grossesse étaient reprochés. La première chambre civile refusait, comme les juges du fond, d’imposer une condition que le règlement intérieur ne prévoyait pas : toute résiliation pour « faute » pendant la période de protection doit être justifiée par des manquements graves, peu important que ces manquements graves aient été commis avant la grossesse [9].
Cette finalité de protection de la maternité a été largement étendue par les modifications récentes du RIN. Après avoir accordé un congé et une protection similaire aux avocats libéraux jeunes pères, le RIN a finalement intégré une véritable protection de la parentalité, les dispositifs bénéficiant désormais au « père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, par le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle » (RIN, art. 14.5.3). La formule est récente. Elle résulte d’une décision à caractère normatif n° 2020-003 relative à la parentalité adoptée le 9 octobre 2020 et reprend, ce qui ne surprendra pas, la formule employée par l’article L. 1225-35 du Code du travail (N° Lexbase : L7092LNY) pour le père, le conjoint, le compagnon ou la compagne de la mère.
C. Condamnation pour violation du statut protecteur et procédure collective
Ici s’arrête le mimétisme avec le droit du travail. En effet, les salariés bénéficient d’un régime exorbitant en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire [10]. Dispensés de l’obligation de déclaration de leurs créances [11], les salariés disposent surtout de puissantes garanties de paiement de leurs créances grâce au privilège spécial des salaires [12] et à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) [13]. Enfin, et c’est là une différence fondamentale avec l’affaire sous examen, les salariés bénéficient de ce que l’on appelle un « superprivilège » qui leur permet d’obtenir le paiement immédiat de créances salariales antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
Une telle faveur n’est pas offerte aux avocats collaborateurs libéraux travaillant pour le compte d’un cabinet placé en redressement judiciaire. Comme pour tout créancier, les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure sont paralysées et ne peuvent être payées. La créance relative à la résiliation du contrat de collaboration en violation des règles protectrices de la maternité étant née avant l’ouverture de la procédure, le juge ne pouvait que procéder à l’inscription des dommages et intérêts au passif de la procédure.
La seconde affaire présentée permet elle aussi de montrer les points communs entre régime du salariat et de la collaboration libérale.
II - Représentation des parties en cas de litige entre un cabinet et son collaborateur
A. L’affaire
Une juriste salariée d’un cabinet d’avocat, après avoir subi une formation d’avocat, prêtait serment et concluait un contrat de collaboration libérale avec le même cabinet en 2008. Le 3 février 2014, le cabinet mettait fin au contrat de collaboration. Estimant ne pas avoir été en mesure de constituer et de développer une clientèle propre, l’avocate saisissait le Bâtonnier du barreau de Paris d’une demande de requalification de la relation en contrat de travail. La demande de l’avocate était rejetée en cause d’appel, si bien qu’elle forma pourvoi en cassation.
Le moyen soutenu par l’avocate ne discute pas le fond de l’affaire, mais se focalise sur des aspects procéduraux. Elle avance que l’appel, en matière de litige entre un avocat et un cabinet, est une procédure sans représentation obligatoire, donc orale. Elle poursuit en soutenant qu’en matière de procédure orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience peuvent valablement saisir le juge. Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 autorise les parties à se faire assister, mais il ne prévoit pas qu’elles puissent être représentées. Par conséquent, le cabinet n’ayant pas comparu à l’audience, il ne pouvait avoir réitéré ses conclusions à l’oral nonobstant la présence de son conseil. Les juges d’appel auraient dû considérer n’être saisis d’aucun moyen ni aucune demande du cabinet.
Par un arrêt rendu le 21 octobre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé que les litiges relatifs aux contrats de collaboration sont de la compétence de l’arbitrage du Bâtonnier en première d’instance, de la cour d’appel au second degré, la Cour reprend les termes de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 selon lequel ces litiges sont jugés selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Or, l’article 931 du code de procédure civile (N° Lexbase : L0426ITX) prévoit que, dans ce type de procédure, les parties se défendent elles-mêmes, ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement et que le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
La combinaison de ces textes lui permet de conclure que, lors de l’appel d’une décision d’arbitrage du Bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l’exclusion de toute autre personne. Le cabinet s’étant fait représenter au cours de la procédure, les conclusions écrites avaient bien été reprises à l’oral et la juridiction était valablement saisie.
B. L’ombre de la procédure prud’homale
Longtemps la procédure prud’homale a imposé la comparution personnelle obligatoire des parties. Ainsi, avant l’adoption d’un décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l’article R. 1453-1 du code du travail disposait que « les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister ».
Or, le contentieux relatif à la requalification d’un contrat de collaboration libérale en contrat de travail s’apparente très fortement à un contentieux prud’homal. Si le décret de 1971 prévoit bien des particularités procédurales telle que la compétence du Bâtonnier en première instance, on sait que cette règle déroge au principe selon lequel les litiges relatifs à la qualification de contrat de travail sont de la compétence du juge prud’homal [14], y compris d’ailleurs lorsque le législateur présume que le professionnel en cause est un travailleur indépendant [15]. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’une procédure sans représentation obligatoire et, par conséquent, une procédure orale. Il pouvait dès lors être tentant, par analogie, d’exiger la comparution personnelle de la collaboratrice et du dirigeant du cabinet afin de réitérer à l’oral les conclusions écrites préalablement déposées, sans admettre que l’un ou l’autre puisse se faire représenter.
La première chambre civile refuse de s’aligner sur la procédure prud’homale de l’époque, ce qui semble assez logique [16]. D’abord parce que, malgré les similitudes, la procédure sans représentation devant le Bâtonnier et au second degré devant la cour d’appel n’est pas régie par le code du travail. Par voie de conséquence, c’est bien le droit commun de la procédure civile qui doit trouver à s’appliquer, en particulier l’article 931 du code de procédure civile qui admet clairement la représentation. Ensuite, la tentation d’une analogie avec la procédure prud’homale a nettement perdu de sa force. En effet, depuis l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : Z62750RE), l’article L. 1453-1 A du code du travail (N° Lexbase : L3000LTB) autorise clairement les parties à un litige prud’homal à être représentée, sans qu’il ne soit plus nécessaire de justifier d’un motif légitime pour ne pas comparaître personnellement. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A), la représentation des parties au stade de l’appel est devenue obligatoire devant la cour d’appel en matière prud’homale. Alors que la représentation se généralise dans le contentieux prud’homal, y compris s’agissant de la qualification de contrat de travail, on comprendrait mal pourquoi la première chambre civile adopterait une position contraire dans les litiges opposant collaborateurs libéraux et cabinets.
[1] Cass. mixte, 12 février 1999, n° 96-17.468 (N° Lexbase : A4601AY3), Bull. ch. mixte, n° 1 ; D., 2000, p. 146, obs. B. Blanchard ; Dr. soc, 1999, p. 404, obs. Ch. Radé ; Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-12.966, FS-P+B+R+I, (N° Lexbase : A9766EGS), JCP éd. G, 2009, n° 25, 6, note C. Puigelier ; Dr. soc., 2009, p. 1195, note J. Barthélémy ; RDT, 2009, p. 505, note J. Levy-Amsallem ; Lexbase, éd. soc., n° 353, 2009 et les obs. de G. Auzero.
[2] L’article 7.4 de la loi de 1971 dispose que l’avocat salarié « n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail » et la règle est reprise, dans des termes proches, par l’article 14.1 du RIN.
[3] Si ces protections émergent principalement par des avancées du CNB traduites dans le RIN, la jurisprudence n’y est pas totalement étrangère, comme en témoigne un arrêt de la cour d’appel de Paris qui jugeait que « si la rupture du contrat de collaboration libérale n'a pas à être motivée et peut intervenir à tout moment, encore faut-il qu'elle ne soit pas fondée sur un motif discriminatoire que la loi de 2008 sanctionne », v. CA Paris, 2, 1, 27-01-2016, n° 13/21837 (N° Lexbase : A3850N7Q).
[4] Sur l’évolution de cette protection, v. H. Adnane, Principes d’égalité et de non-discrimination en raison de la parentalité du collaborateur libéral, Village justice, 31 décembre 2020.
[5] Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat.
[6] Elle conserve, pendant cette durée, la rétrocession habituelle d’honoraires sous déduction des indemnités journalières maternité de sécurité sociale, art. 14.5.2 du RIN.
[7] On peut imaginer en revanche, à l’instar encore des règles applicables au salariat, que la volonté commune du cabinet et de la collaboratrice de mettre fin à la relation contractuelle ne sera pas entravée par le texte. A propos de la rupture conventionnelle d’une salariée en état de grossesse, v., Cass. soc., 25 mars 2015, n° 14-10.149, FS-P+B (N° Lexbase : A6728NEW) et nos obs., Lexbase hebdo, éd. soc., n° 608, 2015 (N° Lexbase : N6832BUL).
[8] Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-21.276, FS-P+B, Cassation (N° Lexbase : A1924RW8) et les obs. de G. Deharo, Lexbase avocats, n° 221, 2016 (N° Lexbase : N3891BWZ).
[9] Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-13.955, F-D (N° Lexbase : A0708MKG).
[10] G. Auzero, D. Baugard, E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, 34ème éd., 2021, p. 1229.
[11] C. com., art. L. 625-1 (N° Lexbase : L3315ICR).
[12] C. trav., art. L. 3253-1 (N° Lexbase : L0953H98).
[13] C. trav., art. L. 3253-6 et s. (N° Lexbase : L0963H9K).
[14] Cass. soc., 22 mars 2006, n° 05-42.346, F-P (N° Lexbase : A8103DNG).
[15] En dernier lieu, v. les affaires Take eat easy et Uber, Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0887YN8), note P. Adam, Plateforme numérique : être ou ne pas être salarié…, Lexbase Social, 2018, n° 766 (N° Lexbase : N6881BX7) et Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A95123GE), lire Ch. Radé, La Cour de cassation et les chauffeurs salariés de la plateforme Uber, Lexbase Social, 2020, n° 817 (N° Lexbase : N2637BYC).
[16] On relèvera que, dans une affaire jugée en 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation semblait déjà considérer que la représentation était admise au stade de l’appel, v. implicitement Cass. soc., 13 juillet 2005, n° 03-14.042, F-D (N° Lexbase : A9152DIS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476345
[Brèves] Utilisation de la visioconférence dans la procédure pénale sans l’accord des parties : inconstitutionnalité pour l'avenir de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Réf. : Cons. const., décision n° 2020-872 QPC, du 15 janvier 2021 (N° Lexbase : A47574C8)
Lecture: 5 min
N6112BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 19 Janvier 2021
► Eu égard à l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale et en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à la visioconférence, autorisé par l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, ces dernières dispositions portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire durant leur période d’application.
Rappel des faits. Le 16 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation, dans les conditions de l’article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L1327A9Z), d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-84.360, F-D N° Lexbase : A95443XR). Cette question portait sur la conformité, aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290, du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : Z56465SP).
L’article litigieux permettait, par dérogation à l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5595LZA), relatif aux conditions d’utilisation de la visioconférence dans la procédure pénale, de recourir, sans l’accord des parties, à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales autres que criminelles. Cette dérogation était applicable à partir de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire mis en place par la loi du 23 mars 2020, et devait perdurer pendant un mois après la fin de celui-ci, soit jusqu’au 20 août 2020.
Motifs de la QPC. Le requérant reprochait à l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 de permettre à la chambre de l’instruction de statuer par visioconférence sur la prolongation d’une détention provisoire, sans que la personne détenue puisse s’opposer à cette modalité. Selon le requérant, cette autorisation pouvait avoir pour effet de priver une personne détenue de la possibilité de comparaître physiquement devant un juge pendant plus d’une année. Il résulterait d’une telle situation une atteinte aux droits de la défense. Si les dispositions litigieuses avaient pour but la protection de la santé publique et la bonne administration de la Justice, ces objectifs ne pouvaient, pour le requérant, justifier une telle atteinte aux droits des personnes détenues.
Décision. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions litigieuses contraires à la Constitution.
Les Sages rappellent tout d’abord que les droits de la défense sont garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L4749AQX). Le Conseil précise ensuite certaines circonstances dans lesquelles, l’article 706-71 de Code de procédure pénale, auquel les dispositions litigieuses dérogent, permet, sous certaines conditions, de recourir à la visioconférence au cours de la procédure pénale. La Haute juridiction souligne notamment qu’en matière de détention provisoire, le débat contradictoire préalable au placement ou à la prolongation de la mesure de détention peut se tenir via un moyen de télécommunication audiovisuelle, la personne détenue ayant le pouvoir de s’y opposer, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
Le Conseil précise que les dispositions litigieuses de l’ordonnance du 25 mars 2020 avaient vocation à favoriser la continuité de l’activité des juridictions pénales durant la crise sanitaire. Elles poursuivaient, selon les Sages, un double objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de maintien de la continuité du fonctionnement de la Justice.
Toutefois, le Conseil constitutionnel constate, dans un premier temps, que les termes de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 étendent la possibilité de recourir à la visioconférence, sans l’accord des intéressés, devant toutes les juridictions pénales à l’exception des criminelles. Il s’agit donc d’un régime dérogatoire, dont le champ d’application est extrêmement étendu, susceptible d’être appliqué tant dans le cadre de comparutions devant les juridictions correctionnelles et les juridictions pour mineurs en matière correctionnelle qu’à l’occasion du débat contradictoire précédant un placement ou une prolongation de détention provisoire. Sur ce point plus précisément, le Conseil souligne qu’il peut être recouru à la visioconférence sans considération de la durée pendant laquelle le détenu a été privé de la possibilité de comparaître physiquement devant le magistrat chargé de statuer sur sa détention provisoire.
Dans un second temps, les Sages ne manquent pas de noter que le recours à la visioconférence, tel qu'il est ouvert par les dispositions litigieuses, n’est soumis à aucune condition légale ou aucun critère. Il s’agit d’une simple faculté pour les magistrats.
Au terme de ces constatations, les Sages rappellent l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale. Le Conseil juge qu’en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à la visioconférence, les dispositions litigieuses portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire durant leur période d’application.
Portée de la déclaration d’inconstitutionnalité. Jugeant que la remise en cause des mesures, prises sur le fondement des dispositions censurées, méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel décide que ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses.
Comme le souligne lui-même le Conseil dans son communiqué de presse, c’est la première fois que la Haute juridiction censure des dispositions issues d’une ordonnance non ratifiée par le Parlement.
| Pour aller plus loin : B. Fiorini, Vers une justice pénale de l’écran-total ? Réflexions sur la visioconférence en matière criminelle, Lexbase Pénal, décembre 2020 (N° Lexbase : N5708BY3) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476112
[Brèves] Quid de l’absence de communication des pièces à l’appui d’une requête ?
Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 20-15.673, F-P+I (N° Lexbase : A23004C8)
Lecture: 2 min
N6092BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 21 Janvier 2021
► Par son arrêt rendu le 14 janvier 2021, la Cour de cassation vient préciser qu’il résulte des dispositions de l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6612H7Z), que la copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces à l’appui de la requête ; en conséquence, l’absence de communication des pièces n’entache pas la régularité de l’ordonnance.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société d’avocats suspectant un détournement de sa clientèle par ses anciens collaborateurs et la société qu’ils ont constituée a saisi un juge des requêtes afin de voir désigner un huissier de justice pour exécuter diverses mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). La requête ayant été accueillie, les défendeurs l’ont assignée devant le juge des référés aux fins de rétractation. La requérante a interjeté appel de l’ordonnance ayant rétracté l’ordonnance sur requête.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris d’avoir violé l’article 495 du Code de procédure civile en infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête. Les intéressés indiquent que la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance découlant de l’article précité, doit permettre à la partie à laquelle elle est opposée de prendre connaissance de l’étendue des mesures d’instruction ordonnées, afin de pouvoir évaluer l’opportunité d’un recours.
En l’espèce, les juges d’appel avaient relevé que la communication d’une copie des pièces à l’appui de la requête n’était exigée par aucun texte, et le fait que les pièces n’avaient pas été transmises aux défendeurs à l’occasion de la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance n’emportait aucune atteinte au principe de la contradiction.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi, tout en relevant que durant l’instance d’appel, il n’était pas soutenu que les mesures d’instruction telles que mentionnées dans l’ordonnance n’étaient pas légalement admissibles au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476092







