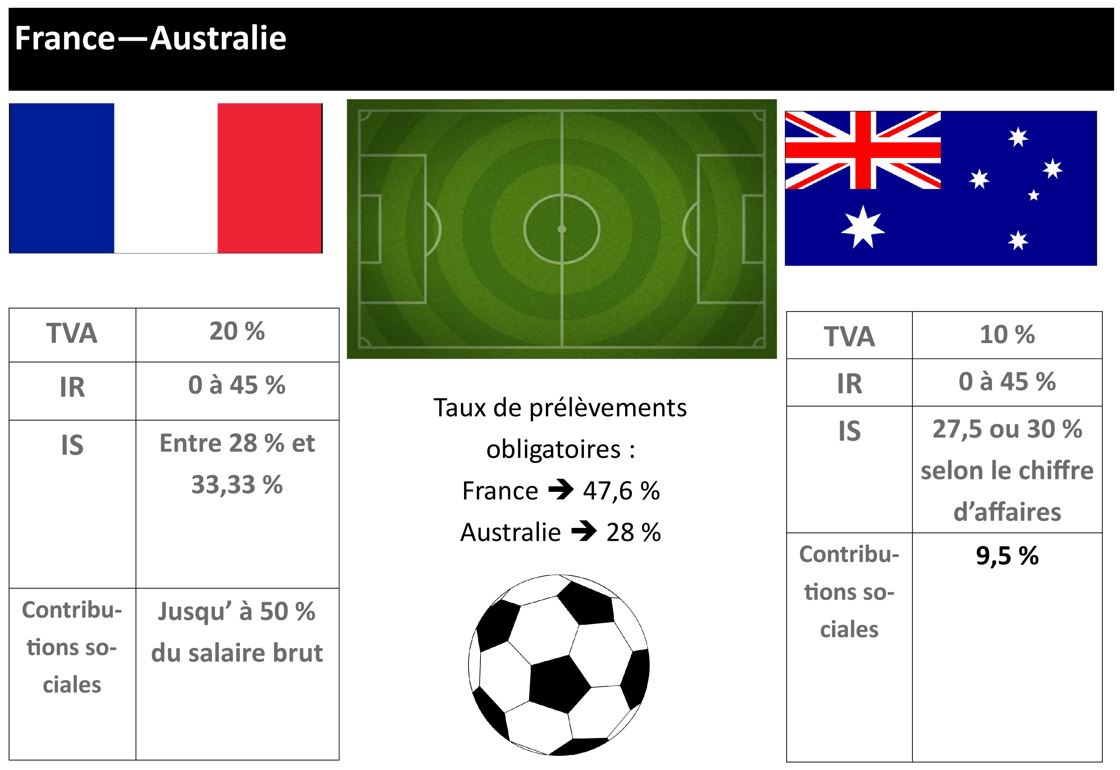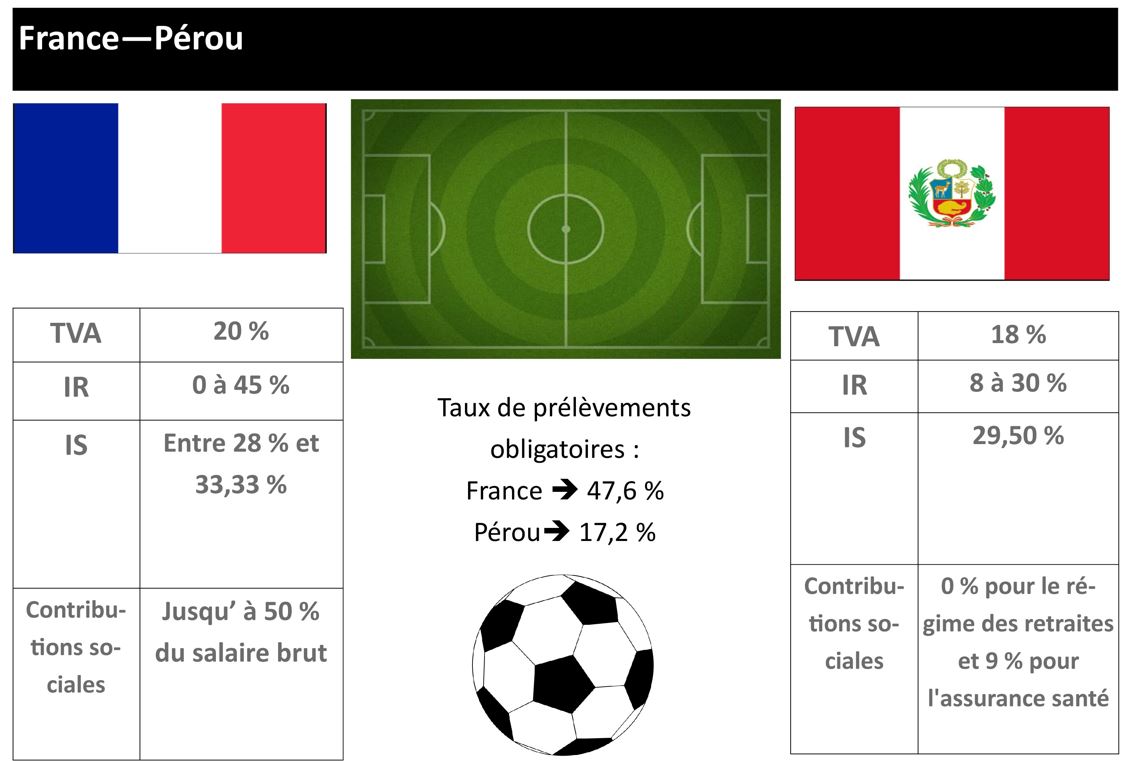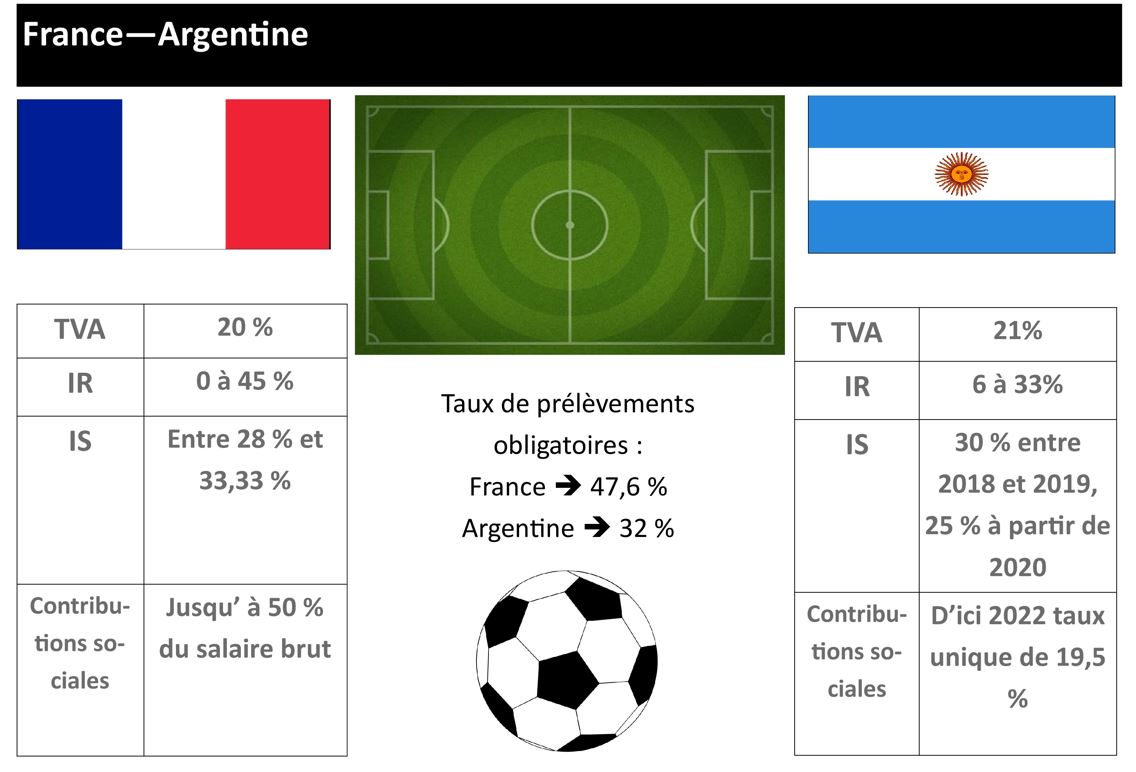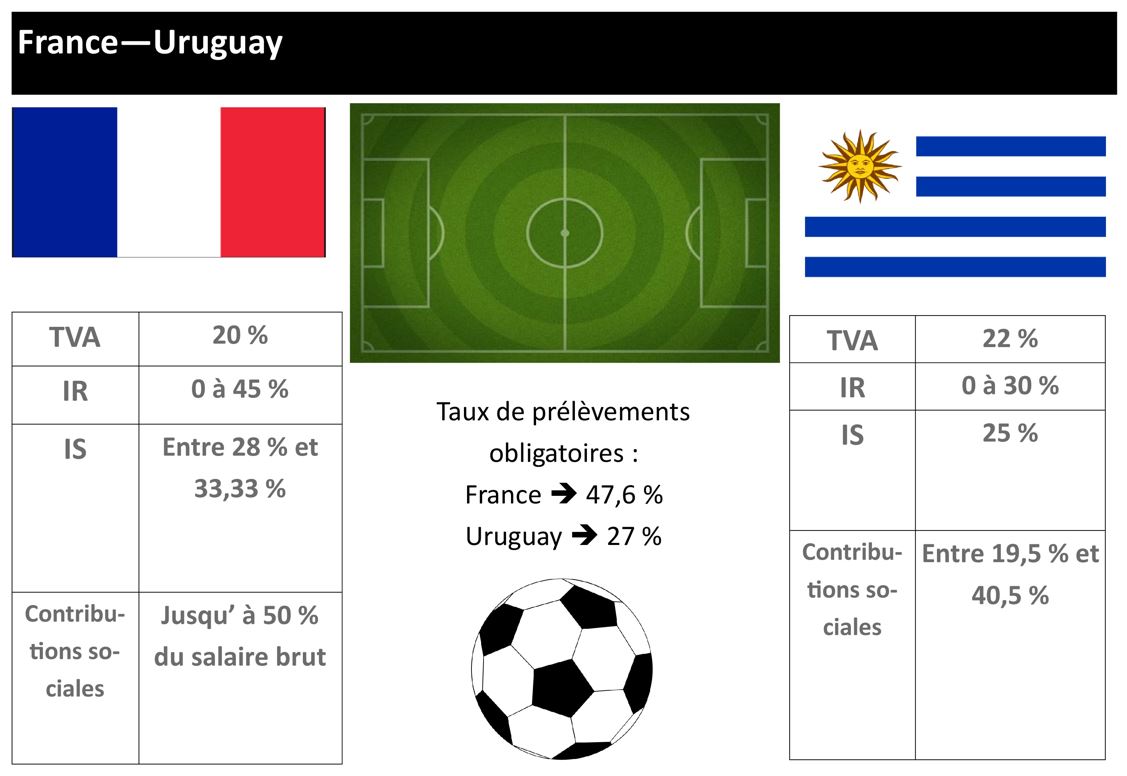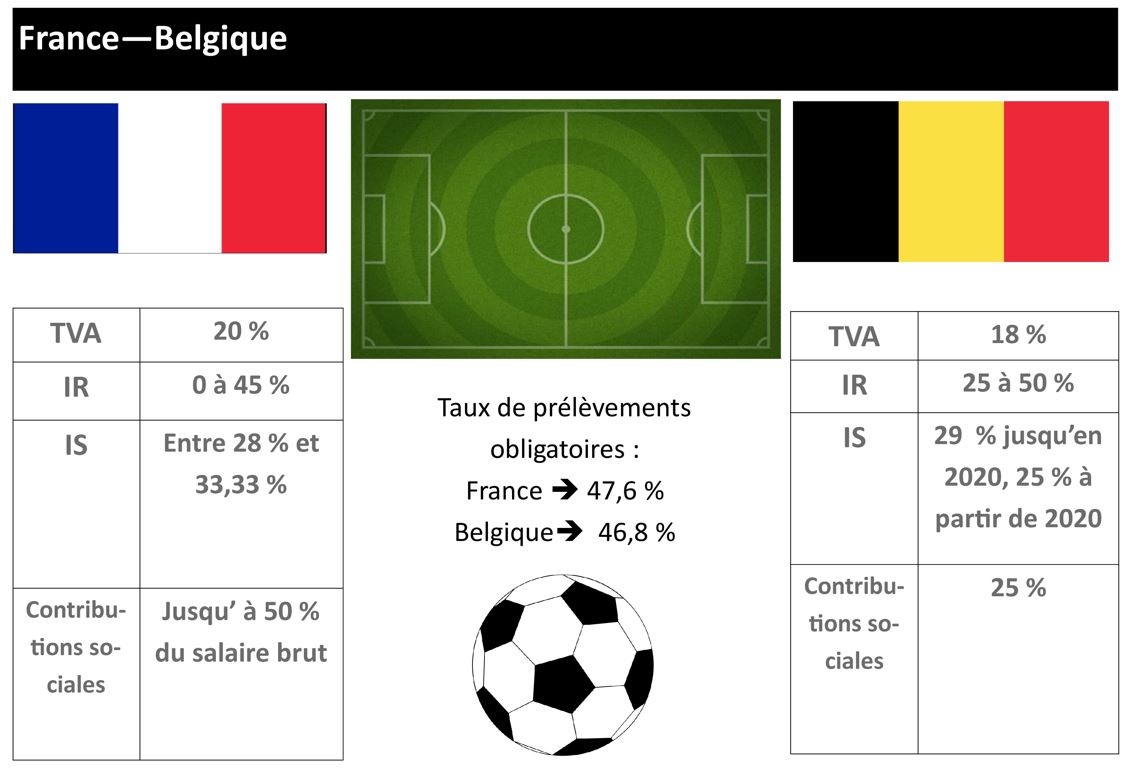[Le point sur...] L’impact du RGPD sur les cabinets d’avocats
Lecture: 8 min
N5041BXY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne Renard, Directeur du département conformité et certification, Alain Bensoussan Avocats
Le 18 Juillet 2018
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en application il y a quelques semaines. S’il s’inscrit pleinement dans la continuité d’une réglementation qui date de 1978, force est de constater qu’un grand nombre de cabinets d’avocats peinent à se conformer aux exigences en résultant. Principale raison : les "robes noires" considèrent que le secret professionnel auquel ils sont astreints les dispenses de se conformer au RGPD. Pourtant, c’est précisément pour cette raison qu’ils sont, au premier chef, concernés et doivent redoubler de vigilance. Décryptage.
I - L’applicabilité du RGPD aux cabinets d’avocats
Le Règlement général sur la protection des données («RGPD» ou «GDPR» en anglais), adopté le 27 avril 2016, est applicable dans l'ensemble des Etats membres de l’Union européenne depuis le 25 mai 2018 [1].
Il s'applique dès lors que le responsable de traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l’Union européenne ou que le responsable de traitement ou le sous-traitant met en œuvre des traitements visant à fournir des biens et des services à des résidents européens. En pratique, il s’applique donc chaque fois qu’un résident européen sera directement visé par un traitement de données [2].
Dès lors que les cabinets d’avocats mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel, en particulier dans le cadre de la gestion de leurs clients, ils sont tous concernés, peu importe leur taille ou leur structure d’exercice.
Les traitements des données des clients ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés. Tous les traitements liés à la gestion des ressources humaines, à la sollicitation personnalisée, à la communication externe, à la gestion de leur comptabilité, à la surveillance des locaux (vidéosurveillance ou badge par exemple) constituent des traitements de données à caractère personnel soumis au nouveau règlement.
II - Les principales obligations des cabinets d’avocats
Principe d’accountability. Avec l’entrée en vigueur du RGPD, les avocats doivent adopter une véritable posture Informatique et Libertés. Le RGPD impose de manière générale aux cabinets d’avocats de se soumettre à de nouvelles obligations, dont celle d'être en mesure de démontrer, à tout moment, la conformité de leurs traitements (principe de responsabilisation ou d'accountability).
Qualité des données. Les données doivent être collectées de manière loyale et licite et pour une finalité déterminée, explicite et légitime. Elles doivent, en outre, être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire. Avant de mettre un œuvre un traitement des données à caractère personnel, il conviendra de s’interroger sur la nécessité de traiter ces données et, dans la mesure où un tel traitement s’avère indispensable, sur les données qui permettront d’atteindre les finalités recherchées par le traitement [3].
Durée de conservation. Ces données ne doivent par ailleurs pas être conservées au-delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées [4]. Bien souvent, aucune véritable politique de durée de conservation n’est mise en œuvre au sein des cabinets, à l’exception du recours à un archivage papier. Les données ne peuvent être conservées de manière illimitée et l’avocat ne saurait être le tiers archiveur de son client. Le respect de ce principe implique la mise en place, au sein des cabinets d’avocats, d’une politique de durée de conservation et de purge tant pour les supports papiers que pour les supports numériques.
Mentions et contrats. La conformité au RGPD passe également par l’information des personnes concernées [5]. Cette information peut se faire par le biais de mentions particulières au sein des conventions d’honoraires, sur le site web ou les formulaires de collecte des données utilisés au sein du cabinet.
Par ailleurs, les avocats, en tant que responsables du traitement, doivent prêter une attention particulière aux contrats de sous-traitance conclus avec les prestataires auxquels ils recourent : prestataires informatiques, éditeurs de logiciel, ou encore prestataires en charge la paie. Conformément aux exigences du RGPD, les cabinets d’avocats devront mettre en place un contrat ou acte juridique avec leurs sous-traitants comportant un certain nombre de mentions spécifiques relatives à la protection et confidentialité des données et aux droits et obligations des parties dans le cadre des traitements mis en œuvre [6].
Sécurité et violation des données. Dès lors que, parmi les données collectées par les cabinets d’avocats, figurent des catégories particulières de données ou des données relatives à des infractions ou condamnation pénale, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de sécurité, tant logique que physique, qui soient adaptées aux risques présentés par ce type de traitements. Ceci est d’autant plus important que le RGPD instaure l’obligation de notifier à la Cnil toute violation de données à caractère personnel et, en cas de risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, l’obligation de communiquer sur l’existence d’une telle violation de sécurité auprès de ces personnes. La publicité d’une telle violation serait particulièrement préjudiciable pour l’image d’un cabinet.
Droits des personnes. Par ailleurs, il convient d’être en mesure non seulement d’informer les personnes concernées mais aussi de répondre à l’ensemble de leurs demandes d’exercice de droit (droit d’accès, droit à l’effacement droit à la portabilité, etc.) étant précisé que les cabinets d’avocats ne disposent que d’un mois pour répondre à une telle demande. Ce délai peut être prolongé à deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre des demandes [7].
Flux transfrontières. Certains cabinets d’avocats sont amenés à transférer des données à caractère personnel en dehors de l’Union européenne, et notamment les cabinets appartenant à des structures internationales. Or, dans ce cas, il est bien souvent nécessaire de prendre des garanties appropriées comme, par exemple, en concluant des clauses contractuelles types afin de s’assurer que le niveau de protection des données soit suffisant. Il est également nécessaire d’informer les personnes concernées sur l’existence de tels flux.
Délégué à la protection des données. Le Règlement général sur la protection des données impose de désigner un délégué à la protection des données (ou DPO) notamment lorsque l’activité, cœur de métier du responsable de traitement ou sous-traitant, requiert le suivi régulier et systématique de données à une large échelle ou lorsque l’activité cœur de métier du responsable ou du sous-traitant consiste à traiter à une large échelle des données sensibles ou relatives à des condamnations ou infractions. A cet égard, il est important de relever que le considérant 91 du RGPD précise que le traitement de données à caractère personnel de clients par un avocat exerçant à titre individuel ne devrait pas être considéré comme constituant un traitement à grande échelle. Au regard de ces critères, il semble que la majorité des cabinets d’avocats n’a pas à désigner de DPO. Toutefois, en fonction de la taille et du secteur d’activité du cabinet d’avocat, une telle désignation doit en tout état de cause s’analyser en opportunité dans la mesure où elle permettrait de désigner une personne afin d’accompagner le cabinet dans sa mise en conformité.
Registre des traitements. Le responsable de traitement doit tenir un registre relatif aux traitements de données mises en œuvre sous sa responsabilité. Cette obligation ne s’impose pas aux entreprises comptant moins de 250 salariés, sauf si le traitement qu'elles effectuent est susceptible de comporter un risque au regard des droits et des libertés des personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte notamment sur des données sensibles ou sur des données se rapportant à des condamnations et des infractions pénales. Au regard de ces critères, les cabinets d’avocats semblent tenus de devoir mettre en place un tel registre et une cartographie préalable des traitements mis en œuvre au sein du cabinet est nécessaire pour pouvoir remplir une telle obligation.
Analyse d’impact. Le RGPD [8] prévoit encore que lorsqu’un traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement doit effectuer, avant toute mise en œuvre, une analyse d’impact. A cet égard, et notamment en raison des termes du considérant 91 du RGPD (cf. supra), il semblerait que les cabinets d’avocats seront peu concernés par cette obligation. Néanmoins, un cabinet d’avocats, quel que soit sa taille, pourrait être amené à réaliser des analyses d’impact si les traitements mis en œuvre répondent à certaines caractéristiques.
III - L’avocat : responsable de traitement ou sous-traitant ?
Les cabinets reçoivent de plus en plus de demandes, de la part de leurs clients, de justifier de leur conformité au RGPD. Et pourtant, le seul fait que le cabinet d’avocats soit mandaté par son client ne présume pas de sa qualité de sous-traitant.
Concernant l’avocat plaidant, la Cnil considère que «dans le cadre de la gestion des affaires contentieuses, les avocats agissent en qualité de responsable de traitement» [9]. En effet, celui-ci agit en toute indépendance dans l’exercice de sa mission et met en œuvre des traitements de données à caractère personnel qui sont accessoires pour réaliser sa mission à la demande du client. Il ne reçoit pas d’instruction de la part du client pour la réalisation même du traitement de données à caractère personnel. Le Groupe de travail «article 29» était lui aussi venu préciser qu’un avocat pouvait être qualifié de responsable de traitement dès lors qu’il jouait, dans sa mission d’expertise, un rôle prépondérant [10].
Concernant l’avocat conseil, il n’est pas toujours amené à traiter des données à caractère personnel. En pratique, lorsque l’avocat a accès à un certain nombre de données personnelles dans le cadre de sa mission de conseil, il devrait également être qualifié de responsable de traitement. Toutefois, la Cnil a pu considérer que l’avocat, intervenant dans un audit sur la «base d’instructions strictement définies par leurs clients» [11], pourrait se prévaloir de la qualité de sous-traitant.
Il convient d’ajouter que l’Information Commissioner’s Office s’est également très récemment prononcée en faveur de la responsabilité de traitement en considérant qu’en fonction de son implication et du détachement des instructions du client, l’avocat peut être considéré comme un responsable de traitement [12].
IV - La protection du secret professionnel de l’avocat
On l’a dit, nombre d’avocats invoquent le secret professionnel auquel ils sont soumis pour être dispensés de se conformer aux obligations découlant du RGPD. Or, il ne fait aucun doute que nous sommes pleinement soumis à cette réglementation, et probablement encore plus à raison de la garantie de ce secret professionnel dont nous sommes investis.
Le RGPD et la loi Informatique et libertés, telle que modifiée par la loi relative à la protection des données personnelles ([LXB=L7645LKD]), prévoient un certain nombre d’exceptions pour qu’il n’y ait pas d’entrave au secret professionnel de l’avocat ce qui, a fortiori, démontre bien que l’avocat est pleinement soumis à cette réglementation.
Néanmoins, lors d’un contrôle par la Cnil, le secret ne peut lui être opposé que lorsque les informations sont couvertes par le secret professionnel «applicable aux relations entre un avocat et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou […] par le secret médical» [13]. Les informations sortant du champ de protection du secret professionnel, seront donc susceptibles d’être contrôlées par la Cnil. Sont concernées notamment les données à caractère personnel des collaborateurs et des salariés du cabinet par exemple.
On le voit, la mise en conformité avec le RGPD est un enjeu majeur pour toutes les entreprises, en ce incluant les cabinets d’avocats. Les responsables de traitement et les sous-traitants peuvent faire l’objet de sanctions administratives importantes en cas de méconnaissance des dispositions du RGPD. Les amendes administratives peuvent s’élever jusqu’à 10 ou 20 millions d’euros, ou, dans le cas d’un cabinet d’avocats, de 2 % jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu.
La mise en conformité des cabinets d’avocats est une nécessité et, outre le gage de confiance qu’elle constitue pour les clients et les collaborateurs, elle risque fort de devenir un enjeu de positionnement concurrentiel entre les cabinets d’avocats eux-mêmes face aux entreprises qu’elles accompagnent.
[1] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L0189K8I).
[2] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 3
[3] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 5
[4] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 5.
[5] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 13 et art. 14.
[6] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 28.
[7] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 12 (3)
[8] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, art. 35.
[9] Cnil, Guide «Les avocats et la loi Informatique et libertés», 2011 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9540ETI).
[11] Cnil, Guide « Les avocats et la loi Informatique et libertés », 2011.
[12] ICO, Data controllers and data processors : what the difference is and what the governance implications are, p. 9.
[13] Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles (N° Lexbase : L7645LKD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465041
[Brèves] CCMI : recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive engagée par le sous-acquéreur à l’encontre du constructeur
Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.627, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7969XXG)
Lecture: 2 min
N5038BXU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 18 Juillet 2018
► L’action engagée par les sous-acquéreurs d’une maison sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s’analyse en une action contractuelle et, étant attachée à l’immeuble, elle est transmissible aux acquéreurs successifs. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.627, FS-P+B+I N° Lexbase : A7969XXG).
Dans cette affaire, des époux avaient confié la construction de leur maison individuelle à une société spécialisée. La livraison était intervenue sans réserve. Ils avaient ensuite vendu leur maison à un couple, qui l’avait ensuite revendue à un autre couple. Des désordres affectant le réseau électrique et la charpente étant constatés, les derniers acquéreurs ont, après expertise, assigné les précédents acquéreurs et le constructeur en indemnisation de leurs préjudices.
En cause d’appel, les juges ont déclaré l’action contractuelle fondée sur la faute dolosive comme étant recevable, au motif qu’elle était attachée à l’immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur. Le constructeur a formé un pourvoi, soutenant que cette action ne se transmettait pas et qu’elle était donc nécessairement de nature délictuelle.
Le raisonnement n’emporte pas la conviction de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.
Notons que la troisième chambre civile n’en est pas à son premier coup d’essai en ce qui concerne la question de la transmission d’une telle action et son «rattachement» à l’immeuble. Elle a en effet retenu, dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-21.910, FS-P+B+R N° Lexbase : A8602KIG) et du 9 juillet 2014 (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-15.923, FS-P+B N° Lexbase : A4316MUE) que, sauf clause contraire, l’acquéreur et les acquéreurs successifs d’un immeuble avaient la qualité à agir contre le constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire. Selon la Haute juridiction, l’action fondée sur la faute dolosive du constructeur est bien de nature contractuelle dans la mesure où il s’agit d’une action attachée à l’immeuble. Par cette nature, elle est donc transmissible au sous-acquéreur, qui est recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A2686KB4) (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4480ET4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465038
[Brèves] Responsabilité contractuelle des constructeurs : caractérisation de la faute dolosive
Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-19.701, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7967XXD)
Lecture: 3 min
N5039BXW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 18 Juillet 2018
► Ne constitue pas une faute dolosive du constructeur, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la circonstance qu’il a commis une erreur de conception de l’ouvrage en utilisant du béton armé de mauvaise qualité et inadapté et en fournissant des plans d’armatures non-conformes conduisant à un important déficit de ferraillage du béton armé. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-19.701, FS-P+B+I N° Lexbase : A7967XXD).
Dans cette affaire, une chambre de commerce et d’industrie avait fait édifier, en qualité de promoteur, un groupe d’immeubles, qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement. Le syndicat des copropriétaires a autorisé des travaux dans un local commercial lui appartenant et situé au rez-de-chaussée d’un des bâtiments. Des travaux entraînant la suppression de toutes les cloisons intérieures du local réaménagé ont été réalisés. Des fissures étant apparues par la suite, le syndicat a, après expertise, assigné la chambre de commerce et d’industrie et la société qui était bureau d’études techniques lors de la construction de l’immeuble, qui a mis en cause la société chargée du contrôle technique. L’assureur de la chambre de commerce est intervenu volontairement à l’instance.
En cause d’appel, la société constituant le bureau d’études techniques (BET) a été condamnée à indemniser le syndicat, au motif que le professionnel avait commis une faute lourde tellement grave qu’elle devait être qualifiée de dolosive.
Cette solution ne convainc pas la Haute juridiction qui censure l’arrêt en énonçant la solution précitée.
La troisième chambre civile estime, de manière constante, que le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles (v. Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-22.772, FS-P+B N° Lexbase : A4806S3E, Cass. civ. 3, 27 juin 2001, n° 99-21.017 N° Lexbase : A7017C8E, Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A2686KB4). Dans un arrêt du 8 septembre 2009, elle offrait une conception relativement souple de la notion de dol puisque, concernant l’installation d’une cheminée dans une maison à ossature bois, réalisée dans des circonstances «calamiteuses» et incorrectes, elle a retenu que le constructeur n’ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle (Cass. civ. 3, 8 septembre 2009, n° 08-17.336, F-P+B N° Lexbase : A8977EKP). Invoquant cette notion de «précautions élémentaires», elle est toutefois revenue en 2017, à une appréciation plus stricte de cette faute dolosive. Elle a en effet estimé, s’agissant de travaux de gros œuvres sous-traités, que ne constituait pas une faute dolosive du constructeur de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la circonstance qu'il n'a pas pris les précautions élémentaires pour surveiller l'exécution des travaux qu'il a sous-traités (Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-22.772, FS-P+B, préc.).
Dans son arrêt rendu le 12 juillet 2018, la troisième chambre civile censure la cour d’appel qui, pour retenir une faute dolosive, avait relevé, notamment, les éléments suivants :
- défauts majeurs sur le plancher ;
- caractéristiques techniques du béton faibles, proches de la valeur minimale imposée ;
- plans d’armatures non-conformes entraînant un déficit en armature de 83 % ;
- qualité du béton à la limite de l’acceptable (selon les dires de l’expert) ;
- ampleur «considérable» du déficit de ferraillage du béton armé.
Tous ces éléments n’ont pas, selon la Cour, suffi à caractériser une faute dolosive de la part du constructeur (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4478ETZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465039
[Brèves] Délocalisation des audiences en zone d'attente de Roissy : la Cour de cassation valide !
Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-10.062, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7974XXM)
Lecture: 3 min
N5021BXA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 19 Juillet 2018
►Sont valides les audiences tenues dans l’annexe du tribunal de grande instance de Bobigny, ouverte depuis le 26 octobre 2017 au bord des pistes de l’aéroport de Roissy et accolée à la zone d’attente. Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt 11 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-10.062, FS-P+B+I N° Lexbase : A7974XXM).
Le juge des libertés et de la détention, statuant dans la salle d’audience concernée attribuée au ministère de la Justice, avait ordonné le maintien d'un ressortissant vénézuélien en zone d’attente pour une durée de huit jours. Le premier président de la cour d’appel de Paris, dans une ordonnance du 30 octobre 2017, avait confirmé ce maintien en zone d’attente (CA Paris, 30 octobre 2017, n° 17/04793 N° Lexbase : A3961WXY). Il avait, notamment, considéré que l’annexe n’était pas située dans l’enceinte de la zone d’attente mais à proximité.
L’intéressé et plusieurs associations (le Syndicat des avocats de France, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés, l’association la Cimade, l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, le Syndicat de la magistrature et l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers) avaient saisi la première chambre civile d'un pourvoi en cassation. Ils contestaient la validité des audiences, donc celle de l’intéressé, tenues dans ladite annexe.
La Cour de cassation rejette, toutefois, leur pourvoi en se fondant sur plusieurs éléments.
- La présence de pancartes
La Cour affirme, d’abord, que l’ordonnance constate que l’accès au bâtiment judiciaire ne peut se faire, pour le public, que par la porte principale au-dessus de laquelle figure en lettres majuscules la mention «TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY ANNEXE», et, pour les personnes maintenues en zone d’attente, par un passage extérieur situé en territoire français, conduisant à une porte signalée par l’inscription «TRIBUNAL» dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations-Unies. Le premier président en a donc, selon elle, exactement déduit que la proximité immédiate entre les locaux de la zone d’attente et la salle d’audience était exclusive d’une installation de celle-ci dans l’enceinte de la zone d’attente.
- L’autorité fonctionnelle du ministère de la Justice
Pour la Cour, en ayant relevé que cette salle était placée sous l’autorité fonctionnelle du ministère de la Justice et, localement, des chefs de juridiction, seuls à décider des modalités du contrôle des entrées confié à des agents des compagnies républicaines de sécurité, le premier président a aussi légalement justifié sa décision sur ce point.
- La conformité aux exigences légales
L’ordonnance énonce que la localisation de la salle d’audience dans la zone aéroportuaire est prévue par la loi qui a été validée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (Cons. const., décision n° 2003-484 DC, du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité N° Lexbase : A1952DAK) sous la réserve d’aménagement de la salle devant garantir la clarté, la sécurité, la sincérité et la publicité des débats. Pour la Cour, elle a donc exactement retenu que, dans ces conditions, l’installation de cette salle à proximité de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy répondait aux exigences légales de l’article L. 222-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5037IQM).
- L’exercice effectif des droits de la défense
La Cour considère, également, qu’après avoir précisé que les avocats et les parties ont accès au dossier pour préparer la défense des personnes en zone d’attente dès l’ouverture de la salle, disposent de locaux garantissant la confidentialité des entretiens, ainsi que d’une salle de travail équipée qui leur est réservée, l’ordonnance a retenu à bon droit que les droits de la défense pouvaient s’exercer effectivement.
- L’adaptations des conditions d’exercice de la Justice à la nature du contentieux
La Cour estime qu’ayant apprécié les conditions d’exercice de la justice au regard de la nature du contentieux soumis à de brefs délais imposés par la loi, et estimé que rien n’établissait que ces conditions étaient meilleures au siège du tribunal, le premier président, constatant l’existence d’un juste équilibre entre les objectifs poursuivis par l’Etat et les moyens utilisés par ce dernier pour les atteindre, a exactement retenu que le juge, qui avait tenu l’audience dans la salle située à proximité de la zone d’attente, avait statué publiquement et dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles.
Enfin, en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation des dispositions relatives à l’exercice d’une justice indépendante et impartiale, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Le pourvoi est donc rejeté, les audiences délocalisées à Roissy maintenues.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465021
[Focus] La France championne du monde de football… et de la taxation !
Lecture: 9 min
N5101BX9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 10 Septembre 2021
Nous l’attendions et c’est fait ! La France est pour la seconde fois de son histoire championne du monde de football. La compétition a battu son plein durant ces dernières semaines et nous nous réjouissons tous de la victoire de cette jeune équipe.
C’est une toute autre compétition que nous vous proposons !
En effet, les éditions Lexbase vous proposent de faire un rapide tour d’horizon des pays qu’a rencontrés la France durant ce tournoi pour désigner celui qui sera le champion cette fois-ci de l’imposition !
Phase de poules : France - Australie
VAINQUEUR : La France !
Pour l’essentiel, rappelons que les impôts des particuliers en Australie sont prélevés directement à la source. En plus de ces prélèvements, les salariés cotisent à un fond de retraite.
L’année fiscale australienne débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante. Deux barèmes d’imposition existent en fonction du statut fiscal de résident ou de non-résident.
Les impôts locaux qui regroupent la taxe d’habitation («Residential Land Tax»), que paient les propriétaires d’un bien immobilier occupé par un locataire, et la taxe foncière («Rates»), que paient les propriétaires d’un terrain ou d’une parcelle de terrain
Particularité de la fiscalité australienne qui présente un atout non négligeable : l’imposition sur le patrimoine et les droits de succession n’existent pas !
Rappel : une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale a été signée le 20 juin 2006 à Paris entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E0505EUA).
Phase de poules : France - Pérou
VAINQUEUR : la France !
Si la pression fiscale progresse régulièrement dans ce pays, elle demeure encore à un faible niveau malgré les mesures mises en œuvre pour lutter contre l’évasion fiscale, en particulier par l’intermédiaire de l’ITF (impôt sur les transactions financières).
Le taux d’imposition sur le revenu des personnes physiques s’articule selon un système d’unités annuelles. Tous les revenus de source péruvienne sont taxables, y compris ceux perçus par les non-résidents au Pérou.
Les principaux impôts péruviens sont : l’impôt sur le revenu (IR), l’impôt général sur les ventes (IGV, équivalent à la TVA), l’impôt sélectif à la consommation (ISC, sur des produits qui ne sont pas considérés comme de première nécessité ou mauvais pour l’environnement), l’impôt sur les transactions financières (ITF), et l’impôt temporaire sur les actifs nets (ITAN, s’applique sur la valeur nette des actifs de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédente à un taux de 0,4 % à partir d’un million de nuevos soles péruviens).
En l'absence de convention d'élimination des doubles impositions, les revenus de source péruvienne sont soumis au droit interne de chacun des Etats et de nombreux problèmes persistent en matière de double imposition. Il est d’ailleurs observé que le réseau conventionnel péruvien avec le reste des pays est extrêmement limité.
Phase de poules : France – Danemark
VAINQUEUR : la France !
Le seul véritable adversaire de cette compétition fiscale, le Danemark continue de garder une place prépondérante au palmarès de la fiscalité ! Et les charges sont loin d’être équitablement réparties ! En effet si le royaume danois se montre plutôt clémente avec les entreprises (à l’inverse de la France qui avec près de 35 % est le pays qui prélève le plus d’impôts sur les entreprises), les particuliers eux sont lourdement imposés.
Ainsi, le pourcentage varie ainsi de 41 % à 60 % du salaire brut. Et les festivités sont loin d’être terminées ! Aucun taux réduit en matière de TVA, des taxes sur des produits particuliers (à titre d’exemple l’achat d’un véhicule est imposé à 180 %). Il existe même un impôt «facultatif», destiné à financer les cultes. La contrepartie, une politique sociale généreuse puisque l'indemnisation chômage atteint par exemple 90 % du dernier salaire pendant deux ans.
Rappel : une convention a été signée à Paris le 8 février 1957 entre la France et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E2844EYY). A noter cependant que, par note diplomatique du 10 juin 2008, le Danemark a notifié à la France sa décision de mettre fin à cette convention.
Le match est ici serré mais la clarté globale du système fiscal danois, facteur d’acceptation de la population ne laisse aucun espoir à la défense française !
Huitième de finale : France - Argentine
VAINQUEUR : la France !
Historiquement érigé sur le socle des droits de douane, le système fiscal argentin s’est diversifié et modernisé par l’introduction d’impôts directs et progressifs.
L’impôt à la consommation représente la plus grande part des recettes fiscales (70 %) Le taux maximal d’impôt sur les revenus est de 33 % et les revenus du capital sont eux faiblement imposés. Particularité, les dividendes n’étaient pas imposés jusqu’en 2018 : 0 % (pour les dividendes versés sur des revenus obtenus jusqu'au 1er janvier 2018) ; 7 % (entre 2018 et 2019) ; 13 % (après 2019).
En Argentine, un dicton populaire dit qu’«après le foot, l’évasion fiscale est le deuxième sport national» (clin d’œil sans doute à l’affaire des «Football Leaks»). Et pour preuve, l’évasion fiscale atteindrait les 35 %.
Rappel : une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 4 avril 1979 à Buenos Aires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Argentine (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E4262EX7).
Quart de finale : France - Uruguay
VAINQUEUR : la France !
De manière très brève, rappelons que le taux d’impôt sur les sociétés en Uruguay est de 25 % pour les sociétés étrangères au même titre que les sociétés résidentes. Les plus-values sont imposées au taux standard de cet impôt sur les sociétés à 25 %.
Le taux standard de TVA (22 %) est réduit (10 %) pour certains bien essentiels, les médicaments, les services fournis par les hôtes à la haute saison, les services touristiques, les services de santé.
Le pays applique également une taxe de commercialisation, l’impuesto especifico interno, qui s'applique à la première vente, agissant comme des droits d'accise.
Les entreprises internationales ont basculé depuis le 1er janvier à une TVA de 22 % et un impôt sur le revenu de 12 %, appliqués aux sociétés non résidentes.
Aucune convention fiscale n’a été à ce jour signée avec la France. Notons que l’Uruguay a longtemps été considéré comme un paradis fiscal avant de s’engager dans la coopération internationale en matière fiscale pour mettre en place une assistance administrative effective.
Demi-finale : France - Belgique
VAINQUEUR : la France !
La Belgique est la seconde destination des expatriés fiscaux. Le pays est doté en effet d’une fiscalité patrimoniale attractive (pas d’ISF). De plus, elle n’impose pas les plus-values sur actions lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une gestion normale du patrimoine privé. Cette notion de gestion normale du patrimoine privé permet également de faire échapper à tout impôt les plus-values sur biens immobiliers et sur biens mobiliers. Les droits de donations entre vifs sont très réduits. Pour attirer les investissements internationaux, le pays a mis en place des dispositifs très accueillants avec ce qu'on appelle des «déductions d'intérêts notionnels». Les entreprises peuvent ainsi réduire leur base imposable en utilisant des capitaux propres pour financer leurs investissements. Les montants déductibles correspondent à un intérêt fictif calculé sur les fonds propres corrigés de la société. Enfin, les plus-values sur les ventes d'actions ne sont pas taxées, tout comme les plus-values immobilières après cinq ans de détention.
Seul l’impôt sur le revenu belge est plus élevé qu’en France, la tranche marginale s’établissant à 50 %. S’ajoute la taxe locale appelée «centimes communaux». La variation peut être importante en fonction des communes de 6 à 8 % de l’impôt sur le revenu.
La France a signé, le 10 mars 1964, avec la Belgique, une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E1711EUW).
La Grande finale : France - Croatie
VAINQUEUR : la France !
Une personne ayant établi sa résidence en Croatie doit payer des impôts sur la totalité de ses revenus, cela inclut les revenus provenant de biens immobiliers, les revenus d'une activité salariée, les revenus sur le capital, les revenus d'assurance, les revenus d'activités indépendantes, les pensions... Est considérée comme résidente fiscalement en Croatie une personne y séjournant plus de 183 jours de manière ininterrompue.
Les salaires sont taxés à la source et suivent un barème à trois niveaux.
Les municipalités peuvent imposer une taxe additionnelle, allant de 10 % à 30 % en fonction de la population.
Le taux normal de TVA est de 25 %, le taux réduit étant de 5 % ou 13 % selon les cas.
Là encore, les recettes fiscales proviennent pour l’essentiel par la taxation de la consommation et du capital.
Rappel : une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu a été signée le 19 juin 2003 à Paris entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E0411EUR).
Comme vous le voyez le France ne brille pas seulement dans un domaine. En matière de fiscalité elle se démarque aussi c’est certain mais malheureusement pas pour ses performances ! Complexité, illisibilité, augmentation incessante des impôts indirects pour compenser la faiblesse des recette fiscales, le chemin pour une fiscalité plus juste et moins inégalitaire sera encore long !
Mais que ce constat ne nous fasse pas oublier cette période de célébration nationale et l’exploit de notre équipe française alors malgré tout… allez les Bleus !
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465101
[Brèves] Traitement des données à caractère personnel : responsabilité d’une communauté religieuse
Réf. : CJUE, 10 juillet 2018, aff. C-25/17 (N° Lexbase : A6542XXL)
Lecture: 2 min
N5019BX8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 18 Juillet 2018
Une communauté religieuse, telle que celle des témoins de Jéhovah, est responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, du traitement des données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte. En outre, les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre d’une telle activité doivent respecter les règles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 10 juillet 2018 (CJUE, 10 juillet 2018, aff. C-25/17 N° Lexbase : A6542XXL).
La Cour de justice considère, tout d’abord, que l’activité de prédication de porte-à-porte des membres de la communauté des témoins de Jéhovah ne relève pas des exceptions prévues par la Directive 95/46 du 24 octobre 1995 (N° Lexbase : L8240AUQ). En particulier, cette activité n’est pas une activité exclusivement personnelle ou domestique à laquelle ce droit ne s’applique pas. La circonstance que l’activité de prédication de porte-à-porte est protégée par le droit fondamental à la liberté de conscience et de religion, consacré à l’article 10 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas pour effet de lui conférer un caractère exclusivement personnel ou domestique, en raison du fait qu’elle dépasse la sphère privée d’un membre prédicateur d’une communauté religieuse.
Ensuite, la Cour rappelle que les règles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ne s’appliquent, cependant, au traitement manuel des données que lorsque ces dernières sont contenues dans un fichier ou sont appelées à figurer dans un fichier. A cet égard, la Cour conclut que la notion de «fichier» couvre tout ensemble de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte et comportant des noms et des adresses ainsi que d’autres informations concernant les personnes démarchées, dès lors que ces données sont structurées selon des critères déterminés permettant, en pratique, de les retrouver aisément aux fins d’une utilisation ultérieure. Pour qu’un tel ensemble relève de cette notion, il n’est pas nécessaire que celui-ci comprenne des fiches, des listes spécifiques ou d’autres systèmes de recherche. Les traitements de données à caractère personnel qui sont effectués dans le cadre de l’activité de prédication de porte-à-porte doivent donc respecter les règles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.
En ce qui concerne la question de savoir qui peut être considéré comme responsable du traitement des données à caractère personnel, la Cour estime notamment qu’une personne physique ou morale qui influe, à des fins qui lui sont propres, sur le traitement des données à caractère personnel et participe, de ce fait, à la détermination des finalités et des moyens de ce traitement peut être considérée comme étant responsable du traitement. En outre, la responsabilité conjointe de plusieurs acteurs ne présuppose pas que chacun d’eux ait accès aux données à caractère personnel. En l’occurrence, il apparaît que la communauté des témoins de Jéhovah, en organisant, coordonnant et encourageant l’activité de prédication de ses membres, participe, conjointement avec ses membres prédicateurs, à la détermination de la finalité et des moyens du traitement des données à caractère personnel des personnes démarchées. Cette analyse n’est pas remise en cause par le principe de l’autonomie organisationnelle des communautés religieuses.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465019
[Panorama] Panorama de droit de la garde à vue (juin 2017- juin 2018)
Lecture: 26 min
N5020BX9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences - HDR, Université de Strasbourg
Le 18 Juillet 2018
Ce mois-ci, la revue Lexbase Pénal vous propose de retrouver un panorama retraçant un an de jurisprudence relative à la garde à vue, réalisé par Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences - HDR à l'Université de Strasbourg.
Les dispositions légales régissant la garde à vue dans notre pays font, régulièrement, l’objet de modifications. De plus, cet encadrement juridique donne fréquemment lieu à de la jurisprudence notable de la part de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce panorama propose alors de faire un point annuel sur les évolutions juridiques de cette «mesure phare» de la phase préparatoire du procès pénal qu’est la garde à vue. Trois questions y sont ainsi tour à tour abordées : les conditions du placement en garde à vue (I), la durée de la garde à vue (II) et enfin les droits du gardé à vue (III).
I - Conditions du placement en garde à vue
1) Nécessité d’une peine d’emprisonnement encourue
Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.338, FS-P+B (N° Lexbase : A6749XCX)
2) Nécessité de respecter un objectif légal
Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-87.588, FS-P+B (N° Lexbase : A4346WHG)
Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6075UMX)
Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 16-81.680, FS-D (N° Lexbase : A0658W9A)
1) Information de l’autorité judiciaire
Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.700, F-D (N° Lexbase : A6721XCW)
Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017, F-P+B (N° Lexbase : A0735W94)
Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 16-87.205, F-D (N° Lexbase : A8662XBG)
Cass. crim., 26 juin 2018, n° 18-80.596, F-D (N° Lexbase : A5650XUS)
2) Information du gardé à vue
Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-81.842, FS-P+B (N° Lexbase : A8114WXS)
Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.700, F-D (N° Lexbase : A6721XCW)
Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-84.158, FS-P+B (N° Lexbase : A7159WLQ)
II - Durée de la garde à vue
Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 17-80.880, F-D (N° Lexbase : A4533WWS)
Cass. crim., 11 avril 2018, n° 17-86.237, F-P+B (N° Lexbase : A1542XLP)
Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-85.940, FS-P+B (N° Lexbase : A3308XRX)
B - Procédures spéciales
[…]
III - Droits du gardé à vue
Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.872, F-P+B (N° Lexbase : A8110WXN)
B - Examen par un médecin
[…]
Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.380, FS-P+B (N° Lexbase : A6728XC8)
Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017, F-P+B (N° Lexbase : A0735W94)
D - Assistance d’un interprète
[…]
E - Enregistrement audiovisuel
Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.085, F-P+B (N° Lexbase : A0714W9C)
F - Droit au silence et à ne pas s’auto-incriminer
[…]
I - Conditions du placement en garde à vue
1) Nécessité d’une peine d’emprisonnement encourue
1. Selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9627IPA), la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle «une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs». Ainsi, la garde à vue est exclue en matière de contraventions et pour les délits pour lesquels la peine d’emprisonnement n’est pas encourue. Cette règle a vocation à jouer quelle que soit l’enquête dans laquelle la mesure intervient.
2. Cette solution de bon sens a parfois des incidences juridiques, comme en témoigne un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 février 2018 (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.338, FS-P+B N° Lexbase : A6749XCX ; cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4047EYK ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4293EUK) [1].
En l’espèce, un individu de nationalité colombienne avait été interpellé à bord d’un autobus en provenance d’Espagne à direction de Paris. Après qu’il ait présenté un passeport colombien dont le visa avait expiré, les policiers, qui avaient une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, qu’il avait commis le délit d’entrée irrégulière sur le territoire français, l’avaient placé en garde à vue.
3. Cependant, la Cour de cassation censure la procédure diligentée contre l’intéressé. En effet, elle observe «qu’en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n’est possible, en vertu des articles 63 et 67 du Code de procédure pénale, qu’à l’occasion d’enquêtes sur les délits punis d’emprisonnement». Or, le ressortissant d’un pays tiers entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l’espace Schengen, n’encourt pas l’emprisonnement prévu par l’article L. 621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1717I3Y) dès lors que la procédure de retour organisée par la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), n’a pas encore été menée à son terme. En conséquence, l’intéressé ne pouvait pas «être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d’entrée irrégulière».
2) Nécessité de respecter un objectif légal
4. Un placement en garde à vue ne peut pas être décidé dans n’importe quelle circonstance. En effet, depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9584IPN), l’article 62-2 du Code de procédure pénale prévoit que cette mesure doit constituer «l'unique moyen» de parvenir à l'un au moins des objectifs qu’il mentionne, à savoir :
«1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit».
5. La chambre de l’instruction dispose alors logiquement d’un pouvoir de contrôle en la matière. Une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 juin 2017 le rappelle (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-87.588, FS-P+B N° Lexbase : A4346WHG ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4293EUK) [2] .
Les faits concernaient un notaire qui se voyait reprocher plusieurs faits constitutifs d’infractions. Sur réquisitions du procureur de la République, les OPJ l’avaient fait comparaitre et l’avaient placé en garde à vue. Cette mesure était présentée comme l’unique moyen de garantir sa présentation devant le magistrat du Parquet afin que ce dernier puisse apprécier la suite à donner à l’enquête. Or, la garde à vue avait pris fin sans que l’intéressé n’ait été présenté au procureur. Il avait finalement été mis en examen.
6. Sans trop de surprise, ce notaire avait déposé une requête en nullité des pièces de la procédure, et notamment celles relatives à sa garde à vue ainsi que les actes subséquents. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes avait accueilli cette demande et déclaré nul les actes établis lors de la garde à vue. Elle avait ainsi considéré que la mesure en question n’était pas l’unique moyen de garantir la présentation de l’intéressé devant le procureur de la République et en avait déduit que cette irrégularité avait nécessairement causé un grief à l’intéressé qui avait été retenu sous la contrainte alors qu’une audition libre aurait été suffisante. La chambre de l’instruction justifiait ce choix en soulignant le fait que le notaire avait déféré à une première réquisition aux fins de remise de pièces et s’était ensuite rendue une seconde fois à la gendarmerie de sa propre initiative pour les mêmes raisons. En outre, il était noté que l’intéressé, qui disposait d’une famille et d’une situation connue, s’était présenté à la gendarmerie afin d’être entendu. En conséquence, la chambre de l’instruction considérait qu’il n’existait pas de raisons objectives de penser qu’il ne se présenterait pas devant un magistrat, quelle que soit la décision du procureur à propos de la suite de la procédure.
7. Cette solution n’est pas remise en cause par la Cour de cassation. Selon cette dernière, la chambre de l’instruction, en appréciant souverainement les faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 62-2 du Code de procédure pénale.
8. Ainsi, la chambre de l’instruction se doit de rechercher si la mesure de garde à vue retenue constituait réellement «l’unique moyen» de parvenir à l’objectif mentionné par l’article 62-2 choisi en l’espèce. L’arrêt étudié nous donne alors une indication importante sur la méthode à suivre pour opérer un tel contrôle : il faut prendre en considération les «éléments dont disposaient alors les officiers de police judiciaire» au moment où ils ont décidé de recourir au placement en garde en vue. L’appréciation en question se fait in concreto.
9. Rappelons par ailleurs, même si la décision étudiée ne dit mot sur ce point, que la chambre de l’instruction a la faculté, dans l’exercice de ce contrôle, de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l’OPJ (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6075UMX ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4293EUK) [3].
10. Une autre précision utile nous est enfin donnée, en la matière, par un arrêt de la Chambre criminelle du 20 décembre 2017 (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 16-81.680, FS-D N° Lexbase : A0658W9A). Selon ce dernier, la cour d’appel avait écarté, à bon droit, le moyen du demandeur selon lequel le motif de placement en garde à vue, à savoir permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, était fallacieuse dès lors qu’il n’avait été procédé à aucun acte d’investigation à l’exception des auditions de l’intéressé placé en garde à vue. En effet, pour la Haute juridiction, «une audition est une investigation» et le fait qu’il n’ait été procédé à aucun autre acte d’enquête au cours de la garde à vue ne saurait constituer une cause d’irrégularité de celle-ci.
1) Information de l’autorité judiciaire
11. Selon l’article 63, I, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3154I39) : «Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1».
12. Cette formalité est importante, dans la mesure où le procureur de la République incarne l’autorité et doit veiller à la garantie de la liberté individuelle. Il est alors connu que, pour une jurisprudence bien acquise, cette information ne doit pas être trop tardive : tout retard dans la mise en œuvre de l’obligation d’information du parquet non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief à la personne concernée. Les juges ont parfois été très stricts en la matière (pour un avis opéré 45 minutes après le placement en garde à vue jugé trop tardif, Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564, FS-P+B N° Lexbase : A0262RR7).
13. Aujourd’hui, la jurisprudence tend à admettre une information qui aurait été réalisée vingt-cinq (Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.700, F-D N° Lexbase : A6721XCW) ou trente minutes après le début de la garde à vue (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017, F-P+B N° Lexbase : A0735W94 ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4290EUG) [4].
14. Quid lorsque le mis en cause est en état d’ébriété ? Cette circonstance n’a aucune incidence sur l’obligation précitée ; une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 janvier 2018 le rappelle (Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 16-87.205, F-D N° Lexbase : A8662XBG ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4290EUG).
En l’espèce, le prévenu avait été interpellé au volant de son véhicule après avoir heurté un autre véhicule à la suite d’une circulation à contre sens. L’intéressé, en état d’ébriété, avait été placé en garde à vue à 1h30. La notification des droits afférents à la garde à vue était intervenue à 8h40 et le prévenu avait été entendu à 8h41. Or, le procureur de la République n’avait été avisé de ce placement qu’à 10h49 ! Un tel report, à défaut de circonstances insurmontables, était bien évidemment inadmissible. Pourtant, la cour d’appel de Nîmes avait refusé d’annuler d’autres actes que l’audition du mis en cause au cours de cette garde à vue.
15. Cette décision encourt, logiquement, la cassation dès lors que le placement en garde étant intervenu à 1h30 et l’information du procureur de la République à 10h49, il «appartenait aux juges de rechercher quels étaient les actes affectés par l’information tardive du ministère public dans cet intervalle et les actes subséquents dont ils étaient le support nécessaire». En outre, et surtout, la Haute juridiction précise ici qu’il n’importe, pour déterminer l’étendue de l’annulation, «que la notification des droits à l’intéressé ait été différée en raison de son état d’ébriété».
16. Notons enfin qu’un mis en examen ne saurait faire grief, en toutes circonstances, du fait que le procès-verbal rendant compte de l’information du procureur de la République en application de l’article 63, I, du Code de procédure pénale ne comporte pas toutes les mentions exigées par ce texte (Cass. crim., 26 juin 2018, n° 18-80.596, F-D N° Lexbase : A5650XUS).
En l’occurrence, en effet, le procureur de la République, qui dirigeait l’enquête ouverte pour trafic de stupéfiants, avait ordonné, la veille, la comparution de l’intéressé, au besoin par la force publique, pour éviter la disparition des indices matériels, et avait sollicité du juge des libertés et de la détention une autorisation de perquisition sans l’assentiment en vue de rechercher des produits stupéfiants tous éléments de preuve et d’identifier les auteurs. En conséquence, pour la Cour de cassation, ce magistrat était nécessairement informé de la qualification des faits et de la nécessité d’une garde à vue pour éviter la disparition des indices matériels.
2) Information du gardé à vue
17. En vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est «immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa» : de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu’elle bénéficie de différents droits (faire prévenir un proche et son employeur ; être examinée par un médecin ; être assistée par un avocat ; etc.).
18. Cette notification fait logiquement l’objet d’une protection par la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est ainsi que lorsqu’une personne a été placée en garde à vue du chef d’une infraction, l’omission, dans cette même notification, d’autres infractions qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre, emporte l’annulation des auditions effectuées pendant la garde à vue lorsqu’il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, et des actes dont elles sont le support nécessaire (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-81.842, FS-P+B N° Lexbase : A8114WXS) [5].
19. Cette notification doit être réalisée, dans tous les cas, rapidement. Une notification effectuée dans un intervalle de temps de 20 minutes après un placement en garde à vue demeure néanmoins admise (Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.700, F-D N° Lexbase : A6721XCW).
20. Rappelons que l’état d’ébriété de la personne gardée peut justifier un report de cette notification. Une décision du 21 juin 2017 attire, sur ce point, l’attention (Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-84.158, FS-P+B N° Lexbase : A7159WLQ ; cf. les Ouvrages «Procédure pénale» N° Lexbase : E4307EU3 et «Droit pénal général» N° Lexbase : E1553GAR) [6].
En l’espèce, un employé d’hôtel avait déclaré à son directeur avoir été victime d’une agression sexuelle commise par un client dans la chambre qu’il occupait. Rapidement, les services de police avaient arrêté l’agresseur qui se trouvait en état d’ivresse et l’avaient placé en garde à vue. Cette dernière avait alors débuté à l’heure de l’interpellation, soit le soir à 22h22. Or, l’OPJ avait décidé de différer la notification des droits à 2h45 du matin, l’intéressé ayant été placé dans l’intervalle en cellule de dégrisement (il s’était d’ailleurs livré, à cette occasion, à une exhibition sexuelle). Il avait finalement été reconnu coupable des deux infractions précitées.
21. Le prévenu avait alors formé un pourvoi en cassation. L’un de ses moyens nous intéressait plus particulièrement ici. Il reprochait en effet aux juges du fond de ne pas avoir statué sur l’exception de nullité qu’il soulevait. Selon lui, en effet, ses droits de gardé à vue lui avaient été notifiés alors qu’il était encore en état d’ébriété. Il se considérait ainsi, à 2h45 du matin, comme encore sous l’emprise de l’alcool et qu’en conséquence la notification de ses droits était intervenue trop tôt. Or, cette exception de nullité avait été rejetée par la cour d’appel de Bordeaux au motif que les mentions du procès-verbal de notification permettaient, semble-t-il, de s’assurer qu’il avait retrouvé sa lucidité à ce moment-là et qu’il était en état de comprendre ses droits. La Cour de cassation rejette alors le moyen en question. Elle confirme le fait qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a justifié sa décision.
22. Rappelons que l’état d’ébriété est une circonstance de nature à légitimer le retard dans la notification des droits (Ch. Mauro, Garde à vue : Rép. Pénal Dalloz, 2014, n° 102). Pour les juges, en effet, il s’agit d’une «circonstance insurmontable» empêchant l’intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement (Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-86.466, F-D N° Lexbase : A7996NDI. - Cass. crim., 6 décembre 2016, n° 15-86.619, F-P+B N° Lexbase : A3690SPD ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4376EUM). Or, dans notre hypothèse, la notification avait pu avoir lieu à 2h45 du matin, car l’officier de police judiciaire avait bien constaté «de visu et par un questionnement simple» que l’intéressé avait retrouvé sa lucidité et pouvait, par conséquent, se voir notifier la mesure le concernant.
II - Durée de la garde à vue
23. Le délai d’une garde à vue est de 24 heures, que nous soyons en présence d’une enquête de flagrance (C. proc. pén., art. 63, II, al. 1° N° Lexbase : L3154I39) ou une enquête préliminaire (C. proc. pén., art. 77 N° Lexbase : L5572I3R). La nature de l’infraction importe peu.
24. Cette durée peut cependant être prolongée. C’est ainsi que, selon l’article 63, II, alinéa 2 du code, en droit commun, si le gardé à vue est un majeur une seule prolongation de 24 heures de plus est possible. Il en va ainsi «sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2». Notons que l'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, «à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable».
25. Une décision récente attire l’attention en la matière (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 17-80.880, F-D N° Lexbase : A4533WWS). Pour rejeter le moyen de la nullité de la prolongation de garde à vue, tiré du caractère alternatif de la motivation de l’absence de présentation préalable au procureur de la République, les juges de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles avaient retenu qu’il résultait de la procédure que le magistrat du parquet ayant autorisé la prolongation de la garde à vue relevait dans le corps de l’autorisation de prolongation que de nombreuses investigations demeuraient à effectuer compte tenu de l’ampleur du dossier et qu’un défèrement était envisagé. La chambre de l’instruction en avait alors déduit qu’en prévoyant ainsi l’absence de présentation à titre exceptionnel pour la «charge de la permanence du parquet et/ou des services d’enquête», le magistrat avait suffisamment justifié pour l’un ou l’autre, voire pour ces deux motifs, l’absence de présentation préalable de la personne en garde en vue, sans qu’il ait été nécessaire de justifier plus avant son manque de disponibilité en raison de la permanence qu’il devait assurer, ainsi que le manque de disponibilité des services d’enquête à raison des investigations à mener dans un dossier d’ampleur. Dès lors, pour la Cour de cassation, cette décision, reposant sur son «appréciation souveraine du caractère exceptionnel des circonstances permettant de prolonger la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée», était parfaitement justifiée.
26. Signalons également un arrêt récent ayant précisé qu’une telle prolongation ne peut être décidée par une magistrate intérimaire, non membre du corps judiciaire, désignée sur le fondement de l’article 56 du décret du 22 août 1928 modifié (permettant la désignation, pour pourvoir des emplois vacants de magistrats dans les juridictions d’outre-mer, d’intérimaires n’appartenant pas au corps judiciaire), qui a été abrogé par le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (N° Lexbase : L7828BGZ) (Cass. crim., 11 avril 2018, n° 17-86.237, F-P+B N° Lexbase : A1542XLP).
En l’occurrence, la chambre de l’instruction en avait déduit qu’en raison de cette abrogation, la désignation, pour exercer les fonctions de procureur de la République à Mata-Uta (île de Wallis), à compter du 1er janvier 2016, d’une telle magistrate intérimaire était dénuée de base légale, et qu’il en résultait que les actes qu’elle avait accomplis étaient inexistants, ce qui devait conduite à l’annulation, notamment, de la prolongation de la garde à vue de l’intéressé et de son audition réalisée par les enquêteurs pendant cette prolongation.
27. Sans surprise, la Cour de cassation ne remet pas en cause cette solution de bon sens. En effet, «l’abrogation d’un texte ou d’une disposition ayant procédé à l’abrogation ou à la modification d’un texte ou d’une disposition antérieur n’est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale ; une telle remise en vigueur ne peut intervenir que si l’autorité compétente le prévoit expressément». Ainsi, il ne peut en aller autrement que, par exception, dans le cas où une disposition a pour seul objet d’abroger une disposition qui n’avait elle-même pas eu d’autre objet que d’abroger ou de modifier un texte et que la volonté de l’autorité compétente est de remettre en vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale. Or, tel n’était pas le cas ici.
28. Par ailleurs, rappelons que pour l’article 803-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9884I3H) : «Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt». Ce principe n’est cependant pas absolu. En effet, l’article 803-3 prend soin de préciser qu’«en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté». Il incombe par conséquent à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en œuvre de cette mesure dérogatoire. C’est ce que rappelle une décision de la Chambre criminelle du 13 juin 2018 (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-85.940, FS-P+B N° Lexbase : A3308XRX ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E2009EUX) [7].
29. En l’espèce, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions des textes précités, mais aussi de l’article 593 du code, la cour d’appel de Paris avait énoncé qu’il avait été mis fin à la garde à vue d’un individu le 9 mars 2017 à 15 heures 45, au terme du délai de 24 heures, et que par nécessité en raison de contingences matérielles, celui-ci n’avait été présenté que le lendemain, 10 mars, à 11h15, soit avant expiration du délai de 24 heures, au magistrat du Parquet qui lui avait notifié les faits reprochés ainsi que la date d’audience de jugement avant de le laisser libre. Les magistrats ajoutaient que de la sorte l’intéressé n’était plus sous une mesure de contrainte après la 20ème heure. Or, cette solution n’est pas partagée par la Cour de cassation qui estime qu’en se prononçant ainsi, sans déterminer le circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en œuvre de la mesure de rétention, la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision.
30. Pour finir, observons que l’état du droit régissant la prolongation de garde à vue pourrait connaître des évolutions dans les prochains mois. En effet, un projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été présenté au Conseil des ministres du 20 avril 2018 par Mme Belloubet, Garde des sceaux. Or, ce texte, qui a notamment pour ambition la simplification et le renforcement de l’efficacité de la procédure pénale, prévoit, par son article 31, deux nouveautés intéressant la prolongation de la garde à vue (pour une autre évolution, V. infra, n° 44).
31. D’une part, l’article consacre les décisions de justice autorisant la prolongation de la mesure de garde à vue aux seules fins de permettre un défèrement pendant les heures ouvrables. Cette jurisprudence serait alors légalisée. L'idée serait de préciser que la garde à vue peut être prolongée aux seules fins de garantir la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire dans les tribunaux ne disposant pas de «petits dépôts» (autrement dit dans toutes les juridictions à l'exception de Paris, Bobigny et Créteil).
32. D’autre part, afin d'alléger le formalisme de la prolongation de la garde à vue, le même article 31 du projet de loi cherche à rendre facultative la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue. La nature de l’infraction importerait ici peu.
B - Procédures spéciales
[…]
III - Droits du gardé à vue
33. Aux termes de l’article 63-2 du Code de procédure pénale : «I. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays». Ce droit doit être rapidement exercé. En effet, «Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande».
34. Ce principe n’est cependant pas sans limite. En effet, selon le même article : «Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne». Ce report donne parfois lieu à de la jurisprudence notable.
35. Citons, à titre d’exemple, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 octobre 2017 (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.872, F-P+B N° Lexbase : A8110WXN ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4308EU4). En l’espèce, l’avocat d’un mis en examen avait déposé une requête en nullité prise de l’irrégularité de la mesure de garde à vue. Il invoquait ainsi la tardiveté de la requête de l’officier de police judiciaire au procureur de la République tendant à ce qu’il ne soit pas fait droit à la demande de l’intéressé que son frère soit informé de son placement en garde à vue en application de l’article précité.
36. Or, pour la Haute juridiction, l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant écarté ce moyen échappe à la censure (même s’il s’était prononcé à tort sur le fondement de l’article 63-2 dans sa version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 N° Lexbase : L4202K87). La Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en effet en mesure de s’assurer que l’OPJ s’était en l’occurrence référé au procureur de la République moins d’une heure quinze après le placement en garde à vue de l’intéressé, et que ce magistrat, ayant pris sa décision à la suite, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de trois heures prévu au 3ème alinéa de l’article 63-2, il avait été satisfait aux dispositions de ce texte dans sa version alors applicable.
B - Examen par un médecin
[…]
37. Selon l’article 63-4-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L4968K8I), du code : «La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes».
38. Encore faut-il cependant, pour que cet article s’applique, être en présence d’une véritable audition. Une décision récente le rappelle (Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.380, FS-P+B N° Lexbase : A6728XC8) [8].
En l’espèce, lors d’une perquisition effectuée au domicile du demandeur, placé en garde à vue, celui-ci, qui avait déclaré l’assistance d’un avocat, s’était vu présenter des téléphones portables qu’il avait dit ne plus utiliser, ainsi qu’une clé de contact de véhicule qu’il avait identifiée comme étant celle d’une voiture ne lui appartenant, qu’il avait reconnu utiliser et avoir stationnée dans un box de sa résidence. Pour écarter le moyen de nullité, les magistrats de la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Paris énonçaient notamment qu’il n’avait pas été porté atteinte aux droits de l’intéressé des lors qu’il avait été informé du droit de se taire, que les objets saisis ne lui avaient été présentés qu’en vue d’une reconnaissance et que les réponses qu’il avait faites ne pouvaient être considérées comme auto-incriminatoires. Or, pour la Cour de cassation, cette décision est justifiée dès lors que la chambre de l’instruction s’est expliquée comme elle le devait sur la teneur des déclarations du requérant et en a déduit qu’elles n’avaient pas le caractère d’une audition au sens de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale, mais répondaient aux prescriptions de l’article 54 dernier alinéa du même code.
39. Par ailleurs, rappelons que des particularités légales existent concernant le mineur placé en garde à vue. En effet, selon l’article 4, IV, de l’ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) : «dès le début de garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue […]». L’assistance du mineur en garde à vue par un avocat est donc devenue obligatoire. Une décision de la Chambre criminelle du 20 décembre 2017 le rappelle (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017, F-P+B N° Lexbase : A0735W94 ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E1771EU7) [9].
40. En l’occurrence, un mineur avait révélé avoir été victime d’une agression sexuelle, d’une tentative de viol et d’un viol commis par un autre garçon, mineur au moment des faits. Ce dernier avait donc été placé en garde à vue le 21 mars 2017 à 8h05. A 8h15, l’avocat de permanence était avisé de ce placement par un message vocal laissé sur son répondeur téléphonique. A 8h35, le Parquet était à son tour informé. Le gardé à vue était finalement auditionné une première fois, de 10h15 à 11h20, en l’absence de son avocat. Ce dernier avait toutefois pu prévenir les enquêteurs qu’«il passerait voir son client» dans l’après-midi. Un entretien avait ainsi eu lieu entre les deux protagonistes de 15h40 à 16h. Or, après cela, de 16h à 17h05, le mineur avait été une nouvelle fois entendu sur les faits sans l’assistance de son avocat avant d’être mis en examen le lendemain.
41. L’intéressé avait, par l’intermédiaire de son avocat, déposé une requête en annulation des actes accomplis au cours de la garde à vue. Cependant, la chambre de l’instruction avait écarté le moyen de nullité invoqué, au motif que l’avocat, avisé de la mesure dont le mineur faisait l’objet dix minutes après le début de celle-ci, avait pu faire connaître aux enquêteurs le moment auquel il se présenterait à leur service et avait pu effectivement s’entretenir, lors de sa venue, avec son client. Un pourvoi en cassation avait alors été formé.
42. La décision de la Cour de cassation est à l’origine de plusieurs précisions utiles. D’une part, elle constate qu’en raison du renvoi opéré par l’article 4, IV, de l’ordonnance du 2 février 1945 précité à l’article 63-4-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les enquêteurs pouvaient procéder deux heures après le début de la garde à vue, à une première audition du mineur sans l’assistance de son avocat qui avait été avisé. D’autre part, et surtout, elle estime que la chambre de l’instruction aurait dû constater que la seconde audition était irrégulière au motif qu’il n’apparaissait pas au procès-verbal de la garde à vue que «l’avocat qui s’était présenté et avait eu un entretien avec le mineur avait été informé de l’horaire de la seconde audition». Dès lors, la Haute juridiction annule cette seconde audition et étend les effets de cette annulation aux actes dont elle était le support nécessaire.
43. Enfin, rappelons que depuis la loi du 3 juin 2016 l'article 63-4-3-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4840K8R), modifié à la suite d’un amendement sénatorial, prévoit que l'avocat de la personne gardée à vue doit être informé sans délai si cette dernière est transportée sur un autre lieu. La circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces du 30 juin 2016 a alors logiquement précisé qu'il «résultait des débats parlementaires que cette information ne doit évidemment intervenir qu'en cas de transports effectués pour les nécessités de l'enquête, mais qu'elle ne s'applique pas aux autres transports, comme ceux nécessités par une hospitalisation ou un examen médical, ou ceux nécessités pour les présentations devant un magistrat en vue d'une éventuelle prolongation de la garde à vue». Néanmoins, et en dépit de cette circulaire, force est de constater que cette obligation n’est pas circonscrite par la loi aux seuls actes durant lesquels la personne gardée à vue a le droit à la présence de son avocat. Cela est donc de nature à imposer une contrainte excessive aux enquêteurs.
44. Face à cette difficulté, le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (v. supra, n° 30 et s.) cherche, par son article 31, à préciser la portée de l’obligation pour les enquêteurs d’aviser l’avocat du transport d’une personne gardée à vue, qui ne s’appliquerait que lorsque la personne devrait être entendue ou participer à un tapissage ou une reconstitution. En revanche, cet avis ne se rencontrerait plus en cas de transport à l’hôpital pour un examen médical.
D - Assistance d’un interprète
[…]
E - Enregistrement audiovisuel
45. Aux termes de l’article 64-1 du Code de procédure pénale : «Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel».
46. Concernant cette obligation, une décision récente a eu l’occasion de préciser qu’un requérant ne saurait faire grief de ce qu’aucun enregistrement n’a été effectué durant sa garde à vue qui s’est déroulée à bord d’une frégate de la Marine nationale, lieu non visé par l’article 64-1 du Code de procédure pénale, texte qui ne concerne que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.085, F-P+B N° Lexbase : A0714W9C).
F - Droit au silence et à ne pas s’auto-incriminer
[…]
[1] Dalloz.fr, actualité, 20 février 2018, obs. J.-M. Pastor ; JCP éd. G, 2018, 254, obs. Ph. Collet ; Dr. Pénal, 2018, comm. 91, obs. A. Maron et M. Haas.
[2] Dalloz.fr, actualité, 30 juin 2017, obs. D. Goetz ; RSC, 2017, p. 765, obs. F. Cordier ; AJ Pénal, septembre 2017, p. 403, obs. G. Roussel ; Procédures, 2017, comm. 210, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; Gaz. Pal., 24 octobre 2017, p. 56, obs. F. Fourment.
[3] D., 2017, p. 1339, note S. Pellé ; AJ Pénal, 2017, p. 353, obs. J. Andréi ; Dr. Pénal, 2017, comm. 80, obs. A. Maron et M. Haas ; D., 2017, Pan. p. 1676, obs. J. Pradel.
[4] Dalloz.fr, actualité, 15 janvier 2018, obs. D. Goetz ; Procédures 2018, comm. 90, obs. A.-S. Chavent-Leclère.
[5] Dalloz.fr, actualité, 5 décembre 2017, obs. S. Fucini.
[6] Dalloz.fr, actualité, 17 juillet 2017, obs. D. Goetz.
[7] D., 2018, AJ, p. 1314.
[8] Procédures, 2018, comm. 124, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; Dr. Pénal, 2018, comm. 69, obs. A. Maron et M. Haas ; JCP éd. G, 2018, 469, n° 15, obs. J.-B. Perrier.
[9] Dalloz.fr, actualité, 15 janvier 2018, obs. D. Goetz ; Procédures, 2018, comm. 90, obs. A.-S. Chavent-Leclère.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465020
[Brèves] Explosion d’un transformateur électrique en raison d’un défaut de sécurité : quid des régimes de responsabilité et de prescription applicables
Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-20.154, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7968XXE)
Lecture: 3 min
N5022BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 19 Juillet 2018
► Si selon l’article 1386-18, devenu l’article 1245-17 du Code civil (N° Lexbase : L0637KZM), le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas la possibilité pour la victime d’un dommage d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, telles la garantie des vices cachés ou la faute (v. CJCE, 25 avril 2002, C-183/00, point 31 N° Lexbase : A5768AYB).
Tel n’est pas le cas de l’action en responsabilité du fait des choses, prévue à l’article 1242, alinéa 1er du Code civil (N° Lexbase : L0948KZ7) qui, lorsqu’elle est invoquée à l’encontre du producteur après la mise en circulation du produit, procède nécessairement, elle aussi, d’un défaut de sécurité.
En conséquence, l’action en responsabilité du fait des choses intentée par le propriétaire d’un bâtiment d’exploitation détruit en raison d’une surtension accidentelle sur le réseau électrique et à l’explosion d’un transformateur situé à proximité de la propriété, plus de trois ans après la connaissance de l’origine électrique du sinistre, est prescrite. Telle est la solution d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-20.154, FS-P+B+I N° Lexbase : A7968XXE).
Dans cette affaire, un incendie avait détruit un bâtiment d’exploitation. Le dommage ayant été imputé à une surtension accidentelle sur le réseau électrique et à l’explosion d’un transformateur électrique situé à proximité de la propriété, le propriétaire de l’immeuble et son assureur ont assigné sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la société ERDF, qui leur a opposé la prescription de leur action, en se prévalant de l’application de la responsabilité du fait des produits défectueux. En cause d’appel, leur action a été déclarée irrecevable comme prescrite, l’arrêt s’étant fondé sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et donc du délai de trois ans. Un pourvoi a été formé.
Les demandeurs soutenaient, d’une part, que la réparation des dommages causés par une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relevait pas du domaine de la Directive du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT) et qu’ils étaient donc libres d’agir sur un autre fondement et, d’autre part, que le régime de la responsabilité du fait des choses n’est pas fondé sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre mais sur le fait de la chose. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi, raisonnant comme suit :
- Champ d’application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux
Elle procède d’abord à un examen du champ d’application de la Directive, pour conclure que le législateur national n’a pas limité le champ d’application de ce régime de responsabilité à la réparation du dommage causé à un bien destiné à l’usage ou à la consommation privé et utilisé à cette fin. Elle énonce par ailleurs que, si par une décision du 4 juin 2009 (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-285/08 N° Lexbase : A9623EHU), la Cour a dit pour droit que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relevait pas du champ d’application de la Directive, pour autant, elle a précisé que celle-ci devait être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’interprétation d’un droit national ou à l’application d’une jurisprudence bien établie, selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage dès lors qu’elle rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre les deux.
- Rejet de l’application du régime de la responsabilité du fait des choses
La Haute juridiction rejette le pourvoi, estimant que l’action en responsabilité du fait des choses repose, à l’instar de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, sur un défaut de sécurité du produit, de sorte que seul ce régime peut s’appliquer en l’espèce. En conséquence, l’action intentée par le propriétaire de l’immeuble détruit était soumise à une prescription de trois ans, conformément à l’article 1245-16 du Code civil (N° Lexbase : L0636KZL) (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E3544EUS et N° Lexbase : E3532EUD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465022
[Jurisprudence] Responsabilité et paris sportifs : «La vida es una tombola»
Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.046, F-P+B+I (N° Lexbase : A9313XQY)
Lecture: 19 min
N5053BXG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Henri Conte, docteur en droit qualifié aux fonctions de maître de conférences
Le 18 Juillet 2018
Mots-clés : responsabilité sportive / football / hors-jeu / violation des règles du jeu / paris sportifs
Résumé : Un joueur parie sur le résultat de plusieurs matchs de Football dont les bons pronostics sont susceptibles de lui faire gagner 1 500 000 euros. La faute d’un joueur sur le terrain lors de l’un de ces matchs lui fait perdre la majorité de ses gains, ce qui le pousse à agir en responsabilité contre lui et son club. Cet arrêt permet de s’interroger sur les conditions d’application de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, de la responsabilité pour faute au regard de la nature de celle-ci et sur les conditions de réparation du préjudice de perte de chance.
«Si yo fuera Maradona
Perdido en cualquier lugar
La vida es una tombola
De noche y de dia» [1]
1. Un parieur, qu’il faudra appeler Joseph. K, a validé une grille de jeu «loto foot» sur laquelle il a pronostiqué les résultats de 14 matchs de Football. Il vise juste sur 13 d’entre eux. Le 14ème opposait le club du «LOSC» à celui de l’«AJ Auxerre» et le joueur paria sur un match nul entre les deux équipes. Mais en matière sportive, le destin peut être cruel pour certaines équipes qui peuvent perdre un match à cause d’une faute dans le jeu. En l’espèce, ce n’est pas la «Main de Dieu» [2] qui est intervenue pour accabler l’équipe adverse mais un hors-jeu lillois qui a crucifié les Auxerrois sur l’autel de la justice sportive. En effet, le joueur lillois Moussa Saw parvient à marquer un but facilité par un hors-jeu de plus de deux mètres, à 24 secondes de la fin du temps réglementaire [3].
Le destin fut en effet douloureux pour notre parieur qui prétendait que cette faute lui avait fait perdre la chance de gagner la somme de 1 494 441,70 euros. Puisque la justice sportive ne pouvait rien pour lui, il se retournait vers celle des hommes mais fut débouté en première et en seconde instance. Le tribunal de Clermont-Ferrand comme la cour d’appel de Riom n’étaient pas enclins à reconnaître l’existence d’une faute civile de la part du joueur et de son club susceptible d’engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) et/ou 1242, alinéa 5 (N° Lexbase : L0948KZ7), du Code civil.
Joseph K, pas plus découragé que l’homme de la campagne [4], forma alors un pourvoi devant la Cour de cassation qui lui répondit le 14 juin 2018 qu’il ne pouvait «l’autoriser à entrer» [5]. Elle rejeta le pourvoi en expliquant tout d’abord que, contrairement à ce qui est développé dans celui-ci «seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur, et le cas échéant de son club, à l’égard d’un parieur». Les juges du droit ont ensuite considéré que la cour d’appel avait exactement retenu que la transgression de la règle sportive, ici le hors-jeu, ne constituait pas un tel fait.
Cet arrêt rendu le 14 juin 2018, promis à une large diffusion [6], répond classiquement à une question sur la distinction entre la faute dans le jeu et la faute contre le jeu qui peut, elle, donner lieu à une responsabilité civile mais il recèle par ailleurs de nombreuses questions sous-jacentes sur l’évolution possible de cette jurisprudence.
La question qui se pose de la manière la plus évidente est celle de savoir si la position de hors-jeu du joueur qui lui permet de marquer un but, constitue une faute caractérisée, au sens de l’article 1240 du Code civil et si elle est de nature à engager sa responsabilité et celle de son club pour permettre au parieur d’être indemnisé de son préjudice de perte de chance. Mais ce serait effectuer une lecture trop rapide de l’arrêt qui ne fait pas référence à une faute caractérisée mais à une transgression de la règle sportive ayant sciemment porté atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs. Il est donc nécessaire d’analyser les liens de concordance entre les deux. Il est tout aussi envisageable de s’interroger sur la nature des fautes susceptibles d’engager la responsabilité d’un club ou d’un joueur à l’égard d’un parieur.
Il est une autre question, posée devant les instances inférieures, relative à la portée de cette perte de chance. Etait-il raisonnable, pour Joseph. K, de demander en exorde, l’exacte somme qu’il aurait pu gagner si l’issue du match lui avait été favorable ?
Pour répondre à ces interrogations, il est possible de reprendre l’attendu de la Cour de cassation et de considérer, dans un premier temps, la transgression de la règle sportive susceptible d’engager des responsabilités (I) pour ensuite envisager les faits susceptibles de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs (II).
I - La mise en jeu des responsabilités d’après la transgression des règles sportives
2. Les commettants et préposés. Le parieur a décidé de n’engager la responsabilité que du commettant, le «LOSC» et de son joueur préposé. Pourtant, c’est bien l’arbitre, lui aussi préposé de la fédération [7], qui est à l’origine d’une mauvaise lecture du jeu et il paraît nécessaire d’expliquer pourquoi les actions contre les commettants aboutissent rarement dans ces cas (A) avant de se pencher sur la responsabilité pour faute du joueur professionnel (B).
A - Les responsabilités de l’arbitre et du commettant
3. La responsabilité de l’arbitre. Le demandeur, à l’évidence procédurier, n’a pas cru bon d’agir en responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du Code civil contre le préposé de la ligue de football professionnelle qui le fait intervenir dans des compétitions sportives. Bien lui en a pris puisqu’il aurait fallu démontrer que celui-ci avait agi en excédant les limites de sa mission, ce qui aurait eu pour effet de lever son immunité que lui a conférée la jurisprudence «Costedoat» [8] et qui aboutit rarement [9]. Il y a certes un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 1965 [10] qui reconnaît la responsabilité du commettant pour une faute commise par un arbitre mais cet arrêt avait justement été rendu sous un empire différent de celui de la jurisprudence précitée. Dans l’arrêt du 31 mars 1965, un joueur de Water-Polo avait reçu de la part d’un autre nageur, un coup de poing involontaire à l’œil gauche sous la direction et l’arbitrage d’un M. Y. Les juges du droit avaient confirmé l’analyse de la cour d’appel qui reprochait à ce dernier d’avoir commis une faute de surveillance et de ne pas avoir su modérer «l’ardeur des joueurs» [11].
Une autre difficulté [12] aurait pu surgir au sujet du lien de subordination qui est classiquement exigé entre le commettant et son préposé pour engager la responsabilité du premier. Ce lien est l’expression du «fait qu'une personne en commette une autre, c'est-à-dire lui assigne une tâche particulière» [13]. Il est caractérisé par l'autorité qu'exerce le commettant sur un préposé qui lui est subordonné et trouve son essence dans un rapport d’autorité [14]. L’article L. 223-3 du Code du sport (N° Lexbase : L1364LDU) disposait, pourtant, dans sa version applicable au litige que «les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B) et L. 1221-3 (N° Lexbase : L0771H9G) du Code du travail» [15]. Il s’agit d’une qualification négative de la qualité de salarié de l’arbitre [16] mais qui a pour objectif louable de sanctuariser son indépendance vis-à-vis de la fédération. Or, ce lien de préposition semble a priori contraire au principe d’indépendance de l’arbitre qui doit caractériser l’exercice d’une telle profession. Une analogie peut être faite avec l’avocat collaborateur salarié à qui il serait difficile de donner la qualité de préposé de l’avocat qui l’emploie sans nier ce caractère d’indépendance qui fait la force de la profession ou encore avec celle du médecin libéral qui doit exercer son art en toute indépendance. Toutefois, ce serait nier que le lien de préposition est apprécié dans un but purement indemnitaire et que les juges ne se gênent pas pour reconnaître la qualité de préposé à un travailleur dont l’essence de sa mission est caractérisée par une totale indépendance [17]. L'absence de subordination, inhérente notamment aux professions libérales, n'est donc pas exclusive de la préposition [18]. C’est tout du moins le sens de l’arrêt du 5 octobre 2006 [19] qui reconnaît la qualité de préposé à un arbitre de rugby tout en considérant qu’il avait agi dans les limites de sa mission [20]. L’article L. 223-3 du Code du sport n’existait toutefois pas encore dans cette dernière espèce puisqu’il a été promulgué le 23 octobre 2006 mais la portée de cet arrêt lui résistera sûrement et on continuera de voir des préposés non-salariés, totalement indépendants, dont la faute sera rarement retenue [21].
4. La responsabilité du club de football. Au terme de l’article 1242, alinéa 5, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Le club sportif du «LOSC» est le commettant du joueur responsable du hors-jeu et le lien de préposition ne pose ici pas de problème [22]. En revanche, pour que puisse être engagée la responsabilité du club, il faut que la victime parvienne à démontrer la faute du préposé [23]. Mais quelle est la nature de cette faute qui doit être rapportée ? Selon l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 avril 2004, il s’agit, en matière sportive, d’une «faute caractérisée par une violation des règles du jeu» [24]. Il est nécessaire de rappeler la nature de cette faute puisqu’elle est différente en fonction du domaine dans lequel elle est réclamée. Il serait, en effet, absurde de demander au salarié d’une usine de voiture de prouver une faute de cette nature. De manière générale, la faute du salarié en dehors du domaine sportif doit être intentionnelle [25], ce qui constitue finalement un durcissement de la jurisprudence de l’arrêt «Costedoat» [26] qui se contentait d’affirmer que «n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant» [27].
5. Stratégie procédurale. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le joueur n’avait pas commis de faute caractérisée par une violation des règles du jeu mais il est utile de rappeler que si tel avait été le cas, le commettant aurait pu essayer d’échapper à sa responsabilité en démontrant que le footballeur n’avait pas agi dans le cadre de ses fonctions et avait commis, par son positionnement hors-jeu, un «abus de fonction» [28]. Une telle stratégie aurait eu toutefois bien peu de chance d’aboutir puisqu’il est difficilement contestable que M. Moussa Saw agissait parfaitement dans les limites de ses fonctions, étant entendu que ce genre de faute est très fréquente dans ce sport.
Que ce soit contre l’arbitre ou contre le club, il paraît extrêmement difficile de parvenir à retenir la responsabilité du commettant sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du Code civil. Il y a donc un paradoxe qui peut être mise en avant dès maintenant. La Cour de cassation est très encline à reconnaître le lien de préposition entre un commettant et un préposé. Cela permet d’étendre les cas d’ouverture de la responsabilité de l’article 1245 alinéa 5 et d’encourager une meilleure indemnisation. Elle est en revanche, beaucoup plus réticente à reconnaître la faute du préposé ce qui protège le commettant par contumace. En conséquence, ce fondement n’est pas toujours satisfaisant pour les victimes. Les conditions de l’article 1240 du Code civil sont-elles plus protectrices pour ces dernières ?
B - La responsabilité pour faute du joueur
7. Faute dans le jeu et faute contre le jeu. L’avantage de l’article 1240 du Code civil sur l’article 1242, alinéa 5, et que dans ce dernier, c’est la responsabilité du commettant pour la faute du préposé qui est recherchée alors que dans le premier, ce n’est que la responsabilité de l’auteur présumé qui l’est. Les conditions sont donc normalement moins difficiles à réunir puisqu’il n’y a pas toute la jurisprudence de l’article 1242, alinéa 5, qui s’y attache et qui est devenue, on l’a vu [29], particulièrement contraignante. Toutefois, il faut relativiser cet apparent avantage puisque la nature de la faute exigée est la même. Il faudra, pour engager la responsabilité du joueur professionnel, parvenir à démontrer une faute civile contre le jeu ou encore «une faute caractérisée par une violation des règles du jeu» [30]. Quelle est cette faute d’une nature toute spéciale puisqu’elle n’a vocation qu’à s’appliquer au domaine sportif ? D’origine prétorienne, elle ne peut se définir que négativement par des cas d’espèce. Ainsi, un joueur de tennis qui lance une balle dans la direction du carré de service de son partenaire et qui le blesse commet une irrégularité de service mais non une faute au sens de l’article 1240 du Code civil [31]. Dans le même sens, un coup reçu sur la tête lors de la dispute d’une balle aérienne au cours d’un match de football n’a pas été considéré comme un manquement caractérisé aux règles du jeu du football [32]. Le même sort a été réservé au tacle d’un gardien de but qui est sorti de sa surface de réparation et qui a occasionné une fracture du tiers moyen du tibia au joueur qui essayait de le dribbler [33]. Il semble donc bien difficile de caractériser une faute civile puisque même en présence d’un dommage corporel, une telle action est rarement qualifiée comme contraire aux règles du jeu.
8. Le rôle de l’acceptation des risques dans l’appréciation de la faute. Il est peut-être possible d’expliquer cette réticence des juges à reconnaître une telle faute par l’imprégnation de la théorie de l’acceptation des risques. Cette théorie vise : «à partir de l'idée selon laquelle celui qui accepte de participer à une activité à risques doit supporter les conséquences de la réalisation de ceux-ci, à alléger ou à supprimer la responsabilité de l'auteur du dommage»[34] et constitue, selon une partie de la doctrine, la reconnaissance de lege lata du pouvoir de s’exonérer de la responsabilité extracontractuelle [35]. Alors qu’elle était déclarée moribonde en matière de responsabilité du fait des choses [36], elle semble encore imprégner le fait personnel en matière sportive. Analysée comme une convention visant à s’exonérer de sa responsabilité extracontractuelle, elle ne doit alors jouer que lorsque les différentes parties se sont mises d’accord entre elles, ce qui justifie qu’elle soit exclue à l’égard des tiers [37]. Par exemple, elle pourra s’appliquer à l’ensemble des joueurs présents sur le terrain lors d’un match de rugby, aux deux boxeurs sur un ring ou encore aux cavaliers dans un manège. Elle se justifie dans le domaine sportif par la haute technicité et le danger inhérent à des activités parfois dangereuses auxquelles les sportifs s’adonnent volontairement et qui justifierait que le critère de la faute soit rehaussé. En conséquence, la théorie de l’acceptation des risques ne peut justifier l’application, en l’espèce, d’une faute caractérisée puisque le parieur est justement un tiers qui ne peut être considéré comme ayant accepté un risque lors d’un match auquel il n’a pas participé.
La première branche du moyen faisait référence à «toute faute résultant d’une transgression de la règle sportive commise par un joueur dans le cours du jeu […] engage sa responsabilité et celle du club dont il dépend dès lors qu’elle a indûment faussé le résultat de la rencontre […]». La Cour de cassation a répondu à cette seule branche du moyen opérante en expliquant que l’auteur du pourvoi avait tort et que «seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard du parieur». La Cour de cassation ne se place donc pas entièrement du point de vue de la faute dans le jeu et contre le jeu, qui a donné lieu à une abondante jurisprudence, mais de celui du fait fautif, ici la transgression de la règle sportive, qui aurait sciemment porté atteinte à l’aléa du pari sportif.
9. Il faut donc se demander quelle est la nature de cette transgression de la règle sportive et en quoi elle aurait sciemment porté atteinte à l’aléa du pari sportif.
II - La transgression de la règle sportive et les atteintes à l’aléa des paris sportifs
10. Le hors-jeu et le gain. Pour répondre à la question posée ci-dessus, il suffira d’analyser dans un premier temps la nature de cette transgression (A) pour ensuite envisager dans quelle mesure elle a porté atteinte ou non à l’aléa du pari sportif (B).
A - La transgression de la règle sportive
11. Le hors-jeu. La Cour de cassation dit clairement qu’un fait qui a pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif peut se matérialiser dans la transgression de la règle sportive et que cette transgression peut être une faute au sens de l’article 1240 du Code civil. En l’espèce, la transgression de la règle sportive porte sur le positionnement hors-jeu du footballeur donc les juges du fond devaient se demander, dans un premier temps, si ce hors-jeu était susceptible d’être qualifié de faute et, dans un second temps, s’il avait porté sciemment atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs.
En France, c’est l’«International Football Association Board» qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du Football et c’est la loi n° 11 du règlement qui concerne le hors-jeu. Elle prévoit qu’un joueur est en position de hors-jeu si, hors de sa moitié de terrain, il est au-delà du ballon et de l’avant-dernier adversaire (gardien de but compris) [38]. Le règlement distingue la position du hors-jeu de l’infraction de hors-jeu. Dans la première, le hors-jeu n’a aucune incidence sur le cours du jeu. Le joueur se situe simplement hors de sa moitié de terrain, au-delà de l’avant-dernier adversaire et du ballon. Dans la seconde, non seulement le joueur est en position de hors-jeu mais il prend une part active dans celui-ci et profite donc d’un avantage certain sur les autres joueurs. L’infraction du hors-jeu devient donc une faute sanctionnée par un coup franc indirect qui doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commise. C’est précisément ce qu’il s’est passé dans le cas d’espèce puisque le joueur a profité de son hors-jeu pour marquer un but contre l’adversaire. Dans le Football, une telle transgression qui devient une infraction quand le joueur a influencé le jeu reste toutefois mineure puisqu’elle n’est pas sanctionnée d’un carton. Si l’arbitre s’était rendu compte du hors-jeu, il aurait simplement annulé le but et sifflé un coup franc pour l’équipe adverse.
Pourtant, ce n’est pas parce qu’il y a une infraction au sens de la loi n° 11 du Football qu’il y a une faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil. Depuis longtemps, le juge garde la possibilité d’apprécier librement si le comportement d’un sportif, même en cas d’infraction dans le jeu, constitue une faute civile : «Mais attendu que le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité» [39]. Cela n’empêche pas le juge de faire référence aux règles du sport en cause mais il n’est heureusement pas lié par elles.
Pour dire qu’une telle transgression ne caractérisait pas une faute civile, les juges du fond avaient, eux, expliqué que «la rapidité qui caractérise les actions menées au football de même que le rôle conféré à tout joueur qui, recevant le ballon et se trouvant en position offensive, se doit de réagir immédiatement dans le cadre de l’action de jeu, mettent obstacle à ce qu’une telle action puisse recevoir la qualification d’une faute civile génératrice de responsabilité» et que «la simple transgression de la règle sportive, survenue dans le cours du jeu et non contre le jeu en saurait, ne saurait à elle seule constituer une faute civile […]». Ils avaient donc classiquement répondu à la question au travers de la logique de la faute dans le jeu et contre le jeu exposé auparavant [40]. La Cour de cassation reprend aussi la problématique de la faute contre le jeu en répondant à la première branche qui avait pour objectif de modifier la jurisprudence de la deuxième chambre civile. On peut lire dans cette première branche du moyen que «toute faute résultant d’une transgression de la règle sportive commis par un joueur dans le cours du jeu, engage sa responsabilité […] dès lors qu’elle a indument faussé le résultat de la rencontre». La Cour de cassation va plus loin en ajoutant la référence à l’aléa inhérent aux paris sportifs. Les juges du droit apportent donc une véritable plus-value à l’arrêt de la cour d’appel de Riom et il ne faut pas douter que cette formulation sera reprise dans le futur. La Cour de cassation précise, par ailleurs, que la transgression doit avoir été «sciemment» réalisée. L’adverbe renvoie à l’idée d’une action effectuée : «En sachant précisément ce que l'on fait […] en connaissance de cause, consciemment, délibérément, volontairement» [41]. Les juges du droit confirment donc l’idée qu’en matière sportive une faute intentionnelle est nécessaire pour s’assurer de la gravité du fait commis. Sans doute est-il fait allusion, par cet adverbe, à l’organisation de tricheries qui sont intentionnelles par nature. Cela permettrait de faire la différence avec les transgressions aux règles sportives qui ont porté atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs mais de manière involontaire. C’est le cas ici. Il s’agit, enfin, d’un arrêt important car les décisions rendues en matière de paris sportifs consécutives à une action en responsabilité intentée par un parieur à l’égard d’un joueur ou d’un club sont très rares.
12. Dans l’arrêt du 14 juin 2018, la transgression de la règle du jeu qui est patente, ne suffit pas pour caractériser la faute civile. Il faut qu’elle ait porté sciemment atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs.
B - L’atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportif
13. Le gain. Même une faute caractérisée n’aurait pas suffi pour engager la responsabilité du joueur ou de son club. En effet, pour engager une telle action, il faut avoir un intérêt à agir et cet intérêt n’existait pas s’il n’y avait pas eu un pari sportif et la perte substantielle d’un gain pour son parieur. Dès lors, les motifs de la décision de la cour d’appel de Riom auraient gagné à le préciser. En effet, il s’agissait bien ici de démontrer le lien de causalité entre la faute de hors-jeu et la perte de chance de gagner la somme de 1 500 000 euros et non pas simplement de constater que la faute de hors-jeu ne constituait pas une faute civile.
C’est donc bien une précision supplémentaire que livre la Cour de cassation. S’il y avait eu une transgression de la règle sportive d’une gravité telle qu’elle aurait tourné en faute civile, il aurait fallu qu’elle porte atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs. Cela est déjà arrivé dans un arrêt du 14 mai 1972 [42]. Dans celui-ci, un parieur avait assigné un jockey en responsabilité car il considérait que ce dernier avait violé un article du Code des courses, que cette faute avait bien été relevée par les commissaires de la société et qu’elle lui avait faire perdre la chance de gagner des gains correspondant à ses paris. La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges du fond qui avaient retenu que la violation de ce Code des courses pouvait être analysée en une faute qui avait entraîné, pour le parieur, la perte de chance de réaliser des gains.
14. Quelles fautes ? Il est légitime de se demander quels faits seraient suffisamment graves pour dépasser la simple faute dans le jeu et être susceptibles de porter atteinte à l’aléa qui le caractérise ? Les cas de dopages et d’organisation de matchs truqués font sans doute partie de ces cas-là et ils pourraient voir leur nombre augmenter depuis la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : L0282IKN). Il est indéniable que, grâce à internet, les paris ont connu un développement exponentiel. Les sommes colossales qu’ils engendrent attirent la convoitise de personnes malavisées qui ne rechignent pas à truquer les rencontres sportives. La dimension internationale de ce genre de pari rend, de plus, les contrôles et la régulation difficile [43] et il est reconnu «qu'historiquement le secteur des jeux attire les réseaux criminels […] que la dimension «cyber» des paris modernes offre encore plus de possibilités de dissimulation criminelle» [44]. De tels scandales ont déjà éclaté dans le Handball [45], dans le tennis [46] ou encore dans le championnat national de Football français [47]. La gravité de telles actions est indiscutable et a justement pour objectif de supprimer l’aléa inhérent à la rencontre sportive et par conséquent, aux paris qui en dépendent. Qu’il s’agisse du dopage ou de falsifications de résultats sportifs, ces faits devraient être de nature à engager la responsabilité civile [48] de leurs auteurs à l’égard des parieurs floués.
15. La perte de chance. Dans l’arrêt commenté, le parieur aurait dû prouver le lien de causalité entre la faute du joueur et la perte de chance de gagner une certaine somme. Or, celui-ci demandait, en première instance, la somme totale de ses gains à laquelle il a soustrait la somme qu’il a pu empocher grâce à ses treize autres bons pronostics et qui s’évaluait à 5 538, 30 euros. S’il s’est ravisé devant la cour d’appel, il est entendu qu’une telle demande n’aurait pu aboutir sur le principe du quantum puisque l’aléa demeure attaché au principe de la réparation du préjudice de perte de chance. La Cour de cassation affirme constamment à ce sujet que «la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée» [49]. En demandant la somme totale possible des gains, c’est précisément l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée qui a été demandé. Il faut toutefois reconnaître qu’en marquant un but à 24 secondes de la fin du match, les chances étaient très fortes pour que le match nul sur lequel Joseph. K pariât, se réalisât. Mais qui sait si une autre intervention divine ou fautive ne serait pas intervenue ci-après pour mettre de nouveau un terme aux espérances légitimes de notre homme de campagne. Ce simple doute justifie à lui seul la réduction du montant de la réparation à de plus justes proportions.
16. Le samedi 3 mars 2018, au siège de la Fédération internationale de football (FIFA), l’International Football Association Board [50] (IFAB) s’est prononcée en faveur de l’introduction de l’assistance vidéo dans les lois du jeu, notamment pour vérifier les positions de hors-jeu. Cette décision s’applique déjà pendant la coupe du monde qui a lieu en Russie. Elle aura sans doute le mérite de mettre fin à des polémiques incessantes sur les arbitrages humains par nature faillibles mais tarira peut-être aussi une littérature abondante sur le sujet. Le droit comme le sport sont la source de passions qui font sortir l’Homme de sa torpeur originelle pour le combler d’une belle ardeur. Malheureusement, le droit comme le sport ne se pratiquent pas toujours sportivement.
[1] D’après la chanson de Manu Chao, La vida tombola, 2007, Trad. «Si j'étais Maradona, Je perdrais dans n'importe quel lieu, La vie est une tombola. De nuit et de jour».
[2] La «Main de Dieu» fait référence à l’expression utilisée par Diego Maradona pour qualifier son but de la main marqué le 22 juin 1986 contre l’Angleterre.
[4] Dans la parabole de la loi de Franz Kafka, l’homme de la campagne se trouve empêché d’entrer et reste bloqué devant les portes de la Loi sans comprendre pourquoi. Le personnage principal du roman, Le procès, se nomme Joseph. K.
[5] F. Kafka, Le procès, éd. Poche, p. 368.
[6] L’arrêt porte les mentions F-P+B+I.
[7] C’est une qualité dont il faudra vérifier la réalité.
[8] Supra n° 4.
[9] Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-18.494, F-P+B (N° Lexbase : A5002DRP), D., 2007, p. 2004, note J. Mouly, D., 2007, p. 2346, obs. J.-C. Breillat, C. Durdognon, J.-P., Karaquillo, J.-F. Lachaume, F. Lagarde et F. Peyer.
[10] Cass. civ. 2, 31 mars 1965, n° 62-12.256.
[11] Ibid.
[12] V. J.-P. Vial, Pari sportif perdu pour cause de hors-jeu : pas d’indemnité pour le parieur !, note sous CA Riom, 19 avril 2017, n° 15/03002 (N° Lexbase : A0113WAG), Jurisport, 2018, n° 185, p. 35.
[13] Rep. Droit civ. Œuvre coll. (J. Julien), actualisation 2018, n° 110.
[14] Cass. civ. 2, 16 novembre 2006, n° 05-19.973, FS-D (N° Lexbase : A3419DSG), RCA, 2007, n° 44
[15] C. sport., art. L. 223-3 ancien (N° Lexbase : L1513IER). Ce dernier a été modifié par la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 (N° Lexbase : L1062LDP) - art. 19 et dispose désormais que «Sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 222-2-2 du présent code, les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail».
[16] J. Mouly, L'arbitre sportif : travailleur indépendant, mais préposé au sens de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, D., 2007, p. 2004.
[17] V. sur la déformation du droit à cause de la recherche absolue de l’indemnisation : H. Conte, Volonté et droit de la responsabilité civile, thèse Toulouse, 2017.
[18] Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-82.802 (N° Lexbase : A5357CIA).
[19] Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-18.494, F-P+B, préc., D., 2007, p. 2004, note. J. Mouly.
[20] Ibid : «Viole l'article 1384, alinéa 5, du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer l'arbitre personnellement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par un joueur, énonce que la faute de l'arbitre a consisté à ne pas pénaliser le «relevage» des mêlées, ce qui a eu pour effet de décourager dès la première mi-temps la stratégie de l'équipe et de faire cesser la poussée dont avait été victime son joueur, loyale de la part de ses équipiers mais dommageable en ce qu'elle était confrontée aux avants adverses relevés et que le coup de sifflet de l'arbitre aurait eu pour effet de faire cesser la contrainte subie par les cervicales de la victime, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arbitre avait agi dans les limites de sa mission».
[21] Voir toutefois un arrêt de la Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière qui admet le recours en garantie du commettant contre le médecin préposé ce qui revient à affaiblir l’immunité de celui-ci au regard, justement, de son «indépendance professionnelle intangible». : Ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378 (N° Lexbase : A8154AG4), D., 2000, Jur. p. 673, note Ph. Brun, et Somm. p. 467, obs. Ph. Delebecque, D., 2003, p. 459, note P. Jourdain.
[22] V. Y.-M. Serinet, La responsabilité civile du club professionnel pour le geste blessant commis par son joueur préposé lors d'une compétition sportive, D., 2004, p. 2601, n° 6.
[23] Sur la question en matière sportive justement, v. Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 03-11.653, FS-P+B (N° Lexbase : A8470DBC), D., 2004, p. 2601, note Y.-M. Serinet, D., 2005, Pan, p. 187, note D. Mazeaud, D., 2006, Pan, p. 194, note F. Lagarde, JCP éd G, 2004, II, 10131, note Imbert, Gaz. Pal., 2004, Doctr, p. 2785, note Perez et Polere, Dr. et patr., oct. 2004, p. 105, obs. F. Chabas, RTDCiv., 2004, p. 517, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.222, FS-P+B (N° Lexbase : A2031DC9) : au sujet d’une action intentée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er.
[24] Ibid.
[25] V. J. Mouly, Quelle faute pour la responsabilité civile du salarié ?, D., 2006, p. 2756.
[26] Ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378, préc., JCP éd. G, 2000, II, 10295, concl. R. Kessous, note M. Billiau, JCP éd. G, 2000, I, 241, n° 5, obs. G. Viney.
[27] Ibid.
[28] Ass. plén. 10 juin 1977, JCP, 1977, II, 18730, concl. Gulphe, D., 1977, p. 465, note C. Larroumet, Gaz. Pal., 1977. 2. 441, Defrénois, 1977, p. 1517, obs. J.-L. Aubert, RTDCiv., 1977, p. 774, obs. G Durry ; Ass. Plen. 15 novembre 1985, JCP, 1986, II, 20568, note G. Viney ; Ass. plén. 19 mai 1988, D., 1988, p. 513, note C. Larroumet, Defrénois, 1988, art. 34316, obs. J.-L. Aubert.
[29] Infra n° 4.
[30] Ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141, P+B+R+I (N° Lexbase : A9647DW9).
[31] Cass. civ. 2, 20 novembre 1968, n° 66-12.644 (N° Lexbase : A5084AYX).
[32] Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-16.938, F-D (N° Lexbase : A6845RID).
[33] Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 13-23.759, F-D (N° Lexbase : A9311M3A).
[34] J. Mouly, Vi sport, in Rep. Dr. civ., Œuvre collective, n° 108.
[35] H. Conte, op. cit, n° 352 et s. Pour un avis contraire, voir : J. Julien, Vis acceptation des risques, in Dalloz Action, œuvre collective sous la direction de Philippe Le Tourneau, 2018, n° 1892 et s..
[36] J. Mouly, L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques en matière de responsabilité du fait des choses. Enjeux et perspectives, D., 2011, p. 690 ; RCA, 2011, chron, p. 3, obs. S. Hoquet-Berg ; JCP éd. G, 2011, n° 12, note D. Bakouche ; JCP éd. G, 2011, n° 435, note C. Bloch ; RTDCiv., 2011. 137, obs. P. Jourdain ; Voir aussi pour le cas d’un fait personnel : Cass. civ. 2, 25 juin 1980, n° 79-11.296 (N° Lexbase : A9709CIG). L’arrêt de la cour d’appel a été cassé pour avoir laissé, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, une part de responsabilité à la victime d'un accident survenu au cours d'une séance d'entraînement aux barres asymétriques à la suite d'une "tape d'encouragement" du moniteur reconnue fautive. La Cour de cassation rejette l’argument selon lequel l'exercice aux barres asymétriques constituerait un sport dangereux, impliquant de celui qui le pratique l'acceptation d'une part de risque et qui limiterait sont droit à indemnisation ; Cass. civ. 1, 13 janvier 1993, n° 91-11.864 (N° Lexbase : A3222CS7) : la Cour retient la responsabilité d’un moniteur de sport qui a commis une faute d’imprudence en pratiquant une prise d’une haute technicité sur l’un de ses élèves.
[37] Cass. civ. 2, 13 mai 1969, n° 68-12.068 (N° Lexbase : A9691XX9).
[39] Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-18.649, FS-P+B (N° Lexbase : A7361DCM), RTDCiv., 2005, p. 135, note P. Jourdain ; voir aussi : Cass. civ. 2, 20 novembre 1968, Bull. civ. II, n° 277 ; 21 juin 1979, Bull. civ. II, n° 196 ; D., 1979, IR, p. 543, obs. F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo, Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.222, FS-P+B (N° Lexbase : A2031DC9).
[40] Supra, n° 7.
[42] Cass. civ. 2, 4 mai 1972, n° 71-10121 (N° Lexbase : A0167CGB). L’arrêt est rendu, ici encore, avant l’arrêt «Costedoat».
[43] V. P. Verschuuren, Il devient pertinent d'appliquer un principe de précaution au secteur des paris sportifs, JS. 2016, n° 162, p. 14 ; C. Kalb, Protéger son intégrité : le nouvel impératif du sport business, JS. 2018, n° 182, p. 24 ; Dossier : Sport et corruption, La lutte s'organise. JS, 2017, n° 181, p. 17.
[44] P. Verschuuren, op. cit, n° 41.
[45] Match de handball truqué : Karabatic et quinze autres prévenus attendus en appel, Le Monde, 21 novembre 2016.
[47] Football: l'affaire des matches truqués, L'Express,
[48] Responsabilité civile à laquelle s’ajoutera dans la plupart des cas, une responsabilité pénale.
[49] Cass. civ. 1, 9 avril 2002, n° 00-13.314, F-P+B (N° Lexbase : A4814AYX), D., 2002, p. 1469 ; Gaz. Pal., 2003. 2. Somm. 1289, obs. F. Chabas. - adde : Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-42.741, FS-P+B (N° Lexbase : A2613HSL).
[50] Supra, n° 10.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465053
[Manifestations à venir] L’urgence en kinésithérapie : risques et enjeux pour la profession
Lecture: 5 min
N5103BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 18 Juillet 2018
Lorsqu’ils interviennent dans un but thérapeutique, les kinésithérapeutes exercent leur art sur prescription médicale. La nouvelle rédaction de l’article L. 4321-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9863KXL), issu de la loi du 26 janvier 2016, introduit une circonstance dérogatoire à cette règle générale : en cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, les kinésithérapeutes sont habilités à mettre en oeuvre, sans prescription médicale, les premiers actes de soin en masso-kinésithérapie.
Au-delà de la notion d’urgence qui n’est pas juridiquement définie, cette nouvelle disposition invite à s’interroger sur ses conséquences qui sont autant de risques que d’enjeux pour la profession de kinésithérapeute.
C’est ainsi que la Faculté libre de droit de l’institut Catholique de Toulouse, la Faculté de droit de l’Université Toulouse I Capitole ainsi que l’association Santéjuris organisent un colloque sur ces questions, qui aura lieu le samedi 20 octobre 2018, à l’Institut Catholique de Toulouse.
I - Présentation scientifique du colloque
Plus que jamais, l’heure est à la délégation d’actes de soins entre professionnels de santé et à l’autonomisation des professions de santé. Dès lors, dans ce contexte, la nouvelle rédaction de l’article L. 4321-1 du Code de la santé publique introduit une grande nouveauté au bénéfice des masseurs-kinésithérapeutes : en cas d’urgence et en l’absence de médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités, sans prescription médicale, à pratiquer les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. En d’autres termes, si le principe demeure la prescription médicale lorsque les masseurs-kinésithérapeutes interviennent dans un but thérapeutique, cette nouvelle disposition, par exception, leur offre la possibilité d’agir en dehors de toute prescription médicale. Le législateur consacre ainsi l’accès direct à la kinésithérapie et participe à l’autonomisation de la profession.
Naturellement, cette dérogation est nécessairement d’interprétation stricte et ne permet l’accès direct qu’en présence de ses deux conditions cumulatives : l’absence d’un médecin et une situation d’urgence. L’urgence, n’étant pas définie juridiquement, renvoie à la notion de «préjudice dans le retard». Dès lors, il appartiendra au masseur-kinésithérapeute d’apprécier, au cas par cas, si son intervention se situe dans ce cadre. La question à laquelle celui-ci devra répondre se résume ainsi : «y-a-t-il un risque à différer les actes de kinésithérapie ?».
Il y a ainsi urgence à définir l’urgence en kinésithérapie ! Si l’interprétation du nouvel article L. 4321-1 du Code de la santé publique n’a sans doute pas fini de diviser la doctrine et les professionnels de santé, il n’en demeure pas moins que la possibilité d’un accès direct à la kinésithérapie, au-delà de ses conditions de mise en oeuvre, conduit à de nombreuses interrogations auxquelles ce colloque se propose de formuler quelques éléments de réponse. En effet, les questions ne manquent pas :
- Quid de la responsabilité du masseur-kinésithérapeute ayant agi dans le cadre de l’urgence de masso-kinésithérapie ?
- Quid de la relation professionnelle entre le médecin et le masseur-kinésithérapeute ?
- Quid encore du consentement et de l’information du patient en situation d’urgence de masso-kinésithérapie ?
- Quid enfin de la prise en charge financière des premiers soins nécessaires en masso-kinésithérapie hors prescription ?
II - Programme de la journée du colloque
8h30-9h15 : Accueil des participants et petit-déjeuner
9h15 : Allocutions d’ouverture
- Marie-Christine Monnoyer, Doyen de la Faculté de libre de droit de l’Institut catholique de Toulouse
- Philippe Nélidoff, Doyen de la Faculté de droit et science politique de l’Université Toulouse I Capitole
- Guy Cardona, Président de Santéjuris
- Pascale Mathieu, Présidente du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
9h45 : Introduction
- Séverin Jean, Maître de conférences en droit privé à l’Université Toulouse I Capitole (IEJUC - EA1919)
1ère Partie - De l’urgence en masso-kinésithérapie à la responsabilité des masseurs kinésithérapeutes
Président de séance : madame Marie-Christine Monnoyer
A - De la mise en oeuvre de la responsabilité des masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de l’urgence
10h00 : De la responsabilité civile du masseur-kinésithérapeute face à l’urgence
- Céline Mangematin, Professeur agrégé des universités en droit privé à l’Université Toulouse I Capitole (CDA - EA780)
10h30 : De la responsabilité pénale du masseur-kinésithérapeute face à l’urgence
- Paul Cazalbou, Maître de conférences en droit privé à l’Université Toulouse I Capitole (IERDEC - EA4211)
11h00 : De la responsabilité disciplinaire du masseur-kinésithérapeute
- Jean-François Dumas, Secrétaire général du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
11h30-12h00 : Pause
B - De l’appréciation contentieuse de la responsabilité des masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de l’urgence
12h00 : De l’appréciation judiciaire de la responsabilité du masseur-kinésithérapeute
- Raphaëlle Rondy, Magistrate
12h30 : Du recours à l’expertise pour l’appréciation de la responsabilité du masseur-kinésithérapeute
- Roland Rocton, Masseur-Kinésithérapeute, Expert près la cour d’appel de Versailles, Expert près la cour administrative d’appel de Versailles, Expert agréé en matière de Sécurité Sociale
13h00-14h30 : Pause déjeuner
2nde Partie - De l’incidence pratique de l’urgence en masso-kinésithérapie
Président de séance : madame Pascale Mathieu
A - De l’incidence professionnelle de l’urgence en masso-kinésthérapie
14h30 : De l’information et du consentement du patient dans le cadre de l’urgence en masso-kinésithérapie
- François Vialla, Professeur des universités en droit privé à l’Université de Montpellier, Directeur du Centre européen d’études et de recherche en droit et santé UMR 5815, Co-directeur du Master 2 Droit et gouvernance des établissements de santé et droit international et humanitaire de la santé, Fondateur et Directeur scientifique de la revue Droit et Santé
15h00 : Diagnostics croisés du médecin-prescripteur et du masseur-kinésithérapeute
- Michel Chassang, Médecin, Président de l’UNAPL, Secrétaire général du Conseil économique social et environnemental
- Michel Gedda, Masseur-Kinésithérapeute, Chargé de projet à la Haute-Autorité de Santé, Directeur de l’Institut de formation de masso-Kinésithérapie de Berck-sur-mer
B - De l’incidence financière de l’urgence en masso-kinésithérapie
15h30 : L’assureur de l’urgence en masso-kinésithérapie
- Germain Decroix, Juriste à la Mutuelle d’assurance du corps sanitaire français
16h00-16h30 : Conclusion et clôture
- Guillaume Beaussonie, Professeur agrégé des universités en droit privé à l’Université Toulouse I Capitole (IEJUC - EA1919), Directeur du Master 2 Droit pénal des affaires
III - … Et pendant ce temps là… : une journée à Toulouse pour les accompagnants
Un peu de culture sur la ville rose à travers des visites guidées et circuit en bus touristique (ou péniche, selon le nombre de participants) à destination des accompagnants. Un programme détaillé et sur mesure vous sera adressé dès que le groupe sera constitué.
- Départ à 8h30 de l'ICT (site du colloque : 31, Rue de la Fonderie Toulouse). - Découverte de la ville jusqu'au lieu de départ de la 1ere visite. - Déjeuner du groupe dans un restaurant du centre-ville.
- Vers 14h30, reprise du circuit touristique pour finir aux alentours de 17h00. Prix de la journée : 60 euros (visites et déjeuner inclus).
Inscription validée avec le règlement (à l’ordre de : Santejuris).
Pour toute information complémentaire : catmal@wanadoo.fr
IV - Comment venir ?
Adresse :
Institut Catholique de Toulouse
Salle Tolosa
31 rue de la Fonderie 31068 Toulouse
Metro :
- Ligne A : station Esquirol
- Ligne B : station Carmes ou Palais de justice
Bus :
- Ligne 12 station Salin Parlement
VélôToulouse :
- Les stations les plus proches de l'ICT sont place des Carmes, rue du Languedoc, place du Salin, église de la Dalbade, place M. Hauriou
Voiture :
- Vous trouverez des parkings place des Carmes et au carrefour St- Michel.
V - Inscriptions et contacts
Tarifs de l’inscription au colloque (les tarifs comprennent le déjeuner) :
- Normal : 150 euros
- Enseignants des professions de santé : 100 euros
- Anciens étudiants du DU d’expertise judiciaire : 80 euros
- Etudiants : 20 euros
- Stagiaires du DU d’expertise judiciaire en cours, Magistrats et intervenants : gratuit
Pour s’inscrire il suffit simplement d’utiliser le lien suivant : https://www.weezevent.com/colloque-l-urgence-en-masso-kinesitherapie
Tarif de l’inscription à l’événement «Et pendant ce temps-là» : 60 euros
Les contacts :
- Organisation scientifique : severin.jean@ut-capitole.fr
- Organisation logistique : gaelle.lichardos@ict-toulouse.fr
- Organisation de l’événement «Et pendant ce temps-là» : catmal@wanadoo.fr
Où retrouver l’actu sur l’événement ?
- http://www.ict-toulouse.fr/fr/index.html
- http://tls-droit.ut-capitole.fr/
- https://www.santejuris.fr/
Réagir sur les réseaux sociaux : #soskiné
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465103
[Jurisprudence] Participation pour raccordement à l’égout : pas d’exonération possible fondée sur la qualité du maître d’ouvrage - Conclusions du Rapporteur public
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 399932, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8913XQ8)
Lecture: 11 min
N5108BXH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Daumas, Rapporteur public au Conseil d'Etat
Le 18 Juillet 2018
Les dispositions de l'article L. 1331-7 du Code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige, font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant. Elles ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement. En revanche, elles ne sauraient être regardées comme autorisant l'instauration d'exonérations en fonction de la qualité du maître de l'ouvrage, celle-ci étant sans incidence sur la capacité du système d'évacuation et sur l'économie réalisée en ne l'installant pas. Lexbase Hebdo - édition publique vous propose de retrouver les conclusions anonymisées du Rapporteur public, Vincent Daumas.
1. Le présent pourvoi pose une question intéressante relative au régime de la «participation pour raccordement à l'égout».
Selon les dispositions de l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8147I4I), dans leur version antérieure à celle résultant de la première loi de finances rectificative pour 2012, celle du 14 mars 2012 [1] : «Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation».
Ces dispositions autorisaient la perception par les communes de ce qu’il est convenu d’appeler la «participation pour raccordement à l'égout» (PRE). Le législateur, en adoptant l’article 30 de la loi du 14 mars 2012, a entendu substituer à cette PRE une «participation pour le financement de l’assainissement collectif» (PAC). Les deux participations, pour l’essentiel, se ressemblent furieusement, la principale différence tenant à leur fait générateur : alors que la PRE était mise à la charge du propriétaire de l’immeuble par l’effet d’un permis de construire, d’un permis d'aménager, de prescriptions émises à l'occasion d'une déclaration préalable de travaux ou encore de l'acte approuvant un plan de remembrement [2], le fait générateur de la PAC est constitué par l’utilisation effective du réseau d’assainissement [3]. Tout cela pour vous dire que la question posée par cette affaire, même si elle est soulevée à propos de la PRE, reste pertinente, à notre avis, de même que la réponse que vous y apporterez, en l’état actuel des textes relatifs à la PAC.
La question dont il s’agit peut être formulée ainsi : lorsqu’une commune -ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent- avait décidé, en application des dispositions de l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique, d’instituer à la charge des propriétaires la PRE, pouvait-elle prévoir des tarifs différenciés ou un régime d’exonération ou d’abattement définis en fonction de la qualité du propriétaire ou du maître d’ouvrage, ou encore, s’agissant d’immeubles à usage d’habitation, de la destination des logements ? ou devait-elle, au contraire, proscrire de tels critères, au motif qu’il sont sans rapport avec le coût d’une installation d’assainissement individuel ?
La jurisprudence est parfaitement fixée en ce qui concerne la nature de la PRE- signalons que les dispositions qui la régissent sont anciennes puisqu’elles ont été introduites initialement à l’article L. 35-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1285DL8), pratiquement telles que nous les avons citées, par une ordonnance du 23 octobre 1958 [4]-. Vous fondant sur les termes employés par ces dispositions, vous jugez avec constance que la PRE constitue une redevance pour service rendu et non une imposition de toute nature [5] : voyez en ce sens, parmi une abondante jurisprudence, CE Plén., 27 juin 1973, n° 85510 (N° Lexbase : A8488B8U), au Recueil p. 444 (avec concl. Mehl parues à Dr. fisc. 1974 comm. 267), dans laquelle vous jugez que les sommes réclamées au titre de la PRE ont la nature «de redevances demandées à des usagers en vue de couvrir les frais d’établissement d’un ouvrage public destiné à leur éviter les frais d’une installation personnelle» ; voyez aussi CE 9 juillet 1986, n° 71154 (N° Lexbase : A4427AMW), inédite au Recueil, RJF 10/1986 n° 901.
Votre jurisprudence est moins prolixe en ce qui concerne les montants susceptibles d’être mis à la charge des propriétaires au titre de la PRE. Compte tenu de sa nature, vous avez jugé, très logiquement, qu’aucune somme ne pouvait être réclamée à un propriétaire au titre de la PRE dès lors que le réseau public d’assainissement desservant son immeuble avait déjà été financé par le lotisseur (CE 22 octobre 1990, n° 54540 N° Lexbase : A4791AQI, aux tables du Recueil, RJF 12/1990 n° 1494). Vous avez également jugé que les dispositions de l’article L. 1331-7, alors même qu’elles font de la PRE une redevance, ne sont pas un obstacle à ce que son montant soit fixé selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement (CE 24 septembre 2003, n° 242065 N° Lexbase : A6069C9N, aux tables du Recueil). Vous admettez donc une certaine approximation -sans doute inévitable- dans le rapport qui doit exister entre le montant de la PRE et le coût évité au propriétaire à qui elle est réclamée. Mais sur la question précise qui nous occupe, votre jurisprudence paraît vierge.
La réponse à cette question ne nous paraît pas pour autant douteuse. Dans le silence de la loi sur ce point, vous devez appliquer à la PRE les principes généraux qui régissent les prélèvements ayant sa nature de redevance pour service rendu. Ces principes sont clairs : en matière de redevance pour service rendu, si vous admettez les différenciations tarifaires destinées à prendre en compte des situations différentes, ou même justifiées par un motif d’intérêt général, c’est toujours à la condition, dans l’un comme l’autre cas, que cette différence de situation ou ce motif soient en rapport avec l’objet de la redevance – c’est-à-dire avec l’ouvrage ou le service qu’il s’agit de financer (voyez, codifiant les grandes lignes de votre jurisprudence, CE Section, 10 mai 1974, n° 88032, 88148 N° Lexbase : A0207A2P, au Recueil [6]). Ce n’est rien d’autre que la déclinaison du principe d’égalité au cas particulier des redevances pour service rendu, principe dont les implications, il est vrai, se trouvent sans doute renforcées par celui, parfois mentionné dans vos décisions, dit «d’équivalence» ou «de proportionnalité», qui exige que le montant d’une redevance soit essentiellement déterminé en fonction du service rendu à l’usager [7].
Vous jugez ainsi, par exemple, qu’une commune ne peut pas instaurer des différenciations tarifaires en matière de fourniture d'eau en fonction du caractère permanent ou non de la résidence de l'abonné, ces discriminations n'étant justifiées ni par la différence de situation existant entre ces deux catégories d'usagers ni par aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, 28 avril 1993, n° 95139 N° Lexbase : A9399AM3, au Recueil p. 138). De même, ont été jugés illégaux des dégrèvements de redevance d'assainissement consentis par un syndicat intercommunal aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, ainsi qu'à certaines personnes âgées ou atteintes d'une invalidité les rendant inaptes au travail (CE, 17 décembre 1982, n° 23293 N° Lexbase : A9680AKQ, au Recueil p. 427). Est encore illégale la délibération d'un conseil municipal décidant d'exonérer de redevance pour enlèvement des ordures ménagères les personnes âgées de plus de soixante-dix ans, une telle exonération étant sans lien avec le service rendu (CE, 27 février 1998, n° 160932 N° Lexbase : A6326AS4, aux tables du Recueil, RJF 4/1998 n° 514). Et c’est la même solution qui est retenue, là aussi s’agissant de redevance pour enlèvement des ordures ménagères, pour une délibération d’une communauté de communes exonérant du paiement de cette redevance -selon une liste à la Prévert- les artisans du bâtiment, les commerces ambulants, les métiers du bois et de l’art, les taxis et ambulances, les activités à domicile et les agriculteurs disposant de moins de dix unités de gros bétail (CE, 25 juin 2003, n° 240411 N° Lexbase : A2039C9E, au Recueil, RJF 10/2003 n° 1187).
Au regard de ces précédents, et à défaut de disposition législative l’autorisant expressément, nous pensons que la PRE, compte tenu de sa nature de redevance pour service rendu, qui découle des dispositions de l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique, ne peut faire l’objet de tarifs différenciés ou de régimes d’exonérations ou d’abattements définis en fonction de critères sans lien avec le coût de l’installation d’assainissement individuel évité au propriétaire -c’est-à-dire sans lien avec les besoins en termes d’assainissement qu’implique l’occupation de l’immeuble-. Cette analyse de la portée des dispositions de l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique rejoint, soulignons-le, celle exprimée par le ministre de l’intérieur dans deux réponses récentes faites à des questions écrites émanant de parlementaires, à propos du régime de la PAC [8].
2. Une fois exposés ces développements généraux, il est temps de présenter le pourvoi qui les justifie.
Le maire de la commune de Saint-Louis-de-Montferrand (Gironde) a délivré à la société civile immobilière (SCI) X, en 2008, un permis de construire dans le cadre d’un programme de construction de logements sociaux. Ce permis prévoyait le paiement d’une participation pour raccordement à l’égout, exigible en vertu d’une délibération de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) du 21 juillet 2006. Le permis a ensuite été transféré à la SCI Y et c’est vers elle que la CUB s’est tournée pour obtenir le paiement de la PRE, en émettant à cette fin un titre exécutoire d’un montant de près de 134 000 euros. Ce titre a été contesté conjointement par les deux SCI devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui a prononcé une décharge très partielle de la somme en litige, motivée par une réduction du nombre de branchements autorisés. Il a, pour le surplus, rejeté les conclusions des requérantes. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur requête d’appel.
Devant la cour, les deux SCI avaient formulé, entre autres moyens, une argumentation qui, sous ses apparences sommaires, était tout à fait raffinée. Elles mettaient en avant les dispositions de la délibération de la CUB du 21 juillet 2006 prévoyant un abattement de 25 % sur le montant de la PRE exigée, dans certaines zones, «en ce qui concerne les opérations d’habitat à caractère social et strictement locatifs réalisés par les organismes d’HLM ou sociétés d’économie mixte communautaires, départementales ou communales». Elles soutenaient que ces dispositions méconnaissaient non seulement le principe d’égalité mais aussi les règles du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne protégeant la libre circulation des capitaux, en ce qu’elles créaient, selon elles, une discrimination injustifiée entre les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte (SEM) d’une part, les autres constructeurs d’autre part. Elles en déduisaient que cette délibération était illégale en tant qu’elle ne prévoyait pas le bénéfice de l’abattement de 25 % à l’ensemble des constructeurs de logements sociaux, quel que fût leur qualité. Autrement dit, elles se prévalaient, par la voie de l’exception, d’une illégalité partielle, «en tant que ne pas», de la délibération qui constituait la base légale du titre exécutoire litigieux, en espérant bénéficier, si leur argumentation était accueillie, d’une extension à leur situation de l’abattement de 25 % réservé par cette délibération aux seuls organismes HLM et SEM locales.
Une telle argumentation pouvait paraître opérante à première vue : vous-même avez jugé, s’agissant d’une exonération fiscale réservée aux seules sociétés de capitaux, que la discrimination illégale instituée au détriment des sociétés en nom collectif devait conduire le juge à leur étendre cet avantage, «alors même que l'extension de l'exonération ne serait pas l'unique manière […] d'y mettre fin» (CE, 16 octobre 2009, n° 305986 N° Lexbase : A0748EMN, aux tables du Recueil, RJF 1/2010, n° 42). C’est sans doute pourquoi la cour administrative d’appel a répondu au fond à l’argumentation des requérantes, en jugeant que l’abattement prévu par la délibération de la CUB ne méconnaissait ni le principe d’égalité, ni le droit de l’Union européenne. Les SCI, dans leur pourvoi, ne font porter leurs critiques que sur ces motifs de l’arrêt. Nous croyons inutile, cependant, de se pencher sur leur bien-fondé, dès lors que la CUB était, en tout état de cause, en situation de compétence liée pour refuser d’étendre aux requérantes le bénéfice de l’abattement qu’elles revendiquaient, motif pris de son illégalité -ce qui différencie cet abattement de l’exonération dont il était question dans le précédent que nous venons de citer-.
Les longs développements par lesquels nous avons débuté ces conclusions ont dû vous convaincre de l’illégalité de l’abattement prévu par la délibération de la CUB du 21 juillet 2006 : son champ était défini exclusivement en fonction de critères dépourvus de tout lien avec les besoins en termes d’assainissement des immeubles ; il méconnaissait donc les dispositions de l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique et le caractère de redevance pour service rendu de la PRE. La situation de compétence liée de la CUB, au sens de votre jurisprudence [9], pour refuser aux requérantes le bénéfice de cet abattement découle directement du constat objectif de cette illégalité -puisque l’administration ne peut, sans que cela implique aucune appréciation de fait de sa part, que refuser de faire application de dispositions illégales-. Cette situation de compétence liée rendait inopérants les moyens critiquant la légalité de la délibération du 21 juillet 2006, en tant qu’elle n’avait pas prévu d’appliquer l’abattement en question à l’ensemble des constructions de logements sociaux à caractère locatif. Ainsi un tel motif tiré de la compétence liée répond aux moyens invoqués devant la cour administrative d’appel et, étant de pur droit, ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, de sorte que vous pouvez y recourir dans le cadre d’une substitution de motif en cassation (CE, 13 mars 1998, n° 171295 N° Lexbase : A6737ASC, aux tables du Recueil) -sans même devoir vous prononcer au préalable sur le bien-fondé des motifs de l’arrêt critiqués par le pourvoi (CE, 20 mai 1994, n° 143680 N° Lexbase : A0988ASE, au Recueil ; CE, 5 juillet 1999, n° 179711 N° Lexbase : A4960AXY, aux tables du Recueil sur un autre point)-.
Le motif que nous vous invitons à retenir pour confirmer le dispositif de l’arrêt attaqué et rejeter le pourvoi a été communiqué aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, conformément à ce que requiert votre jurisprudence lorsqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration estimait être en situation de compétence liée (CE, 15 décembre 2016, n° 389141 N° Lexbase : A2382SXI, aux tables du Recueil). Ni la CUB, ni les SCI requérantes n’ont présenté d’observations, en réponse, qui soient de nature à remettre en cause la situation de compétence liée que nous avons identifiée. Enfin signalons que l’argumentation du pourvoi tirée de ce que la délibération du 21 juillet 2006 serait contraire aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est nouvelle en cassation et, n’étant pas d’ordre public, doit être écartée, en tout état de cause, comme inopérante (CE, 24 novembre 2010, n° 325195 N° Lexbase : A4320GLL, aux tables du Recueil).
Dans les circonstances de l’espèce nous vous proposons de ne pas faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Bordeaux, qui vient aux droits de la CUB, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4).
Par ces motifs nous concluons dans le sens qui suit :
1. Rejet du pourvoi ;
2. Rejet des conclusions présentées par Bordeaux Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
[1] Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L4518IS7).
[2] Voir les anciens articles L. 332-28 (N° Lexbase : L3417HZL) et L. 332-6-1 (2°, a) (N° Lexbase : L4659ISD) du Code de l’urbanisme.
[3] Voir le quatrième alinéa de l’actuel article L. 1331-7 du Code de la santé publique.
[4] Ordonnance n° 58-1004 du 23 octobre 1958, relative au raccordement obligatoire des immeubles aux réseaux d’égouts et modifiant les articles L. 33 et suivants du Code de la santé publique, art. 2.
[5] A l’inverse, vous jugez que la contribution exigée, sur le fondement de l'article L. 1331-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8146I4H), d'un propriétaire qui n'a pas effectué les travaux nécessaires au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement est un impôt (CE, 5 février 2009, n° 306045 N° Lexbase : A9336ECR, aux tables du Recueil, RJF 5/2009 n° 521).
[6] Voyez aussi, reprenant ces grandes lignes dans sa propre jurisprudence, la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-513 DC du 14 avril 2005 (N° Lexbase : A9488DHU), cons. 12 à 18.
[7] Il arrive que ce principe soit repris et explicité par les textes propres à certaines redevances pour service rendu : voir par exemple, pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3271LC7).
[8] Réponse à la question n° 22651 de Mme Zimmermann (14e législature, JOAN du 20 mai 2014 p. 4103 N° Lexbase : L1629KBX) ; réponse à la question n° 5091 de M. Masson (14e législature, JO Sénat du 22 mai 2014 p. 1208 N° Lexbase : L4182KHD).
[9] CE Sect., n° 149722, 152848 (N° Lexbase : A4357AXN), au Recueil.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465108