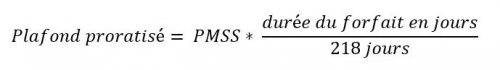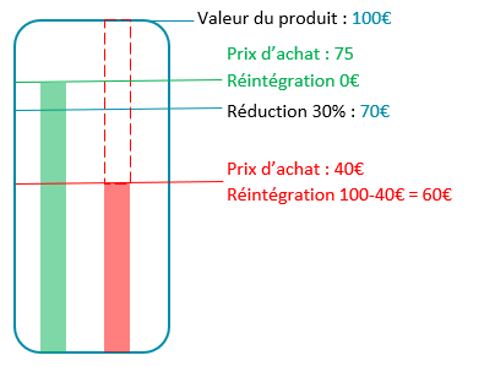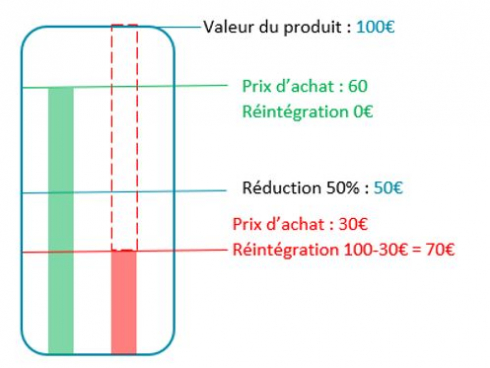[Focus] Un avocat peut-il défendre un membre de sa famille ?
Lecture: 8 min
N7718BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Pierre-Louis Boyer, Maître de conférences HDR – Le Mans Université Thémis-UM EA4333 et IODE-Rennes 1 UMR CNRS6262
Le 21 Juillet 2021
Mots-clés : Avocat • famille • Indépendance • désintéressement
L’avocat, dans l’exercice de sa profession, peut être parfois conduit à conseiller ou défendre des proches, notamment de sa famille. Si la situation interroge, c’est qu’elle appelle une réflexion quant à l’équilibre de cette situation au regard du respect des principes déontologiques de l’avocat.
Curieuse question que celle de savoir si un avocat peut défendre un membre de sa famille. D’autant plus qu’il arrive bien souvent (trop souvent) à l’avocat d’être sollicité par bon nombre de membres de sa famille qui considèrent que le « juriste de la famille » est un puit de science du droit, capable de conseiller tant sur la succession de l’arrière-grand-père que sur le bornage de l’oncle Jeannot, le litige de copropriété de tante Huguette ou les problèmes de droit administratif ou électoral d’un cousin devenu maire de son village de 50 habitants.
Quand la défense en vue de la justice se heurte à l’affection familiale, est-il possible de remplir éthiquement et déontologiquement ses obligations d’avocat ?
Loysel écrivait que la profession d’avocat « désire son homme tout entier » [1] ; mais est-il possible que l’indépendance de l’avocat, « vertu consubstantielle de la profession » [2], soit « tout entière » si ce dernier est amené à défendre un membre de sa famille ? Cette indépendance n’est-elle pas, par ailleurs, au-delà des considérations déontologiques des articles 1.3 et 4.1 du Règlement intérieur national [3], la qualité de l’avocat qui lui permet d’assurer l’entièreté et l’établissement structuré de sa personne, de telle sorte que l’on a pu dire de l’avocat qu’il s’agit d’une « profession dont la vertu fait toute la noblesse et dans laquelle les hommes sont estimés, non par ce qu’on fait leur père, mais par ce qu’ils sont eux-mêmes »[4] ?
La défense d’un membre de sa famille, que l’on remonte à l’antiquité grecque avec les synégores ou aux romains avec les patronii, a toujours été acceptée, que cette défense soit exercée par avocat ou une autre personne. Faut-il y voir l’origine de notre article 762 du Code de procédure civile ?
La littérature traditionnelle du barreau souligne que l’avocat peut défendre sa famille, mais à condition que le principe d’indépendance ne soit pas écorné et, conséquemment à cela, que le principe de désintéressement soit respecté (puisqu’il s’agit encore d’un fondement déontologique de la profession d’avocat…) et que l’avocat ne tire aucun intérêt de l’affaire qui lui aurait été confiée [5]. On ne peut à la fois servir la famille et l’argent. Ce n’est que s’il s’agit d’un « devoir ou d’un service de famille » [6] que l’accomplissement d’un mandat confié à un avocat par un membre de sa famille est acceptable, et à condition que prudence et indépendance restent de rigueur : « L’avocat peut accepter un mandat, donné par sa famille, par son intimité, par un ami, pour régler des intérêts qui sont comme le siens. Dans ces cas, sa prudence doit être extrême, et la délicatesse doit surveiller chacun de ses actes » [7].
La difficulté qui se pose à l’avocat réside dans le double attachement qui se dessine dans la situation de la défense d’un membre de sa famille. L’attachement déontologique à son indépendance d’une part, et l’attachement sentimental d’autre part. Or, dans l’exercice de sa profession, c’est le premier qui prime, bien évidemment. L’indépendance de l’avocat doit être « matérielle, morale et intellectuelle » [8] et, surtout, à l’égard de tous, qu’il s’agisse des magistrats et des autres professions judiciaires, mais aussi de la société, des médias, et surtout de ses clients, en ce compris les membres de sa famille.
De plus, au même titre qu’un avocat ne saurait plaider pour deux parties qui auraient des intérêts divergents [9] faute de conflit d’intérêts, l’avocat ne saurait lui-même se retrouver sujet d’un conflit d’intérêt, raison pour laquelle la défense d’un membre de sa famille face à un autre membre de sa famille pourrait s’apparenter à une faute déontologique.
Tout cela nous conduit à évoquer un arrêt de la cour d’appel de Paris de 2018 qui venait confirmer la sanction du conseil de discipline du barreau de Paris émise à l’égard d’un avocat qui avait manqué de prudence quant au principe d’indépendance et de délicatesse. Ledit avocat avait défendu père et oncles face à oncles et tantes dans une affaire de succession, refusant de se soumettre à l’avis de la commission déontologique de l’Ordre qui lui avait demandé de se désister. Dans un arrêté du 6 décembre 2016, le conseil de discipline du barreau de Paris a prononcé une sanction d’avertissement à l’encontre de l’avocat sur le fondement de l’article 1.3 du RIN susvisé. La cour d’appel de Paris a confirmé l’arrêté disciplinaire en rappelant deux choses. Tout d’abord en l’espèce, quand l’avocat défend, dans un cadre successoral, un client dont il est lui-même un potentiel héritier, il y a bien évidemment conflit d’intérêt car l’avocat est « indirectement concerné ». De surcroît, la défense d’un membre d’une famille au sein d’un litige familial empêche la réalisation du devoir de prudence et la mise en œuvre d’une indépendance réelle : « les devoirs incombant à l’avocat lui imposent une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment résultant de ses propres intérêts »[10]. L’arrêt de la cour parisienne met très justement en exergue que si aucune disposition n’interdit « à un avocat d’assister ou de représenter en justice les membres de sa famille, une telle situation ne doit pas porter atteinte au principe d’indépendance que tout avocat est tenu de respecter aux fins de remplir la mission qui lui est confiée ».
Enfin, rappelons qu’il est de coutume d’agir avec délicatesse avec son client, notamment quand il s’agit d’un membre de sa famille, et que doit alors se réaliser matériellement le principe déontologique du désintéressement. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juin 2009 a relevé « l’usage fréquent confirmé » des interventions gratuites des avocats pour les membres de leur famille proche [11]. Dans cette affaire, le client était le beau-père de l’un des avocats du cabinet qu’il avait sollicité. Aucune convention d’honoraires n’avait été établie, mais le client avait néanmoins reçu une facture d’honoraires qu’il a contestée, au motif qu’il avait confié son litige au cabinet dans lequel son gendre était avocat et que les dossiers antérieurs confiés au même cabinet n’avaient donné lieu à aucune facture. Si l’on comprend l’exaspération du cabinet de plaider gracieusement les litiges du beau-père de l’un des avocats membres de la structure, il n’en demeure pas moins que l’absence de convention d’honoraires, couplée au lien familial existant entre le défenseur et le client, conduit au respect du principe de désintéressement, le cabinet ayant librement accepté la défense de celui-ci.
Dès lors, réaliser une convention d’honoraires avec un membre de sa famille pourrait heurter le principe de délicatesse [12]. Et, à défaut de convention, exiger auprès d’un membre de sa famille des honoraires fixés selon les usages contreviendrait au principe de désintéressement [13].
La défense d’un membre de sa famille n’est pas interdite, et certaines situations font même reposer sur l’avocat un véritable devoir de service quant à sa famille. Mais cela ne saurait être aux dépens du principe d’indépendance. L’avocat ne saurait avilir cette indépendance au profit d’une défense biaisée, non pas par une subjectivité dont il est impossible de se départir dans le cadre de la défense d’un client, mais par l’aveuglement sentimental dû à la proximité familiale ou à des intérêts injustement convoités.
Entre entièreté du dévouement et nécessité de l’indépendance, l’équilibre du service est complexe à trouver, chose que rappelle fort justement le Code déontologie des avocats du barreau de Paris [14].
Si, dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’avocat doit avoir une famille (et un père), mieux vaut pour éviter toute difficulté morale et déontologique, qu’il considère qu’il s’agit de l’Ordre (et de son Bâtonnier).
| A retenir : Il est possible, pour un avocat, de défendre un membre de sa famille, mais à la condition que prime, dans le cadre de cette défense, le principe déontologique d’indépendance, et, subséquemment, celui de désintéressement. Ces situations appellent l’avocat à user de la vertu de prudence afin de se conformer aux obligations déontologiques et morales de son Ordre. |
[1] A. Loysel, Pasquier ou Dialogue des avocats du parlement de Paris, Paris, Videcoq, 1844, p. 101.
[2] J.-M. Braunschweig, Profession Avocat. Le guide, Paris, Lamy, 2017.
[3] RIN, art. 1.3 : « […] L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. […] Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence » (N° Lexbase : L4063IP8) ; art. 4. 1 : « […] Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. […] ».
[4] Citation de René Pichot de la Graverie, cité dans F. Pitou, La robe et la plume, Rennes, PUR, 2003, p. 172.
[5] Arrêté du conseil de discipline du barreau de Paris du 21 mai 1833, cité dans E. Cresson, Usages et règles de la profession d’avocat, t. I, Paris, Larose, p. 281.
[6] Ch. Mollot, Règles de la profession d’avocat, t. I, Paris, Durand, 1866, n°32, p. 51, et M. Rivière, Pandectes françaises, t. XI, Paris, Chevalier-Marescq, 1891, n° 724, p. 332.
[7] E. Cresson, Usages et règles de la profession d’avocat, op. cit., p. 277.
[8] H. Ader, A. Damien et alii, Règles de la profession d’avocat, Paris, Dalloz, 2018-2019, n°315-23 et 323-11.
[9] Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, art. 7.
[10] CA Paris, 2, 1, 22 mars 2018, n° 17/01850 (N° Lexbase : A7534XHI)
[11] Cass. civ. 2, 4 janvier 2009, n° 08-14.294, F-D (N° Lexbase : A6311EH9).
[12] H. Ader, A. Damien et alii, Règles…, op. cit., n° 335 s..
[13] H. Ader, A. Damien et alii, Règles…, op. cit., n° 333 s..
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477718
[Brèves] Fixation d’honoraires : la décision du Bâtonnier devenue irrévocable ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par le président du TJ
Réf. : Cass. civ. 2, 27 mai 2021, n° 17-11.220, F-P (N° Lexbase : A09134TY)
Lecture: 6 min
N7703BYX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 03 Juin 2021
► La décision prise par le Bâtonnier d’un Ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.
Faits et procédure. Un avocat avait défendu jusqu’au mois d’octobre 1996 les intérêts d’un client et des sociétés que celui-ci dirigeait. Par décision du 1er août 2002, le Bâtonnier de son Ordre avait fixé à une certaine somme le montant des honoraires que ces derniers restaient lui devoir et, par ordonnance du 3 décembre 2003, devenue irrévocable par suite de la déchéance du pourvoi en cassation introduit par ces derniers, le premier président de la cour d’appel avait déclaré irrecevable le recours formé contre la décision ordinale, au motif que son auteur n’était ni identifiable, ni expressément mandaté par un pouvoir spécial. À la suite du décès du dirigeant, le 16 avril 2012, l’avocat poursuivant le recouvrement de sa créance à l’encontre des ayants droit du défunt avait fait signifier une opposition à partage auprès du notaire chargé du règlement de la succession et inscrire une hypothèque judiciaire sur divers immeubles appartenant aux intéressées ou dépendant de la succession. Les ayants droit soutenant que l’avocat ne disposait pas d’un titre exécutoire, l’ont fait assigner devant un tribunal en vue d’obtenir la mainlevée des inscriptions d’hypothèque et l’annulation de l’opposition à partage.
En cause d’appel. Pour dire que l’avocat dispose d’un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires fixée par la décision du Bâtonnier de son Ordre, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 24 novembre 2016, n° 16/02975 N° Lexbase : A9098SIS) relève que cette décision a fait l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel qui, par une ordonnance devenue irrévocable, l’a déclaré irrecevable. Il retient ensuite qu’il importe peu que le premier président ne se soit pas prononcé sur le montant des honoraires de l’avocat, dès lors que la décision du Bâtonnier lui ayant été déférée, l’ordonnance, par laquelle ce magistrat a déclaré le recours irrecevable, a eu pour effet, après déchéance du pourvoi en cassation dont elle a été frappée, de rendre exécutoire la décision déférée, sans que l’avocat eût à saisir, à cet effet, le président du tribunal de grande instance. Il énonce, à cet égard, que l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 ne confère au président du tribunal judiciaire le pouvoir de donner force exécutoire à la décision du Bâtonnier qu’en l’absence de recours formé devant le premier président de la cour d’appel et que, lorsqu’un tel recours a été introduit, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction, que le texte ne prévoit pas, selon que ce recours est jugé recevable ou non, et, dans la négative, d’imposer à l’avocat de saisir le président du tribunal en vue d’obtenir un titre exécutoire, au motif que l’ordonnance du premier président ne vaudrait elle-même titre qu’en cas d’examen au fond de la contestation.
Réponse de la Cour de cassation. La Cour rend sa décision au visa des articles L. 111-2 (N° Lexbase : L5790IRU) et L. 111-3, 1° et 6° (N° Lexbase : L5301LUU) du Code des procédures civiles d’exécution, 502 du Code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : Z44140RS). Selon le deuxième de ces textes, ne constituent des titres exécutoires dont un créancier peut, en application du premier, poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, que, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. Aux termes du troisième, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Il résulte du dernier que la décision prise par le Bâtonnier d’un Ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires ne peut être rendue exécutoire que par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Pour la Cour, en statuant ainsi, alors que la décision prise par le Bâtonnier d’un Ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cassation. La Cour censure, par conséquent, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2016.
| Pour rappel : si le Bâtonnier est investi d'une véritable fonction juridictionnelle, ses décisions ne sont jamais exécutoires par elles-mêmes (Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-29.246, F-P+B N° Lexbase : A4417MDX). |
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, L'absence de force exécutoire de la décision du Bâtonnier en matière de contentieux des honoraires de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37983R4). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477703
[Brèves] Transposition de la Directive « ECN+ » : des améliorations notables du droit de la concurrence français
Réf. : Ordonnance n° 2021-649, du 26 mai 2021, relative à la transposition de la Directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (N° Lexbase : L6122L4I)
Lecture: 6 min
N7683BY9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 15 Juin 2021
► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 27 mai 2021 et prise sur le fondement de l'article 37 de la loi « DDADUE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC), procède à la transposition en droit français de certaines dispositions de la Directive « ECN + » (Directive n° 2019/1 du 11 décembre 2018 N° Lexbase : L9459LNN).
Cette Directive donne, notamment, davantage de moyens aux autorités de concurrence des États membres. L’ordonnance permet de transposer les dispositions de la Directive qui ne font pas déjà partie du droit français. En effet, la plupart des exigences clés de ce texte sont déjà satisfaites en France depuis la loi « LME » (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l’économie N° Lexbase : L7358IAR), qui a remplacé le Conseil de la concurrence par l’Autorité de la concurrence et l’a dotée de pouvoirs et de moyens renforcés.
Parmi les dispositions de la Directive non encore présentes dans le droit positif interne, certaines nécessitent l'introduction de mesures nouvelles ou des modifications substantielles des textes en vigueur. D'autres dispositions de la Directive n'appellent que des clarifications, des précisions ou des modifications modestes.
Les dispositions de l'ordonnance qui introduisent des mesures nouvelles et des modifications substantielles sont les suivantes :
(i) La possibilité pour l'Autorité de la concurrence de rejeter des saisines lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité (opportunité des poursuites) ;
(ii) La possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'imposer aux entreprises ou associations d'entreprises, non seulement des mesures coercitives de nature comportementale mais aussi des mesures coercitives de nature structurelle proportionnées à l'infraction commise et nécessaires pour faire cesser effectivement l'infraction ;
(iii) La possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'agir non seulement à la suite d'une saisine mais aussi de sa propre initiative pour ordonner l'imposition de mesures conservatoires ;
(iv) S'agissant des critères de détermination de la sanction, le critère de la durée de l'infraction, qui figure aujourd'hui dans le communiqué de l'Autorité de la concurrence relatif à la détermination de la sanction et qui est pris en compte pour établir la sanction, est désormais inscrit dans la loi. Le critère de l'importance du dommage à l'économie présent dans le droit positif n'est ni exigé, ni interdit par la Directive ; afin de lever toute ambigüité à l'égard de la notion de réparation d'un dommage subi par une victime d'une pratique anticoncurrentielle, l'ordonnance procède à sa suppression ;
(v) S'agissant des associations d'entreprises, l'ordonnance introduit les modifications suivantes :
- le montant maximum de l'amende qui peut être infligée à une association d'entreprises, actuellement fixé à 3 millions d'euros, est modifié pour l'aligner sur le plafond de 10 % du chiffre d'affaires mondial total actuellement en vigueur pour les entreprises. De plus, l'ordonnance prévoit que, lorsque l'infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association ;
- concernant le recouvrement de la sanction pécuniaire, l'Autorité de la concurrence peut contraindre les membres d'une association d'entreprises à payer l'amende infligée à l'association ;
(vi) L'ordonnance prévoit que lorsqu'une exonération totale des sanctions pécuniaires a été accordée à une entreprise ou une association d'entreprises en application de la procédure de clémence, les directeurs, gérants et autres membres du personnel de ladite entreprise ou association d'entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques sanctionnées par l'Autorité sont exempts des peines pénales prévues par l'article L. 420-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1755LCY) s'il est établi qu'ils ont activement coopéré avec l'Autorité de la concurrence et le ministère public ;
(vii) Des mesures renforçant la coopération entre les autorités nationales de concurrence, aux stades de l'enquête, de l'instruction et de la décision sont introduites par l'ordonnance dans le Code de commerce et dans le Code de l'organisation judiciaire ;
(viii) L'ordonnance introduit des dispositions qui organisent l'accès des parties au dossier lors d'une procédure menée devant l'Autorité de la concurrence et posent les limites à l'utilisation des informations qui peuvent s'y trouver, notamment celles relatives aux procédures de clémence et de transaction ;
(ix) L'ordonnance précise explicitement que les pratiques dont l'Autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve. Elle prévoit par ailleurs un certain de nombre de clarifications et précisions ;
(x) L'ordonnance précise la notion d'entreprise au sens du droit de la concurrence ;
(xi) Des dispositions soulignent explicitement la possibilité pour les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) d'accéder aux informations accessibles aux personnes et entreprises interrogées, et pouvant être sur des supports numériques (« courriels, messageries instantanées ») quel que soit le lieu de stockage (« nuage informatique et serveurs ») et permettront de sécuriser les procédures d'enquête ;
(xii) Des dispositions précisent que les engagements proposés par les entreprises ou associations d'entreprises et que l'Autorité de la concurrence peut accepter, peuvent être d'une durée déterminée ou indéterminée. Il est précisé également que l'Autorité de la concurrence peut, de sa propre initiative ou sur demande de l'auteur de la saisine, du ministre de l’Économie, de toute entreprise ou association d'entreprises ayant un intérêt à agir, modifier, compléter ou mettre fin aux engagements qu'elle a acceptés si certaines conditions sont réunies ;
(xiii) Les dispositions du titre VI du livre IV du Code de commerce sont complétées afin de préciser que le chiffre d'affaires pris en considération pour calculer l'astreinte que l'Autorité de la concurrence peut prononcer à l'encontre d'une entreprise ou association d'entreprises est un chiffre d'affaires mondial total journalier moyen ;
(xiv) Certaines dispositions de l'ordonnance clarifient les mesures relatives à la prescription figurant déjà dans le Code de commerce.
L’ordonnance transpose les dispositions de la Directive, à l'exception des articles 17 à 22 relatifs à la procédure de « clémence » en droit de la concurrence, qui relèvent du domaine règlementaire et ont été transposés par décret (décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 N° Lexbase : L4345L4P ; V. Téchené, Lexbase Affaires, mai 2021, n° 676 N° Lexbase : N7582BYH).
L'ordonnance est composée de trois titres, le premier relatif aux dispositions modifiant le Code de commerce, le deuxième relatif aux dispositions modifiant le Code de l'organisation judiciaire et le troisième concernant les dispositions diverses et finales.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477683
[Brèves] CCMI : l’exercice de la faculté de rétractation prive-t-il le maître d’ouvrage d’une demande indemnitaire ?
Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2021, n° 20-13.204, FS-P (N° Lexbase : A48244TT)
Lecture: 3 min
N7739BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 03 Juin 2021
► L’exercice du droit de rétractation ne prive pas, per se, le maître d’ouvrage de solliciter des dommages et intérêts du constructeur de maison individuelle ;
► les juges du fond exercent, à cet égard, leur liberté d’appréciation sur la faute commise par le constructeur.
La législation et la règlementation du contrat de construction de maison individuelle protègent, pour ne pas dire, surprotègent l’accédant à la propriété parce qu’il est souvent primo-accédant et que la construction de sa maison d’habitation nécessite, aussi souvent, la souscription d’un important prêt bancaire.
Le juge, dans son interprétation de ces dispositions, verse, lui aussi, dans une approche in favorem comme en atteste l’arrêt rapporté.
En l’espèce, des accédants à la propriété concluent un contrat de construction de maison individuelle (ci-après désigné CCMI), financé par un emprunt. Ils assignent le constructeur et le banquier en résiliation des contrats de construction et de prêt avant de modifier leurs prétentions pour solliciter, à titre principal, l’anéantissement du contrat de CCMI outre l’allocation de dommages et intérêts. Déboutés par les conseillers d’appel de leur demande indemnitaire, ils forment un pourvoi en cassation.
Ils exposent que l’exercice, par le maître d’ouvrage de sa faculté de rétractation ne le prive pas de la possibilité d’exercer une action en responsabilité délictuelle sur la faute commise par le cocontractant dans la conclusion du contrat. Les deux fautes invoquées par le maître d’ouvrage sont, d’une part, l’inachèvement de la maison à la date de livraison prévue par le contrat et, d’autre part, les irrégularités ayant affecté le contrat.
Le pourvoi est rejeté. Le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir des conséquences dommageables du non-respect du délai prévu par le contrat anéanti par l’exercice de son droit de rétractation dont il n’a pas été privé. L’exercice du droit de rétractation ne résulte pas, en l’espèce, d’une faute du constructeur mais du seul exercice de ce droit par le maître d’ouvrage.
L’exercice du droit de rétractation ne prive donc pas le maître d’ouvrage de l’allocation de dommages et intérêts, mais encore faut-il prouver une faute distincte de l’exercice même de ce droit. Ils sont ainsi déboutés de leur demande de démolition.
La solution n’est pas nouvelle. En cas d’anéantissement du contrat par rétractation du consentement comme en cas d’annulation de celui-ci, la démolition de l’ouvrage ne peut être ordonnée que si elle constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités (pour exemple, Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-23.612, FS-P+B+R N° Lexbase : A5827NTY), notamment au regard des travaux réalisés et de la gravité des désordres (Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-12.537, FS-P+B+I N° Lexbase : A3876YMI).
La solution mérite d’être approuvée. La formule célèbre du Doyen Carbonnier, « du néant, rien ne peut sortir » (J. Carbonnier, Les obligations, tome IV, PUF 2000, n° 106), se prête assez mal au contrat de CCMI tant les causes d’anéantissement de l’acte sont nombreuses. Il faut, par exemple, que l’exécution en nature du contrat soit impossible (pour exemple, Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-26.906, FS-D N° Lexbase : A1441XLX).
Pour autant, le maître d’ouvrage ne perd pas la possibilité de solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices qui lui sont causés par cette nullité (Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-26.085, FS-P+B {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 28685320, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. civ. 3, 21-01-2016, n\u00b0 14-26.085, FS-P+B, Cassation partielle", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A5599N47"}}) comme le rappelle l’arrêt rapporté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477739
[Brèves] Inconstitutionnalité des pénalités pour défaut de délivrance d'une facture
Réf. : Cons. const., décision n° 2021-908 QPC, du 26 mai 2021 (N° Lexbase : A88534SP)
Lecture: 2 min
N7688BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 02 Juin 2021
► Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 1737 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1727HNB), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512, du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (N° Lexbase : L4620HDH), est contraire à la Constitution.
🖊️ Que prévoient ces dispositions ? L’article 1737 du Code général des impôts sanctionne les professionnels ne respectant pas l’obligation de délivrance d’une facture à leurs clients d’une amende égale à 50 %. L’amende encourue est réduite à 5 % du montant de la transaction si ces derniers apportent, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a toutefois été régulièrement comptabilisée.
📌 Renvoi devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État avait transmis au Conseil constitutionnel une QPC afin de savoir si cette amende portait atteinte au principe de nécessité des peines (CE 9° et 10° ch.-r., 24 février 20251, n° 443476, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A06114IH).
Solution du Conseil constitutionnel :
- en l'absence de délivrance d'une facture, le législateur a prévu l'application d'une amende dont le montant n'est pas plafonné et dont le taux, qui s'élève à 50 % du montant de la transaction, est fixe. D'autre part, cette amende reste due, alors même que la transaction a été régulièrement comptabilisée, si le fournisseur n'apporte pas la preuve de cette comptabilisation dans les trente jours suivant la mise en demeure de l'administration fiscale ;
- le législateur a prévu l'application d'une amende réduite dont le montant n'est pas non plus plafonné et dont le taux de 5 % est fixe, quand bien même le fournisseur justifierait d'une comptabilisation régulière de la transaction permettant à l'administration d'effectuer des contrôles.
👉 Les dispositions contestées peuvent donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, comme de l'avantage qui a pu en être retiré.
💡 L'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477688
[Brèves] Procédure de partage post-divorce : attention à ne rien oublier (notamment les créances nées avant le mariage), après c’est trop tard !
Réf. : Cass. civ. 1, 26 mai 2021, n° 19-23.723, FS-P (N° Lexbase : A88504SL)
Lecture: 3 min
N7764BY9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Juin 2021
► Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d'époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage ;
il appartient dès lors à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l'établissement des comptes s'y rapportant, sous peine d’irrecevabilité de toute demande distincte postérieure au partage.
Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une solution désormais bien acquise qui amène à considérer, selon l’expression consacrée de Jérôme Casey, que la procédure de partage est une sorte de « voiture-balai » qui englobe toutes les questions patrimoniales entre les époux, et donc toutes leurs demandes financières (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.308, F-D N° Lexbase : A06883MG ; Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-14.150, F-P+B N° Lexbase : A9716YUE ; J. Casey, obs. n° 11, in Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (janvier 2020 - août 2020), Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 836 N° Lexbase : N4543BYW).
Dans ces précédentes décisions, la Cour de cassation était amenée à sanctionner le juge du partage qui, saisi d’une action en compte liquidation et partage post-divorce, déclinait sa compétence s’agissant du règlement de créances entre époux, et notamment de créances antérieures au mariage ; la Haute juridiction avait ainsi pu énoncer que : 1° « Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins » ; 2° « la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant » (Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-14.150, préc.).
Dans sa décision rendue le 26 mai 2021, la Cour de cassation énonce dans les mêmes termes cette dernière règle (2°) ; mais la question ne portait pas ici sur la compétence du juge du partage, mais sur l’obligation pour les époux de faire valoir toute créance sur l’autre à l’occasion de l’action précitée, sous peine d’irrecevabilité de toute demande distincte postérieure au partage.
En l’espèce, un jugement du 20 janvier 2000 avait prononcé le divorce des époux et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 9 avril 2008, le notaire désigné avait dressé un procès-verbal de difficultés. Le juge commis avait constaté la non-conciliation des parties et les avait renvoyées devant le tribunal qui, par un jugement du 6 avril 2010, avait statué sur les désaccords persistants. Le 24 septembre 2010, les parties avaient signé l’acte de partage établi par le notaire.
Le 27 octobre 2015, l’ex-époux avait assigné son ex-épouse aux fins d’obtenir une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour avoir financé, avant le mariage, la maison dont celle-ci était seule propriétaire.
Les juges du fond ont déclaré la demande irrecevable, après avoir relevé que le jugement de divorce du 20 janvier 2000 avait fait application de l’article 264-1 du Code civil, alors en vigueur (N° Lexbase : L2648ABP).
La solution est approuvée par la Haute juridiction, qui relève que la cour d'appel en avait exactement déduit que l’ex-époux n’était plus recevable à agir postérieurement au jugement du 6 avril 2010 et à l’acte de partage.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477764
[Jurisprudence] Déclaration d'appel et mentions de l'article R. 411-21 du CPI : revirement de jurisprudence pour atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal
Réf. : Cass. com., 12 mai 2021, n° 18-15.153, FS-P (N° Lexbase : A52794RX)
Lecture: 12 min
N7736BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la Cour, NFALAW – SCP d'avocats
Le 02 Juin 2021
Mots clés : recours contre les décisions du directeur de l’INPI • déclaration d’appel • personnes morales • mentions requises • sanction • revirement • CESDH, art. 6 § 1
Opérant un important revirement de jurisprudence, la Cour de cassation retient, dans un arrêt du 12 mai 2021, que l'irrecevabilité du recours résultant de l'omission d'une des mentions requises par l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure au 2019-1316 du 9 décembre 2019, dans la déclaration d’appel, peut faire l'objet d'une régularisation en application des dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile.
S'il est évidemment possible de régulariser un recours contre une décision d'opposition défavorable, l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3862ADE) – dans sa version applicable au litige [1] – requiert que la déclaration comporte alors un certain nombre d'informations permettant d'identifier la personne du requérant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, doivent notamment être précisés sa forme sociale ainsi que l'organe qui la représente légalement. À défaut, l'irrecevabilité du recours est prononcée d'office. Telle est la désagréable expérience vécue par la société Sogiphar, à qui la cour d'appel de Douai reprochait de s'être contentée d'avoir renseigné la mention « prise en la personne de ses représentants légaux » dans sa déclaration [2].
Procédant à un spectaculaire revirement de jurisprudence par un arrêt du 12 mai 2021 publié au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient désormais que l'irrecevabilité du recours résultant de l'omission d'une des mentions requises dans la déclaration peut faire l'objet d'une régularisation en application des dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H).
Aux termes d'un arrêt du 8 février 2018, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable le recours formé par la société Sogiphar à l'encontre de la décision du Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en date du 21 juin 2017, ayant rejeté son opposition sur le fondement de la marque complexe « LIBEOZ » à l'encontre de la demande d'enregistrement portant sur le signe verbal « LIBZ », les produits en question étant identiques et similaires [3].
La cour a relevé que la seule mention de la forme sociale « société anonyme » ne permet pas de déduire l'organe la représentant légalement, ainsi que le requiert l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, si le représentant légal de la société est le directeur général et les éventuels directeurs généraux délégués dans une société anonyme avec conseil d'administration, le président du directoire ou le directeur général unique voire les éventuels directeurs généraux sont exclusivement compétents dans l'hypothèse d'une société anonyme avec directoire et conseil de surveillance.
À l'inverse, dans une autre affaire, la cour d'appel de Bordeaux a eu l'occasion de juger recevable le recours enregistré par une société par actions simplifiée « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège », dès lors que l'organe qui est le représentant légal de ce type de société est nécessairement son président [4]. Il avait donc été satisfait à l'obligation d'information complète et d'identification sous-tendue par le texte réglementaire.
En l'espèce, les débats devant la Cour de cassation se sont finalement portés vers la possibilité de régulariser une irrégularité de forme, conduisant à l'arrêt de revirement objet du présent commentaire.
I. La possibilité de régularisation devant le juge judiciaire
Les dispositions du Code de procédure civile imposent au demandeur à une action en justice de faire figurer un certain nombre de mentions au sein de son acte d'assignation délivré au(x) défendeur(s). Lorsque le requérant est une personne morale, il s'agit notamment de sa forme et de l'organe qui la représente légalement [5].
De jurisprudence constante, le défaut de désignation de l'organe représentant la personne morale [6] constitue un vice de forme avec les conséquences prévues à l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G). L'indication erronée de l'organe représentant légalement la société encourt d'ailleurs la même sanction [7].
À l'inverse des nullités de fond de l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q), l'omission / erreur d'une des mentions requises n'est donc susceptible de donner prise à la nullité de l'acte qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
S'est ainsi développée une certaine pratique, parmi les plaideurs, de ne pas préciser spécifiquement l'organe représentant la société et de lui préférer la formule devenue de style « prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ». Il s'agit ainsi d'éviter d'éventuelles controverses lorsque, sans en prévenir son conseil, la société change sa forme sociale / représentant légal alors même qu'une assignation est sur le point d'être délivrée en son nom. À défaut d'un grief, les actes introductifs d'instance correspondants ont été jugés valides par les juridictions françaises [8].
Il est d'ailleurs intéressant de constater que l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Douai précise que la société Biogaran [9] (qui a notamment soulevé l'irrecevabilité du recours formé par la société Sogiphar au motif de l'absence de mention de l'organe représentant légalement cette dernière société)… est « prise en la personne de son représentant légal » sans autre précision !
Quoi qu'il en soit, l'article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H) dispose en son 1er alinéa que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Il est ainsi loisible au demandeur de purger la cause de nullité en indiquant la mention omise.
II. Le régime procédural distinct de l'article R. 411-21 (ancienne version) du Code de la propriété intellectuelle
L'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, prévoyait que le recours devait être formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour et que, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration devait notamment comporter la mention de la forme, de la dénomination, du siège social et de l'organe qui représente légalement la personne morale.
Eu égard au parallélisme rédactionnel évident avec les dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6811H7E), l'on aurait pu s'attendre à ce que le régime procédural de la déclaration de recours soit calqué sur celui de l'assignation. Il aurait ainsi ouvert la voie à une possibilité de régularisation conformément aux dispositions de l'article 126 précité.
D'ailleurs, le Règlement délégué (UE) n° 2018/625 du 5 mars 2018, complétant le Règlement (UE) n° 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (N° Lexbase : L0431LK8), prévoit expressément la possibilité de régulariser l'acte de recours lorsque les renseignements relatifs à la personne du requérant ont été omis (article 23.1).
Pourtant, telle n'a pas été l'option retenue par la Cour de cassation – dans un premier temps tout du moins – et par les juges du fond [10]. En effet, pour écarter la possibilité d'une régularisation ultérieure à défaut de mention, la Haute Cour a tout d'abord jugé que les dispositions de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle sont spécifiques et qu’elles excluent donc l’application de l’article 126 du Code de procédure civile [11].
La sanction de l'irrecevabilité édictée par voie réglementaire n'apparaissait pas disproportionnée dès lors que la disposition critiquée a manifestement pour but de s'assurer de l'identité exacte de l'auteur du recours. L'intéressé n'étant pas privé de l'accès à un juge, les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'étaient pas en cause (N° Lexbase : L7558AIR) [12].
Reprenant apparemment les enseignements de la jurisprudence de la Cour de cassation [13] relative à l'article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L0384ITE) [14], la cour d'appel de Versailles avait par ailleurs jugé que « la déclaration de recours étant un acte unilatéral destiné à saisir la cour d'appel », il ne saurait être prétendu que l'application de l'article R. 411-21 serait contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales [15].
III. Le revirement de jurisprudence opéré par l'arrêt du 12 mai 2021
Dans ce contexte, le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 12 mai 2021 est d'autant plus notable qu'il est particulièrement motivé et que la formule retenue par la Chambre commerciale (point 14) est dénuée d'ambiguïté : « Il apparaît donc nécessaire d’abandonner la jurisprudence précitée et d’interpréter désormais l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l’application de l’article 126 du Code de procédure civile et que, dès lors, l’irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l’INPI résultant de l’omission, dans la déclaration de recours, d’une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes ».
La Cour de cassation rappelle tout d'abord que, si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, ces dernières ne sauraient « restreindre l'accès ouvert à un justifiable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ». De telles atteintes ne peuvent se concilier à l'article 6 §1 de la CESDH que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé [16].
En l'espèce, les exigences de forme posées par le texte réglementaire visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. L'exigence de précision de la forme, de la dénomination, du siège social et de l'organe qui représente légalement une personne morale requérante apparaît donc légitime afin d'assurer le respect du principe de sécurité juridique et permettre ainsi au juge et à la partie défenderesse de s'assurer que le recours formé par un organe habilité à engager et représenter la personne morale.
Pour autant, la Chambre commerciale juge que la possibilité de régularisation – jusqu'alors déniée au requérant dans le cadre d'un recours – n’empêcherait pas le contrôle du juge et ne porterait aucune atteinte aux intérêts légitimes de la partie défenderesse. Par ailleurs, les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice ne seraient pas affectés par l’ouverture d’une telle possibilité de régularisation.
Par conséquent, l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu’il avait été jusqu'alors interprété, n’assurait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et portait une atteinte excessive au droit d’accès au juge. Le revirement de jurisprudence s'imposait.
***
La Chambre commerciale de la Cour de cassation renvoie finalement l'affaire devant la cour d'appel de Douai autrement composée. Elle considère en effet que la société Sogiphar n'avait pas été mise en mesure de régulariser son recours dès lors que la jurisprudence antérieure excluait cette possibilité. Reste à savoir si, à l'inverse du directeur de l'INPI, la cour d'appel retiendra l'existence d'un risque de confusion entre les signes « LIBEOZ et « LIB » en cause.
Quoi qu'il en soit, entre-temps, l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle a été modifié selon décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 (N° Lexbase : L8139LTM) dans le cadre de la transposition en droit interne du « Paquet Marques » [17]. Les exigences formelles de la déclaration de recours sont désormais précisées à l'article R. 411-25 (N° Lexbase : L9100LT9)… lequel renvoie expressément à l'article 54 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8645LYT). Ce changement réglementaire pourrait expliquer en partie l'évolution de la position de la Cour de cassation.
[1] Modifiées selon décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 (N° Lexbase : L8139LTM) ; les dispositions relatives aux mentions requises sont désormais codifiées à l'article R.411-25 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9100LT9), lequel renvoie expressément à l'article 54, 3° du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8645LYT).
[2] CA Douai, 8 février 2018, n° 17/04577 (N° Lexbase : A9290XC3).
[3] Dont produits pharmaceutiques.
[4] En vertu des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6161AIZ) : CA Bordeaux, 18 août 2016, n° 15/04986 (N° Lexbase : A5751RYN) ; dans le même sens : CA Lyon, 14 mai 2020, n° 19/06291 (N° Lexbase : A36573NR).
[5] CPC, art. 54 (N° Lexbase : L8645LYT) et s. et art. 648 (N° Lexbase : L6811H7E).
[6] Cass. mixte, 22 février 2002, n° 00-19.639, publié (N° Lexbase : A0661AY7) ; Cass. civ. 2, 18 septembre 2003, n° 01-15.608, F-P+B (N° Lexbase : A5351C93).
[7] De même, l'indication erronée de l'organe représentant légalement la société constitue une nullité de forme : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-17.622, F-D (N° Lexbase : A6909YQX) ; Cass. civ. 1, 21 novembre 2012, n° 10-23.985, F-D (N° Lexbase : A5157IXB).
[8] Cass. civ. 2, 18 septembre 2003, n° 01-15.608, F-P+B (N° Lexbase : A5351C93).
[9] À l'origine du dépôt de la demande de marque « LIBZ » objet de l'opposition.
[10] CA Bordeaux 26 janvier 2021, n° 19/06632 (N° Lexbase : A63844DS) – CA Aix-en-Provence, 25 janvier 2018, n° 17/08985 (N° Lexbase : A5163XBT) – CA Paris, 13 février 2013, n° 11/19562 (N° Lexbase : A8068I7X).
[11] Cass. com., 7 janvier 2004, n° 02-14.115, F-D (N° Lexbase : A6955DAT) – Cass. com., 17 juin 2003, n° 01-15.747, FS-P (N° Lexbase : A8564C8P).
[12] CA Nancy, 26 juin 2007, n° 05/02297 (N° Lexbase : A6234G3B).
[13] Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-12.691, FS-P+B (N° Lexbase : A6318DBM).
[14] « Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat », modifié par le décret n° 2019-1316, préc..
[15] CA Versailles, 18 février 2014, n° 13/07442 (N° Lexbase : A4624MEY) – CA Versailles, 16 décembre 2010, n° 10/60072.
[16] CEDH, 28 octobre 1998, req. 116/1997/900/1112, § 44 (N° Lexbase : A7537AW3) – CEDH, 26 janvier 2017, req. n° 797/14, § 42 (N° Lexbase : A5893TAI) – CEDH, 13 mars 2018, req. n° 56354/09, § 40 (N° Lexbase : A9077XGB).
[17] Cf. Numéro spécial sur la Transposition de la Directive « Marques » par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, Lexbase Affaires, janvier 2020, n° 620 (N° Lexbase : N1904BY8) et not., sur les questions procédurales, F. Fajgenbaum et Th. Lachacinski, Transposition de la Directive « Marques » : les (r)évolutions procédurales en questions, Lexbase Affaires, janvier 2020, n° 620 (N° Lexbase : N1875BY4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477736
[Jurisprudence] Privilège et communauté : plus jamais sans le consentement du conjoint
Réf. : Cass. civ. 1, 5 mai 2021, n° 19-15.072, FS-P (N° Lexbase : A96834QP)
Lecture: 18 min
N7740BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alex Tani, Maître de conférences à l’Université de Corse (UR 7311)
Le 03 Juin 2021
Mots clés : emprunt • privilège de prêteur de deniers (PPD) • saisie immobilière • bien commun • droit de gage • consentement • notaire • responsabilité
Si l’acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté est valable, la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l’emprunt. Cette solution inédite est d’une importance capitale pour la pratique.
La saisie d’un bien commun peut se révéler particulièrement piégeuse, en ce qu’elle oblige à l’articulation de plusieurs dispositions, loin d’être toujours parfaitement compatibles. Parfois, c’est avec le droit pénal que doivent se conjuguer les règles des régimes matrimoniaux : c’est ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation – suivant scrupuleusement l’avis de sa première chambre civile [1] – a récemment retenu que « la confiscation d’un bien commun prononcée en répression d’une infraction commise par l’un des époux ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’État » et « faire naître un droit à récompense pour la communauté » [2]. D’autres fois, comme ce fut le cas dans l’arrêt du 5 mai 2021, c’est avec le droit des sûretés que doit composer celui des régimes matrimoniaux [3].
Les faits à l’origine de cette affaire sont des plus classiques. En cours d’union, une épouse fit l’acquisition – seule, mais pour le compte de la communauté (C. civ., art. 1401 N° Lexbase : L1532ABD) – d’un bien immobilier qu’elle finança au moyen d’un prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers. En l’absence de remboursement de la somme prêtée, le préteur délivra à l’épouse-emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière du bien litigieux. Les difficultés auraient pu s’arrêter là, mais c’était sans compter sur l’annulation par une décision judiciaire devenue irrévocable dudit commandement, au motif que le conjoint de l’emprunteur n’avait pas donné son consentement à l’acte. Le prêteur se trouva contraint de rechercher la faute du notaire qui avait reçu l’acte de vente et procédé à l’inscription du privilège de prêteur de deniers, en l’assignant en responsabilité et indemnisation. Saisie de l’affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence [4] suivit le prêteur dans son argumentation et condamna le notaire instrumentaire au paiement de dommages-intérêts, en le reconnaissant fautif de ne pas avoir sollicité le consentement du conjoint commun en biens. Le notaire forma un pourvoi en cassation à l’appui duquel il faisait finement remarquer que le privilège de prêteur de deniers est constitué de plein droit par le seul effet de la loi, pour en conclure que même si l’emprunt avait été souscrit sans le consentement du conjoint, il était titulaire d’une créance privilégiée qui l’autorisait à saisir le bien ainsi grevé sans autre formalité.
Le débat judiciaire était des plus captivants et invitait la Cour de cassation à se déterminer : le titulaire d’un privilège de prêteur de deniers peut-il exercer son droit de poursuite sur un bien commun, lorsque le conjoint de l’emprunteur n’a pourtant pas consenti au prêt ?
La réponse formulée est inédite et mérite à ce titre toute l’attention. Après avoir rappelé la teneur des articles 1413 (N° Lexbase : L1544ABS), 1415 (N° Lexbase : L1546ABU) et 2374, 2° (N° Lexbase : L2351LYQ), du Code civil, la Cour de cassation se prête à l’exercice subtil de leur articulation : « si l’acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n’est pas inefficace, la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l’emprunt ». Faute d’avoir obtenu le consentement de l’époux commun en biens (I), le prêteur ne peut pas poursuivre le bien entré en communauté malgré le privilège légal qui le grève ; ce qui invite à l’avenir à revoir certaines pratiques professionnelles (II).
I. L’obtention du consentement du conjoint
On sait que les lois de 1965 (la « réforme ») et de 1985 (la « réforme de la réforme », comme aimait à le dire Carbonnier) étaient parvenues à trouver un équilibre entre la garantie des droits des créanciers d’une part, et la protection du patrimoine familial d’autre part. Pourtant, l’articulation des textes était loin de relever de l’évidence ; et il y avait, comme l’illustre l’arrêt commenté, matière à hésiter.
La Cour de cassation lève pour la première fois les hésitations : le privilège de prêteur de deniers ne peut pas être mis en œuvre quand le bien grevé, en l’absence de consentement du conjoint commun en biens, échappe au droit de gage général du créancier.
La solution peut surprendre, surtout pour qui avait coutume de retenir que le privilège de prêteur de deniers peut valablement grever un bien entré en communauté, même lorsque le conjoint n’a pourtant pas consenti à l’emprunt [5] ; la justification doctrinale reposait sur le caractère légal du privilège [6]. C’est d’ailleurs en reprenant cette analyse que le moyen tentait, assez classiquement, de faire valoir que « le créancier, titulaire d’un privilège de prêteur de deniers constitué de plein droit et par le seul effet de la loi sur le bien qu’il a financé, peut saisir le bien ainsi grevé même s’il est entré en communauté et si l’emprunt a été souscrit par un seul des époux sans le consentement de son conjoint ». La source légale du privilège de prêteur de deniers et sa constitution automatique, sitôt que les conditions de l’article 2374, 2°, du Code civil sont réunies, n’ont pas convaincu la Cour de cassation qui opte ici pour une autre analyse.
En dépit d’une formulation peut-être maladroite (en ce sens M. Cottet, préc.), la solution se comprend bien. La Cour de cassation invite à raisonner en deux temps et à distinguer le privilège de son assiette.
D’abord, elle reconnaît que le privilège de prêteur de deniers existait bel et bien : « aux termes de l’article 2374, 2°, du Code civil, les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, même en l’absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ». Le privilège de prêteur de deniers est constitué de plein droit par l’effet de la loi, sitôt que certaines conditions sont respectées ; ce qui ne soulevait aucune difficulté ici. Or, après avoir vérifié l’existence du privilège qui s’inférait de la validité de l’acte de prêt, il restait à s’interroger sur son efficacité ; et c’est là en revanche que les interprétations divergeaient.
En effet, il convenait ensuite de raisonner en considération du droit de gage général des créanciers qui, au stade de l’obligation à la dette, détermine les biens que ceux-ci peuvent poursuivre en paiement de leur créance. Avec pédagogie, la Cour de cassation rappelle « qu’aux termes de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu ». Et d’ajouter : « par exception, l’article 1415 du même code prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ».
En matière d’emprunt ou de cautionnement, les créanciers disposent d’un gage dont l’assiette varie : celui-ci est dit « réduit » (limité aux biens propres et aux revenus) s’il n’est souscrit que par un seul des époux ; « ordinaire » (élargi aux biens communs, à l’exception des gains et salaires du conjoint) s’il est souscrit par un seul des époux, mais avec le consentement de l’autre ; ou « augmenté » (étendu à tous les biens du couple) s’il est souscrit par les deux époux.
En l’espèce, dès lors que l’emprunt n’avait été souscrit que par l’épouse – sans solliciter le consentement de son conjoint – la Cour de cassation parvenait à la conclusion que l’assiette du droit de gage n’était composée que des biens propres et revenus du souscripteur ; à l’exclusion donc du bien commun, pourtant grevé par le privilège de prêteur de deniers. Ce faisant, il convenait d’en déduire que si le prêteur disposait bien d’un privilège légal lui conférant une priorité sur les créanciers chirographaires, la « mise en œuvre » de ce droit (pour reprendre les mots de l’arrêt) était conditionnée au consentement de son conjoint. Par un subtil jeu de combinaison entre les règles du droit des sûretés (C. civ., art. 2374, 2°) et celles de la communauté légale (C. civ., art. 1413 s.), les Hauts magistrats concluent que le prêteur de deniers était titulaire d’un privilège, mais que le bien grevé échappait à son droit de gage général : un « privilège sans assiette », un « droit creux » en somme (comme celui qui est institué légataire d’un bien qui ne se trouve plus dans le patrimoine du défunt et qui, en définitive, dispose d’un « droit à… rien » !).
Ce résultat est le fruit d’un raisonnement en deux étapes : d’une part, le prêteur est-il prioritaire sur la distribution du prix en cas de vente du bien grevé ? Oui, car en raison de la validité de l’acte d’emprunt, il est titulaire d’un privilège légal qui lui confère un droit de priorité ; d’autre part, peut-il poursuivre le bien commun grevé par le privilège légal ? Non, car celui-ci n’entre pas dans son droit de gage général. Tel est sans doute ce que veut dire ici la Cour de cassation en retenant que l’emprunt souscrit sans le consentement du conjoint n’est « pas inefficace » (entendons qu’il est « valable »), mais que le privilège de prêteur de deniers ne peut pas être « mis en œuvre ». On retrouve là l’argumentation développée par l’arrêt d’appel où il fut expliqué que la mise en œuvre du privilège « reste subordonnée à l’exercice préalable d’une poursuite en recouvrement forcé qui seule, permettra ensuite au prêteur de disposer des attributs de son privilège, à savoir, un droit de préférence sur le paiement en cas de vente et également un droit de suite ».
A l’évidence, si un époux ne peut pas engager la communauté en souscrivant un emprunt sans l’accord de l’autre, le prêteur ne peut pas davantage espérer se saisir des biens qui la composent. Sans doute est-ce ce qui explique aussi que la Cour de cassation retient de longue date qu’à défaut de consentement exprès du conjoint à l’engagement de caution pris par un époux, le créancier ne peut être judiciairement autorisé à prendre inscription d’hypothèque sur un immeuble commun [7].
Civilement, la décision dit beaucoup de ce qu’est un privilège. Bien que le texte ne soit pas visé, la solution semble traduire le sens profond de l’article 2324 du Code civil qui définit le privilège comme « un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires ». Partant, le privilège confère un « droit de priorité » par rapport à certains créanciers, quand le gage permet de déterminer un « droit de poursuite » sur certains biens.
Il reste que cela aboutit tout de même à la situation curieuse dans laquelle une personne est titulaire d’un droit de préférence en cas de vente du bien grevé (le privilège est valable) alors qu’elle n’a pourtant pas le droit de le poursuivre (il échappe à son droit de gage). Dès lors, était-ce bien la solution à retenir ? Il est vrai que si les règles de passif en régime de communauté sont claires, ce n’est pas sur ce fondement que s’appuyait le prêteur, mais sur celui du droit des sûretés qui reconnaît, de plein droit, un privilège à son profit. En conditionnant, la mise en œuvre de cette sûreté réelle, au consentement du conjoint de l’emprunteur, l’arrêt peut donner à penser qu’il ajoute une condition à la loi ; laquelle, à s’en tenir à la seule lecture de l’article 2374, 2°, ne prévoit rien de tel, mais il faut bien sûr dorénavant le lire en contemplation de l’article 1415. On peut néanmoins s’interroger sur le choix opéré. Fallait-il, suivant une interprétation classique, considérer qu’en raison de sa nature légale le privilège de prêteur de deniers primait les règles du passif en communauté légale ? Ou devait-on, au contraire, donner la priorité aux règles qui protègent le conjoint contre des opérations réputées dangereuses (l’emprunt et le cautionnement) pour lesquelles il n’aurait pas donné son consentement ? Évidemment, chacun perçoit les implications : soit on donne la faveur au droit des sûretés (au détriment du conjoint), soit on la donne au droit des régimes matrimoniaux (au détriment des créanciers). L’arrêt du 5 mai 2021 tranche nettement la question : si la solution est protectrice du conjoint dont certains biens échappent au droit de poursuite du créancier si celui-ci n’a pas consenti à l’acte, elle est en revanche moins satisfaisante pour le créancier qui croyait légitimement pouvoir compter sur les prévisions légales pour bénéficier d’un privilège lui permettant de poursuivre le bien qu’il a, par son emprunt, participé à financer.
Quoi que l’on en pense, la portée de cette décision n’est pas négligeable en pratique et l’arrêt invite les professionnels à la plus grande prudence.
II. L’invitation à la prudence des praticiens
La solution retenue par l’arrêt du 5 mai 2021 est d’une importance capitale pour les praticiens, et elle mérite à ce titre d’être largement portée à la connaissance des établissements de crédit et des notaires qui, à l’avenir, devront faire montre d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agira d’inscrire un privilège de prêteur de deniers.
D’abord, on peut s’attendre à ce que les créanciers – comme il le font très largement aujourd’hui – continuent, lorsqu’il apparaît que leurs clients sont mariés sous un régime communautaire, d’exiger d’eux une solidarité à la dette, ou du moins le consentement du conjoint du débiteur. En effet, en l’absence de consentement du conjoint à l’emprunt, la sûreté réelle que la loi reconnaît au prêteur de deniers s’en trouve sensiblement affaiblie : or on imagine bien que personne ne voudra d’un privilège qui conserve certains de ses attributs, mais qui devient privé de son essence faute de pouvoir poursuivre le bien grevé en raison de son caractère commun. Ainsi, lorsque le couple est marié sous le régime de la communauté légale, le prêteur (le plus souvent une banque) aura tout intérêt à ce que l’emprunt soit solidaire ou a minima à ce que le conjoint y consente, afin de bénéficier d’un gage plus étendu.
Mais surtout, il faut désormais inviter les notaires à se montrer particulièrement attentifs lorsqu’ils sont amenés à recevoir un prêt en la forme authentique pour inscrire un privilège de prêteur de deniers. La connaissance, comme en l’espèce, que les époux sont communs en biens et que l’achat est réalisé pour le compte de la communauté (on laisse de côté les hypothèses d’emploi ou de remploi, où le bien à condition d’effectuer la double déclaration et de respecter la règle de la major pars restera propre par le jeu de la subrogation réelle facultative) appellera une réaction immédiate de leur part, sauf à prendre le risque de manquer à leur office. Tel est ce que confirme ici très clairement la Cour de cassation : « après avoir relevé que le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l’achat était fait pour la communauté, et justement retenu que [le prêteur] ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière sur le bien commun, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en omettant de solliciter le consentement [du conjoint], [le notaire] avait manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel [il] avait prêté son concours ».
En pareille hypothèse, on croit comprendre qu’il ne s’agit pas seulement de satisfaire à un devoir de conseil renforcé, mais qu’il faut aller jusqu’à refuser strictement d’instrumenter. En effet, il serait sans doute insuffisant de veiller à parfaitement mettre en garde le prêteur, au moyen, par exemple, d’une reconnaissance de conseils donnés. En la matière, même en ayant soigneusement informé ses clients (et particulièrement le prêteur), le notaire devra immanquablement se refuser à recevoir l’acte car, quoi que valable, celui-ci sera nécessairement regardé comme inefficace puisque le prêteur ne pourra pas engager une procédure de saisie immobilière sur le bien commun. S’il ne parvient pas à recueillir le consentement de l’époux, c’est bien à un refus catégorique d’instrumenter auquel le notaire est invité. D’ailleurs, la préconisation est conforme aux prévisions du règlement national de la profession : « le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est requis, sauf à le refuser (…) pour l’élaboration de conventions (…) qu’il sait inefficaces ou inutiles » (Règlement national intérieur des notaires, art. 3.2.3). C’est aussi un principe fréquemment rappelé en jurisprudence [8].
Or le cas évoqué est loin d’être exceptionnel en pratique : il est en effet fréquent que le notaire soit sollicité pour l’acquisition d’un bien par un client marié en communauté mais séparé de fait ou en instance de divorce. Dans ces hypothèses, il faut faire preuve de la plus grande vigilance [9]; d’autant qu’il est probable que l’assentiment du conjoint avec qui le lien matrimonial est distendu (mais pourtant maintenu !) soit difficile à obtenir.
Cela étant, s’il apparaît que ce refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, l’époux pourra s’appuyer sur les dispositions salvatrices de l’article 217 du Code civil pour tenter de se faire autoriser par le juge à accomplir seul un acte pour lequel le consentement du conjoint était pourtant requis [10]. Il en ira de même dans l’hypothèse où l’époux sera, pour toutes sortes de raisons, « hors d’état de manifester sa volonté » ; là encore, pour dépasser la difficulté, l’époux pourra solliciter l’autorisation ou l’habilitation du juge pour agir seul (C. civ., art. 217 et 219). Étant précisé que, depuis la réforme du 23 mars 2019, le juge saisi n’est plus le même : il s’agit du juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’intérêt de la famille (CPC, art. 1286 N° Lexbase : L0808IGZ) ; et du juge des contentieux de la protection, sur celui de l’époux hors d’état de manifester sa volonté (COJ, art. L. 213-4-2 N° Lexbase : L7247LP4 [11]).
Au-delà, l’arrêt souligne ici, comme ailleurs, l’importance pour le notaire d’entretenir un « réflexe matrimonial » [12]. Quel que soit le dossier qu’il est chargé d’instrumenter (vente, succession, société…), le notaire doit s’enquérir du régime matrimonial de ses clients et en tirer toutes les conséquences qui s’imposent [13]. La recommandation vaut aussi pour les partenaires [14] ou les concubins [15], qui méritent tous autant d’égards pour éviter les nombreux pièges patrimoniaux qui les guettent.
Lorsqu’il est appelé à recevoir un acte de prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers, le notaire doit désormais veiller à solliciter le consentement du conjoint ; sans cela, il engage comme ici sa responsabilité professionnelle.
[1] Cass. civ. 1, 5 mars 2020, n° 18-84.619, FS-D (N° Lexbase : A55763TP).
[2] Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-84.619, FS-P+B+I (N° Lexbase : A16713T3) : JCP G 2020, 1216, note J.-H. Robert ; Dr. famille 2020, comm. 149, obs. S. Torricelli-Chrifi ; Procédures 2020, comm. 208, obs. J. Buisson ; D. 2020, p. 2051, note N. Allix ; AJ fam. 2020, p. 602, obs. J. Casey ; AJ pénal 2020, p. 465, note A. Duval-Stalla et V. de Tonquédec ; RTD civ. 2021, p. 191, obs. M. Nicod ; Defrénois 2020, n° 49, p. 38, obs. G. Champenois ; ibid. 2021, n° 1-2, p. 32, note J. Laurent et G. Beaussonie ; Gaz. Pal., 10 nov. 2020, n° 39, p. 23, note J.-H. Robert ; LPA, 10 fév. 2021, n° 29, p. 13, obs. P.-L. Niel.
[3] Cass. civ. 1, 5 mai 2021, n° 19-15.072, FS-P (N° Lexbase : A96834QP) : D. actu., 17 mai 2021, M. Cottet.
[4] CA Aix-en-Provence, 19 février 2019, n° 17/05715 (N° Lexbase : A4354YXK).
[5] CA Aix-en-Provence, 15 septembre 1999 : Les cahiers du Cridon-Lyon, n° 28, p. 7, note B. Lagarde.
[6] V. not. M. Mathieu, JurisClasseur Notarial Formulaire, v° Vente d’immeuble, fasc. 240, spéc. n° 16.
[7] Déjà : Cass. civ. 1, 18 novembre. 1992, n° 91-10.473, publié au bulletin (N° Lexbase : A5655AHW) : JCP G 1993, I, 3656, n° 9, obs. A. Tisserand-Martin. V. les notes sous C. civ., art. 1415.
[8] V. récemment : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-27.411, P+B+I (N° Lexbase : A6480YSS) : JCP N 2019, n° 3, act. 165, obs. É. Simon-Michel ; ibid., n° 11, 1211, obs. M. Mekki ; Gaz. Pal. 22 janv. 2019, n° 34, p. 38, obs. C. Berlaud ; D. 2019. 1428, note Ph. Théry et Ch. Gijsbers; AJ fam. 2019. 219, obs. J. Casey ; RTD civ. 2019. 155, obs. P. Crocq – Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25.883, F-D (N° Lexbase : A1990NZQ) : JCP N 2016, n° 7-8, 1086, note Y. Dagorne-Labbé ; ibid., n° 19, 1155, note C. Corgas-Bernar ; AJDI 2015, p. 857, note J.-P. Borel.
[9] B. Barthelet, Acquisition par un époux en instance de divorce, Aperçu rapide n° 2170, LexisNexis, 2020.
[10] A. Tani, Faire seul, ce qui aurait dû être fait à deux, JCP N 2017, n° 22, 1194.
[11] Sur tout cela, v. V. Egéa, Dr. famille 2020, chron. 4, spéc. n° 2.
[12] B. Beignier, Choix du régime matrimonial : pas de click & collect, D. 2021, à paraître, sous Cass. civ. 1, 3 mars 2021, n° 19-16.065, F-D (N° Lexbase : A02064KT).
[13] V. une illustration récente dans une affaire où il n’avait pas suffisamment alerté ses clients sur la contradiction possible entre la détention de parts sociales et leur régime matrimonial : Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 18-25.115, F-D (N° Lexbase : A78193GP) : Dr. famille 2020, comm. 101, S. Torricelli-Chrifi ; JCP N 2020, n° 17, 1089, M. Storck ; ibid., n° 24, 1129, B. Beignier ; LEFP avr. 2020, n° 4, p. 6, N. Peterka ; RTD civ. 2020. 690, obs. B. Vareille).
[14] W. Baby (coord.), Les 20 ans du Pacs : LexisNexis, 2020 ; V. Martineau-Bourgnignaud (dir.), Le PACS, 20 ans après, Dalloz, 2020, coll. Thèmes & commentaires.
[15] S. Ben Hadj Yahia et G. Kessler (dir.), Le concubinage : entre droit en non-droit : LexisNexis, 2021.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477740
[Brèves] Produits défectueux : caractère récursoire (et non subrogatoire) de l’action de l’établissement de santé contre le producteur
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 mai 2021, n° 433822, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16364TR)
Lecture: 3 min
N7763BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 02 Juin 2021
► L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du Code civil, devenu son article 1245-6 (N° Lexbase : L0626KZ9) ; l'indemnisation versée à la victime par cet établissement public ne l'est donc pas en raison de ce que l'établissement serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; par suite, l'action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l'établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur ; elle constitue l'action propre, à caractère récursoire, dont dispose l'établissement de santé à l'encontre du producteur.
Les faits et procédure. À la suite d’une opération réalisée en 2009 au sein d’un centre hospitalier universitaire, une patiente a subi un accident médical résultant de la défaillance d’un dispositif dit « pantalon anti-G », livré à l’établissement de santé par la société D.. Ayant procédé à une indemnisation transactionnelle de la victime, l’assureur de l’établissement a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à ce que la société D. soit condamnée à lui rembourser le montant de la réparation versée à la patiente.
Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 17NT02106 N° Lexbase : A4180ZLE) ayant rejeté la demande de l’assureur, il a formé un pourvoi en cassation.
Rejet (mais cassation sur un autre point). Sur la demande tendant à la condamnation de la société D. au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, la Haute juridiction rejette le pourvoi et dit que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. Ainsi, en en déduisant que le délai de dix ans qui, en vertu de l'article 1386-16 du Code civil (N° Lexbase : L1509ABI), avait commencé à courir à compter de la livraison du produit en 2004, était expiré à la date d'introduction de l'action indemnitaire engagée par l’assureur devant le tribunal administratif en 2016 et que la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation par la patiente le 27 juin 2012, saisine qui n'avait en tout état de cause pas le caractère d'une action en justice, n'avait pu avoir pour effet d'interrompre ce délai, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit.
| Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La responsabilité civile sans faute des établissements de santé publics, La Directive, la jurisprudence et la loi du 4 mars 2002, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E15413TA) ; et la jurisprudence en ce sens CE, Section, 25 juillet 2013, n° 339922, Falempin, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1195KKH). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477763
[Textes] Quels enseignements tirer du BOSS ?
Lecture: 21 min
N7723BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Nelly Jean-Marie, Avocate associée et Léonore Marie, juriste, Avanty Avocats
Le 02 Juin 2021
Mots-clés : avantages en nature • Bulletin Officiel de la Sécurité sociale (BOSS) • cotisations sociales • déduction forfaitaire spécifique (DFS) • forfait-jours • frais d’entreprise • frais professionnels • justifications • administration • arrêté du 20 décembre 2002 • logement • protection sociale complémentaire • réduction tarifaire • télétravail • titres-restaurant • indemnité de rupture • rupture conventionnelle • transaction
Au-delà de l’acronyme bien choisi pour marquer les esprits, le « BOSS » (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) constitue une nouvelle source documentaire incontournable pour les professionnels des rémunérations, RH/paie, praticiens du droit et de l’ensemble des questions de charges sociales recouvrées par les URSSAF.
L’objectif de centralisation et d’actualisation des diverses positions administratives, jusqu’à présent éparses, est à l’évidence louable. Comme pour toute évolution qui se veut « à droit constant », une attention particulière doit néanmoins être portée sur les différences sensibles pouvant impliquer des changements de pratique, tantôt plus favorables, tantôt plus restrictifs. Chemin faisant, il ne faut pas perdre de vue que cette doctrine ne saurait bien évidemment remplacer le droit positif.
Sans exhaustivité, une sélection des principaux apports du BOSS est ici proposée au regard des thèmes couverts à date, en particulier concernant l’assiette des cotisations, les avantages en nature, les frais professionnels, et les indemnités de rupture.
Issu d’une ambitieuse collaboration entre la Direction de la Sécurité Sociale et l’URSSAF Caisse Nationale (anciennement ACOSS), le « Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale » (ci-après « BOSS ») a fait son entrée dans le paysage des sources juridiques en matière de cotisations et contributions sociales depuis le 8 mars dernier.
Au-delà du sigle qui ne manquera pas de marquer les esprits, cette nouveauté est une réelle avancée pour les professionnels des rémunérations, RH/paie, praticiens du droit et de l’ensemble des questions de charges sociales recouvrées par les URSSAF.
À l’instar du BOFIP bien connu en matière fiscale, le BOSS est destiné à regrouper l’ensemble de la doctrine administrative en matière de cotisations et contributions sociales sur un seul et même site internet : https://www.boss.gouv.fr.
Il faut saluer la démarche qui vise à clarifier et rendre plus accessibles les positions des autorités susvisées. À l’ère du tout numérique et de la « googlisation », l’empilement des diverses instructions, circulaires, lettres ACOSS, lettres DSS, questions-réponses – censées expliciter une législation déjà technique et souvent complexe – n’était guère satisfaisant et pouvait s’avérer contre-productif, en particulier sur le plan de la sécurité juridique. En effet, même s’il est vrai qu’elles présentaient le mérite d’exister et d’accorder certaines tolérances, ces publications éparses étaient parfois difficiles à identifier et à manier, soit en raison de leur ancienneté, les rendant obsolètes sur certains points, soit compte tenu de leur absence de valeur juridique.
L’un des principaux avantages du site est de garantir l’opposabilité juridique de son contenu. Cela peut sembler une évidence à l’aune de la loi pour un État au service d'une société de confiance (loi n° 2018-727 du 10 août 2008 N° Lexbase : L6744LLD ; ESSOC), mais il s’agit là d’une évolution très sensible lorsqu’on sait que bon nombre d’entreprises se sont encore vus rétorquées récemment lors de contentieux URSSAF que telle instruction ou lettre ACOSS (à laquelle elles avaient cru bon de se conformer !), ne leur offrait, finalement, aucune protection contre un redressement.
Autre intérêt majeur, l’ergonomie qu’offre le site devrait permettre des mises à jour plus régulières des positions administratives, qu’il s’agisse notamment de tirer les enseignements d’une jurisprudence ou d’une évolution législative, ou encore de fournir des exemples et éléments de réponse aux questions récurrentes soulevées en pratique.
À ce jour, la base est structurée autour des six thèmes suivants :
- l’assiette générale ;
- les allègements généraux ;
- les exonérations zonées ;
- les avantages en nature et frais professionnels ;
- les indemnités de rupture ;
- les mesures exceptionnelles.
D’autres thèmes sont en cours de rédaction, tels que la protection sociale complémentaire. Les acteurs intéressés devront donc prendre leur mal en patience avant de pouvoir accéder « prochainement » (sic) à la toute nouvelle doctrine actualisée sur ce sujet controversé.
À terme, l’objectif est d’aboutir à une information, unique, complète, accessible, lisible et sécurisée sur l’ensemble des problématiques de charges sociales recouvrées par les URSSAF, ce qui devrait faire du BOSS une référence incontournable en la matière.
Deux points d’attention méritent néanmoins d'être formulés dans l’immédiat :
- d’une part, même s'il est indiqué que le BOSS se substituera aux anciennes circulaires et instructions, et qu’il en reprend « très majoritairement » le contenu, le diable se cachant dans les détails, il faudra naturellement veiller aux différences sensibles impliquant des changements de pratique, dans un sens plus ou moins favorable ;
- d’autre part, les apports du BOSS devront être appréciés à leur juste valeur, ni plus ni moins. Il faut en effet garder à l’esprit que cette production doctrinale ne saurait remplacer le droit positif, en particulier si l’on en vient à identifier des positions plus contraignantes à l’égard des cotisants, leur imposant par exemple des conditions non prévues par la loi et les textes réglementaires en vigueur.
À cet égard, l’arrêté du 30 mars 2021, relatif à la mise à disposition des instructions et circulaires publiées au Bulletin officiel de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8930L37) formalise la volonté de l’administration de doter ces positions d’un caractère opposable à l’égard de l’URSSAF. Mais l’inverse n’est pas vrai : l’URSSAF ne peut se prévaloir de cette opposabilité à l’encontre des cotisants. En ce sens, l’arrêté prévoit que :
- la publication des circulaires et instructions sur le site internet du BOSS [1] conduit à ce que toute personne puisse se prévaloir de leur contenu ;
- cette opposabilité est effective, en principe, depuis le 1er avril 2021 ; sauf pour les aménagements prévus expressément au sein du BOSS.
Ces mesures sont complétées par un arrêté du 31 mars 2021 selon lequel :
- les circulaires et instructions opposables avant l’entrée en vigueur du BOSS le restent jusqu'à la publication des commentaires de l'administration ayant le même objet au sein de ce bulletin ;
- le BOSS doit indiquer les circulaires abrogées lors des mises à jour ; cette information figure dans les communiquées postés au sein de la rubrique « actualités ».
Sans exhaustivité, une sélection des principaux apports du BOSS est proposée ci-après concernant l’assiette des cotisations (I), les avantages en nature (II), les frais professionnels (III), et les indemnités de rupture (IV).
I. Assiette des cotisations
A. Cas des suspensions de contrat non rémunérées
Pour rappel, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues [2].
Cependant, la doctrine administrative admet des exceptions dans le cas :
- d’une suspension du contrat de travail non rémunérée ;
- d’une erreur de paie.
♦ Suspension du contrat de travail non rémunérée. L’administration considérait initialement [3] que les règles d’assiette, de taux et de plafonnement des cotisations sociales applicables en cas de suspension du contrat de travail non rémunérée étaient celles :
- soit, de la dernière période de travail, dès lors que celle-ci intervient la même année civile que celle au cours de laquelle les éléments de rémunération sont versés ;
- soit, en vigueur au moment du versement de cet élément de rémunération dès lors que la dernière période travaillée intervient sur une année civile différente de celle du versement.
La position du BOSS [4] marque une évolution par rapport à la doctrine antérieure. Elle prévoit désormais d’appliquer les règles en vigueur au moment du versement des éléments de rémunération en cause.
Il est indiqué que cette évolution sera applicable à compter du 1er janvier 2022. Toutefois l’opposabilité à l’URSSAF est effective au 1er avril 2021 pour tout employeur choisissant d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021.
♦ Erreur de paie. S’agissant des corrections des erreurs de paie, le BOSS considère désormais de manière générale que les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sont celles en vigueur lors de la période d’emploi, peu important qu’un nouveau bulletin de salaire soit émis ou non [5].
Cette évolution sera effective au 1er janvier 2022. Toutefois l’opposabilité à l’URSSAF est effective au 1er avril 2021 pour tout employeur choisissant d’appliquer ces règles pour les éléments de rémunération dus au titre des périodes d’activité effectuées à compter du 1er janvier 2018.
B. Forfait-jours réduit
La Cour de cassation [6] et l’ACOSS [7] refusaient de considérer les salariés en forfait-joursdont la durée du travail était inférieure à 218 jours comme des salariés à temps partiel. En conséquence, elles ont écarté l'application des règles d'abattement d'assiette aux salariés en forfait jour réduit.
Le BOSS [8] change radicalement de position, et permet l’application d’un abattement aux salariés en forfait-joursréduit, selon la formule de calcul suivante :
Cet assouplissement est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021.
C. Contributions patronales finançant un régime de protection sociale complémentaire
L’article D. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6540LRN) prévoit que les contributions des employeurs au financement d’opération de retraite supplémentaire sont exclues pour la fraction n’excédant pas le montant le plus élevé entre 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (ci-après « PASS ») et 5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale dans la limite de cinq PASS.
Par ailleurs, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues, dans la limite de 12 % du PASS, pour la fraction n’excédant pas le montant égal à la somme de 6 % du PASS et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale.
L’administration prévoyait la réduction de ce plafond de la Sécurité sociale pour :
- la période d’absence non rémunérée ;
- les salariés à employeurs multiples dont les cotisations sont assises sur un plafond proratisé ;
- le temps partiel.
Le BOSS [9] simplifie la règle et indique qu’il n’est plus nécessaire d’opérer un tel prorata pour calculer l’exclusion d’assiette des cotisations applicable au financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire.
II. Avantages en nature
A. Titres-restaurant
L’article L. 136-1-1, III, 4, a) du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1757LZ4) prévoit que la prise en charge de l’employeur des titres-restaurant dans la limite de 5,55 euros au 1er janvier 2021 [10], et dont la participation est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre est exonérée de cotisations de Sécurité sociale.
- Sanction en cas de non-respect des limites d’exonération. Lorsque ces règles d’exonération n’étaient pas respectées, l’administration [11] prévoyait que la totalité de la participation de l’employeur était réintégrée dans l’assiette de cotisations.
De façon plus modérée, le BOSS [12] prévoit à présent que seule la fraction indûment exonérée réintègre l’assiette des cotisations, sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés de l’employeur.
- Cas particulier du télétravail. Le site de l’URSSAF indiquait jusqu’alors que si les salariés bénéficiaient des titres-restaurant, il devait en être de même pour les salariés en télétravail. Le BOSS [13] a toutefois nuancé cette position en indiquant qu’il est possible (et non obligatoire) de mettre en place des titres-restaurant pour les télétravailleurs si les autres salariés en bénéficient.
Dans ce cas, les cotisations bénéficient des mêmes exonérations, sous les mêmes conditions, que pour les autres travailleurs.
Cette position moins affirmative fait écho au débat judiciaire actuel [14] sur l’existence ou non d’une obligation de fournir des titres-restaurant aux salariés en télétravail.
B. Produits et services réalisés ou vendus par l’entreprise
De longue date, l’administration tolère [15] l’exonération de l’avantage en nature résultant de la fourniture aux salariés, de produits et services réalisés ou vendus par l’entreprise, dans la limite d’une réduction tarifaire de 30 % du prix de vente public normal toutes taxes comprises. Dès lors que la remise dépasse les 30 % du prix de vente, la totalité de l’avantage en nature est réintégrée dans l’assiette de cotisations.
Cette tolérance a été reprise en substance par le BOSS.
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (N° Lexbase : L8806LUP) a introduit une mesure d’exonération à compter du 1er janvier 2021 sur les réductions tarifaires de 50 % du prix public normal toutes taxes comprises, accordées aux salariés du groupe sur les « produits initialement destinés à la vente, qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus » [16].
Le BOSS [17] donne une définition de la notion d’« invendu », et indique qu’il est fait référence « à la fin de mise à disposition du produit sur le marché ». Il exclut toutefois les produits dont la fin de mise à disposition a été ordonnée par une autorité publique. Par ailleurs, on relèvera que sont abordés uniquement les produits non alimentaires, alors même que le Code de la Sécurité sociale n’opère pas de distinction particulière selon le caractère alimentaire ou non du produit.
III. Frais professionnels
A. Remboursement au réel
L’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que ne constituent pas un revenu d'activité, et donc n’entrent pas dans l’assiette de cotisations, les remboursements de frais professionnels effectués dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 (N° Lexbase : O1942A9S).
Ces remboursements peuvent être effectués soit sur les bases forfaitaires prévues par la réglementation, soit sur la base des dépenses réelles.
Dans cette seconde hypothèse, l’administration [18] exigeait que l’employeur soit en mesure d’apporter la preuve de la contrainte pour le salarié d’engager des frais supplémentaires et de fournir des justificatifs en cas de contrôle URSSAF.
Le BOSS renforce cette exigence [19]. L’employeur doit désormais :
- présenter des justifications suffisamment précises pour établir la réalité et le montant de la dépense ;
- démontrer que ces frais sont exposés dans l’intérêt de l’entreprise ;
- et démontrer qu’ils ne présentent pas un niveau exagéré.
Si les deux premières conditions s’entendent assez logiquement, la notion de « niveau exagéré » laisse en revanche place à une certaine subjectivité qui pourrait occasionner quelques divergences d’appréciation.
B. Télétravail
Par principe, l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002 fixant les modalités d’évaluation des frais professionnels, prévoit qu’il existe trois types de frais en cas de télétravail dont l’évaluation doit être réalisée au réel :
- frais de mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel ;
- frais d’adaptation d’un local spécifique ;
- frais d’utilisation du matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
Par tolérance, l’administration avait inscrit sur le site de l’URSSAF qu’à compter du 1er janvier 2020, l’employeur pouvait réaliser une évaluation forfaitaire de ces frais dont l’évolution du montant varie en fonction du nombre de jours télétravaillés par semaine (exemple : 1 jour/semaine : 10 euros, 3 jours/semaine : 30 euros, etc.). Le site de l’URSSAF avait aussi indiqué qu’une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou encore un accord de groupe pouvait majorer ce barème.
Le BOSS [20] reprend cette tolérance d’évaluation forfaitaire, et lui donne un caractère opposable. Si l’allocation est fixée par jour, elle est exonérée à hauteur de 2,50 euros par jour dans la limite de 55 euros par mois.
Toutefois n’est pas reprise la possibilité de majorer le barème par voie conventionnelle.
C. Frais d’entreprise
Les frais d’entreprise constituaient une catégorie de frais sui generis prévue uniquement par voie de circulaire administrative [21]. Relevaient de cette qualification les dépenses :
- couvrant des frais relevant de l’activité de l’entreprise ;
- présentant un caractère exceptionnel ;
- réalisées dans l’intérêt de l’entreprise ;
- et réalisées en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Ces sommes étaient justifiées par :
- l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
- la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
- le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Contrairement à l’ancienne circulaire du 7 janvier 2003, le BOSS ne prévoit aucune fiche thématique consacrée spécifiquement aux frais d’entreprise. Il faut désormais se référer aux diverses précisions insérées dans les développements consacrés aux frais professionnels.
- Réception, cocktails, etc. Les dépenses engagées par le salarié dans le cadre de sa participation à la demande de son employeur à titre exceptionnel à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.), alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas, constituent des frais professionnels pouvant faire l’objet d’un remboursement.
Le BOSS [22] indique, que l’employeur doit avoir la capacité de :
- fournir les factures justifiant les dépenses ;
- prouver que les dépenses ont bien été engagées à sa demande et dans l'intérêt de l'entreprise.
- Voyages d’affaires, voyages de stimulation et séminaires. Les dépenses engagées par le salarié dans le cadre des voyages d’affaires, des voyages de stimulation et des séminaires peuvent être exonérées de cotisations. L’événement en cause doit être suffisamment organisé, c’est-à-dire comprendre notamment un programme de travail et des sujétions particulières pour le salarié (alors même que sa participation ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession).
Le BOSS [23] précise les conditions d’exonération et indique que l’employeur doit être en mesure de produire le programme de travail et les justificatifs de frais exposés individuellement par les salariés.
Il indique également, contrairement à la circulaire de 2003, que si le caractère professionnel est prépondérant, aucun avantage en nature n’est retenu, même pour la fraction correspondant à l’agrément.
Toutefois, ces frais ne sont pas exonérés lorsque le salarié travaille moins de la moitié du temps passé sur place ou si ce voyage est ouvert aux conjoints des salariés même contre une participation financière minime.
- Repas d’affaires. Les dépenses engagées par le salarié à l’occasion des repas d’affaires et dûment justifiées constituent des frais professionnels, sauf en cas d'abus manifeste [24].
Ces repas d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel (c’est-à-dire un caractère irrégulier et limité) et comporter pour le salarié des frais exposés en dehors de l’exercice normal de son activité, dans l’intérêt de l’entreprise.
Pour bénéficier de l'exclusion de l’assiette des contributions et cotisations, l’employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, la qualité des personnes y ayant participé et le montant de la dépense effectivement supportée par le salarié.
En revanche, le BOSS ne reprend pas la présomption d’absence d’abus manifeste qui pouvait être accordée en cas de limitation du nombre de repas par semaine ou par mois, telle que prévue dans la circulaire de 2005 [25].
D. Déduction forfaitaire spécifique
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que les professions listées à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, comportant des frais dont le montant est notoirement supérieur aux frais professionnels prévus dans ce même arrêté, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est plafonnée à 7 600 euros par salarié et par année civile.
Selon le texte et l’administration [26], les seules conditions requises pour bénéficier de la DFS étaient :
- d’être un professionnel listé à l’article 5 de l’annexe IV du CGI ;
- que ce bénéfice soit expressément prévu par une convention ou un accord collectif, ou à défaut par l’autorisation du salarié.
La jurisprudence a néanmoins considéré que :
« La seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du CGI ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique mais que le chauffeur concerné doit être amené à exposer des frais […] du fait de son activité » [27].
Le BOSS semble vouloir généraliser cette solution jurisprudentielle et prévoit que les salariés doivent :
- effectivement supporter des frais professionnels (justificatifs nécessaires, sans préciser lesquels). Cette mesure entre en vigueur au 1er avril 2021 ;
- en l’absence de convention ou accord collectif, donner leur consentement pour appliquer la DFS, chaque année (alors même qu’aucun texte n’exigeait une telle récurrence jusqu’à présent). Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2022 [28].
Pour ces deux modifications, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2021, l’URSSAF réalisera uniquement des observations pour l’avenir.
Enfin, le BOSS revient sur les règles de cumul entre la DFS et les indemnités versées par ailleurs au titre de remboursements de frais professionnels (principe de non-cumul, liste de frais pouvant exceptionnellement être cumulés).
IV. Indemnités de rupture
La détermination du régime social des indemnités de rupture implique de respecter une certaine méthodologie, ce dernier étant toujours conditionné au régime fiscal.
Le BOSS rappelle les principes applicables en la matière en y consacrant de nombreux développements, révélant ainsi la complexité et la variété des hypothèses rencontrées. À titre d’illustrations, on retiendra ci-après deux points, l’un traduisant une évolution favorable, l’autre une restriction contestable.
A. Indemnité de rupture conventionnelle individuelle
Les indemnités de rupture conventionnelle individuelle sont exclues d’impôt sur le revenu, de cotisations de Sécurité sociale et de CSG-CRDS si le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Contrairement aux anciennes positions générant un contentieux récurrent sur le sujet [29], le BOSS prévoit que :
- d’une part, la condition du bénéfice d’une pension de retraite d’un régime légal obligatoire, s’apprécie au regard du régime de base dont relève l'intéressé au titre de l'emploi occupé au moment de la rupture conventionnelle ;
- d’autre part, pour prouver l’absence du droit de bénéficier d’une pension de retraite, l’employeur peut fournir tout document relatif à la situation du salarié sans qu’il s’agisse nécessairement de l’attestation CARSAT [30]. Le BOSS invite désormais les URSSAF à accepter les documents produits dès lors qu’ils permettent de donner « l’assurance raisonnable » que le salarié n’est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
B. Indemnités transactionnelles
Sans revenir dans le détail des jurisprudences rendues à ce sujet, il est admis de longue date par l’administration que l’indemnité transactionnelle suit le régime social de l’indemnité qu’elle vient compléter.
Sont donc exclues de cotisations les indemnités transactionnelles qui complètent les indemnités exonérées de cotisations listées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L6155LUI ; ex : indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle, etc.), dans la limite des plafonds applicables (en pratique, 2 PASS).
Dès lors qu’une indemnité n’est pas visée par l’article 80 duodecies (ex : démission, départ à la retraite), elle doit en théorie être réintégrée à l’assiette de cotisations, sauf si cette somme indemnise un « préjudice distinct ». L’indemnité réparant le préjudice distinct ne doit pas indemniser une perte de salaire (ex : préjudice moral).
Etonnamment, le BOSS prévoit qu’une décision de justice doit constater la réalité de ce préjudice pour que l’indemnité y afférente ne soit pas assujettie. Cette exigence revient à vider de sa substance l’intérêt de la jurisprudence puisque le principe même de la transaction est d’éviter tout contentieux judiciaire.
[2] CSS, art. L. 136-1 (N° Lexbase : L0432LCY), L. 242-1 (N° Lexbase : L4986LR4) et R. 242-1 (N° Lexbase : L3579LMI).
[3] Circ. DSS, n° 2017/351, du 19 décembre 2017, relative au calcul du plafond de la Sécurité sociale et au fait générateur des cotisations et contributions de Sécurité sociale (N° Lexbase : L7392LHA), question n° 16.
[6] Cass. QPC, 11 juillet 2013, n° 13-40.025, F-D (N° Lexbase : A2856KKY).
[7] Circ. Acoss, n° 2004-136, du 8 octobre 2004.
[10] Montant déterminé à l’article 81, 19° du Code général des impôts (N° Lexbase : L6949LZE).
[11] Circ. DSS, n° 2003/07, du 7 janvier 2003, relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 (N° Lexbase : L0419A9E).
[14] TJ Paris, social, 30 mars 2021, n° 20/09805 (N° Lexbase : A79364MU) : juge que les salariés en télétravail doivent bénéficier des titres-restaurants, et a ordonné la régularisation en numéraire au profit des salariés qui en avaient été privés.
TJ Nanterre, Social, 10 mars 2021, n° 20/09616 (N° Lexbase : A57134KS) : juge qu’un employeur qui attribue des titres-restaurant à ses salariés peut cesser d’en faire bénéficier les télétravailleurs.
[15] Circ. DSS, n° 2003/07, du 7 janvier 2003, préc., et Circ. DSS, n° 2005/389, du 19 août 2005, relative à la publication des quatre questions - réponses relatifs la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés (N° Lexbase : L8139HB3), II, E, Q° 93.
[16] CSS, art. L. 136-1-1, III, 8°.
[18] Circ. DSS, n° 2003/07, du 7 janvier 2003, préc..
[21] Circ. DSS, n° 2003/07, du 7 janvier 2003, préc..
[25] Ces limitations correspondaient à un repas d’affaire par semaine, ou cinq repas d’affaires par mois (Circ. DSS 7 janvier 2003 et Circ. DSS, 19 août 2005, II, E, Q. 22 et 102).
[26] Circ. DSS, n° 2003/07, du 7 janvier 2003 et Circ. DSS, n° 2005/389, du 19 août 2005, Q. 84.
[27] Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 11-27.032, F-D (N° Lexbase : A0468I8T) ; Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-10.782, F-D (N° Lexbase : A7205S9Q).
[28] BOSS, Frais professionnels, chap. 9, n° 2120, 2130 [en ligne], 2180, 2190, 2200, 2210 et 2215 [en ligne].
[29] Circ. DSS, n° 2009/210, du 10 juillet 2009, relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l'issue d'un contrat à durée déterminée à objet défini, et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail (N° Lexbase : L4668IEM).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477723
[Brèves] Responsabilité du gérant de société civile : le quitus donné par l’assemblée des associés n’a pas d’effet libératoire
Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2021, n° 19-16.716, FS-P (N° Lexbase : A47174TU)
Lecture: 3 min
N7727BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 14 Juin 2021
► En application de l’article 1843-5, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2019ABE), aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat, de sorte que le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire au profit de l’ancien gérant pour les fautes commises dans sa gestion.
Faits et procédure. Invoquant des fautes commises dans sa gestion, une SCI a assigné son ancien gérant en réparation de ses préjudices. Ce dernier ayant été condamné à verser des dommages-intérêt à la SCI, il a formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Selon le demandeur au pourvoi, ne constitue pas une faute l'acte du gérant dont l'assemblée lui a donné quitus en pleine connaissance de cet acte et des circonstances l'entourant. Ainsi, en retenant sa responsabilité pour faute pour un acte ratifié par l'assemblée de la société, sans rechercher si l'assemblée, n'avait pas, en connaissance de l'acte et des circonstances l'entourant, valablement ratifié l'acte de son gérant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1843-5, 1850 (N° Lexbase : L2047ABG) et 1998 (N° Lexbase : L2221ABU) du Code civil.
Décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.
Observations. La Cour de cassation applique, ici, assez classiquement l’article 1843-5, alinéa 3, du Code civil, dont elle rappelle la teneur. Cette règle, qui concerne les sociétés civiles, est également prévue par le Code de commerce pour les sociétés commerciales (C. com., art. L. 223-22, al. 5 N° Lexbase : L5847AIE, pour les SARL ; sur renvoi de C. com., art. L. 225-253, al. 2 N° Lexbase : L6124AIN, pour les SA à conseil d’administration, et, sur renvoi de C. com., art. L. 225-256, al. 1er N° Lexbase : L2094LY9 et L. 225-257, al. 2 N° Lexbase : L6128AIS pour les SA à directoire et conseil de surveillance ; sur renvoi de C. com., art. L. 226-1, al. 2 N° Lexbase : L2092LY7, pour les SCA ; sur renvoi de C. com., art. L. 227-8 N° Lexbase : L6163AI4, pour les SAS). La solution retenue par l’arrêt rendu le 27 mai 2021 concerne donc outre les sociétés civiles, les SARL, SA, SCA et SAS.
Cette règle est très rarement appliquée par les tribunaux. On relèvera, toutefois, un arrêt de 2016 dans lequel une SA faisait valoir, pour échapper à sa responsabilité, qu’une cession de fonds de commerce litigieuse avait été autorisée par une assemblée générale. Or, comme le rappelle la Chambre commerciale, aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général d'une société anonyme pour faute commise dans l'accomplissement de son mandat et le dirigeant, qui avait préparé le projet de cession du fonds soumis à l'assemblée générale, avait agi avec une légèreté blâmable envers la société en acceptant un prix très inférieur à sa valeur, sans justifier de la recherche d'un acquéreur à un meilleur prix, ni de la méthode de détermination de ce prix (cf. Cass. com., 8 mars 2016 n° 14-16.621, F-D N° Lexbase : A1752Q7Z).
En outre, la doctrine considère, également, quasi unanimement, que le vote du quitus, ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants (v. not. D. Gibirila, Brèves remarques sur la responsabilité civile des dirigeants sociaux, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 658 N° Lexbase : N5635BYD).
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La gérance de la société civile, L'action en responsabilité civile du gérant de société civile, in Droit des sociétés, (dir. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E9200CD4). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477727
[Brèves] Il n'y aura pas de juridiction unique nationale des injonctions de payer (JUNIP) !
Réf. : AN, projet de loi, TA n° 612, 25 mai 2021 ; AN, projet de loi organique, TA n° 613, 25 mai 2021
Lecture: 1 min
N7713BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 02 Juin 2021
► Le 25 mai 2021, les députés ont adopté les projets de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire » ; ils ont notamment abrogé les dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), prévoyant le traitement dématérialisé des requêtes en injonction de payer devant un tribunal judiciaire unique à compétence nationale spécialement désigné par décret.
Rappel : la loi « Belloulet » avait comme objectif de simplifier et de dématérialiser un certain nombre de procédures, dans le but d’accroître leur célérité. C’est dans ce contexte qu’il avait été envisagé la création d’une juridiction unique à compétence nationale « JUNIP », en charge du traitement dématérialisé des procédures d’injonction de payer, à l’exception de celles relevant du tribunal de commerce, et des procédures européennes.
L’entrée en vigueur avait été initialement fixée au 1er janvier 2021, puis reportée au 1er septembre 2021 par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (N° Lexbase : L4230LXX). Le projet de loi précité prévoyait un report de l’installation de la JUNIP au 1er septembre 2023.
Finalement, son abrogation a été adoptée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477713