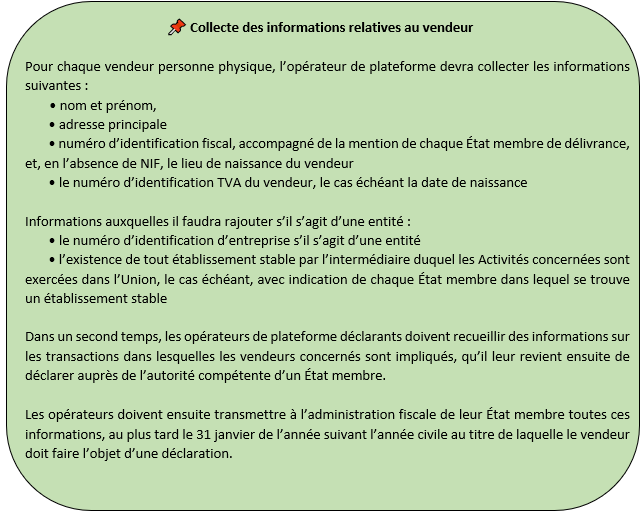[Brèves] Accident du travail chez un particulier employeur : la faute inexcusable peut être reconnue !
Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 20-11.935, FS-P (N° Lexbase : A65554N4)
Lecture: 3 min
N7152BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 14 Avril 2021
► Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l’employé de maison a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les faits et procédure. Une salariée, employée en qualité d’employée de maison a fait, le 13 août 2014, une chute d’un balcon lui occasionnant de graves blessures que la caisse a prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la procédure de conciliation, la victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable
Pourvoi de l’employeur. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que l’accident du travail dont a été victime la salariée a pour cause sa faute inexcusable. Selon lui, la faute inexcusable prévue par l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale est une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l’absence de toute autre cause justificative. Ainsi, pour retenir la faute inexcusable, par des motifs qui ne caractérisent aucun acte ou omission volontaire, d’une exceptionnelle gravité, à l’origine de l’accident du travail dont l’employée a été victime, la cour d’appel n’aurait pas donné de base légale à sa décision.
La définition de la faute inexcusable appliquée au particulier employeur
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, les juges du fond ont pu relever que :
- les constatations effectuées par les services de police immédiatement après les faits ont permis d’établir que le balcon est une avancée en bois en mauvais état, que les morceaux de bois jonchent le sol, le bois étant en piteux état et qu’il se peut que la victime se soit appuyée sur la rambarde qui a cédé ;
- l’employeur, propriétaire de la résidence, ne pouvait pas ignorer l’état de la rambarde qui n’a pu se détériorer en quelques mois, mais dont la vétusté est certaine.
Elle a pu donc en déduire que l’employeur était conscient du danger ou qu’il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères. Il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour condamner l’accès à ce balcon ou en en interdisant l’accès à l’employée ou en la mettant en garde sur la dangerosité du lieu.
|
À retenir : la Cour de cassation hisse le particulier employeur au même rang que l’employeur professionnel et adopte le même critère d’appréciation de la faute inexcusable. Une définition commune de la faute inexcusable est retenue : le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu à l’égard de l’employé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477152
[Questions/Réponses] Accident survenu sur le lieu de télétravail : quelles sont les règles ?
Lecture: 11 min
N7214BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Bougenaux, Avocat au Barreau de Lyon, Cabinet Fayan-Roux-Bontoux et associés
Le 14 Avril 2021
- Quelle est la définition du télétravail ?
Le télétravail est régi par les articles L. 1222-9 (N° Lexbase : L0292LMR) à L. 1222-11 du Code du travail ainsi que par l'Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail (N° Lexbase : L0119KIA).
Définition du télétravail : le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravailleur est, quant à lui, défini comme « toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail. »
Le télétravail vise donc des tâches qui auraient pu être exécutées dans les locaux de l'entreprise. Sont donc exclus de cette définition, les salariés dits nomades (commerciaux par exemple)
Le télétravail peut s’exercer dans différents lieux :
- au domicile du salarié ;
- en centre de coworking ou ailleurs.
La fréquence du télétravail peut varier, et peut aussi bien constituer un mode d’organisation habituel ou n’être qu’occasionnel.
- Quelle est l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre du télétravail ?
L’employeur demeure tenu d’une obligation de sécurité légale envers le télétravailleur, comme envers tout autre salarié :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8043LGY)
Au titre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit s'assurer, par exemple, de la conformité du domicile du salarié à l'exercice du télétravail, notamment ses installations électriques.
Cela est néanmoins difficile si le lieu du télétravail n'est pas fixé précisément et en raison du respect de la vie privée du salarié.
En pratique, les entreprises ont le plus souvent recours à une simple attestation de conformité remplie par le salarié.
Le télétravail peut aussi être une source d'isolement du travailleur et donc de risques psycho-sociaux.
Il convient donc de mettre en place des outils de vigilance sur le sujet, tels que, par exemple, l'entretien annuel spécifique au télétravail.
Au titre de l’obligation de sécurité, le salarié victime d’un accident sur le lieu du télétravail pourrait rechercher la faute inexcusable de son employeur.
Cette obligation de sécurité doit être considérée lors de la mise en place du télétravail dans le cadre :
- de l’accord collectif ;
- ou de la charte.
En l’absence d’accord collectif ou de charte, il peut être mis en place directement entre l’employeur et le salarié :
« Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. »
Article L. 1222-9 du Code du travail
Il est conseillé de formaliser la mise en place du télétravail par accord collectif ou charte ou par un écrit avec le salarié.
Cela permet d’évoquer les conditions du télétravail.
Également en cas de circonstances exceptionnelles (telles que pandémie…), le télétravail peut être imposé par l’employeur :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »
Article L. 1222-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8103LG9)
Les écrits permettent d’encadrer la mise en place du télétravail et doit servir d’occasion pour prévenir les risques liés au télétravail.
- Quel est le cadre légal de l’accident survenu sur le lieu du télétravail ?
Un tel mode d’organisation ne limite pas les accidents du travail.
Un salarié victime d’un accident au temps de travail et sur les lieux de télétravail doit-il être considéré comme victime d’un accident du travail ?
Il convient en premier lieu de revenir à la notion d’accident du travail telle que définie par le Code de la Sécurité sociale :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD)
L’accident du travail est donc constitué :
- d’un fait accidentel ;
- ayant entrainé une lésion ;
- sur le lieu de travail ;
- au temps de travail.
Le Code du travail prévoit, quant à lui, expressément le cas de l’accident survenu pendant une période de télétravail à l’article L. 1222-9 :
« L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. »
Deux points pour que le salarié bénéficie de la présomption d’accident du travail en situation de télétravail :
- un accident survenu sur le lieu de réalisation du télétravail ;
- un accident survenu pendant l’exercice de l’activité professionnelle.
La notion de temps de travail, évoquée à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale n’est pas retenue pour que le salarié bénéficie de la présomption d’accident de travail pour l’accident survenu durant le télétravail.
Ainsi les quatre éléments de l’accident de télétravail sont les suivants :
- un accident ;
- ayant entrainé une lésion ;
- sur le lieu du télétravail ;
- pendant l’exercice de l’activité professionnelle.
Ce n’est donc pas parce que le salarié se situe dans le temps de travail qu’il doit être considéré comme exerçant son activité professionnelle et donc bénéficier de la présomption d’accident du travail.
Cela est lié à la plus grande porosité entre la vie professionnelle et la vie privée dans le cadre de l’exercice du travail en situation de télétravail.
Le salarié doit alors indiquer que l’accident est survenu pendant l’exercice de l’activité professionnelle.
- Comment réagir face à un accident survenu sur un lieu de télétravail ?
Les situations d’accident à l’occasion du télétravail peuvent conduire à des confusions.
En effet, l’accident survenu dans ce cadre se déroule généralement sans témoin et donne lieu à des situations pour le moins ambiguës :
- que faire en effet face à un salarié qui s’est ébouillanté avec son thé ?
- que faire avec un salarié tombé dans les escaliers ?
Il convient alors de rappeler que l’employeur n’a pas à être juge de la réalité de l’accident du travail.
S’il est informé de la survenance d’un accident ou si le salarié prétend avoir été victime d’un accident du travail, l’employeur doit établir une déclaration d’accident du travail dans les 48 heures :
« La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 (N° Lexbase : L5285AD4) doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. »
Article R. 441-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0580LQK)
À défaut, la CPAM peut demander à l’employeur le remboursement de la totalité des dépenses occasionnées par l’accident (CSS, art. L. 471-1 N° Lexbase : L0610LCL). L’employeur s’expose également à des pénalités financières.
La seule possibilité pour l’employeur de contester est d’assortir la déclaration d’accident du travail de réserves motivées, afin d’imposer à la CPAM de diligenter une instruction contradictoire et d’éviter une notification de prise en charge d’emblée.
- Faut-il établir une lettre de réserve ?
En cas de doute sur la réalité d’un accident du travail, il est nécessaire d’assortir la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves.
Ce courrier peut être adressé en même temps que la déclaration d’accident du travail ou dans un délai de 10 jours à compter de la déclaration du travail (et non de la date de l’accident) :
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
Article R. 441-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0570LQ8)
Pour être considéré comme motivée, il convient de remettre en question la réalité de l’accident du travail.
À titre d’exemple, la responsabilité du salarié dans la survenance de l’accident ne permet pas de remettre en cause la réalité d’un accident.
La lettre de réserves peut être adressée en même temps que la déclaration d’accident du travail ou dans un délai de 10 jours par lettre recommandé avec accusé de réception afin de conserver la preuve de la réception de ladite lettre par la CPAM.
- Comment prévenir les accidents survenus au lieu du télétravail ?
La phase de mise en place du télétravail est déterminante pour limiter les accidents.
En cas de mise en place par accord collectif, il est nécessaire de préciser :
- les conditions de passage en télétravail ;
- les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
- les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
- la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
- les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail.
| D’une manière générale il est conseillé de mettre en place le télétravail par accord collectif ou charte et d’être vigilant sur les points suivants :
Il est nécessaire de mettre à jour du document unique d’évaluation des risques afin de tenir compte des risques spécifiques liés à l’exercice du travail en situation de télétravail. Attention aux assurances de la société : vérifier qu’elles couvrent les risques liés au télétravail. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477214
[Brèves] « Demander justice » : la condamnation de la société à payer 500 000 euros d'astreinte au CNB confirmée en appel
Réf. : CA Paris, 8 avril 2021, n° 20/02866 (N° Lexbase : A87734NA)
Lecture: 3 min
N7218BYY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 14 Avril 2021
► La cour d’appel de Paris confirme la condamnation de la société « Demander Justice » à payer 500 000 euros d'astreinte au CNB (Conseil national des barreaux) dans une décision du 8 avril 2021.
Procédure. La société « Demander justice » exploite des sites Internet mettant à la disposition de clients des formulaires types de mise en demeure et permettant de saisir sans avocat certaines juridictions devant lesquelles la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Par un arrêt du 6 novembre 2018, la cour d'appel de Paris avait condamné sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard la société à faire disparaitre de son site dans le mois de la signification de cet arrêt les mentions relatives aux taux de réussite, sauf à en mentionner précisément les modalités de calcul et lui avait fait interdiction d'utiliser ensemble les trois couleurs de drapeau français, un mois après la signification de cette décision et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, donc sans limitation de délai. Le CNB avait fait assigner la société devant le juge de l'exécution (JEX) du tribunal de grande instance de Paris afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 1 380 000 euros et pour obtenir la fixation d'une nouvelle astreinte. Par jugement du 29 janvier 2020 (TJ Paris, 29 janvier 2020, n° 19/82171 N° Lexbase : A75333EQ ; lire M. Le Guerroué, Lexbase Avocats, mars 2020 N° Lexbase : N2242BYP), le JEX a effectivement condamné la société à payer la somme de 500 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période 14 mars au 6 novembre 2019 et a dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte. La société demande l’infirmation de cette décision.
- Sur l'injonction interdisant d'utiliser ensemble les trois couleurs de drapeau français
La cour d'appel de Paris retient que l'examen des différentes photographies communiquées ne permet pas de différencier sur un écran de consultation le gris très clair de la couleur blanche, de sorte que c'est avec exactitude que le premier juge a retenu que le risque de confusion, à l'œil nu, avec les couleurs du drapeau français, objet de l'injonction prononcée par l'arrêt du 6 novembre 2018 avait persisté.
- Sur l'injonction relative au taux de réussite
La cour adopte également les motifs du premier juge sur ce point lequel, pour dire que l'injonction de supprimer l'annonce d'un taux de succès à 82 % ou d'insérer les modalités de son calcul sur le site au plus tard le 13 mars 2019 n'avait pas été respectée, a relevé que le constat du 5 août 2019 mentionnait qu'en cliquant sur la mention « 82 % des plaignants ont obtenu gain de cause depuis 2012 », l'accès à cette information était rendu particulièrement aléatoire puisque le curseur, généralement constitué d'une flèche ou d'une main donnant accès à un lien hypertexte, se transformait en l'espèce, lorsqu'il était positionné sur la phrase en question en une simple barre verticale assortie de deux petits traits horizontaux, ce qui donnait à penser à l'internaute qu'aucune information n'est accessible par ce biais. La succession de plusieurs manipulations pour accéder ce mode de calcul démontre que l'injonction n’a pas été respectée.
La cour d’appel confirme le jugement litigieux et condamne la société à payer au Conseil national des barreaux la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0421ITR).
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Les sanctions pour contravention au monopole judiciaire de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E36323RX). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477218
[Brèves] Précisions sur le contenu de l’offre de crédit à la consommation
Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-25.236, FS-P (N° Lexbase : A12244PZ)
Lecture: 5 min
N7196BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jérôme Lasserre Capdeville
Le 14 Avril 2021
► Le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
Selon l’article R. 312-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9730LBY), l’encadré placé au début de l’offre doit, notamment, mentionner « le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ». Or, une incertitude s’est rencontrée sur le calcul du montant en question.
Pour un certain nombre d’arrêts, cette mention devait concerner la somme totale devant être effectivement réglée et ainsi comprendre la prime d’assurance facultative lorsque l’emprunteur en avait souscrite une (v. par ex., CA Amiens, 19 septembre 2019, n° 18/00672 N° Lexbase : A2693ZPG – CA Rouen, 17 octobre 2019, n° 18/04358 N° Lexbase : A4389ZRY – CA Rouen, 12 décembre 2019, n° 19/00957 N° Lexbase : A0904Z8Y – CA Basse-Terre, 20 janvier 2020, n° 18/016011 N° Lexbase : A20163DZ – CA Toulouse, 5 février 2020, n° 18/03258 N° Lexbase : A49033DX). La déchéance du droit aux intérêts était alors prononcée en cas de manquement en la matière.
Cependant, force était de constater que toutes les juridictions ne partageaient pas la solution précitée. En effet, plusieurs d’entre elles estimaient, à l’inverse, que l’assurance facultative n’avait pas à être comptabilisée ici (v. par ex., CA Douai, 16 janvier 2020, n° 17/05631 N° Lexbase : A78073BR – CA Chambéry, 23 janvier 2020, n° 18/02081 N° Lexbase : A41093C8 – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 18 juin 2020, n° 17/12565 N° Lexbase : A95803N7 – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 25 juin 2020, n° 17/12530 N° Lexbase : A50123PC – CA Chambéry, 14 janvier 2021, n° 19/01592 N° Lexbase : A37434CM – CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 14 janvier 2021, n° 18/04664 N° Lexbase : A44764CR).
Il était donc attendu que la Haute juridiction se prononce en la matière. Elle le fait par l’arrêt sélectionné.
Faits et procédure. La société de financement A. avait consenti à un couple un crédit à la consommation. À la suite de la défaillance des emprunteurs, l’établissement prêteur avait prononcé la déchéance du terme et les avait assignés en paiement.
La cour d’appel d’Amiens ayant, par un arrêt du 19 septembre 2019 (CA Amiens, 19 septembre 2019, n° 18/00672, préc.), prononcé la déchéance du droit aux intérêts et rejeté sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle, le prêteur avait formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. L’emprunteur invoquait le fait que, dans sa rédaction applicable au litige, l’article R. 311-5 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9067IX4, devenu C. consom., R. 312-10) n’exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l’encadré prévu à l’article L. 311-18 du même code (N° Lexbase : L8204IMS). Dès lors, en décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé les textes précités.
Décision. La Cour de cassation est sensible au moyen précité. Elle se fonde sur les anciens articles L. 311-18, L. 311-48, alinéa 1er (N° Lexbase : L9552IMQ), et R. 311-5 du Code de la consommation. Elle considère ainsi qu’il s’en déduit que « le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat ».
Or, pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et rejeter sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle, après avoir énoncé que le montant de l'échéance qui doit figurer dans l’encadré prévu à l’article R. 311-5 du Code de la consommation « s'entend de la somme totale que l’emprunteur doit effectivement régler et comprend donc la prime d'assurance facultative lorsqu’il l’a souscrite », l’arrêt de la cour d’appel a retenu que le coût de l’assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré n’a pas été intégré au montant de la mensualité mentionnée dans l’encadré, qu’ils n’ont pas été informés, à sa seule lecture, des caractéristiques essentielles du contrat et qu’ainsi, les exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 ont été méconnues.
Dès lors, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités. Sa décision est, par conséquent, cassée.
Observations. Cet arrêt vient donc définitivement clarifier l’incertitude relevée précédemment. Cette solution va-t-elle pour autant dans le sens de la partie la plus faible au contrat, c’est-à-dire l’emprunteur ? Probablement pas. Ce dernier devra ainsi garder à l’esprit, s’il a souscrit une ou plusieurs assurances non obligatoires, que les frais liés à celles-ci devront être additionnés par lui-même au montant de l’échéance figurant dans l’offre s’il souhaite connaître exactement l’effort financier qu’il devra produire pour rembourser son prêt.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477196
[Brèves] Objet du dépôt de garantie et extinction de la solidarité du colocataire : petite mise au point de la Cour de cassation
Réf. : Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 19-23.343, FS-P (N° Lexbase : A12514PZ)
Lecture: 4 min
N7174BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 16 Avril 2021
► Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer ; il y a donc lieu de faire droit à la demande de déduction du dépôt de garantie des sommes dues au titre de la dette locative ;
La solidarité du colocataire qui a donné congé s'éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ; ne peuvent être mis à la charge du colocataire qui a donné congé la réparation de dégradations dont il n’est pas constaté qu’elles sont survenues avant la fin de la période de solidarité.
Faits et procédure. Le bailleur donne à bail à des concubins, copreneurs solidaires, une maison d'habitation. La preneuse donne congé à effet au 29 avril 2015. Le 4 janvier 2016, le preneur libère les lieux et un état des lieux de sortie est établi.
Le bailleur assigne les preneurs en paiement d’un arriéré de loyers et de charges, et de réparations locatives.
Par un arrêt du 2 juillet 2019, la cour d’appel de Montpellier condamne la preneuse à payer au preneur les sommes de 4 091,33 euros et de 2 739 euros (CA Montpellier, 2 juillet 2019, n° 17/03718 N° Lexbase : A4862ZHK).
La preneuse se pourvoit en cassation. L’arrêt apporte des précisions intéressantes à deux égards.
- Concernant l’objet du dépôt de garantie
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation énonce clairement que « le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer ».
La solution est logique et découle des textes : selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : Z34730RM), le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; et selon l’article 22 de cette même loi (N° Lexbase : Z06696MW), un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire.
Or, comme le faisait remarquer le demandeur au pourvoi, l’obligation de payer le loyer figure au nombre des obligations locatives du locataire.
La Haute juridiction censure alors l’arrêt qui, pour condamner la preneuse à payer au bailleur une somme de 4 091,33 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges, avait retenu que le dépôt de garantie n’avait pas vocation à couvrir des échéances de loyer.
Il faut néanmoins rappeler que le locataire ne peut, en tout état de cause, s’abstenir de régler les derniers loyers en décidant unilatéralement de les imputer sur le dépôt de garantie qui a vocation à lui être restitué, le loyer étant dû jusqu'à la date d'effet du congé (Cass. civ. 3, 5 octobre 1999, n° 98-10.162 N° Lexbase : A1614CN4).
Inversement, on rappellera que la Cour de cassation avait eu l’occasion de censurer le jugement ayant admis la déduction, du dépôt de garantie, d’une somme équivalant à un mois de loyer au titre de l’occupation postérieure, par le locataire, à l’expiration du bail (Cass. civ. 3, 28 septembre 2004, n° 03-14.870, F-D N° Lexbase : A4884DDA). Cette solution reste en parfaite cohérence avec celle énoncée par le présent arrêt en date du 8 avril 2021, puisque, le bail ayant expiré, il ne pouvait alors s’agir du paiement d’un loyer pouvant être couvert par le dépôt de garantie.
- Concernant l’extinction de la solidarité du colocataire
Selon l’article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : Z34725RM), la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elle s'éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Il en résulte que la solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date.
Pour condamner la preneuse à payer une somme de 2 739 euros au titre de la régularisation des charges et de réparations locatives, l’arrêt de la cour d’appel retient que cette somme correspond à un prorata, au 29 octobre 2015, du montant total de 3 553,03 euros arrêté au 4 janvier 2016, suffisamment justifié par un tableau récapitulatif de régularisation des charges et des devis des travaux de remise en état, et que l’état des lieux de sortie du 4 janvier 2016 en présence de son ex-compagnon justifie de la charge de remise en état des désordres correspondant aux devis produits.
Le demandeur au pourvoi faisait valoir que ne peuvent être mis à la charge du colocataire qui a donné congé la réparation de dégradations dont il n’est pas constaté qu’elles sont survenues avant la fin de la période de solidarité.
L’argument est accueilli par la Haute juridiction qui relève que la créance du bailleur au titre de la remise en état des lieux était née après l'expiration de l’obligation solidaire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477174
[Brèves] La contestation de la qualité des travaux, un obstacle à la réception tacite ?
Réf. : Cass. civ. 3, 1er avril 2021, n° 20.14.975, FS-P (N° Lexbase : A48044NA)
Lecture: 4 min
N7208BYM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 14 Avril 2021
► La réception tacite ne peut pas être caractérisée si la volonté des maîtres d’ouvrage de recevoir l’ouvrage est équivoque ;
► le paiement des factures doublée de la prise de possession n’y change rien ;
► la contestation de la qualité des travaux empêche la caractérisation d’une volonté non-équivoque.
Il serait, sans doute, temps d’intervenir pour mettre un terme à cette création prétorienne qui est la réception tacite. La multiplicité des contentieux, jusqu’en cassation, est bien la preuve de l’inefficacité du régime mis en place, sans même évoquer l’absence de sécurité juridique consécutif. Devoir aller jusqu’en cassation pour savoir si un ouvrage est réceptionné n’est pas satisfaisant. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Législateur a souhaité y mettre un terme. L’article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX) ne prévoit pas la réception tacite. Seules les réceptions expresses et judiciaires sont possibles. La jurisprudence, tant administrative que judiciaire, a toutefois résisté.
Le régime de la réception tacite est trop compliqué. Doit être caractérisée la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Si cette volonté est caractérisée, il y a réception tacite mais si, au contraire, est caractérisée la volonté non-équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, il n’y a pas de réception tacite possible. L’approche paraît simple mais cela est loin d’être le cas.
Sont ainsi insuffisants, pris isolément, à caractériser une réception tacite, la prise de possession des lieux (Cass. civ. 1, 4 octobre 2000, n° 97-20.990, publié au bulletin N° Lexbase : A7732AHT Constr. Urb. 2000, n° 298), le paiement du prix (Cass. civ. 3, 30 septembre 1998, n° 96-17.014 N° Lexbase : A5487AC9, Constr. Urb. 1998, com 409), la signature d’une déclaration d’achèvement des travaux et d’un certificat de conformité (Cass. civ. 3, 11 mai 2000, n° 98-21.431, F-D N° Lexbase : A4667CRB, AJDI, 2000, 741), des difficultés financières (CA Metz, 12 mars 2003, n° 01/01157 N° Lexbase : A8846S3Z), l’achèvement de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 25 janvier 2011, n° 10-30.617 N° Lexbase : A8600GQL), la succession d’une entreprise à une autre (Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-17.129, FS-P+B N° Lexbase : A0851RQL), le paiement du solde dû à l’entreprise (Cass. civ. 3, 22 juin 1994, n° 90-11.774 N° Lexbase : A6284ABD), surtout lorsque des réserves importantes sont émises par le maître d’ouvrage (Cass. civ. 3, 10 juillet 1991, n° 89-21.825, publié au bulletin N° Lexbase : A2841ABT).
Mais, la prise de possession des lieux doublée du paiement complet du prix peut suffire à caractériser cette volonté (Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.260, FS-P+B N° Lexbase : A4987WD3) même si les travaux ne sont pas achevés (Cass. civ. 3, 8 novembre 2006, n° 04-18.145, FS-P+B N° Lexbase : A2934DSH, JCP G 2006, IV, 3336). C’est ainsi que, depuis une jurisprudence amorcée le 24 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 24 novembre 2016, n° 15-25.415, FS-P+B N° Lexbase : A3460SLQ) clairement confirmée en 2019 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 18-10.197 N° Lexbase : A5083YUS ; Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-13.734 N° Lexbase : A3818Y9B), la réception tacite est présumée lorsqu’il y a paiement intégral du prix et prise de possession. La Haute juridiction y tient. Elle a déjà eu l’occasion d’y revenir (Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-13.024, FS-D N° Lexbase : A54163IG, obs. J. Mel, Lexbase, Droit privé, avril 2020, n° 819 NN° Lexbase : N2886BYK).
Forts de cette jurisprudence, les maîtres d’ouvrage avaient invoqué la prise de possession et le paiement de 80 % du prix pour prétendre avoir tacitement réceptionné les travaux et solliciter l’application de la responsabilité civile décennale des constructeurs.
Ils obtiennent gain de cause en première instance, mais pas en appel. Pour les conseillers, la contestation constante par les maîtres d’ouvrage de la qualité des travaux exécutés, accompagnée d’une demande d’expertise judiciaire relative aux manquements de l’entrepreneur dont l’abandon du chantier est de nature à rendre équivoque la volonté des maîtres d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
La Haute juridiction ne trouve rien à y redire et rejette le pourvoi. L’arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence amorcée il y a quelques années (Voir récemment Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-13.024, préc.) ; Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-19.969, F-D N° Lexbase : A06363WH ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-24.752, FS-P+B+I N° Lexbase : A3673W78), récemment confirmée (Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-24.537 N° Lexbase : A89024LB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477208
[Jurisprudence] Les conditions de recevabilité d’une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français jugées contraires au droit à un recours effectif
Réf. : CA Paris, 17 mars 2021, n° 20/05267 (N° Lexbase : A89404M3)
Lecture: 11 min
N7167BY4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Solal Cloris, Avocat au barreau du Val-de-Marne
Le 14 Avril 2021
Mots-clés : jurisprudence • CESDH • article 13 • relèvement en relèvement d’une interdiction du territoire français • recevabilité • droit à un recours effectif • article 8 • grief sérieux.
Par un arrêt du 17 mars 2021, la cour d’appel de Paris a jugé recevable une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire alors même que le requérant résidait sur le territoire français et n’était ni incarcéré, ni assigné à résidence. Cette décision, à première vue contraire aux dispositions juridiques applicables en la matière, est en réalité justifiée par la recherche d’un équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge.
Le requérant, un ressortissant tunisien arrivé en France en 1976 a été condamné en 2009 par la cour d’appel de Paris à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, conformément aux articles 131-30 (N° Lexbase : L7623LPZ) et suivants du Code pénal. Dix ans après cette condamnation pour des faits de participation à un trafic de stupéfiants, il a sollicité le relèvement de cette interdiction auprès de cette même juridiction dans les conditions prévues par les dispositions des articles 702-1 (N° Lexbase : L9382IE9) et 703 (N° Lexbase : L2597DGB) du Code de procédure pénale.
En application de l’article L. 541-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L7222IQK), la recevabilité de la demande de relèvement d’une interdiction du territoire est conditionnée à une résidence de l’étranger hors de France. Il existe toutefois deux exceptions à cette exigence. L’étranger résidant en France est recevable à demander le relèvement de cette peine s’il effectue une peine d’emprisonnement ferme ou s’il est assigné à résidence par arrêté préfectoral, en vue d’organiser son éloignement. Aucune autre exception n’est prévue.
En l’espèce, le requérant résidait en France, était libre et ne faisait pas l’objet d’une assignation à résidence. Par application des dispositions législatives précitées, sa requête aurait en principe dû être rejetée. C’était en tout cas la position soutenue par l’avocat général lors de l’audience qui s’est tenue en chambre du conseil.
Néanmoins, la cour a, par une motivation audacieuse mais juridiquement pertinente, admis la recevabilité de la requête.
Les juges ont d’abord constaté que le requérant justifiait d’un grief sérieux résultant d’une atteinte au respect de la vie privée. En effet, il est arrivé en France en 1976 et a obtenu un premier titre de séjour en 1981, lequel a été renouvelé plusieurs fois. En outre, il est le père de cinq enfants, tous de nationalité française, et réside auprès de son épouse, laquelle est en situation régulière et souffre de troubles psychiatriques nécessitant sa présence à ses côtés. Sur le plan professionnel, le requérant justifie d’un emploi sous contrat à durée indéterminée. À l’inverse, il n’avait plus aucun lien familial dans son pays d’origine. Or ce contexte familial était déjà établi au moment du prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, ce qui semble avoir été un élément décisif pour les juges.
La cour a alors estimé qu’opposer au requérant les règles internes relatives à la recevabilité de sa requête en relèvement de l’interdiction du territoire français constituerait une charge disproportionnée et aurait pour effet de le priver de son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4746AQT).
Cette solution, qualifiée d’ « exceptionnelle » par la cour, n’est pourtant pas inédite.
Dans un arrêt en date du 25 avril 2006, la cour d’appel de Paris avait déjà admis la recevabilité d’une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français alors que le requérant résidait, libre, sur le territoire français. Elle posait alors le principe selon lequel : « si tout recours est soumis à des conditions de recevabilité spécifiques, édictées par les lois, et à des limitations généralement admises par la communauté de nation comme relevant de la doctrine de l’immunité des États, ces règles ne peuvent avoir pour effet d’interdire complètement à l’individu d’accéder à son droit de saisir un tribunal ou de le priver de son droit effectif à exercer un recours, sans porter atteinte au principe général fixé par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. » [1].
On notera toutefois que dans l’arrêt de 2006, la cour motivait sa solution par le fait que le requérant justifiait d’une impossibilité de se rendre dans son pays d’origine ainsi que dans plusieurs autres pays susceptibles de pouvoir l’accueillir et que ses démarches intentées pour être assigné à résidence étaient restées vaines. C’était parce que le requérant apportait la preuve de son impossibilité de se conformer aux dispositions légales relatives à la recevabilité de la requête que la cour avait décidé de faire primer le droit à un recours effectif sur les règles internes.
Dans le cas d’espèce, la particularité de la décision résulte de l’application par la cour d’appel du principe général du droit à un recours effectif fixé par l’article 13 de la Convention sous l’angle de la seule atteinte au droit à une vie privée et familiale du requérant. En effet, ce dernier ne justifiait ni d’une impossibilité de se rendre à l’étranger, notamment dans son pays d’origine où certes il n’avait plus aucune famille, ni d’avoir sollicité son assignation en résidence auprès du ministre de l’Intérieur.
C’est au regard de la situation familiale très spécifique du requérant que la cour a considéré que les exigences imposées par le droit interne constituaient pour lui une charge disproportionnée. Cette application du droit à un recours effectif est à notre sens plus conforme à l’esprit des dispositions de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Rappelons en effet que l’article 13 de la Convention a vocation de permettre la protection des autres dispositions de la Convention. En d’autres termes, elle est un moyen de garantir les individus contre une atteinte caractérisée à un droit ou une liberté garantis par la Convention. Aussi la Cour européenne des droits de l’Homme soumet-elle la possibilité d’invoquer l’article 13 à la démonstration d’un « grief défendable », lequel doit être tiré d’une autre disposition de la Convention [2]. Dans le même sens, la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 13 juin 2007 que « le droit à un recours effectif devant une instance nationale n’est garanti qu’aux personnes qui justifient d’un grief sérieux résultant d’une atteinte à un droit reconnu par la Convention susvisée » [3].
Or l’atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR), dès lors qu’elle est caractérisée, constitue indéniablement un tel grief.
La solution n’était certes pas évidente, ce qui explique que la cour ait siégé en formation collégiale. L’éventuelle méconnaissance du principe garanti par l’article 13 de la Convention ne résultait pas de l’absence de recours contre la mesure d’interdiction du territoire français mais des exigences restrictives de ce recours. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà jugé que des exigences trop restrictives peuvent faire perdre le caractère effectif d’un recours prévu par la loi nationale [4].
La situation personnelle du requérant se prêtait parfaitement à une telle interprétation. Non seulement le respect des règles de recevabilité l’aurait obligé à quitter sa famille pour rejoindre un pays dans lequel il n’a plus d’attaches mais à plus court terme, cela l’aurait conduit à perdre son emploi. Dans ces conditions, on comprend qu’exiger d’un individu qu’il quitte un pays dans l’unique fin d’intenter un recours contre une mesure prononcée plus de dix ans auparavant ait pu être considéré comme une charge disproportionnée.
La démonstration d’un grief « sérieux » suffit en soi à écarter les règles internes de recevabilité d’un recours contre une mesure d’éloignement. Il aurait été superfétatoire de devoir apporter la preuve d’une impossibilité matérielle de se rendre dans un autre pays. De même, il aurait été vain d’intenter préalablement des démarches tendant à solliciter une assignation à résidence dans l’unique but de former une telle requête en relèvement. En effet, l’assignation à résidence prévue par l’article L. 561-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L1958LMH) est une mesure que l’administration peut prendre pour s’assurer de l’exécution d’une mesure d’éloignement telle qu’une interdiction du territoire français. Le fait que l’administration ait décidé de ne pas entreprendre d’exécution forcée ne devrait pénaliser l’étranger dans l’exercice de son recours effectif. On ne peut exiger d’un étranger qu’il sollicite de lui-même une mesure restrictive de liberté afin d’exercer un recours qui au surplus était parfaitement légitime dans le cas d’espèce.
La position de la cour d’appel de Paris est également en cohérence avec la jurisprudence administrative relative aux demandes d’abrogation d’un arrêté d’expulsion. L’article L. 524-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L5799G4K) soumet la recevabilité d’une demande d’abrogation aux mêmes conditions que celles applicables à l’égard des requêtes en relèvement d’une interdiction du territoire français. Or dans un arrêt du 23 février 2000 [5], le Conseil d’État avait estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention n’étaient pas inopérants à l’encontre de cette décision, nonobstant le caractère irrecevable de la demande d’abrogation au regard des règles internes. Pour la haute juridiction administrative, les exigences procédurales ne doivent pas entraver l’application de la Convention européenne des droits de l’Homme, dont il veille à bonne application.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris rejoint donc la position du Conseil d’État dans cette volonté de garantir le respect des principes garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, rappelant au passage la primauté du droit international résultant de l’article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R).
Enfin, dans cette affaire, le sort de la requête au fond était étroitement lié à celui de sa recevabilité. Certes, la protection du droit à un recours effectif ne saurait garantir ipso facto une issue favorable à ce recours. Néanmoins, il aurait été difficilement concevable que la Cour, après avoir admis la recevabilité de la requête en application des dispositions combinées des articles 13 et 8 de la Convention, décide de ne pas y faire droit au fond.
D’ailleurs la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises [6] qu’il appartient aux juges du fond de s’assurer que le maintien d’une mesure d’interdiction du territoire français respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. En l’occurrence, la cour d’appel de Paris a estimé qu’en dépit de la condamnation de 2009 à l’origine de la mesure d’interdiction du territoire français, l’absence de nouvelles condamnations en lien avec les infractions relatives aux stupéfiants, d’une part, et la situation familiale du requérant, d’autre part, conduisaient logiquement à considérer le maintien de la mesure comme une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée familiale.
Au final, la décision nous semble justifiée au regard de la situation exceptionnelle du requérant. Le sort du pourvoi en cassation déposé par le ministère public à l’encontre de cette décision conduira sans nul doute la haute juridiction judiciaire à confirmer cette position.
| À retenir : la cour d’appel de Paris a écarté les règles de recevabilité d’une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français au nom du droit à un recours effectif. Le requérant justifiait d’un « grief sérieux » résultant d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. |
[1] CA Paris, CT0111, 25 avril 2006.
[2] CEDH, 27 avril 1988, Req. 9659/82, Boyle et Rice c/ Royaume-Uni (N° Lexbase : A1274IZ9), § 52 ; CEDH, 6 octobre 2005, Req. 11810/03, Maurice C/ France (N° Lexbase : A6794DKT), § 106.
[3] Cass. crim., 13 juin 2007, n° 06-86.065, FS-P+F (N° Lexbase : A9545DWG), Bull. crim., 2007 n° 162.
[4] CEDH, 16 décembre 1997, Req. 136/1996/755/954, Camenzind c/ Suisse N° Lexbase : A6228AXX), 1997, § 54.
[5] CE, 23 février 2000, n° 196721 (N° Lexbase : A0436AUP).
[6] Cass. crim., 25 mai 2005, n° 04-85.180, F-P+F (N° Lexbase : A7661DIL), Bull. crim. 2005, n° 150, p. 68 ; Cass. crim., 30 mars 2011, n° 09-86.641, F-P+B (N° Lexbase : A5788HNP), Bull. crim., 2011 n° 68.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477167
[Brèves] Nouvelles obligations déclaratives pour les plateformes numériques : la Directive « DAC 7 » publiée au JOUE
Réf. : Directive (UE) n° 2021/514 du Conseil, du 22 mars 2021, modifiant la Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (N° Lexbase : L8094L38)
Lecture: 2 min
N7184BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 16 Avril 2021
► La Directive « DAC 7 » modifiant la Directive (UE) n° 2011/16/UE, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (N° Lexbase : L5101IPM), a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 mars 2021.
Rappelons que depuis son adoption, la Directive (UE) n° 2011/16/UE initiale avait déjà été modifiée cinq fois afin d'inclure des informations sur les comptes financiers, sur les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert, sur les déclarations pays par pays, sur les bénéficiaires effectifs, sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration et maintenant sur les plateformes numériques :
- Directive (UE) n° 2014/107/UE, qui a introduit l’échange automatique informations relatives aux comptes financiers (N° Lexbase : L0202I7M) ;
- Directive (UE) n° 2015/2376/UE, en ce qui concerne l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales et les accords préalables en matière de prix de transfert (N° Lexbase : L3592KWX) ;
- Directive (UE) n° 2016/881/UE, sur l’échange automatique d'informations sur les déclarations pays par pays (N° Lexbase : L4143K8X) ;
- Directive (UE) n° 2016/2258/UE, qui garantit l’accès des autorités fiscales aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs collectées conformément à la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (N° Lexbase : L8214LBT) ;
- Directive (UE) n° 2018/822/UE en ce qui concerne l’échange automatique d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (N° Lexbase : L6279LKR).
⌛ Chronologie du nouveau texte
- La Commission européenne a formulé une proposition de révision de la Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscale le 15 juillet 2020, dans le cadre du plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance.
- En décembre 2020, les États membres conviennent de nouvelles règles en matière de transparence fiscale pour les plateformes numériques.
- Le 10 mars 2021, le Parlement a également approuvé le texte après quelques modifications.
- Le projet de Directive a été adopté par le Conseil de l’Union européenne le 22 mars 2021.
🔎 Détail des mesures. Dans les grandes lignes, le texte introduit des obligations de déclaration pour les plateformes du numérique concernant les revenus perçus par les vendeurs de biens et de services qui utilisent ces plateformes.
⏲️ Entrée en vigueur. Les États membres devront transposer le texte au plus tard le 31 décembre 2022, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
💡 Bon à savoir. La Commission a publié une feuille de route visant à étendre le champ d'application de la Directive aux cryptoactifs et à la monnaie électronique (DAC 8).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477184
[Brèves] Procédure d’appel en matière civile : le Conseil d’État rejette la requête en abrogation des « Décrets Magendie »
Réf. : CE, 26 mars 2021, n° 438146 (N° Lexbase : A68294MU)
Lecture: 3 min
N7183BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 14 Avril 2021
► Le Conseil d’État a rejeté le recours de la Confédération nationale des avocats (CNA), tendant à l’abrogation des décrets « Magendie » n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW), n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L9934INA) et n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile (N° Lexbase : L2696LEL).
Pour rappel, la Confédération nationale des avocats avait saisi par LRAR le 20 novembre 2019, le Premier ministre d’une demande tendant à l’annulation des décrets « Magendie ». Face à l’absence de réponse du Premier ministre, le CNA a déposé une requête complétée d’un mémoire, les 31 janvier et 18 août 2020, sollicitant l’annulation de la décision de rejet implicite de rejet du Premier ministre, pour excès de pouvoir.
Pour le Conseil d’État, « L'obligation pour l'appelant de mentionner expressément dans la déclaration d'appel les chefs du jugement de première instance qu'il entend critiquer, de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé lorsque ce dernier n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration ou en cas de retour au greffe de la lettre de notification, ou de déposer ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration à peine de caducité de celle-ci », et plus largement les différentes dispositions procédurales contraignantes qui sont imposées aux parties dans le cadre de la procédure d'appel en matière civile, le sont dans un objectif de bonne administration de la justice et afin d'améliorer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire.
En conséquence, le Conseil énonce qu’elles ne portent pas une atteinte excessive au droit d’accès au juge et ne méconnaissent aucune exigence découlant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).
Par ailleurs, le Conseil d’État juge que la circonstance que le délai moyen de jugement devant les cours d’appel soit passé de 11,5 en 2009 à 13,5 en 2018, alors même que l’un des objectifs de la réforme était d’améliorer l’efficacité et la célérité des procédures d’appel civiles, « n'est pas de nature à établir à elle seule que les décisions de refus d'annulation des décrets seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation »
Solution du Conseil d’État. La requête du CNA est rejetée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477183
[Jurisprudence] L’obstination des plaideurs à l’origine d’un spectaculaire revirement de jurisprudence de l’Assemblée plénière : il n’y a pas de cause perdue !
Réf. : Ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814, P+R (N° Lexbase : A17864NH)
Lecture: 22 min
N7178BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yannick Joseph-Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes - Directeur adjoint de l’Institut d’Études Judiciaire de Grenoble en charge de la prépa ENM - Membre du Centre de Recherches Juridiques - EA 1960
Le 14 Avril 2021
Mots-clés : cassation • recevabilité du moyen • changement de norme • revirement • jurisprudence • droit au juge •égalité de traitement des justiciables
L’arrêt rendu le 2 avril 2021 marque un revirement de jurisprudence inattendu et important qui met fin à une solution appliquée depuis cinquante ans puisque l’Assemblée plénière de la Cour de cassation énonce que le changement de norme (prétorien ou législatif) implique désormais la possibilité de présenter un moyen de cassation qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation l’ayant saisi en raison de ce changement dans la règle applicable.
En l’espèce, un salarié s’estimant victime d’une discrimination syndicale saisit un conseil des prud’hommes en vue d’obtenir un nouveau positionnement professionnel et des rappels de salaires, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Devant la cour d’appel, il fait valoir qu’il a travaillé sur différents sites où il explique avoir été exposé à l’amiante, et à ce titre, présente une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété.
Dans son arrêt du 1er avril 2015, la cour d’appel de Paris accueille cette demande et condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, sans rechercher si les établissements dans lesquels le salarié avait été affecté figuraient sur la liste des établissements éligibles au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), mentionnée à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : O2143BLX).
L’employeur, s’appuyant sur une jurisprudence bien établie de la Chambre sociale de la Cour de cassation [1] selon laquelle l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante n’est possible qu’au bénéfice des salariés ayant travaillé dans un des établissements figurant sur une liste mentionnée à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale [2] pour 1999, forme un pourvoi en cassation qui, sans surprise, est accueilli par la Haute juridiction qui casse l’arrêt d’appel par arrêt du 28 septembre 2016, et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée.
Par arrêt en date du 5 juillet 2018, la cour d’appel de renvoi de Paris constate que les conditions de l’indemnisation ne sont pas réunies et rejette, en conséquence, la demande d’indemnisation du salarié.
L’affaire aurait pu en rester là, sauf que la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a opéré, à l’occasion d’un arrêt rendu le 5 avril 2019, un important revirement de jurisprudence en reconnaissant à tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, la possibilité d’agir contre son employeur sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l’article 41 de la loi du 23 décembre1998 précitée [3].
L’absence de signification de l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d’appel de renvoi entre les parties permet au salarié débouté de former un second pourvoi dans lequel il se prévaut bien évidemment du revirement intervenu.
A priori, ce nouveau moyen avait peu de chance de prospérer dès lors que, en se fondant sur une lecture a contrario des dispositions de l’article L. 431-6 du Code de l’organisation judiciaire [4], la Cour de cassation affirme, depuis 1971, que tout moyen formé au soutien d’un nouveau pourvoi contre une décision rendue par une juridiction du fond de renvoi conformément à l’arrêt de cassation l’ayant saisie, même si un revirement de jurisprudence était intervenu postérieurement à cet arrêt, était irrecevable[5]. Contre toute attente, ce nouveau moyen est reçu par l’Assemblée plénière en raison du revirement de jurisprudence intervenu sur la question en jeu !
Dans l’arrêt rendu le 2 avril 2021, l’Assemblée plénière procède à spectaculaire revirement de jurisprudence au motif que la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’y a pas mis un terme, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours.
L’arrêt commenté est intéressant à plus d’un titre !
D’une part, il marque un abandon partiel de la règle de l’irrecevabilité issue de l’arrêt de 1971 en présence de tout changement de norme, ce qui implique, outre le cas des revirements de jurisprudence, les évolutions de la loi. La rigueur de la règle de l’irrecevabilité cède donc le pas à une souplesse procédurale dont rien ne permet d’affirmer aujourd’hui qu’elle ne sera pas tempérée à l’avenir par la Cour de cassation elle-même, eu égard à la généralité de l’expression « un changement de norme » qui, si elle traduit la volonté de la Haute juridiction d’englober toutes les situations dans lesquelles un changement dans les règles applicables intervient - que ce changement ait une origine législative ou prétorienne - est riche de sens, et donc sujette à interprétation.
D’autre part, il porte le sceau de la reconnaissance par la Cour de cassation de son rôle normatif. Nul n’ignore combien la Cour de cassation a parfois pu se montrer timide pour reconnaître le rôle normatif qu’elle peut avoir, notamment en raison de l’article 5 du titre préliminaire du Code civil (N° Lexbase : L2230AB9) prohibant les arrêts de règlement. Or, dans l’arrêt rendu le 2 avril 2021, la Cour de cassation fait une référence explicite à la contribution de ce revirement « tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence ». Il y a donc ici une reconnaissance pleine et entière de son rôle normatif, ce dont nous nous réjouissons.
Au-delà de ces apports qui mériteraient des développements sur lesquels d’autres auteurs ont fait le choix de se focaliser, il nous semble que cet arrêt mérite avant tout d’être commenté sur les causes de son existence, et pas seulement sur les conséquences qu’il emporte. De ce point de vue, l’attention du lecteur sera attirée ici sur le fait qu’il nous semble que le revirement de jurisprudence auquel procède l’Assemblée plénière se fonde principalement sur une conception renouvelée de la sécurité juridique (I), comme du respect des droits fondamentaux processuels dont le contenu est enrichi (II).
I. Une conception renouvelée de la sécurité juridique
À lire le communiqué de presse qui accompagne l’arrêt du 2 avril 2021, il semblerait qu’une des composantes du raisonnement de l’Assemblée plénière expliquant le revirement de jurisprudence auquel elle procède réside dans une conception renouvelée de la notion de sécurité juridique qui constituait le fondement de la règle de l’irrecevabilité (A) ; renouvellement de la conception à laquelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) n’est pas étrangère (B).
A. La sécurité juridique : fondement de la règle de l’irrecevabilité
La question de savoir si un plaideur est recevable à soumettre à la même Chambre de la Cour de cassation une question qu'elle a déjà jugée contre lui dans le même litige, après que la juridiction de renvoi ait statué conformément à la solution dégagée par la Haute juridiction, s’est posée pendant longtemps, sans que la jurisprudence ou la doctrine n’y apporte une réponse ferme. Des arrêts vont se prononcer pour la recevabilité [6], d'autres dans le sens de l'irrecevabilité [7]. Cette incertitude a subsisté pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que la question soit tranchée par la Chambre mixte dans l’arrêt précité du 30 avril 1971. Déduite a contrario des termes de l'article 15 de la loi de 1967 (devenu l’article L. 431-6 COJ), par une interprétation audacieuse, cette solution se fonde pourtant davantage sur des considérations d’ordre pratique, plus que d’ordre juridique.
En effet, il a pu paraître peu satisfaisant d’imaginer la Cour de cassation devoir trancher de nouveau une question de droit sur laquelle elle se serait déjà prononcée, à la requête de plaideurs obstinés et ayant les moyens de leurs ambitions, au risque de la voir dire le droit en sens contraire dans le même procès. En d’autres termes, dans l’arrêt du 30 avril 1971, et bien qu’elle ne l’exprime pas en ces termes, la Chambre mixte se fonde sur le raisonnement suivant : les impératifs de bonne administration de la justice et de sécurité juridique commandent la règle de l’irrecevabilité du moyen formé au soutien d’un nouveau pourvoi qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt l’ayant saisie. Durant cinquante ans, ce raisonnement va tenir, malgré les critiques toujours plus nombreuses, car il peut y avoir quelque injustice, si un revirement de jurisprudence est intervenu entre-temps, à ce que le plaideur déjà jugé ne puisse en bénéficier en formant un pourvoi contre l'arrêt de la juridiction de renvoi.
Si nous laissons volontairement de côté l’argument tiré d’une bonne administration de la justice pour la raison évidente qu’il peut tout aussi bien justifier le maintien de la règle de l’irrecevabilité que son évincement, quid de l’argument tiré de la sécurité juridique des plaideurs ? Le communiqué de presse qui accompagne l’arrêt du 2 avril 2021 précise que la décision du 30 avril 1971 était justifiée par « des préoccupations de bonne administration de la justice, par une conception classique de la sécurité juridique et visait à la fois à éviter que la Cour de cassation adopte successivement des positions contraires dans une même affaire et à mettre un terme au litige ». Un "conception classique“ de la sécurité juridique ? Il y aurait donc une conception moderne de la sécurité juridique, et ce serait elle qui fonderait, en partie au moins, le revirement opéré par l’Assemblée plénière ? À notre sens, il n’existe qu’une seule conception de la sécurité juridique : celle qui permet aux justiciables de garder le droit prévisible malgré son caractère nécessairement évolutif. C’est la prévisibilité de la norme, et de la manière dont elle est interprétée, qui garantit la sécurité juridique. De ce point de vue, il n’y a pas, nous semble-t-il, de conception « classique » ou « moderne » de la sécurité juridique. En revanche, il y a peut-être une conception renouvelée à l’aune de la jurisprudence de la CEDH.
B. L’influence de la jurisprudence de la CEDH
L’analyse de la jurisprudence de la CEDH met en évidence que, selon le juge européen, le principe de la sécurité des rapports juridiques tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu'à favoriser la confiance du public dans la justice [8]. Pour le juge européen, l’incertitude « qu'elle soit législative, administrative ou tenant aux pratiques appliquées par les autorités est un facteur qu'il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l'État » [9]. Toutefois, l’exigence de sécurité juridique ne consacre pas, pour la CEDH, un droit acquis à une jurisprudence figée et qu’un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à unemotivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme [10]. Encore récemment, le juge européen a affirmé que « les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante. Ainsi, une évolution de la jurisprudence n’est pas, en elle‑même, contraire à la bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration » [11]. Pour la CEDH, non seulement aucune disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ne consacre un quelconque principe de non-rétroactivité de la jurisprudence, mais encore un tel principe ne saurait se fonder sur le principe de sécurité juridique.
Invoquer la sécurité juridique pour maintenir la règle de l’irrecevabilité du moyen formé au soutien d’un nouveau pourvoi qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt l’ayant saisie, alors qu’un changement des règles applicables était intervenu entre-temps, devenait donc difficile à l’aune des solutions dégagées par la CEDH. Cela devenait d’autant plus difficile qu’il est de moins en moins possible de soutenir sérieusement que la jurisprudence ne serait pas une source créatrice de droit, et par voie de conséquence, que la Cour de cassation ne joue pas un rôle créateur ! Il suffit pour s’en convaincre de se replonger dans les débats – passionnants – relatifs à la question de la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence, et de manière plus pragmatique dans les faits de l’espèce ayant donné lieu précisément à l’arrêt rapporté, et notamment le rapport de M. le conseiller Dominique Ponsot qui ne dit pas autre chose : « Pour autant, les nécessités d’une bonne administration de la justice, à la lumière desquelles avait été adopté l’arrêt fondateur d’une Chambre mixte du 30 avril 1971, doivent être réexaminées à l’aune des évolutions intervenues depuis, qu’il s’agisse de la reconnaissance du rôle de l’Assemblée plénière dans la formation de la jurisprudence, de l’affirmation, plus généralement, du rôle normatif de la Cour de cassation, de la diffusion de sa jurisprudence, de la motivation développée des revirements, ou encore de la différenciation des circuits de traitement des pourvois ». Nul doute qu’en intégrant les revirements de jurisprudence dans les « changements de norme », la Cour de cassation affirme son rôle de source du droit et entend maîtriser ses conséquences pour les plaideurs. Avec l’arrêt du 2 avril 2021, c’est en réalité toute la structure de la technique de cassation qui se trouve renforcée, et la conception que se fait la Cour de cassation du principe de sécurité juridique qui se trouve renouvelée pour se rapprocher de celle retenue par la CEDH.
II. Une conception renouvelée des droits fondamentaux processuels
Si le renouvellement de la conception du principe de sécurité juridique fonde pour partie le revirement opéré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 2 avril 2021, ce n’est qu’en partie seulement. C’est qu’en effet la question de l’irrecevabilité du moyen formé au soutien d’un nouveau pourvoi qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt l’ayant saisie, alors qu’un changement de norme postérieur intervient se discute aussi sous l’angle des droits fondamentaux. Comme la Cour de cassation l’évoque elle-même dans son communiqué de presse, si le revirement opéré a notamment pour finalité de rendre totalement effectif l’accès au juge (A), il tend également à assurer une égalité de traitement entre les justiciables placés dans des situations équivalentes (B).
A. Assurer l’effectivité de l’accès au juge
Pour la Cour de cassation, prendre en considération la norme nouvelle ou modifiée pour permettre à une partie à un litige qui n’a pas encore été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement participe de l’effectivité de l’accès au juge. Par cette affirmation, la Cour de cassation semble admettre que la solution appliquée depuis cinquante ans, et sur laquelle l’Assemblée plénière revient à l’occasion de l’arrêt commenté, méconnaissait donc le droit au juge dont peut se prévaloir tout justiciable.
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’aucune disposition ne consacre expressément un droit au juge, et qu’il s’agit là d’une consécration de la CEDH [12] fondée sur des arguments tels que la prééminence du droit, les principes généraux du droit, parmi lesquels « le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus », et le texte même de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR), dont les juridictions françaises ont admis l’existence.
Ensuite, que contrairement au recours effectif de l’article 13 qui vise à assurer une protection réelle des droits reconnus par la Convention dans les États contractants, le recours au juge de l’article 6 § 1 concerne que la possibilité de faire trancher un différend de nature civile ou pénale devant une juridiction interne, ce qui ne met pas nécessairement en cause la violation d’un droit reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme. De plus, le recours de l’article 13 doit être ouvert devant une instance nationale qui peut ne pas être un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1 (même s’il doit s’agir d’une autorité compétente, indépendante et impartiale).
Enfin, que l’effectivité du d’accès au juge ne suppose pas l’existence d’un droit absolu, ce qui conduit la Cour à admettre des limites fondées sur l’intérêt général ou encore sur le respect d’une bonne administration de la justice. Elle reconnaît donc aux États une certaine marge d’appréciation, tout en vérifiant que le droit à un tribunal n’a pas été atteint dans sa substance même, que le but poursuivi par la limitation est légitime, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé [13]. À ce titre, la CEDH a jugé conforme à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, par exemple : la réglementation des délais pour agir[14], pourvu qu’ils soient raisonnables [15], l’obligation de constituer avocat [16], l’obligation, à peine d’irrecevabilité de la demande, de constituer une sûreté, au prorata de la valeur de l’objet de la contestation et des frais prévisibles[17], ce qui n’est pas le cas de la cautio judicatum solvi imposée à un étranger [18], ou encore l’obligation pour le demandeur d’exécuter la décision frappée de pourvoi en cassation à peine de radiation de l’affaire du rôle, puis de péremption de l’instance à défaut d’exécution dans le délai de deux ans[19] prévu par le Code de procédure civile [20].
La solution antérieure à l’arrêt rapportée méconnaissait-elle réellement l’effectivité du droit au juge, laquelle implique, par voie de conséquence, l’effectivité du droit à un recours juridictionnel effectif ? En décidant de prendre désormais en considération dans un procès en cours tout changement de norme, dont les revirements de sa jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable, c’est-à-dire une décision qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours, n'a pas mis un terme au litige, la Cour de cassation permet aux parties de bénéficier d’une évolution de jurisprudence intervenue depuis la première cassation, ce que la solution antérieure ne permettait pas. Puisqu’une nouvelle norme est intervenue – plus favorable pour le plaideur –, le demandeur, dès qu’aucune décision irrévocable ne tranchant le litige au fond est intervenue, et que les délais de recours sont encore disponibles, devrait pouvoir en profiter en exerçant les voies de droit lui permettant d’obtenir gain de cause. En lui interdisant de le faire, alors que la décision qui lui est défavorable n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée, il est possible de considérer que la solution ancienne portait une atteinte manifeste au droit au juge. Mais, comme nous venons de le voir, le droit au juge n’est pas un droit absolu, et la CEDH admet qu’il y soit porté certaines limites, pourvu que le droit à un tribunal n’ait pas été atteint dans sa substance même, que le but poursuivi par la limitation soit légitime, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Était-ce le cas ? La réponse se discute au regard des arguments qui fondaient la solution retenue depuis cinquante ans, mais cela mériterait un espace dont nous ne disposons pas dans le format qui est le nôtre ici. Aussi intéressante que puisse être une telle discussion, il convient toutefois de reconnaître que la solution retenue dans l’arrêt du 2 avril 2021 améliore assurément l’effectivité du droit au juge en permettant aux plaideurs de se prévaloir d’un revirement de jurisprudence dans une instance ou aucune décision irrévocable n’est venue trancher le litige.
B. Garantir l’égalité de traitement des justiciables placés dans des situations équivalentes
L’égalité de traitement des justiciables dans l’application de la loi est un principe qui a été longtemps négligé, surtout en matière pénale où la doctrine n’a d’yeux que pour le principe d’individualisation des peines qui, dans son application, peut pourtant donner lieu au sein d’une même juridiction à des écarts significatifs entre les condamnations prononcées qui interrogent. Si un travail significatif est réalisé au sein des juridictions pour juguler les disparités qui peuvent exister entre les différentes formations de jugement d’un même tribunal ou d’une même cour d’appel, conduisant à l’élaboration d’outils d’aide à la décision, y compris dans le champ de la répression pénale [21], la problématique semble avoir du mal à trouver une réponse juridique viable et qui soit conforme aux principes fondamentaux qui irrigue les procédures civile et pénale. Il n’est donc pas anodin, selon nous, que la Cour de cassation s’empare de ce principe dans l’arrêt rendu le 4 avril 2021. Le principe d’égalité de traitement s'inscrit parmi les principes fondamentaux de l'Union européenne, et le principe d'équivalence auquel la Cour de justice se réfère pour encadrer l'autonomie procédurale des États membres, a pour finalité d'assurer une égalité de traitement entre les justiciables sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. En droit interne, la Cour de cassation s’est peu emparée de ce principe. Une recherche rapide montre que, quelques arrêts seulement y font explicitement référence, et aucun ne concerne le champ de la procédure civile. Le principe d’égalité constitue pourtant un principe à valeur constitutionnelle figurant dans la devise de notre République, et il est consacré à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Ce principe dispose d’une triple dimension : égalité devant la loi ; égalité dans la loi ; égalité par la loi [22]. C’est précisément l’égalité par la loi que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation mobilise, pour la première fois à notre connaissance, dans le champ de la procédure civile ! Il s’en est fallu de peu que cet arrêt du 2 avril 2021 ne voit jamais le jour. Son existence ne tient qu’à une absence de signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi. Si la Cour de cassation avait maintenu sa solution antérieure, cela aurait conduit à priver le demandeur de la possibilité de se prévaloir d’un changement de norme issu du revirement de jurisprudence résultant de l’arrêt de 2019 qui permet à tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, la possibilité d’action contre son employeur sur le terrain du droit commun en dépit de l’absence de l’établissement concerné du dispositif ACAATA de la loi du 23 décembre 1998. Ce changement qui laissait au plaideur la possibilité d’entrevoir une lueur d’espoir aurait été étouffé dans l’œuf si le revirement du 2 avril 2021 n’était pas intervenu, alors même que les plaideurs se trouvant dans une situation équivalente, mais n’ayant pas encore formé un pourvoi en cassation, auraient pu s’en prévaloir ! Très clairement, la rupture d’égalité de traitement entre les justiciables aurait été alors pleinement consommée.
Bien plus que le vieillissement de la règle de l’irrecevabilité fondée sur « une conception classique de la sécurité juridique » ou l’amélioration de l’effectivité du droit au juge, c’est bien la mobilisation du principe d’égalité de traitement des justiciables qui fonde, selon nous, l’argument le plus sérieux et le plus pertinent du revirement opéré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’arrêt du 4 avril 2021. L’application de ce principe par la Haute juridiction dans le champ de la procédure civile vient enrichir le contenu des droits fondamentaux processuels, et ce faisant, ouvre la voie à un nouveau contentieux dont il reviendra aux plaideurs de s’emparer.
| À retenir : avec l’arrêt du 2 avril 2021, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation apporte une exception à la règle d’irrecevabilité du moyen formé au soutien d’un nouveau pourvoi qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt l’ayant saisie. Quand un changement de norme postérieur intervient, un tel moyen est désormais recevable devant la Cour de cassation. |
[1] Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW).
[2] Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : O2143BLX).
[3] Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 (N° Lexbase : A1652Y8P) ; Confirm. : Cass. soc., 11 septembre 2019, deux arrêts : n° 17-26.879, FP-P+B (N° Lexbase : A4741ZNW) et n° 17-18.311, FP-P+B (N° Lexbase : A4741ZNW).
[4] COJ, art. L. 431-6 (N° Lexbase : L7943HNI).
[5] Cass. ch. mixte, 30 avril 1971, n° 61-11.829 (N° Lexbase : A5413CKP) – Confirm. : Ass. plén., 21 décembre 2006, deux arrêts : n° 05-11.966 (N° Lexbase : A0884DTW) et n° 05-17.690 (N° Lexbase : A0967DTY) ; Ass. plén., 19 juin 2015, n° 13-19.582 (N° Lexbase : A3759NLS).
[6] Cass. crim., 21 février 1835, Bull. crim., n° 55.
[7] Cass. crim., 17 janvier 1835, Bull. crim. n° 64.
[8] CEDH, 5 octobre 2017, Req. 32269/09, Mazzeo c/ Italie (N° Lexbase : A8467WTR).
[9] CEDH, 20 octobre 2011, Req. 13279/05, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c/ Turquie (N° Lexbase : A8911HYP).
[10] CEDH, 26 mai 2011, Req. 23228/08, Legrand c/ France (N° Lexbase : A4634HSG) ; CEDH, 18 décembre 2008, Req. 20153/04, Unedic c/ France (N° Lexbase : A8770E9P).
[11] CEDH, 12 juillet 2018, Req. n° 22008/12, Allègre c/ France, req. n° 22008/12 (N° Lexbase : A7977XXQ).
[12] CEDH, 21 février 1975, Req. 4451/70, Golder c./ Royaume-Uni (N° Lexbase : A1951D7E).
[13] CEDH 28 mai 1985, Req. 8225/78 Ashingdane c/Royaume-Uni (N° Lexbase : A2007AWA).
[14] Comm. EDH, Req. 11-122/84, Victor Welter c/Suède, DR no 45, 2 décembre 1985 ; Comm. EDH, Req.10.857/84, Georges et Louise Bricmont c/Belgique, DR no 48, 15 juillet 1986.
[15] Comm. EDH, 6 octobre 1982, Req. 9707.82.
[16] CEDH 24 novembre1986, Req. 9063/80, Gillow c/Royaume-Uni (N° Lexbase : A1937NTW) ; CEDH 27 février 2001, Req. 35237/97, Adoud et Bosoni c/France (N° Lexbase : A8216AW9) ; CEDH 26 avril 2001, Req. 32911/96 Meftah c/France (N° Lexbase : A1829AZR) ; CEDH 12 janvier 2016, Req. 48074/10, Rodriguez Ravelo c/Espagne, (N° Lexbase : A5139N3Q) ; CEDH 23 avril 2015, Req. 29369/10, Morice c/France (N° Lexbase : A0406NHI).
[17] CEDH 28 octobre 1998, Req. 22924/93, Aït-Mouhoub c/France (N° Lexbase : A8225AWK).
[18] Comm. EDH, 28 février 1979, Req. 7973/77.
[19] CEDH 25 sept embre 2003, Req. 45840/99, Bayle c/France (N° Lexbase : A6915C9Y) ; CEDH 31 mars 2011, Req. 34658/07, Chatellier c/France (N° Lexbase : A5685HMI) ; CEDH 10 octobre 2013, Req. 37640/11, Pompey c/France (N° Lexbase : A4752KMX).
[20] CPC, art. 1009-2 (N° Lexbase : L5883IA7) ; CPC, art. 1009-3 (N° Lexbase : L1239H4N).
[21] Y. Joseph-Ratineau (dir.) Barémisation et droit pénal, rapport de recherche, [lien] – v. aussi : La barémisation de la justice, colloque organisée à la Cour de cassation par la Mission de recherche droit et justice 17 décembre 2020 [lien].
[22] Franck Claude, Le principe d’égalité, in Les techniques juridictionnelles du contrôle de constitutionnalité des lois - Dix ans de saisines parlementaires, Annuaire international de justice constitutionnelle, 1987, pp. 191-197.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477178
[Brèves] Conditions indignes de détention : la loi du 8 avril 2021 crée un recours devant le juge judiciaire
Réf. : Loi n° 2021-403, du 8 avril 2021, tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (N° Lexbase : L9830L3H)
Lecture: 7 min
N7158BYR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 16 Septembre 2021
► La loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention a été publiée au Journal officiel du 9 avril 2021. Elle crée un article 803-8 du Code de procédure pénale instituant une procédure visant à faire reconnaitre et cesser l’existence de conditions indignes de détention affectant tant les détenus provisoires que les personnes condamnées.
« Plusieurs décisions de justice récentes ont constaté que la France n'était pas en mesure de garantir, en toutes circonstances, des conditions de vie en établissement pénitentiaire suffisamment dignes, ni surtout d'y mettre fin lorsque de telles situations apparaissent, via des voies de recours satisfaisantes ». C’est dans ces mots que l’espace presse du Sénat présentait la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention.
De la visite du Contrôle général des lieux de privation de liberté au Baumettes, en octobre 2012, à la décision du Conseil constitutionnel d’octobre 2020, ne laissant au législateur d’autre choix que de créer un recours effectif, il aura fallu huit années de lutte de la part des détenus, des associations et de leurs avocats pour faire reconnaitre les carences de la législation française en matière de droit au respect de la dignité en détention.
Dans sa décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 (Cons. const., décision n° 2020-858/859 QPC, 2 octobre 2020 N° Lexbase : A49423WX), le Conseil des Sages avait jugé que les recours devant les juges administratif et judiciaire ne permettaient pas aux personnes détenues provisoirement d’obtenir qu’il soit mis fin aux atteintes à leur dignité résultant des conditions de leur détention. Il abrogeait l’alinéa second de l’article 144-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2984IZK) et octroyait au Parlement un délai de cinq mois pour adopter de nouvelles dispositions propres à permettre aux personnes ainsi détenues d’obtenir qu’il soit mis fin aux atteintes à leur dignité résultant des conditions de leur détention.
C’est avec un léger retard que la loi du 8 avril 2021 vient créer, en faveur des détenus provisoires et des détenus condamnés, un recours devant le juge judiciaire permettant d’obtenir la cessation de conditions indignes de détention.
I. Nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale
La loi nouvelle crée ainsi un article 803-8 du Code de procédure pénale instituant une procédure tendant à faire reconnaitre et cesser l’existence de conditions indignes de détention affectant tant les détenus provisoires que les personnes condamnées.
Saisine. Toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire et qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine pourra saisir, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes :
- le juge des libertés et de la détention si elle est en détention provisoire ;
- le juge de l’application des peines si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté.
Examen de la recevabilité de la requête. Le juge saisi disposera alors de dix jours pour décider s’il estime la requête recevable. Pour ce faire, celle-ci devra contenir des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve. Dans ce délai ou avant toute décision concernant cette demande, aucune nouvelle requête ne pourra être déposée par l’intéressé.
Vérifications des allégations. Lorsque la requête sera jugée recevable, le juge procèdera ou – plus probablement – fera procéder aux vérifications nécessaires et recueillera les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours à compter de la décision de recevabilité.
Communication et injonction à l’administration pénitentiaire. Lorsque la requête sera jugée fondée, le juge fera connaitre à l’administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision de recevabilité, les conditions qu’il estime contraires à la dignité de la personne humaine. Il fixera un délai compris entre dix jours et un mois au terme duquel il devra être mis fin, par tout moyen, à ces conditions.
Action de l’administration pénitentiaire. C’est l’administration pénitentiaire qui sera seule compétente pour apprécier les moyens propres à faire cesser ces conditions de détention. Elle pourra notamment transférer l’intéressé dans un autre établissement, sous réserve, s’il s’agit d’un prévenu de l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.
Au terme du délai imparti, si le juge considère qu’il n’a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il rend, dans un délai de dix jours une décision ordonnant :
- soit le transfèrement de la personne dans un autre établissement ;
- soit, si la personne est en détention provisoire, sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique ;
- soit, si la personne est définitivement condamnée et éligible à une telle mesure, l’une des mesures prévues au III de l’article 707 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7620LPW) (semi-liberté, placement à l’extérieur, détention à domicile sous surveillance électronique, libération conditionnelle, libération sous contrainte).
Refus de transfèrement d’un détenu provisoire. Lorsque l’administration pénitentiaire aura proposé un transfèrement à une personne détenue provisoirement et que celle-ci aura refusé, pour d’autres raisons, eu égard au lieu de résidence de sa famille, qu’une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, le juge pourra refuser de rendre l’une des décisions ci-dessus énoncées.
Dans le cadre de ce nouveau recours, le détenu pourra être assisté de son avocat.
Motivation des décisions. Toutes les décisions prévues par l’article 803-8 du Code de procédure pénale devront être motivées.
Appel. La décision de recevabilité de la requête, celle reconnaissant la requête fondée et celle prise en conséquence de l’insuffisante action de l’administration pénitentiaire pourront faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. L’appel devra être interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée
Examen de l’affaire. L’affaire devra être examinée dans un délai de quinze jours, à défaut, l’appel est non avenu.
Saisine directe des présidents de chambre. Lorsque les délais prévus à l’article 803-8 du Code de procédure pénale n’auront pas été respectés, la personne détenue pourra également saisir directement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’application des peines.
Précisions règlementaires à venir. Les modalités d’application de l’article 803-8 du Code de procédure pénale seront précisées par Conseil d’État et notamment les modalités de saisine des juges, la nature des vérifications ordonnées par le juge et l’impact de la décision de recevabilité de la requête adressée au juge judiciaire sur la compétence du juge administratif.
II. Détention provisoire et disparition des conditions
En réaction à l’abrogation du second alinéa de l’article 144-1 du Code de procédure pénale, la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 restitue à cet article un alinéa second dans lequel elle prévoit que lorsque les conditions subordonnant le recours à la détention provisoire ne sont plus remplies, le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire.
| Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477158
[Jurisprudence] Exclusion des biens professionnels & divorce : jurisprudence acquise…
Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-25.903, F-D (N° Lexbase : A47944NU)
Lecture: 8 min
N7217BYX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jérôme Casey, Avocat au barreau de Paris, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux
Le 05 Janvier 2022
Mots-clés : participation aux acquêts • créance de participation • exclusion des biens professionnels • avantage matrimonial • révocation • divorce • notaire
Une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens et dettes professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui conduit à avantager celui d'entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce, nonobstant la qualification qu'en auraient retenue les parties dans leur contrat de mariage.
Vu l’article 265 du Code civil :
Selon ce texte, les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.
Il en résulte qu'une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens et dettes professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui conduit à avantager celui d'entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce, nonobstant la qualification qu'en auraient retenue les parties dans leur contrat de mariage.
Pour rejeter la demande de Mme DM visant à voir qualifier la clause d'exclusion des biens professionnels d'avantage matrimonial révoqué par le divorce et dire, en conséquence, qu'il convient d'exclure les biens professionnels respectifs des ex-époux de la liquidation de leur régime matrimonial de participation aux acquêts, l'arrêt retient, d'abord, que tenir la clause litigieuse pour un avantage matrimonial relevant de l'article 265, alinéa 2, du Code civil reviendrait à priver d'effet la commune intention des parties, qui était d'exclure les biens professionnels de l'assiette de calcul de la créance de participation, aux fins notamment de protéger ces biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, volonté qui ressort par ailleurs du fait que les époux ont expressément qualifié d'avantage matrimonial la clause de partage inégal prévue à l'article 11 du contrat et ne l'ont pas fait s'agissant de la clause d'exclusion des biens professionnels, considérant par là même que cette dernière ne relevait pas de cette nature. Elle retient, ensuite, que la clause litigieuse visait non à conférer à l'un des époux un avantage conventionnel, mais à préserver les biens affectés à l'exercice professionnel de chacun d'eux en cas de dissolution par divorce.
En statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion des biens professionnels stipulés par les époux constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par leur divorce en l'absence de volonté contraire exprimée au moment du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Observations. Sale temps pour les notaires qui ont inséré depuis des années des clauses d’exclusion de biens professionnels dans leurs contrats de participation aux acquêts. On sait depuis plus d’un an que la Cour de cassation s’est résolue à déclarer l’article 265 du Code civil (N° Lexbase : L2598LBT) applicable à cette clause, de sorte que celle-ci risque fort de ne jamais s’appliquer en cas de divorce, les biens professionnels n’étant donc, de facto, jamais exclus du calcul de la créance de participation (v., Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-26.337, FS-P+B+I N° Lexbase : A1355Z93 ; RTD civ. 2020. 175, obs. B. Vareille ; JCP G 2020, 225, note J.-R. Binet ; Lexbase, Droit privé, février 2020, n° 813 N° Lexbase : N2276BYX, note J. Casey). Le notariat s’est ému de cette décision, mais on doit à la vérité de rappeler que le régime de la participation aux acquêts ne peut offrir que ce qu’il est : une communauté en valeur. Par conséquent, tout ce qui porte atteinte à cette égalité en valeur finira forcément « haché menu » par l’article 265 en cas de divorce. La solution est certaine tant que ce texte sera rédigé dans sa forme actuelle. Seule une modification de la loi (et donc de cet article) pourrait changer la donne. Cependant, il faut bien admettre que toute rupture d’égalité dans un régime qui postule le primat de celle-ci rend assez illogique l’idée de non-révocation automatique des clauses liquidatives inégalitaires. L’histoire nous apprend que c’est vers un autre type de régime matrimonial qu’il faut se tourner si l’on veut une communauté délimitée aux petits ciseaux, car c’est alors la séparation de biens avec société d’acquêts qui est le régime idéal. Après tout, il fut pratiqué comme régime de droit commun de Bordeaux à Narbonne pendant près de 800 ans, preuve de son intérêt ! Mais pour les communautés en nature (légales, universelles, de meubles et acquêts), ou celles en valeur (participation aux acquêts), il est bien difficile de défendre l’exclusion en cas de divorce.
Trois remarques complémentaires doivent être faites.
1°) La présente décision n’est même pas publiée au Bulletin civil. Il est donc clair que, pour la Cour de cassation, la question est entendue. Pourtant, l’arrêt est très instructif, puisqu’il est dit, dans le chapeau de la décision, que ce qui vaut à la clause d’être révoquée c’est le fait pour un époux de diminuer « la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint ». On comprend donc que si chaque époux bénéficiait, dans la même proportion, de la diminution de son patrimoine final (donc si la clause était bilatérale), aucune révocation ne serait encourue. C’est bon à savoir pour ce qui est de la rédaction du contrat de mariage… Cela prouve surtout que c’est bien l’atteinte à l’égalité en valeur qui est ici sanctionnée (comme le serait une atteinte à l’égalité en nature dans les communautés classiques).
2°) Ce principe d’égalité étant affirmé avec force, la Cour de cassation a jouté une incidente redoutable : l’atteinte à cette égalité « constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce, nonobstant la qualification qu'en auraient retenue les parties dans leur contrat de mariage ». Il faut souligner ce passage, car cela confirme que le contrat de mariage ne changera pas la donne. Si les parties s’avisent de vouloir « finasser » par une clause de leur contrat, le juge devra restituer aux faits leur exacte qualification, donc dire que c’est un avantage matrimonial, et constater sa révocation automatique du fait du divorce. On sent toute la volonté de la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur ces clauses, ici via les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 12 CPC (N° Lexbase : L1127H4I).
3°) La volonté contraire des parties, qui souhaiteraient maintenir expressément l’avantage matrimonial malgré le prononcé du divorce, est réaffirmée par l’arrêt qui reprend au mot près la formulation du précédent de 2019 : « sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce ». Voilà qui dément l’interprétation proposée en doctrine selon laquelle l’accord au maintien de l’avantage matrimonial peut être exprimé dans le contrat de mariage, et qui espérait que le terme « exprimé » ait été une erreur de plume (v., les obs. de J.-R. Binet, prec.). La réalité est bien différente : pour la Cour de cassation, c’est le prononcé du divorce qui compte, et c’est à cet instant, et à aucun autre, que la volonté de maintenir la clause (et donc la rupture d’égalité) doit être exprimée. Prévoir une clause allant en ce sens dans le contrat de mariage serait donc vain, puisqu’il faudra réitérer l’accord au maintien de la clause de non-révocation de l’avantage matrimonial au moment de divorce. Ce serait même dangereux, car cela pourrait laisser croire que le divorce est déjà envisagé et pris en compte, alors qu’il n’en sera rien. De grâce, après une première clause trompeuse, n’en créons pas une deuxième…
Au total, l’arrêt est donc d’une fermeté qui doit être soulignée. Non seulement le juge n’est pas tenu par la qualification des parties dans le contrat de mariage, mais encore toute renonciation à la révocation automatique doit être exprimée au moment du divorce, pas avant. Amis notaires, vous voici prévenus ! Vos actes doivent impérativement être rédigés en tenant compte de ces règles nouvelles. Et songez bien à votre devoir de conseil, comme l’a montré un sinistre récent affectant votre profession, donnant au Conseil constitutionnel l’occasion de rendre une décision très intéressante à ce sujet (v., Cons. const. 23 janvier 2021, n° 2020-880 QPC N° Lexbase : A85144DP ; AJ fam. 2021, p. 184, obs. J. Casey).
Bref, attention aux avantages matrimoniaux, et attention aux montages « d’ingénierie patrimoniale ». Ceux qui les conseillent ne sont pas ceux qui endurent les actions en responsabilité. Revenons au droit civil…
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477217
[Brèves] Mise en œuvre de la solidarité financière : l’URSSAF doit produire le procès-verbal lors de l’instance !
Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 19-23.728, (N° Lexbase : A13934PB) et n° 20-11.126 (N° Lexbase : A12184PS), FS-P-R
Lecture: 2 min
N7164BYY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 14 Avril 2021
► Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de Sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
Les faits et procédure. Dans les deux affaires, l’URSSAF a établi contre une société donneuse d’ordre une lettre d’observations l’avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3605H9E) et du montant des cotisations estimées dues, en suite d’un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de l’un de ses cocontractants.
Les sociétés, contestant les redressements, ont alors saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d’appel avait alors annulé les redressements pour absence de production du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre des entreprises.
Le pourvoi de l’URSSAF. Pour motiver ses deux pourvois, l’URSSAF avance les arguments suivants :
- elle n’est pas tenue de verser aux débats le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé qui a justifié la mise en œuvre de la solidarité financière, sauf si le juge l’ordonne dans le cadre de l’instance (pourvoi n° 19-23.728) ;
- la mise en œuvre de la solidarité financière à laquelle est tenu le donneur d’ordre est subordonnée à la seule existence d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du cocontractant et non à la production de ce dernier par l’URSSAF dans la procédure de redressement dirigée contre le donneur d’ordre (pourvoi n° 20-11.126).
Rejet. Établissant la règle précitée, la Haute juridiction évince les arguments de l’organisme social. S’appuyant sur l’article 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D) qui incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, les juges imposent à l’URSSAF de produire le procès-verbal sur lequel elle s’appuie pour mettre en œuvre la solidarité financière.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477164
[Brèves] Précision sur les limites des pouvoirs du JEX
Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-25.156, F-P (N° Lexbase : A66824MG)
Lecture: 3 min
N7179BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 14 Avril 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 mars 2021, précise que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre.
Faits et procédure. Dans un litige de propriété opposant des voisins, un tribunal d’instance a fixé les limites de deux propriétés contiguës conformément au plan d’un géomètre. Les propriétaires d’une des parcelles, n’étant pas parvenus à faire exécuter la décision, ont saisi le jugement de l’exécution aux fins de désignation d'un géomètre-expert pour procéder à l'implantation des bornes et pénétrer sur la propriété de leur voisin. Ce dernier a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution (JEX).
Le JEX a rejeté son exception d’incompétence, désigné un géomètre expert pour procéder à l’implantation des bornes et autorisé ce dernier à pénétrer sur la propriété du défendeur. Le défendeur a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Poitiers, 4 juin 2019, n° 18/03236 N° Lexbase : A3409ZDM), d’avoir rejeté son exception d’incompétence et désigné un géomètre expert en confirmant la décision rendue par le JEX.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu, dans un premier temps, que seul le JEX est compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution d'un jugement fixant la limite de deux fonds. L’arrêt retient, dans un second temps, que les demandeurs justifient d’avoir tenté en vain de faire exécuter le jugement ordonnant le bornage des parcelles, qui a été confirmé par un arrêt, retenant ainsi une situation caractérisant l’existence de difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire fixant la limite des deux fonds.
Solution. Énonçant la solution précitée, au visa de L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD) la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, qui a retenu la compétence du JEX en raison de difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire. En effet, les Hauts magistrats énoncent qu’il ne résultait pas de ses constatations que la difficulté relative à l’exécution du jugement portait sur des contestations relatives à des mesures d’exécution forcée diligentées sur le fondement de ce jugement.
La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
|
Pour aller plus loin : il aurait été plus judicieux pour les demandeurs d’engager une procédure pour obtenir la fixation d’une astreinte. v. ÉTUDE : Le juge de l'exécution, La compétence exclusive du juge de l'exécution (COJ, art. L. 213-6) et d'ordre public (C. proc. civ. exécution, art. R. 121-4, in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8238E8M). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477179